|
| |
|
|
 |
|
Physique quantique : la première |
|
|
| |
|
| |

Physique quantique : la première "molécule" de lumière
Par Hervé Ratel le 08.11.2013 à 14h17, mis à jour le 08.11.2013 à 15h00
Lecture 3 min.
Des scientifiques sont parvenus à unir ensemble deux photons, édifiant ainsi l'équivalent d'une molécule.
C'est sur une table quantique (ici, celle de Munich, en Allemagne) que des quantons ont pu être assemblés.
© THORSTEN NAESER/MPQ
Assembler deux photons est quelque chose de totalement inédit à l'échelle subatomique, où l'individualisme des particules est de mise. C'est pourtant l'exploit réalisé par Ofer Firstenberg, de l'université Harvard (Cambridge, Etats-Unis), Thibault Peyronel (MIT, Cambridge) et leurs collèges. Ils ont publié la recette dans le magazine Nature du 25 septembre.
Dans un nuage d'atomes
En premier lieu, expédier un photon dans un nuage d'atomes de rubidium ultrafroid (un millième de degré seulement au-dessus du zéro absolu, -273°C). Le résultat est immédiat : la particule lumineuse freine brusquement d'un facteur un million pour passer de 300 000 km/s à 400 m/s. Ensuite, introduire un second photon. "Dans le nuage ultrafroid, les photons "sautent" d'un atome de rubidium à l'autre, les portant chacun à leur tour dans un état d'excitation intense, nommé état de Rydberg", explique Marc Cheneau, du laboratoire Charles-Fabry à Palaiseau (Institut d'optique - CNRS).
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT sciencesetavenir.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Matériaux poreux, de l’énergie mécanique sous le pied? |
|
|
| |
|
| |
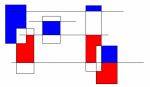
Matériaux poreux, de l’énergie mécanique sous le pied !
25.06.2025, par Sophie Germette-Nicaud (pour le CNRS Alsace)
Mis à jour le 25.06.2025
Un des défis majeurs d’aujourd’hui ? Le stockage de l’énergie. Et là, toutes ses formes sont convoitées, qu’elle soit calorifique, chimique, électrique ou même… mécanique. Si les batteries chimiques sont bien connues, une autre piste, plus discrète et pleine de promesses, est explorée dans le projet MESAMM. Plongez dans ce monde nanométrique sous pression qui pourrait donner un jour naissance, pourquoi pas, à une nouvelle génération d’amortisseurs.
Dans le cadre du projet MESAMM, Andrey Ryzhikov, chercheur CNRS en science des matériaux à l’Institut de Science des Matériaux de Mulhouse1 et ses collègues étudient le potentiel de stockage d’énergie mécanique dans des matériaux microporeux. Ces solides possèdent une structure 3D qui révèle de très nombreuses cavités, en motifs répétés, appelées nanopores. Explorons ce monde subatomique.
Représentation 3D de la structure cristalline d’une zéolithe, révélant la présence de nanopores en motifs répétés © Den Bazin (medillus.com) pour le CNRS Alsace
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT cnrs LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
FISSION ET FUSION NUCLEAIRE |
|
|
| |
|
| |
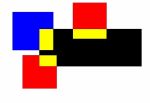
"Le Japon a démarré le premier réacteur à fusion nucléaire. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre la fusion et la fission et nous dire si elle sera disponible pour tous bientôt ?", nous demande Joel Daigle sur notre page Facebook. C'est notre question de lecteur de la semaine. Merci à toutes et à tous pour votre participation.
Fission nucléaire : briser des atomes
Tout d'abord, la fission nucléaire : c'est un phénomène au cœur des centrales qui fournissent près de 70% de l’électricité produite en France en 2019 (selon EDF). Ces centrales, reconnaissables à leurs larges cheminées, sont alimentées en matériaux fissiles, matériaux dont le noyau atomique est suffisamment instable pour pouvoir être brisé sous l’effet d’un bombardement à neutron, tel que l’uranium ou le plutonium.
Certains atomes, possédant un grand nombre de protons et de neutrons (les protons sont chargés positivement tandis que les neutrons ne possèdent pas de charge électrique), sont instables. Cette instabilité pousse le noyau de l’atome à se séparer en composants plus petits émettant par la même occasion une grande quantité d’énergie. Ce phénomène est à l’origine de la radioactivité, émission spontanée de rayons électromagnétiques de haute énergie, et se produit naturellement. À titre d’exemple, une banane est naturellement radioactive due à la présence de potassium 40.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
intelligence artificielle |
|
|
| |
|
| |
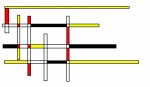
intelligence artificielle
Consulter aussi dans le dictionnaire : intelligence
Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.
Avec l'intelligence artificielle, l'homme côtoie un de ses rêves prométhéens les plus ambitieux : fabriquer des machines dotées d'un « esprit » semblable au sien. Pour John MacCarthy, l'un des créateurs de ce concept, « toute activité intellectuelle peut être décrite avec suffisamment de précision pour être simulée par une machine ». Tel est le pari – au demeurant très controversé au sein même de la discipline – de ces chercheurs à la croisée de l'informatique, de l'électronique et des sciences cognitives.
Malgré les débats fondamentaux qu'elle suscite, l'intelligence artificielle a produit nombre de réalisations spectaculaires, par exemple dans les domaines de la reconnaissance des formes ou de la voix, de l'aide à la décision ou de la robotique.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SCIENCES COGNITIVES
Au milieu des années 1950, avec le développement de l'informatique naquit l'ambition de créer des « machines à penser », semblables dans leur fonctionnement à l'esprit humain. L'intelligence artificielle (IA) vise donc à reproduire au mieux, à l'aide de machines, des activités mentales, qu'elles soient de l'ordre de la compréhension, de la perception, ou de la décision. Par là même, l'IA est distincte de l'informatique, qui traite, trie et stocke les données et leurs algorithmes. Le terme « intelligence » recouvre ici une signification adaptative, comme en psychologie animale. Il s'agira souvent de modéliser la résolution d'un problème, qui peut être inédit, par un organisme. Si les concepteurs de systèmes experts veulent identifier les savoirs nécessaires à la résolution de problèmes complexes par des professionnels, les chercheurs, travaillant sur les réseaux neuronaux et les robots, essaieront de s'inspirer du système nerveux et du psychisme animal.
LES SCIENCES COGNITIVES
Dans une optique restrictive, on peut compter parmi elles : ?– l'épistémologie moderne, qui s'attache à l'étude critique des fondements et méthodes de la connaissance scientifique, et ce dans une perspective philosophique et historique ; ?– la psychologie cognitive, dont l'objet est le traitement et la production de connaissances par le cerveau, ainsi que la psychologie du développement, quand elle étudie la genèse des structures logiques chez l'enfant ; ?– la logique, qui traite de la formalisation des raisonnements ; ?– diverses branches de la biologie (la biologie théorique, la neurobiologie, l'éthologie, entre autres) ; ?– les sciences de la communication, qui englobent l'étude du langage, la théorie mathématique de la communication, qui permet de quantifier les échanges d'informations, et la sociologie des organisations, qui étudie la diffusion sociale des informations.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
