|
| |
|
|
 |
|
LES UNIVERSAUX DE PENSÉE |
|
|
| |
|
| |
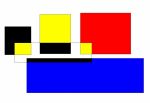
LES UNIVERSAUX DE PENSÉE
Réalisation : 24 juillet 2002 - Mise en ligne : 24 juillet 2002
* document 1 document 2 document 3
* niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
La pensée est liée au cerveau, une entité matérielle qui possède une organisation complexe. Les universaux de pensée se développent à partir de cette organisation. Elle se construit au court de l'évolution, ou plutôt d'une synthèse d'évolutions multiples. Elle résulte de l'évolution des espèces, de l'évolution au court du développement embryonnaire, de la formation des connexions entres cellules nerveuses avant et après la naissance. Des évolutions multiples, emboîtées qui correspondent aux niveaux d'organisation de la matière, de la molécule à la cellule nerveuse, de la cellule nerveuse au circuit, du circuit aux assemblées de neurones.
Au court de l'enfance, il y a des changements de la connectivité en fonction de la culture, de l'environnement. Durant ces évolutions emboîtées, des universaux vont être sélectionnés, ils vont dans un premier cas assurer la survie de l'individu, mais aussi des groupes sociaux. Des universaux qui se retrouvent au niveau du génome, de l'anatomie et de l'organisation du cerveau, ses dispositions fonctionnelles, physiologique et psychologique. Il y a une universalité du génome humain mais aussi une variabilité génétique et épigénétique qui permet l'évolution tout en préservant l'intercompréhension entre les individus.
Intervention
Changeux Jean-Pierre
Neurobiologiste. Membre de l'Académie des sciences
Professeur au Collège de France (1976-2006), titulaire de la chaire "Communications cellulaires"
Thème
Disciplines :
* Sciences de la vie
* Philosophie des sciences et des techniques, épistémologie
* Cerveau
* Évolution
* Génétique
* Épigénétique
* Génome
Documentation
Documents pédagogiques
Résumé* de la 443e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 24 juillet 2002
Jean-Pierre Changeux : "Les universaux de la pensée"
Les "universaux" sont ces termes qui s'étendent à l'univers tout entier, à l'ensemble des êtres ou des idées et qui se distinguent des particuliers. Le philosophe médiéval Albert le Grand distinguait trois manières de considérer les universaux : ante rem en tant que cause universelle, possédant d'avance la totalité de ses effets causés, in re en tant que nature commune reçue dans les particuliers et post rem en tant qu'intention formelle et concept simple de l'esprit séparés du particulier par abstraction.
Aujourd'hui, si l'on reprend les définitions d'Albert le Grand, on peut dire que, ante rem, les universaux vont concerner la réalité physique du monde extérieur, la matière et ses régularités ; in re, les objets, les êtres issus de l'évolution de l'univers, de l'évolution des espèces, en particulier, le cerveau de l'homme qui présente une organisation, ou conformatio, commune aux membres de l'espèce homo sapiens ; et post rem, les représentations communes, ou concepts, qui se forment dans le cerveau de l'homme et s'organisent en pensée.
Cette conférence avance l'idée que le cerveau de l'homme est matériel et que les universaux de pensée se développent à partir de l'organisation de notre cerveau, laquelle se construit au cours de l'évolution.
Celle-ci est la synthèse d'évolutions multiples : celle des espèces au niveau des génomes, celle du cerveau au cours du développement embryonnaire, celle enfin des connexions entre cellules nerveuses après la naissance, puisque le bébé humain naît avec un contingent de connexions qui est la moitié de celui de l'adulte. On a affaire à des évolutions multiples, emboîtées, qui correspondent à ces niveaux d'organisation de la matière, de la molécule à la cellule nerveuse, de la cellule nerveuse aux circuits, des circuits aux assemblées de neurones et aux assemblées d'assemblées de cellules nerveuses.
Au cours de ces évolutions emboîtées, des universaux sont sélectionnés, qui, d'un point de vue darwinien, assurent la survie de l'individu, celle des groupes sociaux et, finalement, celle de l'humanité.
Il faut cependant prendre en compte un problème central, celui de la variabilité locale. Car s'il y a une universalité du génome humain, il y a aussi une variabilité de ce génome - une variabilité génétique- . Il y a aussi une variabilité épigénétique et fonctionnelle qui conduit à la dynamique de la pensée. Cette variabilité des universaux permet l'évolution et évite que nous ayons à concevoir l'homme, la nature, l'univers, dans un cadre fixiste.
L'universalité génétique et anatomique du cerveau de l'homme
Notre génome est composé de trente à quarante mille gènes qui déterminent toutes les protéines - et parmi elles celle du cerveau : 60 % de ces gènes sont exprimés dans le cerveau.
Ces gènes déterminent des molécules qui entrent dans la composition des contacts entre cellules nerveuses qui permettent aux neurones de se connecter entre eux et de constituer des réseaux d'une extrême complexité dans lesquels circulent des signaux électriques ou des signaux chimiques. La complexité de ces réseaux évolue du singe à l'homme. On assiste en particulier à un accroissement considérable, chez l'homme, de la partie qui se trouve en avant du cerveau, le cortex préfrontal, partie critique du développement à la fois de la conscience et de la pensée.
Si l'on compare le nombre de gènes dans le génome de l'homme et dans celui de la souris, on trouve un nombre de gènes très voisin. S'il n'y a pratiquement pas de différence en ce qui concerne le nombre, il y a évidemment des différences génétiques, qui sont cependant extrêmement modestes. Si on compare le génome du chimpanzé et celui de l'homme, il y a entre 1 et 2 % de différence, ce qui est extrêmement peu. Comment comprendre ces constances de nombre alors qu'on passe des 40 millions de neurones de la souris aux 10 à 100 milliards de neurones de l'homme ? La réponse est qu'il n'y a pas beaucoup de gènes de différence, mais que ces gènes portent sur le développement de formes critiques. On arrive ainsi à comprendre comment le cerveau a pu évoluer des ancêtres de l'homme aux anthropoïdes, à l' homo sapiens lui-même, et comment de ce fait un certain nombre de propriétés fonctionnelles associées à l'organisation de ce cerveau apparaissent spontanément, simplement du fait de l'innéité, en quelque sorte, de ce développement embryonnaire. Par exemple la succion du sein, le réflexe palmaire de préhension, la reconnaissance d'un visage humain, la distinction chez le bébé entre être vivant et objet inanimé... et beaucoup d'autres dispositions innées universelles de comportements liés à cette organisation cérébrale.
La variabilité individuelle permet à ces dispositions innées de présenter des formes de plasticité, de mémoire, de mise en place d'empreintes venant du monde extérieur. Au cours du développement du fStus à l'adulte, et notamment chez le nouveau né, à un stade où se constituent près de 50 % des connexions du cerveau de l'homme adulte, les synapses se forment, certaines en nombre supérieur à ce qu'il sera chez l'adulte. L'interaction avec le monde extérieur va contribuer à la sélection de certaines connexions et à l'élimination de certaines autres.
Epigénèse et variabilité individuelle
Si au cours du développement apparaît une variabilité de la connectivité, tous les individus vont être différents les uns des autres et ils n'arriveront plus à se comprendre. Comment apparaissent donc des universaux comportementaux - en particulier des représentations du monde universelles - en dépit de cette variabilité ?
Dans un réseau au sein duquel va se produire une sélection de connexions un même message entrant peut stabiliser des organisations connectionnelles différentes, mais conduire à une relation entrée/sortie identique. Cela veut dire qu'en dépit d'un système nerveux variable d'un individu à l'autre, il se construit de l'invariance.
Dans L'Homme neuronal avait été introduite la notion d'objet mental pour mettre en relation, par exemple, une activité perceptive (cela vaut aussi pour les activités sensorielle ou motrice) avec l'état d'activité de notre système nerveux central. Le constat auquel on parvient est qu'il se forme dans notre cerveau des représentations - représentations perceptives, motrices et conceptuelles. Une expérience réalisée au Japon par le groupe de Tanaka consiste à procéder, par imagerie optique, à des enregistrements de la surface du cortex de sujets regardant des visages. Un visage vu de profil suscite une activité différente de celle qui se produit quand le visage est vu de biais ou de face. Il y a donc des corrélats électro-physiologiques de ces représentations, qui sont des états physico-chimiques d'ensembles ou d'assemblées de cellules nerveuses dans notre cerveau. Selon ce que le sujet perçoit, on a affaire à des distributions d'activité différentes dans diverses régions du cortex cérébral : la reconnaissance des objets suscite dans notre cerveau des objets mentaux caractéristiques d'une catégorie d'objets particuliers. On constate des phénomènes similaires chez le singe, en l'absence d'apprentissage ou avec très peu d'apprentissage.
Invariance des représentations de la réalité extérieure
Comment aller plus loin, jusqu'à l'élaboration de représentations plus spécifiques, plus complexes ? Qu'en est-il pour des inventions techniques ou culturelles récentes ? Que se passe-t- il dans notre cerveau quand nous avons affaire à un objet récent, par exemple un objet technique ?
En fait à partir de ces dispositions innées se produit une évolution d'une autre nature au niveau de l'activité du système nerveux. Des changements d'efficacité entre connexions vont être mémorisées lors d'un apprentissage par essai et erreur. Vont être sélectionnées des représentations adéquates au monde extérieur. Il se formerait (Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene) des pré-représentations, c'est-à-dire des objets mentaux qui sont des esquisses des schémas assez grossiers du monde extérieur. Ces pré-représentations vont correspondre à la mobilisation spontanée de populations de neurones de manières variables au niveau de notre cortex cérébral. Un mécanisme de sélection va stabiliser la représentation adéquate au monde extérieur. Interviennent dans ce processus des systèmes de neurones du système nerveux central et qu'on appelle des neurones de récompense.
Ils ont été découverts fortuitement par Olds en 1958 en plantant des électrodes de stimulation chez le rat pour. Olds a remarqué qu'en plaçant l'électrode de stimulation dans certaines zones du cerveau du rat, il donnait au rat la possibilité de s'auto-stimuler en appuyant sur une pédale dans sa cage pour stimuler les cellules nerveuses située au niveau de l'électrode. Le rat qui essaie le dispositif trouve cela agréable, revient et appuie de nouveau. Il va ensuite s'auto-stimuler d'une manière effrénée. Il ne s'arrête que pour dormir, est indifférent à la nourriture, aux animaux de l'autre sexe, etc. Il se trouve en quelque sorte emprisonné dans son autostimulation. Cela correspond à l'activation de neurones dits de récompense qui interviennent lorsqu'il y a gratification.
L'idée de Jean-Pierre Changeux est que l'individu formule des hypothèses, des pré-représentations et les essaie sur le monde extérieur. Celles qui donnent une réponse positive vont être sélectionnées ; à l'inverse, celles qui apportent une réponse négative seront contre sélectionnées et disparaîtront.
Il a ainsi été construit (Changeux et Dehaene) un modèle de tri de cartes du Wisconsin. C'est une tâche cognitive destinée aux patients dont on veut voir s'ils ont des lésions du cortex frontal. Le modèle avance l'hypothèse que des assemblées de neurones sont activées un moment, les autres inhibées, et qu'il peut y avoir un essai de ces diverses assemblées de neurones jusqu'à ce que l'assemblée qui connaît la bonne règle soit sélectionnée par le système de récompense. On peut à partir de là construire un modèle informatique strictement neurochimique de cet apprentissage cognitif par sélection et par récompense. Un tel modèle permet de rendre compte de l'apparition de représentations du monde extérieur stables sur une base épigénétique.
Conscience et organisation universelle de la pensée
La conscience est un universel propre à l'espèce humaine, donc déterminé génétiquement au niveau d'une architecture cérébrale particulière.
Des philosophes, essentiellement anglo-saxons, pensent que la conscience est un phénomène réel, naturel et biologique, littéralement localisé dans le cerveau et entièrement causé par des processus neurobiologiques. A l'instar des neurobiologistes, ils distinguent d'une part des niveaux de conscience (la veille, le sommeil, le rêve), d'autre part le contenu de l'expérience consciente.
Il a été avancé (Stanislas Dehaene, Michel Kergsberg et Jean-Pierre Changeux) que nous avons des dispositifs particuliers dans le cerveau permettant d'atteindre cette disposition propre au développement de la conscience.
Pour qu'il y ait cet aspect global et unifié de la conscience il faut des neurones avec des connexions permettant de réunir les neurones qui se trouvent mobilisés dans l'ensemble de notre cortex cérébral ainsi que dans les régions sous corticales et en particulier le thalamus - des neurones à axones longues qui se trouvent principalement présents dans la région préfrontale du cortex, cette région qui se développe de manière spectaculaire du singe à l'homme. Apparaît ainsi un espace de travail conscient avec ces neurones à axones longs et des processeurs spécialisés, modulaires, qui pourraient intervenir, eux, dans nombre de processus non conscients comme la motricité.
On peut identifier par imagerie cérébrale les aires corticales qui interviennent dans des processus non conscients et dans des processus conscients, avec par exemple des mots masqués perçus de manière non consciente et des mots visibles perçus consciemment. On peut aussi mener des études d'imagerie cérébrale quand un sujet effectue un raisonnement logique, ou une sorte de choix instinctif. Dans le cas d'un choix instinctif, peu d'activités se manifestent au niveau du cortex préfrontal. Au contraire pour une tâche logique avec effort, sont mobilisés les neurones à axones longs avec une activation spectaculaire des aires préfrontales. Telles sont les premières bases neurales du raisonnement logique. L'on en est aux toutes premières expériences montrant des corrélations entre états d'activité de l'encéphale et raisonnement logique et ce domaine d'étude se développera dans les années qui viennent.
Ces raisonnements s'effectuent de manière épigénétique. L'individu qui effectue une tâche de cette nature utilise son système de neurones cortico-thalamique, en particulier son système de neurones préfrontaux, élabore des représentations, les enchaîne, et découvre que certains raisonnements réussissent. Ce qui est mémorisé alors, ce sont les règles épigénétiques de raisonnement, de calcul, de jugement, de représentations symboliques.
Communication sociale, diversité culturelle et intercompréhension
Une fois ces représentations formées dans le cerveau de l'individu, stabilisées, sélectionnées et réutilisées par le sujet, comment sont-elles être communiquées entre individus ?
Il faut se souvenir en ce point de la distinction faite par de Saussure entre le concept, la représentation mentale telle que je viens de la présenter, c'est-à-dire des représentations du monde qui ont acquis chez l'individu une invariance du fait des mécanismes de sélection par récompense, et le son, la voix qui communique ces représentations. Comment se fait-il qu'avec des cerveaux variables, nous arrivions à nous comprendre ?
Les études aussi bien sur d jeunes animaux que sur de tout jeunes enfants (Thomas Veleau) suggèrent que c'est par un processus de récompense partagée que l'on passe du niveau individuel au niveau social, qu'est validée en quelque sorte l'universalité de la représentation.
Cela vaut non seulement pour la validation du sens des mots, la relation du signifiant au signifié, mais aussi pour l'organisation générale de la phrase et de la pensée, avec au delà un partage d'intentions tel que les linguistes comme Sperber et Wilson, ou Grice le décrivent. Le partage d'intentions, la reconnaissance des intentions d'autrui, l'intercompréhension mettent en jeu des dispositifs qui mobilisent le cortex préfrontal et qui permettent cette capacité d'attribution d'intentions à autrui, d'échange d'intentions et qui font en sorte qu'on puisse parler de la même chose et se comprendre.
Universalisation des connaissances et universalité des savoirs : la connaissance scientifique
De là l'importance de l'éducation, dans les relations parentales ou au niveau de l'école, c'est-à-dire de cette transmission épigénétique de la diversité des cultures, des langues, des écritures, des systèmes de croyance, mais aussi des connaissances partagées, en particulier lorsqu'elles sont tout à fait élémentaires.
Le problème maintenant est de savoir si tous les signifiés qui se trouvent associés aux signifiants sont acceptés universellement comme correspondant à une représentation du monde qui soit une représentation aussi proche du réel que possible. Y a-t-il des représentations du monde acceptées au niveau de l'ensemble de l'humanité ou pas ?
Il existe bien entendu des systèmes de représentation symboliques, entre autres mythiques, très importants dans les sociétés humaines, jouant un rôle crucial pour l'identité et la survie des groupes. Ces représentations, ces mythes correspondent-ils à la réalité du monde ? Leur fonction de renforcement du lien social est importante, mais cela se fait-il à l'avantage ou au détriment de l'objectivité des connaissances ?
C'est là probablement qu'il faut faire intervenir une évolution extraordinaire, qui a pris place en Grèce : le changement de régime politique et juridique rendant possible un débat public et critique acceptant la multiplicité des écoles de pensée, un débat sur les solutions. Par exemple, quel est le meilleur moyen de traiter la maladie ? Invoquera-t-on les dieux ? Fera-t-on un sacrifice ? Prendra-t-on une poudre magique ? Un antibiotique ou un agent antiviral ? A question posée, débat public : qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui est le plus adéquat au réel et qu'est-ce qui est le plus universel ?
A partir de ces représentations sociales, peut se dégager une distinction entre les croyances et les objets de science. La représentation scientifique apparaît alors, avec sa remise en cause permanente, son mode d'exposition publique et sa nécessaire et constante capacité de révision.
* Par Y. Michaud
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
inconscient |
|
|
| |
|
| |

inconscient
En allemand : unbewusst, das Unbewusste, « in-conscient ».
Philosophie Générale, Psychologie
1. Négativement ce qui en l'homme échappe à la pensée consciente ou rationnelle. – 2. Positivement une fonction psychique déterminant souterrainement l'économie du désir.
Que le mot n'apparaisse que tardivement n'interdit pas de parler d'un problème philosophique de l'inconscient avant Freud. Les « petites perceptions » admises par Leibniz(1), ou les « représentations obscures » dont Kant affirme qu'elles recouvrent la plus large part de nos intuitions et sensations(2), signalent bien plus qu'un problème d'intensité ou de clarté de la perception : ce qui est en jeu philosophiquement, c'est l'existence en nous d'un domaine psychique échappant à l'emprise de la raison, non pas tant du point de vue psychologique d'une partition de l'âme humaine que d'un point de vue métaphysique (pour lequel la distinction entre les deux définitions prend toute son importance).
En effet, accorder l'existence d'une fonction psychique positive et efficace, susceptible de déterminer la volonté autant ou plus que ne le fait la conscience, c'est ruiner la métaphysique du sujet (comment puis-je me définir comme substance pensante si ma pensée est discontinue ? Il faut, comme Descartes, distinguer la pensée, qui m'est consubstantielle, et la mémoire que j'en ai, qui peut faillir(3)). C'est aussi contredire l'idée de liberté comme responsabilité et autonomie, dans la mesure où des actes inconscients ne peuvent être imputés à un auteur : pour sauver la volonté libre mis en doute par l'inconscient(4), il faut recourir à des concepts comme la mauvaise foi(5). La thèse de Sartre partage avec celle de Descartes le refus de toute positivité des manifestations de l'inconscient, ramenées à un défaut de la mémoire.
Isoler un noyau métaphysique de la question de l'inconscient n'autorise toutefois pas à considérer comme infra-philosophique la question des psychologues : Platon montre que déterminer la place des désirs irrationnels en nous met en jeu la nature de l'âme.
Sébastien Bauer
Notes bibliographiques
* Leibniz, G.W., Nouveaux essais sur l'entendement humain, préface, 1703, édition française 1966, Paris, Garnier Flammarion.
* Kant, E., Anthropologie d'un point de vue pragmatique, 1ère partie, § 5, trad P. Jalabert 1986, in Œuvres philosophiques, NRF, Paris.
* Descartes, B., Méditations métaphysiques, méditation 1ère Éd. 1992, GF-Flammarion, Paris.
* Nietzsche, F., Par-delà bien et mal, § 19, trad. P. Wotling 2000, Flammarion, Paris.
* Sartre, J.P., L'Être et le Néant, I, 2, a. Paris, Gallimard, TEL, 1976.
* Voir aussi : Vaysse, J.M., L'inconscient des modernes, 1999, NRF Gallimard, Paris.
→ âme, conscience, liberté, moi
Psychanalyse
Notion topique et dynamique qui démontre que « l'essence du psychique » ne se situe pas dans la « conscience »(1). Comme tel, objet de l'étude psychanalytique. Il désigne d'abord un lieu psychique (lcs), dont les contenus sont soumis à une force, le refoulement, qui les rend inaccessibles, puis une qualité (ics) des instances et des processus psychiques. Il a pour propriété de ne connaître que le principe de plaisir, et par conséquent d'ignorer la négation, le doute et le temps (processus primaire) : la pensée y vaut l'acte.
Notion commune au xixe s., promue notamment par Herbart et Hartmann, le terme n'apparaît chez Freud qu'une fois acquise l'intelligibilité dynamique du processus par lequel des représentations sont soustraites au champ de la conscience (théorie du trauma infantile et de l'après-coup). L'étude des psychonévroses de défense, qui révèle l'existence de « groupes psychiques séparés »(2), participe de cette mise au jour de l'inconscient. Des formations locales, symptômes, phobies, obsessions, etc., mais aussi lapsus, actes manques, rêves, etc., sont déterminées par des représentations inaccessibles, mais efficientes. Elles sont l'expression (formation de compromis) de souhaits inconscients ou refoulés, qui s'efforcent inlassablement d'atteindre à la conscience. Les contenus de l'inconscient se composent de traces phylogénétiques héréditaires (fantasmes originaires), du refoulé originaire et des représentations liées à la vie sexuelle infantile refoulée ; ils sont un pôle d'attraction pour les représentations qui seront ultérieurement refoulées. Dans la seconde conception topique de la personnalité psychique, le ça inclut l'inconscient et hérite de ses propriétés. Le moi et le sur-moi sont, dans leur plus grande partie, inconscients, comme le montrent la résistance dans la cure, le sentiment de culpabilité et les conflits entre instances.
La découverte de l'inconscient dynamique est certes la troisième blessure narcissique infligée à l'humanité, après celles de Copernic et de Darwin, mais elle révoque aussi en doute la distinction normal-pathologique et la dichotomie corps-âme. Elle démontre enfin l'ubiquité de la sexualité dans les processus psychiques humains – les plus abstraits compris.
Christian Michel
Notes bibliographiques
* Freud, S., Das Ich und das Es (1923), G.W. XIII, le Moi et le ça, OCF.P XVI, PUF, Paris, p. 258.
* Freud, S., Studien über Hysterie (1895), G.W. I, Études sur l'hystérie, PUF, Paris, p. 96.
→ acte, ça, dynamique, fantasme, moi, origine, principe, processus primaire et secondaire, refoulement, surmoi, topique
Psychologie
Ensemble des manifestations réflexes (c'est-à-dire ni conscientes ni volontaires) qui, au xixe s., enracinent la vie mentale dans le cerveau et lui imposent une rationalité neurologique.
Portée par l'extension du matérialisme réflexologique de la neurologie à la psychologie, l'expression « cérébration inconsciente » (plus qu'« inconscient cérébral ») apparaît chez T. Laycock et W. Carpenter en Angleterre et se systématise chez J. Luys. L'arc réflexe, dans une perspective darwinienne, évolue graduellement, et le cerveau humain est conçu comme un détour infiniment complexe entre input perceptif et output moteur. La volonté apparaît alors comme un système de contrôle biologiquement intégré à la décharge motrice, et perd sa transcendance. Cet étagement, dont la conscience est l'ultime niveau, a inspiré Jackson, Freud, et même le cognitivisme.
M. Gauchet y a vu l'individualisation biologique de « l'asservissement intérieur » qui est la rançon de l'émancipation politique de l'individu moderne, à cause de la déspiritualisation de la volonté qu'implique la notion.
Pierre-Henri Castel
Notes bibliographiques
* Gauchet, M., L'inconscient cérébral, Paris, 1992.
→ réflexe
Psychologie, Philosophie Cognitive
Ensemble des processus non conscients inférés à partir de performances cognitives observables, et qui sont considérés, au moins par destination, comme mentaux.
L'idée d'inconscient cognitif vise à démarquer la nécessité d'inférer des processus mentaux non conscients en psychologie expérimentale de l'usage psychanalytique du concept d'inconscient. Dans l'inconscient cognitif, ni conflit, ni privilège du désir, ni représentations refoulées. Les observables qui lui servent de prémisses ne sont pas pathologiques. Cependant, dans la perception, ou le langage, le traitement computationnel de l'information implique des opérations intelligentes qui ne peuvent faire l'objet de comptes rendus introspectif : par exemple, les transformations qui permettent de passiver une phrase à l'actif. Sans être des actes mentaux donateurs de sens, des opérations de ce type sont conçues autant comme des règles que comme des mécanismes. Elles occupent une place intermédiaire entre cognitions et activations cérébrales. S'ils participent causalement à la genèse de totalités sémantiques de haut niveau, la question se pose enfin de la cohérence entre eux des divers processus cognitifs inconscients.
Pierre-Henri Castel
Notes bibliographiques
* Reber, A. S., Implicit Learning and Tacit Knowledge : An Essay on the Cognitive Unconscious, Oxford University Press, Oxford, 1993.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
RÉALITÉ |
|
|
| |
|
| |

réalité
Du latin res, « chose matérielle, corps, être, fait ». L'usage philosophique du concept déborde largement son étymologie. En allemand : Realität, de real, « réel » ; Wirklichkeit, plutôt traduit par « effectivité ».
Si la supposition pratique de la réalité est toujours première, comme ce qui nous résiste dans l'appréhension sensible, penser la réalité se heurte à l'impossibilité d'une définition intrinsèque. Même si elle suppose conceptuellement l'identité, la permanence et l'univocité, la réalité ne peut être invoquée que sur le fond d'une différence première entre elle et ce dont on la distingue (apparence, phénomène, simulacre, rêve, illusion, idée ou idéal...), ce qui soulève une difficulté, puisque ce qui n'est pas la réalité et se confond parfois avec elle doit participer de celle-ci pour exiger cette discrimination.
Philosophie Générale, Philosophie Cognitive
L'être tel qu'il est pour nous déterminé dans l'existence, par opposition d'une part à ce qui n'est pas vraiment ou ce qui n'est pas au même degré ontologique éminent, et d'autre part à ce qui demeure un concept.
C'est moins la nature de la réalité qui fait problème que le statut ontologique de ce qui nous en sépare et qui contribue à sa définition et à sa désignation, comme si on devait nécessairement l'aborder par son contraire.
Cette difficulté provient de ce qu'on attribue au concept de réalité une finalité descriptive, comme ensemble des étants déterminés, alors qu'il relève toujours également d'une visée normative de discrimination au sein de ce qui apparaît, même quand la norme se présente comme une description. Cette distinction permet de poser la problématique propre à ce concept. L'extériorité supposée du langage et du réel, le premier devant être adéquat à la description du second, fait de la réalité une hypostase préconçue. À l'inverse, supposer que la réalité n'est pas indépendante de son élaboration dans le discours permet d'établir une ontologie dont les conditions de possibilité demandent à être explicitées autant qu'il est possible, même si le constructivisme ne peut être absolu sous peine de faire de la réalité une fiction. Entre la constitution intégrale et la croyance au réel immédiat, il n'y a de réalité qu'à l'intersection du monde et du logos.
Raynald Belay
Notes bibliographiques
* Cassirer, E., La philosophie des formes symboliques, Minuit, Paris, 1972.
* Descartes, R., Méditations métaphysiques, PUF, Paris, 1992.
* Fichte, J. G., Doctrines de la science (1801-1802), Vrin, Paris, 1987.
* Goodman, N., Manières de faire des mondes, J. Chambon, Paris, 1992.
* Kant, E., Critique de la raison pure, PUF, Paris, 2001.
* Ricœur, P., le Conflit des interprétations, Du verbe à l'action, Seuil, Paris, 1970.
→ apparence, concept, herméneutique, ontologie, phénomène
Psychanalyse
« Dans le monde des névroses, c'est la réalité psychique qui joue le rôle dominant »(1), aussi le névrosé « doit avoir, en quelque façon, raison »(2), dans ses symptômes et ses fantasmes. Reconnaître la « réalité psychique », différente de la réalité matérielle, fonde la psychanalyse comme discipline scientifique autonome.
Abandonnant la théorie de la séduction, Freud reconnaît que « dans l'inconscient il n'y a pas d'indice de réalité, de sorte qu'on ne peut différencier la vérité de la fiction investie d'affect » (lettre à W. Fliess du 21 septembre 1897)(3) : il existe une réalité psychique, dont l'efficience est spécifique. Néanmoins, réalités psychique et extérieure sont co-construites, dans la phylo- et l'ontogenèse, ainsi y a-t-il une ambiguïté intrinsèque de la « réalité ».
Le moi, cependant, « est la partie du ça modifiée sous l'influence directe du monde extérieur »(4) ; de même, le moi-plaisir se transforme en moi-réalité, l'épreuve de réalité modifiant le principe de plaisir en principe de réalité, par l'élaboration de séparations : « On reconnaît [...] comme condition pour la mise en place de l'épreuve de réalité que des objets aient été perdus qui autrefois avaient apporté une satisfaction réelle (real) »(5).
Selon Freud, la réalité psychique, inconsciente, n'est ni plus ni moins inconnaissable que la réalité du monde extérieur, puisque la conscience appréhende l'une et l'autre dans la méconnaissance qui lui est inhérente, et dans les limites et les formes que l'usage de la langue lui impose. Dénommant « réel » ce qui échappe à l'ordre symbolique, Lacan construit une autre perspective, où la réalité psychique s'identifie presque à celle de la langue.
Mazarine Pingeot et Michèle Porte
Notes bibliographiques
* Freud, S., Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-1917), G.W. XI, trad. « Introduction à la psychanalyse », Payot, Paris, 2001, p. 347.
* Freud, S., « Trauer und Melancholie » (1915), G.W. X, trad. « Deuil et mélancolie », in Métapsychologie, OCP XIII, PUF, Paris, 1988, p. 264.
* Freud, S., Briefe an Wilhelm Fliess (1887-1904). Ungekürzte Ausgabe. Herausgegeben von Jeffrey Moussaieff Masson.
* Deutsche Fassung von Michael Schröter, S. Fischer, Francfort, 1986, p. 284.
* Freud, S., « Das Ich und das Es, trad. le Moi et le ça », in Essais de psychanalyse, Payot, Paris, 2001, p. 237.
* Freud, S., « Die Verneinung » (1925), G.W. XIV, trad. « la Dénégation », in Résultats, idées, problèmes II, PUF, Paris, 2002, p. 138.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ? |
|
|
| |
|
| |
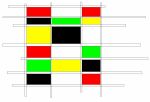
Pour comprendre et expliquer le réel en physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre, les scientifiques utilisent une méthode appelée la démarche scientifique. Quels sont ses grands principes ? Quels outils sont utilisés pour mettre en place des raisonnements logiques ? Découvrez l’essentiel sur la démarche scientifique.
QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ?
La démarche scientifique est la méthode utilisée par les scientifiques pour parvenir à comprendre et à expliquer le monde qui nous entoure. De façon simplificatrice, elle se déroule en plusieurs étapes : à partir de l’observation d’un phénomène et de la formulation d’une problématique, différentes hypothèses vont être émises, testées puis infirmées ou confirmées ; à partir de cette confirmation se construit un modèle ou théorie. L’observation et l’expérimentation sont des moyens pour tester les différentes hypothèses émises.
L’évolution de la démarche scientifique au fil du temps
De l’Antiquité à nos jours, les moyens d’investigation sur le monde ont évolué pour aboutir à une démarche dont les fondements sont communs à toutes les sciences de la nature (physique, chimie, sciences de la vie et de la Terre).
Dès l’Antiquité, Hippocrate, médecin grec, apporte de la nouveauté dans son traité « Le pronostic », qui détaille, pour la première fois, un protocole pour diagnostiquer les patients. Ce texte est l’une des premières démarches scientifiques.
Le XVIIe siècle est l’âge d’or des instruments et désormais l'expérience est au cœur de la pratique scientifique : on parle de Révolution scientifique. En plus des observations, les hypothèses peuvent aussi être testées par l’expérience. Par ailleurs, l’invention d’instruments tels que le microscope donne la possibilité aux scientifiques d’observer des éléments jusqu’alors invisibles à l'œil nu, comme les cellules, découvertes par Robert Hooke en 1665.
A partir du XXe siècle, la science se fait de manière collective. Les études scientifiques sont soumises au jugement des « pairs », c’est-à-dire à d’autres scientifiques et toutes les expériences doivent être détaillées pour être reproductibles par d’autres équipes. En contrepartie, la publication dans des revues internationales, et sur Internet dès les années 1990, permet aux chercheurs du monde entier d’accroître la notoriété de leurs idées et facilite l'accès aux sciences pour le grand public. Mais avec l'arrivée de l'informatique, il n'y a pas que la communication qui change, la méthode scientifique aussi se transforme. Il devient plus simple de trier de grands nombres de données et de construire des études statistiques. Il faut cependant faire attention à sélectionner les critères pertinents, car les progrès technologiques apportent aux chercheurs d’immenses quantités d’informations, appelées big data.
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
Observation et formulation d’une problématique
A la base de toute démarche scientifique, il y a au départ une observation d’un phénomène et la formulation d’une problématique.
Par exemple, depuis l’Antiquité, certains savants sont convaincus que la Terre est immobile au centre de l’Univers et que le Soleil tourne autour d’elle : c’est l’hypothèse du géocentrisme. Elle est émise car à l’époque, toutes les observations se faisaient à l’œil nu. Vu depuis la Terre, le Soleil peut donner l’impression de tourner autour de nous car il se lève sur l’horizon Est et se couche sur l’horizon Ouest. Cependant, ce n’était qu’une intuition car à ce stade, aucune véritable démarche scientifique n’est engagée.
Plus tard, quand les astronomes ont observé le mouvement des planètes, ils ont vu que le déplacement de certaines planètes forme parfois une boucle dans le ciel, ce qui est incompatible avec un mouvement strictement circulaire autour de la Terre. Le problème fut résolu en complexifiant le modèle : une planète se déplace sur un cercle dont le centre se déplace sur un cercle. C’est la théorie des épicycles.
Les hypothèses et la construction d’un modèle
Une nouvelle hypothèse fut émise par Nicolas Copernic au XVe siècle. Selon lui, le Soleil est au centre de l’Univers et toutes les planètes, dont la Terre, tournent autour de lui. On appelle cette hypothèse « l’héliocentrisme ». Ce modèle rend naturellement compte des rétrogradations planétaires mais possède quand même des épicycles pour décrire leurs mouvements avec plus de précisions.
Durant l’hiver 1609-1610, Galilée pointe sa lunette vers le ciel et découvre les phases de Vénus et des satellites qui tournent autour de la planète Jupiter. Ses observations l’incitent à invalider l’hypothèse géocentrique et à adhérer à l’héliocentrisme.
Petit à petit, cette méthode est devenue générale. Une hypothèse reste considérée comme valide tant qu’aucune observation ou expérience ne vient montrer qu’elle est fausse. Plus elle résiste à l’épreuve du temps, plus elle s’impose comme une description correcte du monde. Cependant, il suffit d’une seule observation contraire pour que l’hypothèse s’effondre, et dans ce cas, c’est définitif. Il faut alors changer d’hypothèse.
Reste que l’héliocentrisme de Copernic s’est d’abord imposé par la qualité des éphémérides planétaires qui en étaient tirées plus que par la force de son hypothèse, certes plus pratique que l’hypothèse géocentrique mais pas confirmée directement. Pour cela, il fallut encore attendre quelques années, le temps que la qualité des instruments d’observation progresse.
L’observation et l’expérimentation
Si la Terre est animée d’un mouvement autour du Soleil alors on devrait constater un effet de parallaxe, c’est-à-dire de variation des positions relatives des étoiles au fil de l’année. L’absence d’une parallaxe mesurable était utilisée contre l’héliocentrisme. C’est en cherchant à mesurer la parallaxe des étoiles que l’astronome anglais James Bradley découvrit en 1727 un autre effet, l’aberration des étoiles, dont il montra qu’elle ne pouvait provenir que de la révolution de la Terre autour du Soleil. La première mesure de parallaxe, due à l’astronome Friedrich Bessel en 1838, vient clore le débat.
Le mouvement de rotation de la Terre ne fut prouvé que plus tard. En 1851 le physicien Léon Foucault mène une expérience publique spectaculaire : un grand pendule est accroché à la voûte du Panthéon de Paris et la lente révolution de son plan d’oscillation révèle la rotation de la Terre sur elle-même.
On trouve là une autre caractéristique de la démarche scientifique. Une fois le modèle mis au point en s’appuyant sur des observations qui le justifient, il faut en tirer des prédictions, c’est-à-dire des conséquences encore non observées du modèle. Cela permet de mener de nouvelles observations ou de bâtir de nouvelles expériences pour aller tester ces prédictions. Si elles sont fausses, le modèle qui leur a donné naissance est inadéquat et doit être réformé ou oublié. Si elles sont justes, le modèle en sort renforcé car il est à la fois descriptif et prédictif.
La communication
Aujourd’hui, la « revue par les pairs » permet de contrôler la démarche scientifique d’une nouvelle découverte, par un collège de scientifiques indépendants. Si les observations et expérimentations vont dans le même sens et qu’elles ne se contredisent pas, la proposition est déclarée apte à être publiée dans une revue scientifique.
QUELS OUTILS POUR DÉCRYPTER LA SCIENCE ?
La démarche scientifique repose sur la construction d’un raisonnement logique et argumenté. Elle utilise les bases de la logique formelle : l’induction et la déduction.
L’induction
L’induction cherche à établir une loi générale en se fondant sur l’observation d’un ensemble de faits particuliers (échantillon).
L'induction est par exemple utilisée en biologie. Ainsi, pour étudier des cellules dans un organisme, il est impossible de les observer toutes, car elles sont trop nombreuses. Les scientifiques en étudient un échantillon restreint, puis généralisent leurs observations à l’ensemble des cellules. Les scientifiques établissent alors des hypothèses et des modèles dont il faudra tester les prédictions par des observations et des expériences ultérieures.
La déduction
La déduction relie des propositions, dites prémisses, à une proposition, dite conclusion, en s’assurant que si les prémisses sont vraies, la conclusion l’est aussi.
Exemple classique de déduction : tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme donc Socrate est mortel.
La déduction est beaucoup utilisée en physique ou mathématiques, lors de la démonstration d’une loi ou d’un théorème.
Raisonnement du Modus Ponens et du Modus Tollens
Le Modus Ponens et le Modus Tollens sont utilisés par les scientifiques dans leurs raisonnements.
Le Modus Ponens est, en logique, le raisonnement qui affirme que si une proposition A implique une proposition B, alors si A est vraie, B est vraie.
Mais si une implication est vraie alors sa contraposée l’est également (même valeur de vérité selon les règles de la logique formelle). Cela signifie que « la négation de B implique la négation de A » (contraposée de « A implique B »).
Le Modus Tollens est le raisonnement suivant : si une proposition A implique une proposition B, constater que B est fausse permet d’affirmer que A est fausse.
Un exemple : On sait que tous les poissons respirent sous l'eau. Or le saumon est un poisson donc il respire sous l'eau (Modus Ponens). La proposition initiale peut être énoncée sous une autre proposition équivalente (contraposée) : si « je ne peux pas respirer sous l’eau, alors je ne suis pas un poisson ». Cela permet de construire le raisonnement suivant : tous les poissons respirent sous l’eau, or je ne respire pas sous l’eau, donc je ne suis pas un poisson (Modus Tollens).
Ces outils de logique formelle permettent de vérifier la cohérence logique d’un argument et de détecter les argumentations fautives. Grâce à ces outils et en gardant un bon esprit critique et en vérifiant l'origine des informations diffusées, on peut donc plus facilement repérer un discours non scientifique ou pseudo-scientifique.
Notions clés
* Une hypothèse est considérée comme valide aussi longtemps qu’aucune observation ou expérience ne vient montrer qu'elle est fausse.
* La démarche scientifique consiste à tester les hypothèses pour démontrer si elles sont fausses ou non et à conserver uniquement celles qui sont cohérentes avec toutes les observations et les expériences.
* La fausseté d’une hypothèse est certaine alors que sa validité scientifique est temporaire et soumise à l’évolution des connaissances.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
