|
| |
|
|
 |
|
L'anévrisme cérébral : définition, symptômes, traitement |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 14/08/2025 |
|
|
|
| |

L'anévrisme cérébral : définition, symptômes, traitement
Par Hugo Jalinière le 08.06.2016 à 10h10, mis à jour le 21.12.2022 à 12h20
Lecture 5 min.
Entre 1 et 4% de la population serait porteuse d'un anévrisme cérébral sans même le savoir. Si le risque de rupture est très faible (environ 1/10.000 habitants/an), il s'agit d'un événement grave, mortel dans plus de 50% des cas.
Un anévrisme cérébral (en rouge) vu par angioscanner.
©GOMBERGH/SIPA
Qu'est-ce que c'est ?
Un anévrisme désigne la dilatation localisée d'une artère ou, plus rarement, d'une veine due à une faiblesse du tissu vasculaire. Cette dilatation progressive prend le plus souvent la forme d'une poche de sang, un "ballon" qui se gonfle au niveau de la paroi de l'artère (schéma ci-dessus ©NIH/CC). Cette poche appelée "sac anévrismal", dans laquelle le sang artériel sous pression circule en tourbillonnant, est reliée au reste de l'artère par une zone plus étroite appelée "collet". Chez l'humain, l'anévrisme se situe dans la plupart des cas en trois endroits : l'aorte abdominale, l'aorte thoracique et les artères cérébrales. Une fois formé, il grossit lentement et, en fragilisant davantage l'artère, créé un cercle vicieux. En effet, plus l'artère se dilate, plus sa paroi est fragile, et plus elle a tendance à se dilater rapidement... Jusqu'à atteindre le point de rupture. L'anévrisme se rompt et provoque une hémorragie interne qui peut être fatale, en particulier s'il s'agit d'une artère cérébrale.
Pour lire la suite consulter le LIEN
DOCUMENT sciencesetavenir.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
La dégradation du plastique en mer mauvaise pour la santé ? |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 10/08/2025 |
|
|
|
| |

La dégradation du plastique en mer mauvaise pour la santé ?
PUBLIÉ LE : 23/01/2014 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE
Vous lisez une page qui n’a pas été modifiée depuis 2014.
Les nanoparticules de polystyrène qui résultent de la dégradation naturelle du plastique modifient les propriétés des membranes cellulaires et donc l’activité de certaines protéines. Les chercheurs Inserm à l’origine de ces travaux souhaitent mobiliser la communauté scientifique pour étudier les conséquences possibles sur la santé humaine.
La dégradation des plastiques aurait-elle des conséquences sur la santé humaine et animale ? Les résultats de travaux menés par des chercheurs de l’Inserm relatifs à l’effet des nanoparticules de polystyrène sur des membranes cellulaires posent légitimement la question. Leurs résultats montrent en effet une modification des propriétés de ces membranes qui peut avoir un impact important sur l’activité des protéines qui les composent.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Hyperglycémie : vers une meilleure compréhension de son impact délétère sur la peau |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 01/08/2025 |
|
|
|
| |

Une dégradation de la qualité de la peau, de sa capacité à cicatriser, et de son vieillissement normal, est souvent observée chez les personnes présentant une hyperglycémie chronique. Une équipe de chercheuses et chercheurs de l’Inserm, de l’université de Bordeaux et de LVMH Recherche, s’est intéressée à la façon dont l’hyperglycémie altère le derme humain et en particulier les cellules impliquées dans sa cicatrisation, les fibroblastes. Ses travaux, parus dans Redox Biology, montrent qu’une trop forte concentration en glucose dans le derme vient perturber une mécanique complexe et finement régulée de production de l’énergie par les fibroblastes, avec des impacts sur leur capacité à maintenir l’intégrité de la peau.
LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le microbiote, un allié de choix pour prédire la sensibilité de chacun aux additifs alimentaires |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 01/08/2025 |
|
|
|
| |
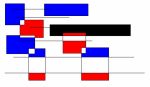
Largement utilisés par l’industrie agroalimentaire, les agents émulsifiants, un type d’additifs alimentaires, sont retrouvés dans de nombreux aliments de notre quotidien (pain de mie, glaces, crème fraîche, laits végétaux…). Les effets de leur consommation sur la santé sont devenus un véritable sujet de santé publique, tant leur présence dans l’alimentation actuelle est importante. Benoit Chassaing, directeur de recherche Inserm et responsable de l’équipe Interactions Microbiote-Hôte à l’Institut Pasteur (Inserm/Université Paris Cité/CNRS), a précédemment montré que ces additifs pourraient favoriser le développement de maladies inflammatoires chroniques et de dérégulations métaboliques en agissant directement sur notre microbiote intestinal. Dans une nouvelle étude, publiée dans le journal Gut, son équipe et lui ont développé un modèle de microbiote humain capable de prédire la sensibilité de chacun à un agent émulsifiant, et ceci grâce à un simple échantillon de selles. Cette découverte ouvre ainsi la voie à une approche de nutrition personnalisée fondée sur le microbiote intestinal afin de maintenir une bonne santé intestinale et métabolique.
Pour lire la suite , consulter le LIEN.
LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
