|
| |
|
|
 |
|
Plongée dans le nanomonde |
|
|
| |
|
| |

Plongée dans le nanomonde
L’essor constant de la miniaturisation va de pair avec la mise au point de nouveaux microscopes, ouvrant la voie aux nanosciences et aux nanotechnologies.
Publié le 1 juillet 2012
Les possibilités offertes par la miniaturisation avaient été perçues très en amont, dès 1959, par le physicien Richard Phillips Feynman. Celui-ci avait émis l’hypothèse que l’homme pouvait manipuler les atomes et les utiliser soit pour stocker de l’information, soit pour créer des systèmes fonctionnels. L’idée était là, mais pas les instruments permettant de vérifier cette hypothèse.
En appliquant à l’électronique une loi économique datant de la fin du XIXe siècle, Gordon Moore, cofondateur d’Intel, estimait en 1965 que la cadence de miniaturisation des transistors intégrés sur une même puce suivrait une pente régulière. En 1974, une puce contenait 4 transistors intégrés. Aujourd’hui, cette même puce en contient des dizaines de millions, chacun de la taille de 100 nm. En 2020, selon la courbe de cette « loi de Moore », les transistors devraient atteindre 10 nm !
Grâce à cette miniaturisation, les industriels fractionnent le cœur des processeurs en plusieurs sous-unités travaillant parallèlement, augmentant ainsi les fonctionnalités des processeurs.
Selon la loi de Moore, d’ici à 2020, la taille des transistors devrait atteindre 10 nm, contre 100 nm aujourd’hui.
Pour en savoir plus
* Focus sur la physique quantique
* Dossier sur les microscopes
TOP-DOWN ET BOTTOM-UP
Cette volonté de miniaturisation est celle de la voie descendante, ou top-down. Le matériau est découpé, sculpté, gravé pour atteindre la dimension souhaitée, grâce à l’instrumentation élaborée et améliorée par l’homme, en vue d’atteindre le micromètre, puis le nanomètre. À l’inverse, la voie ascendante, ou bottom-up, permet d’assembler atome par atome des agrégats, puis des molécules, pour construire la matière. Cette voie est similaire à celle suivie par la Nature qui, à partir de molécules simples, a formé le monde du vivant durant les 4 milliards d’années d’évolution.
L’étude du nanomonde englobe :
* les nanosciences, qui étudient la composition de la matière, son assemblage et ses propriétés intimes à l’échelle du nanomètre ;
* les nanotechnologies, qui correspondent aux techniques et outils utilisés pour étudier ces nouvelles propriétés de la matière et pour réaliser de nouveaux dispositifs, objets et systèmes qui les exploitent.
DES OUTILS TRÈS FINS ET PRÉCIS
Pour manipuler des objets aussi petits, les outils doivent être très fins et précis. Le microscope à effet tunnel est l’un des premiers instruments créés afin de « voir » les atomes à la surface de la matière. Cet instrument comporte une pointe métallique extrêmement fine qui permet de cartographier, atome par atome, la surface d’un matériau. Il est uniquement utilisé pour l’observation de la surface des matériaux conducteurs. Une tension électrique, créant un courant d’électrons, est exercée entre la pointe et la surface. La surface est donc balayée à une distance de quelques nanomètres, la pointe capture les électrons qui transitent grâce à l’effet tunnel. Les variations de ce « courant tunnel » sont enregistrées et traitées par un ordinateur fournissant une image du relief de la matière, atome par atome (voir schéma ci-dessous). Ses inventeurs, les Suisses Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, du laboratoire de recherche d’IBM à Zurich, ont été couronnés par le prix Nobel de physique en 1986.
Le microscope à effet tunnel
Le microscope à force atomique permet d’observer des matériaux non conducteurs, tels que les matériaux céramiques, polymères ou biologiques.
S’appuyant sur un dispositif semblable à celui qui équipait la tête de lecture des tourne-disques, il est 100 % mécanique. La pointe de ce microscope est fixée sur un bras de levier flexible, qui est en interaction avec la surface du matériau. Elle balaye la surface en suivant à très faible distance le relief. La déformation du levier, éclairé par un laser, est mesurée par un photodétecteur et enregistrée sur un ordinateur.
Dans un grand nombre d’expériences, les chercheurs ont recours à la puissance de calcul des supercalculateurs pour modéliser l’assemblage atomique et restituer ses propriétés propres. L’objectif est d’augmenter les connaissances en sciences de la matière ou du vivant et de constituer en amont des assemblages inédits ou de contrôler certaines propriétés.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Innover pour un nucléaire durable |
|
|
| |
|
| |
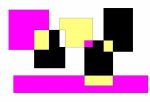
Innover pour un nucléaire durable
LES DÉFIS DU CEA NO HORS-SÉRIE –
PARUTION : JUIN 2016
Au sein du CEA, la Direction de l’énergie nucléaire apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise et d’innovation sur les systèmes de production d’énergie nucléaire. Pour répondre à cet enjeu, elle conduit ses travaux selon trois axes majeurs : les systèmes nucléaires du futur, dits de 4e génération, réacteurs et cycle du combustible associé ; l’optimisation du nucléaire industriel actuel ; le développement et l’exploitation de grands outils expérimentaux et de simulation indispensables pour mener ses recherches. En parallèle, en tant qu’exploitant nucléaire, le CEA mène des programmes de construction et de rénovation de ses installations nucléaires, ainsi que des programmes d’assainissement et de démantèlement de celles arrivées en fin de vie. A l’occasion de la deuxième édition du salon international du nucléaire WNE, qui se tient du 28 au 30 juin 2016 au Bourget, un dossier spécial du journal Les Défis revient sur ces grands thèmes d’activité.
nucléaire du futur
astrid, une option pour la quatrième génération
© P.Stroppa/CEA - Modélisation du comportement nominal d’un réacteur à neutrons rapides de IVe génération (vue du coeur et de son circuit de refroidissement). Assurer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement, améliorer les standards de sûreté, optimiser durablement la gestion des matières et minimiser la production des déchets. Le tout, sans émettre de gaz à effet de serre. Voici le cahier des charges du nucléaire du futur fixé par le Forum international génération IV. La conception du démonstrateur technologique de réacteur à neutrons rapides Astrid, prévue par la loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, est confiée au CEA et financée dans le cadre des investissements d’avenir votés par le Parlement en 2010.
© S.Le Couster/CEA - Intérieur de la chaîne blindée procédé (CBP) de l’installation Atalante du centre CEA de Marcoule. La France a fait le choix d’une politique de traitement-recyclage des combustibles usés. Cette option, déjà déployée industriellement depuis les années 1990, trouvera sa pleine mesure avec la quatrième génération. La Direction de l'énergie nucléaire du CEA (CEA-DEN), qui a mis au point les procédés actuellement mis en œuvre, poursuit aujourd’hui des recherches pour améliorer, compléter et adapter les technologies aux enjeux de demain.
Combustible nucléaire
Moisson d'innovations pour le combustible nucléaire
Produit industriel bien défini et dûment éprouvé depuis plusieurs décennies, le combustible nucléaire reste toutefois au cœur de nombreuses innovations. Des optimisations sont en effet nécessaires, tant pour répondre aux impératifs économiques et industriels actuels que pour préparer les défis de demain. Pour cause, le combustible est un assemblage complexe et compliqué à mettre en œuvre pour concilier performances et exigences de sûreté accrues. Le défi est relevé par les chercheurs du CEA-DEN qui maîtrisent savoir et savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne : de la conception jusqu’à la caractérisation post-irradiation, en passant par la simulation numérique.
matériaux du nucléaire
Des matériaux faits pour durer !
© P.Stroppa/CEA - Matériau composite, à base de fibres de carbure de silicium tressées,
en cours de réalisation au CEA pour fabriquer de nouvelles gaines de combustibles. Fortes températures, irradiations, contraintes mécaniques, environnements corrosifs : les matériaux des centrales nucléaires sont soumis à des conditions extrêmes. Ainsi, la garantie de la sûreté, de la durée de fonctionnement et des performances des réacteurs actuels, tout comme la conception et la qualification de matériaux adaptés aux contraintes spécifiques des systèmes nucléaires du futur, constituent les principaux enjeux du CEA-DEN dans le domaine des matériaux du nucléaire. Pour cela, les chercheurs s’appuient sur un solide retour d’expérience, des compétences et des installations uniques au monde.
moyens de R&D
Une recherche bien outillée
© CEA-DEN - Maillage du casier (partie centrale), du réflecteur (blocs) et de la piscine (zone extérieure) du RJH, modélisé grâce au logiciel plateforme Salome pour un calcul APOLLO2. Les recherches pour les systèmes nucléaires actuels ou du futur nécessitent des outils expérimentaux et de simulation spécifiques. Dans ce cadre, le CEA-DEN développe et exploite un parc complet et cohérent d’installations expérimentales, prépare le remplacement des installations vieillissantes et réalise de nouvelles installations telles que le Réacteur Jules Horowitz (RJH) à Cadarache. Dans le domaine de la simulation, il développe des codes dans tous les grands domaines du nucléaire (neutronique , thermo-hydraulique, mécanique, thermique, chimie du cycle et matériaux) afin de modéliser l’ensemble des phénomènes entrant en jeu dans un réacteur.
assainissement - démantèlement
Démantèlement : héritage du passé, perspectives d’avenir
© CEA - État final d’un laboratoire chaud du CEA à Grenoble, après écroûtage des surfaces puis contrôles radiologiques Leader sur l’ensemble du cycle de l’électronucléaire, la France assume également les exigences d’assainissement-démantèlement de ses installations nucléaires en fin d’exploitation. À ce titre, le CEA fait figure de pionnier tant dans la maîtrise d’ouvrage de chantiers que dans la R&D pour en optimiser les délais, coûts et sûreté. Définir le scénario le plus adapté, caractériser l’état radiologique des équipements, décontaminer les lieux, procéder au démontage et optimiser les déchets qui en découlent : fort de ce large panel de compétences et de la diversité de ses installations concernées, la Direction de l’énergie nucléaire du CEA (CEA-DEN) développe des solutions innovantes qui font déjà l’objet de transferts industriels.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ÃNERGIE |
|
|
| |
|
| |

ÉNERGIE
Nous sommes tous entourés d'énergie : dans notre corps, notre maison, notre environnement... Elle est là, dans notre quotidien. Qu'est-ce que l'énergie ? Quelles sont les différentes formes de l'énergie ? Ses sources ? Que signifient les expressions "énergies primaires", "énergies secondaires", "énergies renouvelables", "énergies non-renouvelables", "énergies fossiles" ?
QU'EST-CE QUE L'ÉNERGIE ?
Le mot « énergie » vient du Grec Ancien « énergéia », qui signifie « La force en action ». Ce concept scientifique est apparu avec Aristote et a fortement évolué au cours du temps. Aujourd’hui, l’énergie désigne « la capacité à effectuer des transformations ». Par exemple, l’énergie c’est ce qui permet de fournir du travail, de produire un mouvement, de modifier la température ou de changer l’état de la matière. Toute action humaine requiert de l’énergie : le fait de se déplacer, de se chauffer, de fabriquer des objets et même de vivre.
L’énergie est partout présente autour de nous : dans la rivière qui fait tourner la roue du moulin, dans le moteur d’une voiture, dans l’eau de la casserole que l’on chauffe, dans la force du vent qui fait tourner les éoliennes… et même dans notre corps humain.
Une énergie de qualité
Toutes les formes d’énergie n’ont pas la même « valeur ». Dans les machines, on distingue classiquement l’énergie mécanique, ou travail, de l’énergie thermique, ou chaleur. La première est beaucoup plus utile que la seconde. C’est elle qui permet de déplacer les objets ou de les déformer.
De son côté, la chaleur a tendance à se diluer dans la matière et seule une petite partie peut être transformée en énergie mécanique. C’est ce qui fait qu’une centrale électrique n’arrive à transformer qu’un tiers de la chaleur de son feu de charbon ou de ses fissions nucléaires en électricité, le reste étant inutilisable et rejeté à l’extérieur.
LES DIFFÉRENTES FORMES D'ÉNERGIE
L’énergie peut exister sous plusieurs formes. Parmi les principales :
* L’énergie thermique, qui génère de la chaleur ;
* L’énergie électrique ou électricité, qui fait circuler les particules – électrons - dans les fils électriques ;
* L’énergie mécanique, qui permet de déplacer des objets ;
* L’énergie chimique, qui lie les atomes dans les molécules ;
* L’énergie de rayonnement ou lumineuse, qui génère de la lumière ;
* L’énergie musculaire qui fait bouger les muscles.
Conservation de l'énergie
L’énergie se conserve. La quantité totale d'énergie dans un système donné ne change pas, on ne peut donc ni la créer, ni la détruire. L'énergie est transmise d'un élément vers un autre, souvent sous une forme différente.
Un exemple : quand on chauffe de l'eau, différentes transformations d’énergie ont lieu. En brûlant dans l’air, le bois libère son énergie chimique. Cette énergie se transforme en chaleur, l’énergie thermique, et en lumière, l’énergie de rayonnement. Lors de cette réaction, la quantité d'énergie totale ne change pas, elle change simplement de forme.
Un autre exemple : lorsqu’une voiture fonctionne, l’essence libère son énergie chimique en brûlant dans l’air. Elle chauffe le moteur et pousse les pistons (énergie thermique et énergie mécanique). Les pistons font tourner le moteur et les roues, transfert d’énergie mécanique, et la voiture se déplace (énergie cinétique). Au passage, la courroie fait tourner l’alternateur qui transforme une petite partie de l’énergie mécanique en électricité qui sera stockée dans la batterie.
LES SOURCES D'ÉNERGIE
L’énergie est issue de différentes sources d’énergie qui peuvent être classifiées en deux groupes : les énergies non renouvelables, dont les sources ont des stocks sur Terre limités et les énergies renouvelables qui dépendent d’éléments que la nature renouvelle en permanence.
Les diverses sources d'énergie
Votre navigateur ne permet pas de lire des vidéos.
télécharger : version vidéo |
Qu'est-ce qu'une énergie intermittente ?
Une énergie intermittente est une énergie pour laquelle les sources ne sont pas disponibles en permanence et dont la disponibilité varie fortement sans possibilité de contrôle. Les énergies solaire et éolienne sont définies comme intermittentes car leur efficacité varie en fonction de la météo et de paramètres extérieurs (jour/nuit).
Pour pallier à cette intermittence, il est nécessaire de stocker ces énergies. Le développement de technologies de stockage est un enjeu important de recherche et développement.
Pour plus d’informations sur le stockage de l’énergie, consultez notre dossier « l’essentiel sur… le stockage stationnaire de l’énergie ».
Les sources d'énergie non renouvelables
Énergies fossiles
Dans les énergies non renouvelables, on trouve les énergies dites fossiles : ce sont les résidus des matières végétales et organiques accumulés sous terre pendant des centaines de millions d’années. Ces résidus se transforment en hydrocarbure (pétrole, gaz naturel et de schiste, charbon…). Pour pouvoir les exploiter, il faut puiser dans ces ressources qui ne sont pas illimitées, c’est pourquoi les énergies fossiles ne sont pas renouvelables.
Énergie nucléaire
L’énergie nucléaire est « localisée » dans le noyau des atomes. Dans les centrales nucléaires actuelles, on utilise la fission (cassure) des noyaux d’uranium, élément que l’on retrouve sur Terre dans les mines. Les mines d’uranium s’épuiseront un jour tout comme le charbon, le gaz et le pétrole.
Au rythme de l’utilisation des ressources actuellement exploitées, on estime les réserves de pétrole à 40 ans, de gaz naturel conventionnel à 60 ans et de charbon à 120 ans. Les réserves d’uranium, combustible de l’énergie nucléaire, à 100 ans avec les réacteurs actuels.
Le saviez-vous ?
L’énergie nucléaire a un excellent bilan carbone : elle ne génère pas de CO2. Cependant, la production d’électricité avec le nucléaire génère des déchets radioactifs, dont la gestion spécifique est encadrée par la Loi.
Les sources d'énergies renouvelables
Le soleil, le vent, l’eau, la biomasse et la géothermie sont des sources qui ne s’épuisent pas et sont renouvelées en permanence.
Biomasse et géothermie : quelles différences ?
La biomasse et la géothermie sont deux sources d’énergies bien distinctes.
La géothermie est l’énergie générée par la chaleur des profondeurs de la Terre et sa radioactivité. Le mot « géothermie » vient du grec « geo » (la terre) et « thermos » (la chaleur). On l’exploite pour chauffer des habitations grâce à des forages légers.
La biomasse a, quant à elle, pour source le Soleil dont l’énergie de rayonnement est transformée en énergie chimique par les matières organiques d’origine végétale (bois), animale, bactérienne ou fongique (champignons). Il existe des centrales « biomasse » qui produisent de l’électricité avec la combustion de matières organiques.
Parmi toutes ces sources d’énergie, on distingue les énergies primaires des énergies secondaires.
Énergie primaire
Une énergie primaire est une énergie brute n’ayant pas subi de transformation, dont la source se trouve à l’état pur dans l’environnement. Le vent, le Soleil, l’eau, la biomasse, la géothermie, le pétrole, le charbon, le gaz ou l’uranium sont des sources d’énergies primaires.
Énergie secondaire
On appelle « énergie secondaire » une énergie qui est obtenue par la transformation d’une énergie primaire.
Par exemple, l’électricité est une énergie secondaire qu’on obtient à partir de plusieurs énergies primaires : l’énergie solaire avec des panneaux, l’énergie nucléaire avec des réacteurs, l’énergie hydraulique avec des barrages ou encore l’énergie du vent avec des éoliennes. Il n’existe pas d’électricité à l’état naturel.
L’essence, le gasoil et les biocarburants sont également des énergies secondaires ; on les obtient par la transformation du pétrole, qui lui, est brut ou de la biomasse. L’hydrogène, qui n'existe pas à l'état pur, est également une énergie chimique secondaire car il faut le produire.
La domestication des sources d'énergie au fil du temps
La maîtrise des sources d’énergie par l’Homme remonte à 400 000 ans av. J-C. A l’époque, l’Homme apprend à maîtriser le feu. Puis, plus tard, il apprend à maîtriser le vent, l’eau avec des moulins….
Avec l’ère industrielle, l’Homme commence à exploiter des ressources fossiles (charbon, puis pétrole et gaz) et à développer des machines qui vont changer son mode de vie. Depuis, les besoins en énergie n’ont cessé d’augmenter.
En chiffres
81 % des besoins mondiaux en énergie primaire sont actuellement comblés par le pétrole, le charbon et le gaz.
Source : Données 2019 de l'Agence internationale de l'énergie
Énergie et puissance
On mesure l’énergie à l’aide d’une unité particulière nommée le joule. Son nom vient du physicien anglais James Prescott Joule. Un joule représente par exemple l'énergie requise pour élever une pomme de 100 grammes d'un mètre ou encore l'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme (un litre) d'air sec de un degré Celsius.
Dans le domaine de la nutrition, c’est la kilocalorie qui est utilisée. 1 kilocalorie équivaut à 4,2 kilojoules. Pour évaluer l’énergie utilisée sur une année, on utilise généralement la tonne équivalent pétrole, tep.
1 tep est égale à 41 868 000 000 joules.
La puissance correspond, quant à elle, à la vitesse à laquelle l'énergie est délivrée. Elle se mesure en watt, ce qui correspond à un joule par seconde.
Par exemple, si pour faire bouillir un litre d’eau, on utilise d’un côté une flamme d’un gros feu de bois et de l’autre, la flamme d’une bougie : dans les deux cas, la même quantité d’énergie sera utilisée pour faire bouillir l’eau. Seulement, ce sera fait plus rapidement avec un feu qu’avec une bougie. L'énergie est dégagée plus rapidement avec le feu de bois qu'avec la flamme de la bougie. Le feu de bois est donc plus puissant que la flamme de la bougie.
UTILISATION DES ÉNERGIES EN FRANCE ET ENVIRONNEMENT
L’énergie, en France, est surtout utilisée pour le transport, l’habitat (chauffage), l’industrie, le tertiaire et l’agriculture.
En chiffres
En 2019, un Français a en moyenne consommé 30 fois plus d’énergie qu’un habitant d’Afrique de l’Est.
Source : Connaissance des Énergies, d'après BP Statistical Review of World Energy
Bien que la dépendance énergétique de la France se soit réduite depuis 1973 grâce à la construction du parc nucléaire, son mix énergétique dépend encore fortement des énergies fossiles qui couvrent près de 50 % de la consommation d’énergie primaire. A eux seuls, le transport et l’habitat représentent en France près de 80 % de la consommation finale. Le bâtiment dépend à plus de 50 % [2] des combustibles fossiles et le transport à 95 % du pétrole. Ces deux secteurs sont à l’origine de plus de 50 % des émissions de CO2, l’un des principaux gaz à effet de serre.
Ces émissions impactent directement le climat en contribuant au réchauffement climatique. Face à ce défi climatique majeur, il devient indispensable de disposer de sources d’énergie à la fois compétitives et bas carbone (faiblement émettrices de gaz à effet de serre) et de faire évoluer le mix énergétique de la France.
Les défis énergétiques
Toute action humaine requiert de l’énergie. Depuis toujours, l’Homme a cherché à accéder à des sources d’énergie abondantes et peu chères pour satisfaire ses besoins. Mais depuis le début de la révolution industrielle, la société moderne utilise sans compter de l’énergie provenant de sources, qui sont, pour la plupart, non renouvelables. Conséquence, les ressources s’épuisent et la quantité d’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, issue de l’exploitation des ressources fossiles, menace le climat. Face à ces réalités, il devient nécessaire de :
* Mieux gérer l’utilisation des énergies en faisant notamment moins de gaspillage ;
* Repenser notre mix énergétique en utilisant des sources d’énergie bas carbone tels que le nucléaire et les énergies renouvelables ;
* Améliorer les technologies de stockage de l’énergie (batteries, hydrogène) ;
* Continuer à travailler sur les énergies du futur : nucléaire du futur (fission et fusion nucléaire), solaire, éolien, bioénergies.
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LE NANOMONDE |
|
|
| |
|
| |
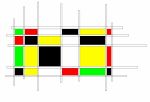
LE NANOMONDE
Pour un développement citoyen
Les usages et les impacts des nanotechnologies font l’objet de nombreuses études portant sur la maîtrise des risques potentiels.
Publié le 1 juillet 2012
LES NANOTECHNOLOGIES : DES APPLICATIONS DANS TOUS LES DOMAINES
Les nanotechnologies devraient permettre de créer des objets rendant plus de services en utilisant moins de matière première et d’énergie. Elles pourraient ainsi amoindrir l’impact environnemental de certaines industries (comme celles liées à l’énergie) ou activités (comme les transports ou les technologies de l’information).
Parallèlement à leur apport dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie, elles contribueront à diminuer la consommation d’énergie en améliorant le rendement énergétique d’objets courants. Ainsi, citons des matériaux plus légers et résistants utilisés pour les véhicules, le remplacement des lampes à incandescence par des diodes électroluminescentes (beaucoup moins gourmandes en électricité), le remplacement des écrans cathodiques par des systèmes à cristaux liquides (dix fois moins consommateurs)… Enfin, un des enjeux, et non des moindres, est de développer des composants nanoélectroniques faible consommation pour des systèmes de calcul efficaces énergétiquement ; 13 % de l’électricité mondiale est aujourd’hui consacrée à ce secteur !
Les nanotechnologies peuvent contribuer à la détection des pollutions : des nano-capteurs fiables, rapides et peu onéreux permettront de traquer toutes sortes de molécules organiques ou minérales indésirables dans l'eau, l'air ou le sol. Une fois détectées, il faut remédier à ces pollutions ; qu'il s'agisse du traitement des eaux ou de la conception de nouveaux catalyseurs pour emprisonner les nanoparticules des fumées des moteurs d'automobiles, des réacteurs d'avions, des cheminées d'usines…
La diffusion des rayons X aux petits angles permet de caractériser l’organisation spatiale des nanoparticules et leur agrégation, éléments fondamentaux dans la compréhension des mécanismes de toxicologie. © C.Dupont/CEA
Un panel international de spécialistes a listé les dix applications des nanotechnologies jugées comme les plus intéressantes pour les pays en voie de développement : énergie (nouvelles cellules solaires et piles à combustible), agriculture (nanofertilisants), traitement de l'eau (filtration, décontamination, désalinisation), diagnostic médical, délivrance de médicaments, emballage et stockage des aliments, remédiation de la pollution atmosphérique, matériaux de construction, suivi de paramètres biologiques (glycémie, cholestérol), détection des insectes nuisibles et des vecteurs de maladies. Certaines d'entre elles ne sont pas trop compliquées, chères ou demandeuses d'infrastructures et peuvent être développées sur place. L'Inde, le Brésil ou la Chine y consacrent des investissements importants, et de nombreux autres pays, qui possèdent déjà une infrastructure universitaire et industrielle, comme l'Afrique du Sud, la Thaïlande ou l'Argentine font également de la recherche en nanotechnologies.
Des recherches en toxicologie évaluent les dangers réels ou supposés des nanotechnologies.
RISQUES POTENTIELS
La notion de risque lié aux nanotechnologies comporte deux aspects : le danger (issu de la toxicité) et l’exposition. Les recherches en toxicologie sont là pour évaluer les dangers réels ou supposés.
L'étude de la pollution urbaine recherche son impact sur la santé humaine, notamment les effets des particules ultrafines émises par les véhicules diesel. Sur le même schéma, d'autres études qui font état d'interactions entre nanoparticules et cellules incitent à la prudence en cas d’inhalation, de pénétration par voie cutanée ou digestive. Une démarche d’anticipation est donc mise en place.
Dans les ateliers de production et de mise en œuvre, si les nanoparticules sont constituées de matière toxique (métaux lourds par exemple), elles peuvent exposer les hommes aux mêmes risques que sous forme macroscopique. Un risque potentiel supplémentaire est lié aux propriétés spécifiques des nanoparticules : surface multipliée, réactivité chimique… Des recherches sont donc menées actuellement pour étudier le devenir des nanoparticules et nanofibres si elles étaient inhalées. Les bonnes pratiques de travail sont très similaires à celles recommandées pour tout produit chimique dangereux, mais elles revêtent une importance particulière en raison de la grande capacité de diffusion des nano-objets dans l'atmosphère. Dans le milieu industriel, il faut concevoir des procédés qui minimisent les étapes d’exposition potentielles, par exemple en réalisant la collecte des nano-objets en phase liquide afin de garantir leur non-diffusion en cas d’incident. Il faut aussi veiller à automatiser les étapes du procédé, capter les polluants à la source, filtrer l'air des locaux avant rejet dans l'atmosphère, et équiper individuellement chaque travailleur d'une protection respiratoire et cutanée.
Dans le cas du consommateur, il s’agit d’éviter qu’il soit mis en contact avec un produit potentiellement dangereux. Ainsi, tout est mis en œuvre pour que les produits grand public ne contiennent pas de nanoparticules libres et pour éviter qu’un produit n’en génère, par exemple lorsqu’il vieillit ou se dégrade.
Des questions se posent sur les effets potentiels des nanoparticules manufacturées dans l’environnement (comportement, mécanismes de dégradation) et l’impact de leur dispersion sur les écosystèmes (danger éventuel pour certaines espèces). Des recherches visant à étudier leur écotoxicité sont mises en place.
De nombreux états, comme les États-Unis et la France, se mobilisent pour évaluer et maîtriser les risques liés aux nanoparticules et leurs effets secondaires éventuels ; prenant en compte leurs caractéristiques, leurs possibles voies de contamination, les moyens de protection, les moyens de production, le comportement des nanoparticules dans l’environnement…
En Europe, le CEA s’est associé en 2005 avec des partenaires R&D de l’industrie chimique et technologique pour constituer un « projet intégré » baptisé Nanosafe 2. Ce projet se décompose en quatre axes de développement :
* technologies de détection et de caractérisation des nanoparticules dès l’étape de production ;
*
* réseau international pour constituer une base de données sur les effets des nanoparticules sur l’organisme et l’environnement ;
*
* filières industrielles entièrement intégrées, dont l’objectif est de produire sans mettre en contact le précurseur de la nanoparticule (aérosol, gaz, liquide) et le composant final ;
*
* études d’analyses du cycle de vie et de filières de recyclage, afin de maîtriser les effets sur la santé et l’environnement, en association avec la Commission européenne de normalisation.
*
Des structures d'études
pour les nanos au CEA
* OMNT : Observatoire des micro et nanotechnologies
La mission de cet observatoire, lancé en 2005 à l’initiative du CEA et du CNRS, consiste à réaliser en continu une veille scientifique et technologique dans le domaine des micro- et nanotechnologies. Il s’appuie pour ce faire sur un réseau de plus de 230 experts français et européens. Ainsi, il peut informer les organismes et ministères concernés et fournir aux industriels une information pertinente et actualisée.
* LARSIM : Laboratoire des recherches sur les sciences de la matière
Le LARSIM a vu le jour au sein du CEA en 2007. Premier laboratoire du CEA dédié à la philosophie des sciences, le LARSIM a pour but d’étudier et de mieux faire comprendre les enjeux de la recherche scientifique contemporaine. Parallèlement à son travail sur la place de la science dans la société, le LARSIM mène un programme de recherche en fondements de la physique.
Pour la première fois, les répercussions sanitaires, environnementales et sociales sont considérées et étudiées parallèlement au développement des technologies et à la mise en place de méthodes sûres de production des nanoparticules. Cette simultanéité devrait permettre l’anticipation et la maîtrise des risques potentiels associés et faire évoluer des réglementations spécifiques en fonction des progrès des connaissances et des recherches en cours.
QUESTIONS ÉTHIQUES POSÉES PAR LES NANOSCIENCES ET LES NANOTECHNOLOGIES
Par rapport à la problématique des nanotechnologies, la réflexion éthique dépasse les limites de la pure déontologie, définie comme un ensemble de comportements et de règles professionnelles. L’éthique analyse les changements que la recherche scientifique introduit dans le monde, les responsabilités des chercheurs vis-à-vis de la société et les réactions que suscitent en son sein les nouveautés techniques. L’excellence scientifique et l’innovation doivent être accompagnées des mesures de précaution correspondant aux incertitudes sur les nouveaux produits issus des nanotechnologies. S’ils souhaitent assurer l’acceptabilité des fruits de leurs recherches, les chercheurs sont tenus à prendre en considération les intérêts des différents acteurs. De multiples rapports tentent ainsi d’évaluer les impacts potentiels des nanotechnologies sur la société, par exemple, le rapport britannique « Nanosciences et nanotechnologies : opportunités et incertitudes » réalisé en 2004.
Il recommande d’appliquer le principe de précaution, tout comme le rapport du Comité de la prévention et de la précaution français en 2006, suivi par celui de l’Agence française de sécurité sanitaire et de l’environnement au travail. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a organisé plusieurs concertations sur les nanotechnologies et établi un rapport « Nanosciences et progrès médical », incitant à mener les recherches sur les nanosciences et nanotechnologies en parallèle avec celles sur les risques et impacts éventuels.
Depuis 2005, la Commission européenne a lancé un Plan stratégique européen afin de mener une réflexion approfondie sur les risques, les usages et les impacts des nanotechnologies. Mi-2007, elle a proposé l’adoption d’un code de conduite sur le même sujet, qui a été publié en février 2008. La Commission a également mis en place en mars 2008 le nouvel Observatoire européen des nanotechnologies.Pour la France, cet observatoire s’appuiera sur l’OMNT et le LARSIM.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
