|
| |
|
|
 |
|
Premier film moléculaire en âslow motionâ et 3D dâune protéine membranaire, la bactériorhodopsine |
|
|
| |
|
| |

Premier film moléculaire en ‘slow motion’ et 3D d’une protéine membranaire, la bactériorhodopsine
28 décembre 2016 RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
Une prouesse technique a permis à un consortium international incluant un chercheur de l’Institut de biologie structurale, de montrer comment la protéine bactériorhodopsine utilise la lumière pour transporter des protons à travers la membrane cellulaire pour créer un différentiel de charge qui peut ensuite être utilisé pour générer l’énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Cette étude a été publiée le 23 décembre dans la revue Science.
La bactériorhodopsine est une protéine qui absorbe la lumière et transporte des protons à travers les membranes cellulaires, une fonction essentielle des systèmes biologiques. Les chercheurs se sont longtemps interrogés sur le mécanisme que la protéine utilise pour expulser des protons de façon unidirectionnelle, de l’intérieur vers l’extérieur de la cellule. Pour le découvrir, un consortium international de chercheurs a utilisé le laser à électrons libres SACLA localisé au Japon, qui produit un faisceau de rayons X un million de fois plus intense que ceux des sources synchrotron, pourtant déjà très intenses. Les rayons X de SACLA présentent la particularité d’êtres générés pendant un temps extrêmement court, un centième de milliardième de seconde (une dizaine de femtosecondes). Les rayons X sont utilisés pour déterminer la structure de protéines qui traversent le faisceau sous la forme de microcristaux au sein d’un jet de graisse.
Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé une technique appelée cristallographie sérielle femtoseconde en temps résolu, avec laquelle ils ont enregistré des dizaines de milliers d’images de la bactériorhodopsine après un intervalle de temps variant entre la nanoseconde et la milliseconde suivant l’excitation de lumière verte. En analysant les données, ils ont pu décrypter le mécanisme qui fait que le protéine expulse des protons hors de la cellule, dans un milieu chargé donc plus positivement. A l’instar d’une pile, c’est ce différentiel de charges qui permet d’alimenter les réactions chimiques qui font vivre la cellule.
Antoine Royant, à l’Institut de Biologie Structurale à Grenoble, a contribué à l’analyse structurale des 13 structures d’états intermédiaires obtenues sur 5 ordres de grandeur d’échelle de temps, et à l’identification du mécanisme d’action de la protéine.
« Cette expérience nous a permis de confirmer les hypothèses proposées au début des années 2000 sur les premières étapes du mécanisme, mais surtout de visualiser en temps réel les différents mouvements d’atome au sein de la bactériorhodopsine et comprendre ainsi comment ils s’enchaînent » explique A. Royant. L’excitation lumineuse entraîne un changement de configuration du rétinal (une forme de la vitamine A), la molécule colorée située au cœur de la protéine. Ce changement force une molécule d’eau structurale à s’en aller, puis un ensemble de réarrangements structuraux de la protéine entraîne l’expulsion d’un proton du côté extracellulaire de la protéine.
« Nous avons enfin compris comment les changements au voisinage du rétinal empêchent le proton de retraverser la protéine. Ce résultat permet d’envisager de comprendre à un très grand niveau de détail le mécanisme de protéines, et donc d’être capables de les utiliser à notre profit » conclut A. Royant.
Figure : Microcristaux de bactériorhodopsine obtenus en phase cubique de lipides. Les cristaux sont injectés dans le faisceau du laser à électron libre SACLA, et illuminés par un laser vert déclenchant le photocycle de la protéine. Des clichés de diffraction sont enregistrés entre quelques nanosecondes et quelques millisecondes et permettent d’identifier les changements structuraux au sein de la protéine (formée de sept hélices transmembranaires) qui se déroulent au cours de la photoréaction, permettant à des protons d’être expulsés hors de la cellule de façon unidirectionnelle.
© Eriko Nango, Cecilia Wickstrand, Richard Neutze, Antoine Royant
Contact
Antoine Royant
04 76 88 17 46
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ORIGINES ET POSITION DE L'HOMME DANS L'ÃVOLUTION : LA CONNEXION CHROMOSOMIQUE |
|
|
| |
|
| |

ORIGINES ET POSITION DE L'HOMME DANS L'ÉVOLUTION : LA CONNEXION CHROMOSOMIQUE
Il est possible de montrer que l'homme partage ses chromosomes, support de l'hérédité, avec l'ensemble des mammifères, et d'utiliser les différences, d'espèce à espèce, pour reconstruire leur phylogénie, c'est-à-dire leurs positions respectives dans l'arbre de l'évolution. L'étude qui sera basée sur des approches de cytogénétique classique et moléculaire, utilisant des sondes spécifiques de chromosomes humains, appliquées à une centaine de primates et une centaine de mammifères appartenant à d'autres ordres comme les carnivores, les rongeurs, les artiodactyles etc. Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que l'on connaît, de notre grand ancêtre mammalien, beaucoup mieux les chromosomes que la morphologie. Cette reconstitution d'une centaine de millions d'années d'évolution des chromosomes amène à poser des questions sur les mécanismes de la spéciation, l'origine des ordres de mammifères et celle de l'homme, l'origine de certaines pathologies, séquelles de notre propre évolution et à proposer des règles montrant que l'évolution n'est pas aléatoire.
Transcription de la 5ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 5 janvier 2000 par Bernard Dutrillaux
Origines et position de l'Homme dans l'évolution: la connexion chromosomique
Un même caryotype, c'est-à-dire un même lot de chromosomes, est partagé par 99 % de la population humaine. Les variations, qui touchent donc 1 % de la population peuvent être considérées comme des modifications récentes et sans avenir, puisque liées à des pathologies ou des difficultés de procréation. Des conclusions semblables s'appliquent à un grand nombre d'espèces, et en particulier aux gorilles et aux chimpanzés, qui nous sont proches. Ainsi chaque espèce, ou presque, possède un caryotype qui lui est propre, mais cela ne signifie pas que tous les chromosomes diffèrent d'une espèce à l'autre. Ainsi l'homme partage 12 chromosomes avec le chimpanzé, 10 avec le gorille, 12 avec l'orang-outang, 5 avec le macaque, 2 avec le singe capucin et plus aucun avec les lémurs et les mammifères non primates. Pourtant, lorsqu'on analyse les structures chromosomiques, avec les moyens les plus fins possibles, il est possible de montrer que la quasi-totalité du matériel chromosomique est conservé entre l'homme, le lapin, l'écureuil, le bœuf, le chat etc. Seule varie l'organisation de ces structures. Cela démontre que nous avons tous des ancêtres communs, qui ne sont pas si éloignés de nous à l'échelle de l'évolution. Comparant les structures chromosomiques, soit par des méthodes faisant apparaître des bandes, soit par études de réplication de l'ADN, il est aujourd'hui possible de reconstituer, assez exactement le caryotype de l'ancêtre de tous les mammifères placentaires, dits euthériens. Ainsi, les chromosomes de cet animal, qui a vécu il y a quelques 100 millions d'années sont beaucoup mieux connus que tout autre de ses caractères. Une reconstitution des événements chromosomiques peut être réalisée, permettant l'établissement d'un arbre évolutif. Cette phylogénie chromosomique, progressivement établie à partir des années 70, n'a jamais été démentie, et a souvent permis de réajuster certaines interprétations. Quelles sont donc les informations que l'on peut y puiser ?
Dans un premier temps nous verrons comment les progrès techniques en cytogenétique, l'étude des chromosomes, ont permis à partir d'une information, qui il y a quelques années encore était relativement modeste, d'arriver à obtenir finalement beaucoup de données non pas sur les gènes mais sur leur support.
Après avoir exposé comment on peut observer les structures chromosomiques, nous les utiliserons progressivement pour comparer nos chromosomes à ceux de beaucoup d'autres espèces. Le caryotype représente l'ensemble des chromosomes d'une espèce. Nous reconstituerons les caryotypes ancestraux d'espèces qui nous ont précédé voici - 5 à 10 millions, - 30 millions, - 50 millions d'années et environ - 100 millions d'années d'évolution. Une fois reconstitué ce qu'étaient les chromosomes de nos lointains ancêtres, nous ferons le chemin inverse pour comprendre comment les chromosomes se sont différenciés, et comment situer notre propre espèce parmi les primates. Enfin nous aborderons les conséquences de cette évolution en terme de pathologie.
Commençons par un rappel sur l'ordre des primates. Les primates comprennent les singes, les humains et les pré-singes ou prosimiens. Les prosimiens sont représentés par les lémuriens de Madagascar, plus de 30 espèces, et d'autres prosimiens qui vivent en Afrique et en Asie, soit au total, environ 60 espèces.
Les simiens ou singes proprement dit plus les humains, comprennent deux infra ordres : les singes du nouveau monde ou plathyrrhiniens, environ 60 espèces, et les catharrhiniens, environ 70 espèces. L'ensemble des primates comprend donc près de 200 espèces.
Le travail qui a été réalisé sur les chromosomes a consisté à comparer les caryotypes, donc les chromosomes, d'une centaine de ces espèces de primates, soit près de la moitié des espèces vivantes. Certains groupes ayant les mêmes chromosomes, ils n'ont pas été étudiés systématiquement. Cette étude sur les chromosomes et l'évolution des primates est aujourd'hui encore la plus détaillée qui ait été développée sur la phylogénie de l'Homme et de toutes les espèces qui lui sont plus ou moins proches.
Le génome humain, l'ensemble de nos caractères héréditaires, est porté par l'ADN qui comprend un milliard de nucléotides ou unités du code génétique. Le nombre de nos gènes serait d'environ 100 000. Il y a 46 chromosomes chez l'Homme soit 23 paires. Chaque individu reçoit un chromosome pour chaque paire de son père et de sa mère. Chaque chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN. Un chromosome moyen par conséquent va contenir
3 000 à 4 000 gènes. Les structures qu'on peut faire apparaître sur les chromosomes, les bandes, comprennent en moyenne une centaine de gènes. C'est donc l'évolution du support matériel des gènes et non des gènes eux-mêmes que l'on va suivre.
Commençons par des aspects techniques. Les 100 000 gènes humains sont contenus dans le noyau de chaque cellule. Lorsque les cellules se divisent on voit apparaître des chromosomes au niveau du noyau. Il a fallu attendre jusqu'en 1956 pour parvenir à compter les 46 chromosomes qu'il y a chez l'Homme.
Pour cela il a fallu faire de la culture de cellules. À la fin des années 50, a été mis au point l'étalement sur lame de verre de tous les chromosomes permettant de les analyser, après avoir fait gonfler les cellules par un choc hypotonique.
Les techniques utilisées autour des années 60 consistaient à prendre des photos dont on découpait les chromosomes pour les reclasser grossièrement en fonction de la taille. L'étape d'après a consisté à faire apparaître des bandes sur les chromosomes. Ces bandes permettent d'appairer les chromosomes, car elles sont identiques sur les deux chromosomes de la même paire.
Le perfectionnement de ces méthodes a permis d'observer un ensemble de 1000 structures chromosomiques, très conservées durant l'évolution des mammifères. Nous allons suivre les modifications de position de ces structures soit d'un chromosome à l'autre, soit à l'intérieur d'un même chromosome.
D'autres techniques permettent de mettre en évidence par fluorescence, un gène donné sur un chromosome. Dans ce cas, un petit fragment d'ADN est utilisé comme sonde moléculaire et est hybridé sur le chromosome. Ainsi, lors de la comparaison des chromosomes d'une espèce à l'autre, il sera possible de rechercher si les gènes se trouvent là où on les attend par rapport à la structure chromosomique.
Il est également possible d'utiliser non plus le gène comme sonde moléculaire mais un chromosome. Suite à une hybridation in situ, tout le chromosome sera fluorescent.
Il y a une telle conservation du matériel génétique au cours de l'évolution qu'il est possible d'utiliser la sonde d'un chromosome humain donné et de l'hybrider sur une cellule d'un individu d'une autre espèce et ainsi savoir d'emblée que ce chromosome correspond au chromosome humain testé. Par exemple, le chromosome 3 humain a été utilisé comme sonde pour l'hybrider sur une cellule de macaque. Un seul chromosome est colorié, donc tous les composants du
chromosome 3 humain se trouvent sur un seul chromosome chez le macaque et tous les composants de ce chromosome étaient présents chez nos ancêtres communs avec le macaque il y a 30 millions d'années.
Une autre amélioration permet à la fois d'observer les bandes et de réaliser l'hybridation in situ.
Revenons au marquage en bandes chromosomiques. La comparaison d'un demi caryotype d'Homme et d'un demi caryotype de chimpanzé permet d'observer que des chromosomes sont tout à fait semblables et d'autres sont un peu différents. Ces différences sont dues à des cassures-fusions ou remaniements de chromosomes. Ainsi, une inversion correspond à la cassure d'un chromosome en deux points et à une rotation de l'ensemble qui sera rabouté. Une inversion péricentrique a lieu autour du centromère, qui est un peu comme le moteur du chromosome. Une inversion est dite paracentrique lorsque les cassures sont du même côté du centromère. Une translocation correspond à l'accrochage d'un fragment de chromosome sur un chromosome d'une autre paire. Ces types de remaniements se retrouvent au cour de l'évolution. Le matériel reste globalement présent mais les structures chromosomiques vont s'échanger, ou se remanier à l'intérieur d'un même chromosome.
Il existe ainsi une douzaine de remaniements qui vont séparer les chromosomes de l'Homme et du Chimpanzé. Des résultats équivalents sont obtenus lors de la comparaison du caryotype de l'orang-outan avec celui du chimpanzé, du gorille ou de l'homme. Ainsi en terme de remaniements des chromosomes, nous sommes à peu près équidistants du gorille, du chimpanzé et de l'orang-outan, de même que ces animaux sont à peu près équidistants entre eux.
Ces comparaisons nous amènent à reconstituer un caryotype ancestral selon le principe dit de parcimonie. Si 2, 3 ou 4 espèces ont exactement le même chromosome, on considère que leur ancêtre commun avait le même chromosome. C'est l'hypothèse la plus simple. Par exemple le chromosome 6 est partagé entre l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et l'Homme. Donc, l'ancêtre commun à ces animaux et à nous-même avait déjà ce chromosome. Le dernier ancêtre commun au chimpanzé, au gorille et à l'Homme a vécu il y a - 5 à 10 millions d'années. L'orang-outan s'est séparé avant. Nous pouvons reconstituer, par les bandes et les sondes chromosomiques, le caryotype de l'ancêtre commun au macaque et à l'Homme. Ceci nous ouvre le possibilité de comparer toute la branche des cercopithèques environ 60 espèces africaines et asiatiques, ce que nous avons fait.
Nous avons aussi étudié une trentaine d'espèces de singes du nouveau monde (platyrrhiniens) et reconstitué des points communs pour dresser leur caryotype ancestral commun. Il s'agit du caryotype d'un animal qui a vécu il y a une cinquantaine de millions d'années.
Pour savoir si ces reconstitutions sont exactes, il est très intéressant de comparer le caryotype reconstitué pour un groupe à celui d'un autre groupe. S'il y a des erreurs, les caryotypes doivent être très différents. À l'inverse, si les reconstitutions sont correctes, les caryotypes ancestraux devraient se ressembler. Les chromosomes du demi caryotype hypothétique de l'ancêtre commun aux plathyrrhiniens et du microcebus murinus, un prosimien, se ressemblent, d'où l'idée que des chromosomes identiques étaient présents chez l'ancêtre des simiens et des prosimiens.
Le même type de travail a été fait chez les carnivores et a conduit à un caryotype ancestral commun. La comparaison avec celui des platyrrhiniens a mis en évidence des similitudes et des différences s'expliquant par des inversions et des translocations.
La comparaison des chromosomes d'édentés, de l'ancêtre des carnivores, de l'ancêtre des plathyrrhiniens, de l'ancêtre des prosimiens, et de rongeurs a montré qu'il y a beaucoup de segments chromosomiques communs, mais aussi des différences. Ceci a permis de reconstituer le caryotype d'un ancêtre commun aux mammifères placentaires qui vivait il y a une centaine de millions d'années.
Ces comparaisons de caryotypes et ces caryotypes ancestraux permettent de reconstituer la phylogénie des espèces. La reconstitution de cette évolution chromosomique est basée sur la modification de la position des structures chromosomiques ou bandes. Chaque chromosome est une sorte de chapelet qui a évolué un peu pour son propre compte. En comparant l'évolution de chacun, il s'agit de trouver un schéma unique dans l'évolution.
Le principe peut être expliqué à partir d'un exemple où 5 modifications chromosomiques différencieraient le caryotype de 2 espèces de celui de leur ancêtre commun [figure 1].
Le premier chromosome est le même chez l'espèce A et l'espèce B mais est différent de celui du chromosome de l'ancêtre, qui est supposé connu.
Le chromosome 2 est modifié chez l'espèce A mais pas chez l'espèce B.
Le chromosome 3 est modifié chez l'espèce B mais pas chez l'espèce A.
Le chromosome 4 est modifié mais différemment à la fois chez l'espèce A et chez l'espèce B. Enfin, le chromosome 5 est modifié mais différemment à la fois chez l'espèce A et chez l'espèce B et la modification de B est intermédiaire entre l'ancêtre est celle de A.
Reporté sur un même schéma, nous constatons, que la modification du chromosome 1 est nécessairement sur un tronc commun avec celle du 5a. Celle du 2 est sur la branche de A et celle du 3 est sur celle de B, etc. Ainsi pourra-t-on reconstituer un schéma unique d'évolution.
Les caryotypes des primates comprennent 20 à 72 chromosomes et il y a plusieurs dizaines d'espèces. L'une des difficultés qui est apparue est que l'évolution ne fonctionne pas selon un schéma dichotomique. La dichotomie, la division simple, est une vision de l'esprit. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Une espèce ne naît pas d'un seul coup à partir d'une autre. Le plus souvent un remaniement va être partagé par deux espèces proches mais un autre sera partagé par l'une des deux et une troisième. L'embranchement n'est pas simple et il faut imaginer un tout autre système qui est une évolution en réseau. Qu'en est il lorsqu'on considère l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan ?
La comparaison des remaniements chromosomiques entre l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan conduit à un schéma par chromosome qui est pratiquement toujours différent de celui du chromosome précédent. Chaque chromosome a évolué pour son propre compte, comme les gènes [figure 2]. Il s'agit d'intégrer tous ces schémas dans un seul [figure 3].
La puissance de la cytogénétique réside dans le fait qu'elle considère l'ensemble du génome, l'ensemble des chromosomes, et qu'elle doit fournir des schémas cohérents avec toutes les observations. C'est une difficulté dans l'analyse mais un très gros avantage pour la qualité du résultat final. Il n'empêche que cette évolution n'est pas aussi simple qu'on l'aurait aimé. La comparaison de l'Homme, des deux espèces de chimpanzé, du gorille et de l'orang-outan, montre que trois remaniements sont communs au chimpanzé et à l'homme et qu'ainsi le chimpanzé est l'espèce la plus proche de l'homme. Néanmoins, trois autres remaniements sont partagés par le gorille et le chimpanzé. Pour conserver l'idée d'une évolution dichotomique, il faudrait imaginer qu'il y a eu convergence et que par hasard, dans cette partie de l'arbre de l'évolution, trois mêmes remaniements sont survenus dans deux branches différetes [figure
3.a]. Il est certain que cette interprétation n'est pas satisfaisante. L'autre interprétation [figure 3.b] est exactement la réciproque et elle n'est pas non plus très satisfaisante.
Ce qui est effectivement satisfaisant c'est d'arriver à un schéma où chaque remaniement n'est survenu qu'une fois [figure 3.c] avec des branches propres à chaque espèce. L'évolution a lieu dans une population, et ce n'est que progressivement à l'intérieur de cette population que sont localisées telles et telles anomalies chromosomiques. Une mutation apparaît dans une population et elle va se répandre comme l'onde d'une goutte qui tombe dans l'eau. Une autre mutation apparaît ailleurs dans la population et se répand de la même façon. Dans la population vont se créer des sortes d'hybrides avec deux mutations ou deux remaniements. Ainsi l'évolution ne marche pas d'un seul coup. Il n'y a rien de merveilleux qui permette qu'une espèce se forme à partir d'une autre en une génération.
Dans le schéma général [figure4], les cercopithèques représentent un exemple d'évolution en réseau. Pour qu'un phénomène de spéciation de ce type puisse se produire, il doit y avoir des hybrides, puisque des formes chromosomiques sont distribuées dans différentes branches de l'évolution. Cette théorie se vérifie sur le terrain puisque certains cercopithèques arboricoles vivent en groupes plurispécifiques. Dans la journée, des observateurs ont décrit des groupes formés de trois espèces différentes. La morphologie du mâle dominant était celle d'un hybride. Ces espèces se nourrissent en groupe et vivent ensemble toute la journée, mais le soir les animaux de chaque espèce vont dans un seul même arbre. Chaque matin le mâle dominant rameute tout le monde.
Notre ancêtre euthérien possédait environ 60 chromosomes, l'approximation portant sur quelques micro-chromosomes dont l'identification reste incertaine. Ces chromosomes ont été transmis tels quels aux ordres naissants de mammifères. De la sorte, il est impossible de proposer une filiation entre les ordres, aucune modification commune à deux ou plusieurs ordres n'étant repérée pour l'instant. Ces constatations mènent aux conclusions suivantes :
(1) à l'origine se trouvait une population de mammifères aux multiples potentialités évolutives, un peu comme la cellule à l'origine d'un individu est totipotente et susceptible de donner une descendance de plus en plus spécialisée pour former les tissus et organes qui le constituent ;
(2) à partir de cette population s'est créé un buissonnement, chaque tronc naissant étant rattaché à la base ;
(3) chaque émergence, à l'origine des futurs ordres de mammifères, s'est faite sans grand bouleversement des chromosomes. Cette dernière conclusion n'étaye pas certaines hypothèses imaginant une origine cataclysmique des mammifères soumis à des conditions extrêmes de climat et de radioactivité.
A ce stade, nous sommes donc à plus ou moins 100 millions d'années de l'hominisation, et le tronc évolutif qui nous rattache à nos racines paraît aussi banal que ceux rattachant les autres ordres de mammifères. Ce tronc est commun à tous les primates, et peu de modifications chromosomiques surviendront avant un premier clivage d'où naîtront deux groupes :
(1) les prosimiens [à droite sur la figure 4], surtout représentés par les lémurs de Madagascar et d'autres taxons africains et malaisiens. Ceux-ci se séparent de nous définitivement ;
(2) les simiens [à gauche sur la figure 4], ou singes proprement dits.
A nouveau, un tronc commun se forme pour tous les simiens. Peu de remaniements chromosomiques y surviennent, avant une seconde bifurcation majeure, séparant les futurs singes de l'ancien monde ou catarhiniens (CAT), auxquels nous sommes rattachés de ceux qui deviendront les singes du nouveau monde au platyrrhiniens (PLA). A nouveau, ces derniers se séparent irrémédiablement de nous. Prend alors naissance, vers -50 millions d'années un tronc commun à tous les catarhiniens, dans lequel s'accumulent de nombreuses modifications chromosomiques. Ceci suggère qu'une longue période s'est écoulée, durant laquelle beaucoup d'espèces se seraient formées et n'auraient donné comme descendance à long terme que nos propres lointains ancêtres. On s'attendrait à ce que de nombreux fossiles jalonnent cette longue période, mais ce n'est pas le cas. Une autre interprétation est donc possible, comme la survenue d'une période de forte instabilité, durant laquelle de multiples modifications chromosomiques se seraient produites sans association directe avec un phénomène de spéciation. Survient enfin un fait notable, vers -30 millions d'années : la séparation entre les ancêtres des cercopithécoïdes et des hominoïdes, mais à nouveau, il faudra que plusieurs remaniements chromosomiques s'installent pour parvenir à l'étape des derniers ancêtres des uns et des autres. Plus de soixante espèces se formeront chez les cercopithécoïdes, une dizaine chez les hominoïdes. Chez ces derniers, les gibbons se sépareront d'abord, puis l'orang-outang. Un dernier tronc commun mènera aux ancêtres que nous partageons avec les chimpanzés (il en existe 2 espèces) et le gorille. Ainsi, nous sommes, au plan évolutif, beaucoup plus proches des chimpanzés et du gorille que ces derniers ne sont proches de l'orang-outang. Nos ancêtres étaient donc des Pongidae, et ont subi les mêmes contraintes que ceux des grands singes actuels, du moins jusqu'à une date très récente. Pourtant, l'homme prolifère tandis que les grands singes disparaissent. Certes, l'homme a une responsabilité dans cette disparition, et c'est très regrettable, mais cette disparition ne peut lui être totalement imputée. Les aires de distribution de ces animaux ont toujours été limitées, et leur densité probablement toujours faible.
Ces animaux ont une faible capacité de reproduction. La raison en est leur grande taille, associée à leur longue période d'immaturité. Comme nous, un Pongidae n'est pubère que vers l'âge de 13 ans et n'a qu'un petit à la fois. Les femelles allaitent pendant 3 ans, ce qui entraîne une stérilité, de sorte que l'espace entre deux grossesses est de cinq ans en moyenne. Dans la nature, l'espérance de vie n'étant guère plus que 25 ans, cela ne laisse le temps que pour trois grossesses par femelle. Nos ancêtres Pongidae ont donc probablement vécu en populations réduites, ce qui expliquerait la difficulté de trouver des fossiles jalonnant l'histoire de nos lointains ancêtres. L'explosion démographique humaine, très récente à l'échelle de l'évolution, s'explique par notre organisation sociale, mais nous payons encore quelques tribus à notre évolution chromosomique. Le plus sérieux est la trisomie 21, ou mongolisme, mais pas comme cela a été avancé naguère, parce qu'elle marque un retour vers l'état simien. Cette affection est due à la mauvaise transmission du 21, qui est le plus petit de nos chromosomes. Il s'est formé voici 30 à 50 millions d'années, et s'est réassocié à d'autres chromosomes chez tous les Cercopithecoïdes et tous les gibbons sauf un, mais ni chez les Pongidae ni chez l'homme. Cette réassociation, ou translocation, formant un grand chromosome dont la trisomie est incompatible avec la vie, a débarrassé ceux qui la portent de la trisomie 21 [figure 5].
Cette translocation, avant qu'elle ne passe en 2 copies (état homozygote), comme pour tous les chromosomes, doit nécessairement exister en une seule copie (état hétérozygote). Ceci entraîne une période à haut risque d'aberrations chromosomiques [figure 6], comme on l'observe aujourd'hui, chez les femmes porteuses d'une telle translocation. Cet état hétérozygote, qui réduit considérablement la descendance, est éliminé et ne permet pas le passage à l'état homozygote si la fertilité est réduite. Ainsi, l'accroissement de taille, associé à une puberté tardive et à l'espacement des grossesses, est responsable d'une fertilité réduite et probablement du maintien du chromosome 21, et de sa trisomie. Celle-ci, qui ne touche qu'un descendant sur
700, ne constitue pas un facteur sélectif à l'échelle de l'évolution. Par contre, elle constitue une affection redoutée, que notre société n'a pas encore appris à gérer. La trisomie 21 n'est qu'un exemple parmi d'autres affections dont les racines se trouvent dans l'origine de nos chromosomes.
VIDEO canal U LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LA THÃORIE DE L'ÃVOLUTION |
|
|
| |
|
| |

LA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION
Le but de la communication est de fournir quelques repères pour apprécier les implications des assertions, anciennes et modernes, sur le ""pouvoir de la sélection"". L'on rappellera d'abord la signification des déclarations de Darwin sur le ""pouvoir prédominant"" de la sélection, en les situant par rapport à la conception philosophique qu'il avait du statut épistémologique du principe de sélection naturelle. Dans un second temps, l'on examine deux genres de critiques récentes qui ont été adressées à l'approche darwinienne de l'évolution, et correspondant aux deux acceptions précédemment définies de l'expression ""pouvoir de la sélection"" . Il s'agira donc de comprendre ce que signifie la référence constante de la théorie de l'évolution au nom de Darwin depuis maintenant cent quarante années. L'identification d'un champ scientifique par un nom propre, sur une aussi longue durée, a quelque chose d'exceptionnel dans la science moderne, et demande à être éclaircie.
Texte de la 16ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 16 janvier 2000 par Jean Gayon
La théorie de l’Évolution : Que signifie “ darwinisme ” aujourd’hui ?
L’idée d’une transformation des espèces dans le cours des temps géologiques remonte à la fin du dix-huitième siècle. Le nom de Lamarck est à juste titre souvent mentionné comme une étape capitale dans la maturation de cette idée. Toutefois il n’est guère possible de parler d’une théorie de l’évolution avant Darwin. Si le livre publié en 1859 par Darwin sous le titre L’Origine des espèces a tant marqué les esprits, c’est entre autres parce que ce livre était entièrement consacré à présenter, en 490 pages, une théorie consistant à justifier l’idée que les espèces descendent les unes des autres en se modifiant, et à expliquer le processus indéfiniment continué de modification des espèces par une hypothèse que Darwin appelait
“ sélection naturelle ”.
Après Darwin, de nombreuses théories concurrentes ont été proposées. Mais il est clair que le sort de la théorie de l’évolution est demeuré associé au nom de Darwin plus qu’à tout autre. En témoigne l’importance exceptionnelle, dans tous les débats sur l’évolution de la fin du dix- neuvième siècle et de la totalité du vingtième siècle, du mot “ darwinisme ”. Les spécialistes de l’évolution pourraient sans doute aujourd’hui se dispenser de toute référence à Darwin. Cependant ils ne le font pas, ni dans leurs discussions savantes, ni face au public. L’on ne peut être qu’impressionné par l’insistance avec laquelle les débats généraux les plus récents sur l’évolution ont été formulés et appréciés dans un langage qui fait explicitement référence à l’auteur de L’Origine des espèces. En particulier, depuis le milieu des années 1970, l’on a vu fleurir une littérature considérable sur des alternatives possibles au “ néodarwinisme ” et, corrélativement une littérature non moins abondante sur la vitalité de celui-ci.
Cette référence persistante d’une discipline scientifique bien établie à un individu constitue une situation assez exceptionnelle dans l’histoire de la science contemporaine. Je me propose de clarifier le sens de cette référence. Que signifie, aujourd’hui, pour un(e) biologiste de l’évolution de se dire “ darwinien ” ou “ non-darwinien ? En répondant avec précision à cette question, j’espère contribuer, en tant que philosophe, à une meilleure compréhension de l’état actuel de la théorie de l’évolution, et de ce que cela signifie, précisément, que ce soit une
“ théorie ”. Je montrerai en particulier que les critiques modernes du darwinisme peuvent se ranger en deux grandes catégories, que je forge à partir des réflexions philosophiques spontanées de Darwin lui-même sur le statut du principe de sélection naturelle.
1. Critères d’évaluation
Le darwinisme est une tradition de recherche qui, en tant que telle, ne peut être identifiée avec la pensée de Darwin prise en bloc. Nombreuses sont les idées de Darwin qui n’ont pas grand rapport avec ce que l’on entend aujourd’hui par “ darwinisme ”. Par exemple la théorie darwinienne de l’hérédité, ou théorie de la “ pangenèse ” implique la forme la plus radicale d’hérédité des caractères acquis qui ait jamais été proposée. Elle n’est “ darwinienne ” qu’au sens où elle a été soutenue par Darwin. Mais elle n’a rien à faire aujourd’hui avec les débats sur la validité de ce qu’on appelle communément le “ darwinisme ” en théorie de l’évolution.
Pour comprendre le sens de la référence des évolutionnistes à Darwin, il convient de construire une hypothèse sur la nature de la relation entre le modèle (Darwin) et la copie (darwinisme). C’est ce que fait plus ou moins intuitivement tout évolutionniste qui fait usage
1
des qualificatifs “ darwinien ” et non-darwinienne ”. Je crois cependant que l’on peut introduire un peu plus de rigueur en la matière qu’on ne le fait d’ordinaire, et qu’il n’est pas aberrant d’explorer l’hypothèse selon laquelle il y a une réelle continuité entre certains éléments de la pensée évolutionniste de Darwin, et le darwinisme d’hier et d’aujourd’hui. À la différence de la plupart des savants de la fin du dix-neuvième siècle que plus aucun savant ne lit sauf s’il s’intéresse à l’histoire des sciences, Darwin n’a cessé d’être republié et lu tout au long du vingtième siècle par de nombreux biologistes. Il n’est donc pas aberrant de penser qu’il existe un rapport causal objectif entre le texte darwinien et le “ darwinisme ”.
Les réflexions spontanées de Darwin sur le statut philosophique du principe de sélection naturelle peuvent nous aider à cerner la nature de ce rapport. Darwin a utilisé trois termes pour qualifier le statut philosophique de la sélection naturelle: “hypothèse”, “théorie”, et “pouvoir”. Les deux premiers se rapportent à la justification de la sélection naturelle. Le troisième intervient dans des contextes différents, et concerne la signification causale de la sélection naturelle.
La distinction entre “ hypothèse ” et “ théorie ” de la sélection naturelle est exprimée dans La Variation des animaux et des plantes sous l’action de la domestication (1868), où le naturaliste s’efforce de répondre aux savants et philosophes qui avaient mis en doute la scientificité de la démarche darwinienne dans L’Origine des espèces :
“ Dans les recherches scientifiques, il est licite d’inventer une hypothèse quelconque; si celle- ci explique de grandes classes de faits indépendants, on l’élève au rang de théorie bien établie.
On peut envisager le principe de sélection naturelle comme une simple hypothèse, rendue cependant probable par ce que nous savons positivement de la variabilité des êtres organiques à l’état de nature, de la lutte pour l’existence, de la préservation quasiment inévitable des variations qui s’ensuit, et de la formation analogique des races domestiques.
Or cette hypothèse peut être testée – et c’est là à mon sens la seule manière honnête et légitime d’aborder la question dans son ensemble – en examinant si elle explique plusieurs grandes classes de faits indépendants, tels que la succession géologique des êtres organiques, leur distribution dans les temps passés et présents, leurs affinités mutuelles et leurs homologies. Si le principe de sélection naturelle explique bien ces grands ensembles de faits, elle doit être acceptée ”. (Darwin [1868] 1972, vol. 7, p. 9 ; nous soulignons).
La précision philosophique de ces propos doit être soulignée. Darwin était bien informé sur le vocabulaire technique de ce que l’on commençait à appeler à l’époque la “ philosophie des sciences ”, tout particulièrement la philosophie des “ sciences inductives ”. Ce vocabulaire lui permet de présenter la structure argumentative de L’origine des espèces avec une remarquable clarté, ce qu’il n’avait pas fait de manière explicite dans l’ouvrage de 1859.
Lorsque Darwin parle de la sélection naturelle comme une “simple hypothèse” rendue probable par certaines classes de faits, il pense aux cinq premiers chapitres de L’origine, où la sélection naturelle est donnée comme la conclusion d’un raisonnement fondé sur une série de prémisses ayant valeur de généralisations empiriques (taux de reproduction des organismes, limitation des ressources, faits de variation et d’hérédité). Il faut aussi noter l’allusion à la “formation analogique des races domestiques”. Celle-ci n’est pas à proprement parler une prémisse de l’argument que nous venons d’évoquer ; la sélection artificielle a valeur de
2
modèle expérimental analogique, destiné à convaincre le lecteur de l’efficacité du processus de sélection dans la modification des espèces.
La “théorie bien établie” de la sélection naturelle fait référence à la seconde moitié de L’origine des espèces (Chap. 7-12), où la sélection joue le rôle d’un principe qui explique diverses classes de faits indépendants (extinction, divergence, distribution géographique des espèces, affinités morphologiques, embryologie comparée). De là résulte une seconde stratégie de justification de la sélection naturelle, une justification par les conséquences de l’hypothèse, autrement dit par sa capacité explicative.
Il y a ainsi pour Darwin deux niveaux de justification de la sélection naturelle. Le premier consiste en arguments qui rendent plausible plausible l’existence du processus de sélection naturelle. Ceci est d’autant plus important que L’Origine des espèces ne fournit aucune preuve directe d’un quelconque cas de sélection naturelle ; il n’a d’ailleurs été possible de construire de manière satisfaisante une telle preuve directe avant la fin des années 1940, soit près d’un siècle après la parution de L’Origine. Le second niveau de justification est fondé sur le pouvoir explicatif et unificateur de l’hypothèse. Le diagramme représenté sur la figure 1 récapitule la double stratégie de justification de l’hypothèse de sélection naturelle.
Cette méthodologie est conforme à la stratégie newtonienne traditionnelle de confirmation des hypothèses. Celle-ci repose sur l’idéal de la vera causa, la cause “vraie et non fictive”, suggérée par des données empiriques, et confirmée par les phénomènes indépendants qu’elle explique. Darwin était conscient d’avoir composé L’Origine des espèces en référence à cette conception de la science, très en vogue chez les physiciens du milieu du dix-neuvième siècle. Il en avait pris connaissance dans lesquels Herschel et Whewell l’avaient exposée. Cette période correspond au à celle dans laquelle Darwin a formé l’hypothèse de sélection naturelle (Hull 1973, Kavaloski 1974, Ruse, 1975).
Le troisième terme philosophique employé par Darwin pour qualifier le statut de la sélection naturelle est celui de pouvoir. Il utilise fréquemment ce terme, synonyme traditionnel de ceux de “ cause ” ou d’“ agent ”, pour signifier la capacité quasi illimitée de la sélection naturelle à améliorer l’adaptation des organismes à leur environnement. Voici deux extraits illustrant l’idée que la sélection a un pouvoir transformateur illimité :
“ On peut dire que la sélection naturelle scrute à chaque instant et dans le monde entier, les variations les plus légères ; elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles ; elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l’occasion s’en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d’existence organiques et inorganiques ” (Darwin 1859 : 84).
Dans le chapitre conclusif de L’Origine, l’on trouve une formule encore plus forte, qui renforce donne prise à la critique, souvent adressée à Darwin par ses contemporains, selon laquelle il aurait remplacé le Dieu providentiel de la théologie naturelle par la sélection :
“ Quelle limite pourrait-on fixer à ce pouvoir agissant continuellement à travers les temps, et scrutant rigoureusement la constitution, la conformation et les habitudes de chaque créature, pour favoriser ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais ? Je ne peux concevoir aucune limite à ce pouvoir qui adapte lentement et admirablement chaque forme aux relations les plus complexes de la vie. Même si l’on ne regardait pas au delà, la théorie de la sélection naturelle me paraît en elle-même probable ” (Darwin 1859 : 236).
3
Au delà de l’effet rhétorique, quel est le sens précis des déclarations de Darwin sur le “pouvoir prédominant” (paramount power) de la sélection ? L’ouvrage de 1868 sur La Variation fournit les formules les plus précises :
“ J’ai parlé de la sélection comme d’un pouvoir prédominant, quoique son action dépende absolument de ce que nous appelons par ignorance la variabilité spontanée ou accidentelle... Les variations de chaque créature sont déterminées par des lois fixes et immuables. Mais ces lois n’ont aucun rapport avec la créature vivante qui résulte graduellement du pouvoir de la sélection, que ce pouvoir soit naturel ou artificiel... Bien que la variabilité soit absolument nécessaire, il nous suffit d’observer des organismes complexes et remarquablement adaptés pour comprendre que la variabilité est dans une position subordonnée par rapport à la sélection ”. (Darwin [1875] 1972, vol. 8 : 426).
La thèse du “ pouvoir prédominant ” de la sélection consiste à dire que celle-ci est la force principale qui oriente le changement des espèces. Darwin ne dit jamais d’ailleurs que la sélection naturelle est la seule force qui accomplit le changement évolutif. Il y en a d’autres, comme la variation spontanée, les corrélations de croissance, l’effet d’usage et de non-usage. Mais la sélection naturelle intervient donc comme un facteur régulateur a posteriori, capable par là même de l’emporter sur les autres facteurs de variation, sur lesquels il s’appuie.
La thèse du “ pouvoir prédominant ” de la sélection, en dépit de sa formulation emphatique, ne porte que sur un aspect particulier de la théorie, l’explication du changement adaptatif. Bien que cette thèse soit essentielle à Darwin, elle ne doit pas être confondue avec la représentation de la sélection comme principe unificateur et explicatif de l’histoire naturelle de la vie dans son ensemble. La modification adaptative est une chose; l’extinction, la distribution géographique des espèces, leur diversité, les rapports entre embryologie et évolution en sont une autre (Cf fig. 1).
En quoi les catégories philosophiques spontanées de Darwin nous aident-elles à comprendre les querelles sur la vitalité ou l’obsolescence du darwinisme dans l’évolutionnisme
4
contemporain ? Nous pouvons nous autoriser à durcir une distinction qui, sans être pleinement claire chez Darwin, n’y est pas moins présente. Il convient en effet de distinguer la capacité explicative de la sélection naturelle, et ce que Darwin appelait le “ pouvoir ” de la sélection. La thèse du “ pouvoir prédominant ” de la sélection concerne les adaptations : les adaptations sont l’effet causal immédiat du processus de sélection. En revanche, les extinctions, la divergence, la distribution stratigraphique fossiles, l’allure générale de la classification des êtres vivants, sont des effets indirects, et plus ou moins lointains, de la sélection naturelle. Ces phénomènes illustrent pour Darwin la capacité explicative de l’hypothèse de sélection naturelle, sa capacité à rendre intelligibles et unifier tous les aspects de l’histoire de la vie, l’adaptation des organismes n’étant que l’aspect le plus immédiat de cette histoire.
Cette distinction entre capacité explicative du principe de sélection et pouvoir causal immédiat de la sélection suggère un classent des défis contemporains au darwinisme, que nous allons maintenant examiner.
2. Classification des critiques du darwinisme
Depuis les années 1970, deux catégories majeures de critiques ont été formulées à la théorie synthétique de l’évolution, c’est-à-dire à la forme moderne du darwinisme. La première consiste à contester que la sélection naturelle ait la capacité d’expliquer toutes les classes de faits invoquées par Darwin. L’on déniera par exemple que la sélection naturelle suffise à expliquer les extinctions, ou l’allure de la documentation fossile (en particulier ses lacunes), ou encore les rapports entre embryologie et évolution. Ce genre de critique a été particulièrement développé dans le contexte de la paléobiologie. Mais les critiques émanant de la biologie du développement et de la morphologie relèvent souvent du même esprit. Il s’agit fondamentalement de récuser des modèles explicatifs qui demandent trop au principe de sélection naturelle. Ces critiques visent la structure globale de ce que Darwin appelait la “théorie” de la sélection naturelle, sa prétention explicative, et son pouvoir d’unification de l’histoire naturelle de la vie.
L’autre genre de critique consiste à contester que la sélection naturelle ait un pouvoir illimité et permanent d’amélioration des adaptations. Est alors visé ce que Darwin appelait le
“ pouvoir prédominant ” de la sélection.
2.1 Critiques portant sur la capacité explicative de la sélection naturelle
La plupart des critiques depuis les années admettent que la sélection naturelle est une explication satisfaisante des adaptations, mais n’est pas un principe suffisant, ni même parfois pertinent pour expliquer telle ou telle autre grande classe de phénomènes évolutifs.
Les débats des trente dernières années sur la macroévolution ont été un lieu privilégié de ce genre de critique. Le cas le plus simple est sans doute celui des extinctions. Les travaux de David Raup, résumés dans un livre de synthèse paru en 1991, nous serviront ici de cas exemplaire.
L’interprétation darwinienne classique des extinctions dit schématiquement ceci : à mesure que la sélection naturelle transforme les espèces en vertu d’une concurrence entre individus, certaines espèces se révèlent être moins efficaces que d’autres dans cette course à l’adaptation ; ces espèces voient leurs effectifs se réduire, tandis que d’autres envahissent leur niche écologique. L’extinction résulte donc principalement de facteurs biotiques (concurrence inter-spécifique). Raup ne conteste pas que l’extinction des espèces ne soit explicable de cette
5
manière dans beaucoup de cas. Mais il refuse que toutes les extinctions, en particulier les extinctions de masse, s’expliquent ainsi. Avec d’autres paléontologues et physiciens, il a proposé d’expliquer les extinctions de masse par des perturbations brutales de l’environnement physique – par exemple la collision de la Terre avec des météorites de grande taille – donc par des facteurs non biotiques. Le phénomène de l’extinction est alors expliqué par des causes qui ne tiennent pas d’abord à la concurrence entre les espèces, ou plus généralement à leurs interactions écologiques.
Cette interprétation a défrayé la chronique. Je ne la mentionne que pour bien situer la nature du défi adressé au darwinisme. Raup déclare qu’il ne conteste pas “la sélection naturelle de Darwin”. Celle-ci, dit-il, demeure la seule explication possible des adaptations. Mais la sélection ne saurait à elle seule produire les extinctions de masse, ni la diversification des formes qui a en a résulté, du fait de la libération de niches écologiques qui en résulte. Dans le schéma de la fig. 1, Raup refuserait donc de faire figurer deux des “ boîtes ” figurant en bas du diagramme (extinction et divergence).
À partir de cet exemple, il est facile de comprendre le sens d’autres proclamations non darwiniennes. La divergence des espèces, et les patrons phylogénétiques ont été des cibles préférées des paléobiologistes ouvertement “ non-darwiniens ”. La théorie des équilibres ponctués (Eldredge & Gould 1972) est fondamentalement dirigée contre une vision de l’histoire de la vie qui dérive la cladogenèse et l’allure générale de l’arbre de la vie de la seule sélection naturelle. Des critiques semblables sont souvent formulées par des spécialistes de la mécanique du développement et de la morphologie. L’on fait alors valoir des contraintes de développement, voire des lois de l’organisation, qui rendraient intrinsèquement insuffisante toute théorie de l’évolution qui chercherait à subordonner l’ensemble des phénomènes à l’action graduelle de la sélection naturelle (cf. par ex. Goodwin 1984). La théorie neutraliste de l’évolution moléculaire relève aussi d’un même esprit. Elle ne conteste pas que la sélection naturelle explique la genèse des adaptations, mais soutient qu’au niveau moléculaire (en particulier au niveau de l’ADN), la majorité des mutations sont neutres, et se trouvent éliminées ou fixées par la dérive génétique aléatoire (Kimura 1968).
2.2. Critiques portant sur le pouvoir adaptatif de la sélection
Les critiques du pouvoir adaptatif de la sélection naturelle sont relativement plus rares dans la littérature évolutionniste moderne. Elles étaient en revanche les plus fréquentes au début du siècle, lorsque par exemple les néo-lamarckiens proposaient une autre explication de la genèse des adaptations, ou lorsque les mutationnistes déniaient que la sélection naturelle eût le pouvoir de modifier graduellement les espèces. À l’heure actuelle, c’est surtout dans le domaine de la biologie théorique que l’on trouve une critique organisée de l’idée du pouvoir adaptatif de la sélection naturelle.
L’un des exemples les plus spectaculaires d’un discours sur les limites de ce pouvoir adaptatif s’observe dans l’œuvre de Stuart Kauffman. Dans son livre The Origins of Order (1993), Kauffman développe deux grands arguments visant à montrer que la complexité impose de sérieuses limites au pouvoir adaptatif de la sélection naturelle. D’une part certaines propriétés des systèmes vivants, qu’il nomme génériques, apparaissent spontanément en vertu de leur complexité intrinsèque, quelles que soient les contraintes, et en particulier les pressions sélectives qu’on leur applique. Ainsi, le rapport entre le nombre de types cellulaires dans un organisme et le nombre de gènes présents dans un organisme semble se conformer à une loi de même forme algébrique dans tous les organismes (le nombre de types cellulaires croît
6
comme la racine carrée du nombre de gènes). Toutefois la plupart des “propriétés génériques” ou “universaux biologiques” sont caractérisées de manière plus formelles. D’autre part, Kauffman soutient que, passé un certain degré de complexité, il y a de sérieuses limites à la capacité de systèmes soumis à sélection d’évoluer vers un plus haut niveau de fitness (ou
“ valeur sélective ”), ou même de se maintenir à un certain niveau. L’idée de base est que certains degrés de connectivité dans le génome (boucles de rétroaction entre gènes de régulation) sont plus favorables que d’autres à l’action de la sélection.
Il existe d’autres voies ouvertes à la critique du pouvoir adaptatif de la sélection naturelle. Les généticiens des populations ont développé un certain nombre de modèles visant à montrer la naïveté de l’idée selon laquelle la sélection naturelle a un pouvoir d’accroissement quasi automatique de la valeur adaptative des populations. Même en l’absence de facteurs susceptibles de contrecarrer l’action de la sélection (par ex. dérive aléatoire), un processus de sélection naturelle peut avoir pour effet de diminuer la fitness d’une population. C’est le cas par exemple dans des modèles décrivant l’évolution d’une population dans laquelle sont mis en concurrence des gènes déterminant un comportement égoïste et un comportement
altruiste : dans les plus simples de ces modèles, la sélection conduit à la diffusion des gènes égoïstes, et simultanément à la diminution de la fitness globale de la population. Par delà ce cas légendaire, qui rappelle un mode de raisonnement familier aux économistes, la génétique des populations a développé de nombreux modèles théoriques dans lesquels la sélection a pour effet non d’accroître, mais de diminuer la valeur adaptative globale d’une population.
3. Conclusion
Depuis près de trente ans, un débat récurrent sur la validité du “ Darwinisme ” s’est développé, qui a engendré beaucoup de confusion. Parfois la théorie synthétique de l’évolution, autrement dit la version moderne du “ néodarwinisme ” est visée. D’autres fois, la critique porte sur une strate plus ancienne, ou plus récente de l’évolutionnisme d’inspiration darwinienne.
Le darwinisme, en vertu de sa désignation même, est un processus historique. Rien n’implique a priori que ce terme ait recouvert des engagements théoriques homogènes. L’on peut néanmoins faire le pari que la référence obsessionnelle des biologistes de l’évolution à Darwin a une certaine cohérence conceptuelle. C’est dans cet esprit que j’ai proposé un critère simple pour évaluer les proclamations darwiniennes et anti-darwiniennes. Il y a deux manières d’être non darwinien. L’une est de contester le schéma de reconstruction de l’histoire naturelle proposé par Darwin, et de refuser la position hiérarchique que celui-ci confère au principe de sélection dans l’interprétation de l’ensemble des faits qui constituent ensemble l’histoire de la vie. C’est ce genre de critique qui a été le plus commun depuis les années 1970. En général, il ne conduit pas les auteurs à contester que la sélection naturelle soit une explication valide de la genèse des adaptations. L’autre manière d’être non-darwinien est de contester l’universalité du pouvoir adaptatif de la sélection. Dans les décennies qui ont suivi Darwin, ce fut la ligne d’attaque la plus commune contre Darwin ; l’on opposait alors à la sélection naturelle d’autres explications de la genèse des adaptations, comme l’hérédité des caractères acquis. Une telle contestation de l’hypothèse de sélection entraînait évidemment, par ricochet, la contestation de la sélection naturelle comme principe unificateur de l’histoire naturelle de la vie dans son ensemble. Aujourd’hui, la critique du pouvoir adaptatif de la sélection est devenue rare dans la communauté des biologistes, en particulier chez les naturalistes de terrain. Elle est l’affaire de théoriciens soucieux de dissoudre l’évidence apparente du concept de sélection, mais pas forcément de contester la place qui lui est
7
reconnue par les naturalistes de terrain.[Cette communication résume quelques arguments développés dans Gayon 1990, 1994, 1995, 1997a, 1998.]
Il y aurait une autre manière d’envisager les querelles récurrentes pour et contre Darwin. Le mot “ darwinisme ” ne renvoie pas seulement, en effet, à des débats internes à l’histoire de la biologie. Depuis ses origines, il a été associé à de larges ans de la culture contemporaine (en particulier : économie, politique, philosophie, religion). C’est là, assurément, un facteur majeur de la popularité du mot. Je n’ai pas traité de cet aspect important de la question. Il est en vraisemblable, en réalité, que chez les biologistes eux-mêmes, les débats pour et contre Darwin sont en partie canalisés et entretenus par des controverses qui vont au delà de leurs querelles théoriques spécialisées. Cet aspect familier de la question ne doit pas faire oublier cependant la dimension proprement théorique des querelles sur le darwinisme. Dans le contexte d’un développement sans précédent des biotechnologies, les débats théoriques sur l’évolution, avec leur charge passionnelle propre, sont là pour nous rappeler qu’aujourd’hui comme hier, la science n’est pas seulement un ensemble de recettes pratiques, mais une tentative pour rendre intelligible la nature, tentative indéfiniment ouverte, et légitimement polémique.
Références
Darwin, C., 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of favoured Races in the Struggle for Life. London: Murray. (Facsimile : Cambridge: Harvard University Press, 1964).
Darwin, C. [1875] (1972). The Works of Charles Darwin, vol. 7-8, The Variation of Animals and Plants under Domestication [2nd ed.]. New York, AMS Press.
Gayon J., 1990. Critics and Criticisms of the Modern Synthesis : the Viewpoint of a Philosopher”. Evolutionary Biology, 24: 1-49.
Gayon J., 1994. What does “Darwinism” mean ? Ludus vitalis , 2: 105-118.
Gayon J., 1995. Neo-Darwinism, in Concepts, Theories, and Rationality in the Biological Sciences, The Second Pittsburgh-Konstanz Colloquium in the Philosophy of Science, G. Wolters, J.G. Lennox, P. McLaughlin (eds.), Universitätsverlag Konstanz & University of Pittsburgh Press, pp. 1-25.
Gayon J., 1997. The paramount power of selection: From Darwin to Kauffman, in Structures and Norms in Science, Xth International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science—Florence, August 1995, M. L. Dalla Chiara, K. Doets, D. Mundici, J. van Benthem (eds.), Dordrecht, Kluwer, pp. 265-282.
Gayon J., 1998. Darwinism’s Struggle for Survival—Heredity and the Hypothesis of Natural Selection. Cambridge, Cambridge University Press. [éd. angl. révisée de Darwin et l’après- Darwin, Paris, Kimé, 1992].
Goodwin B., 1984. Changing from an evolutionary to a generative paradigm in Biology, in Evolutionary Theory: Paths into the Future, J.W. Pollard, New York (ed.), New York, Wiley, pp. 99-120.
Hull, D., 1973. Darwin and his Critics. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. Kauffman S.A., 1993. The Origins of Order: Self-Organization and Selection. New York and Oxford, Oxford University Press.
Kavaloski, V.C., 1974. The vera causa principle: a historico-philosophical study of a metatheoretical concept from Newton through Darwin. University of Chicago:
Ph. dissertation.
Kimura, M., Evolutionary Rate at the Molecular Level. Nature, 217 : 624-626.
8
Raup, D. 1991 Extinction. Bad Genes or Bad Luck?. New York, Norton and Company). Trad. fr : De l’extinction des espèces — Sur la disparition des dinosaures et de quelques milliards d’autres, trad. par M. Blanc, Paris, Gallimard, 1993.
Ruse, M., 1975. Darwin’s debt to philosophy: an examination of the influence of the philosophical ideas of John F.W. Herschel and William Whewell on the development of Charles Darwin’s theory of evolution. Studies in History and Philosophy of Science, 6: 159- 181.
VIDEO CANAL U LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LES FAMILLES ANIMALES |
|
|
| |
|
| |
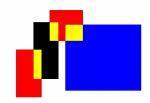
LES FAMILLES ANIMALES
Les discussions sur la famille se restreignent en général à des familles exclusivement humaines. Jusqu'où peut-on étendre la notion de famille sans qu'elle explose ? Une véritable phylogenèse de la famille s'est exprimée chez de multiples espèces animales dans des systèmes d'une très grande diversité. La question des familles animales doit cependant moins servir à illustrer des lieux communs qu'à les mettre en difficulté. Une colonie de fourmi, par exemple, peut-elle être considérée comme une famille monoparentale ?
Dans cette perspective, les familles qui se composent d'agents d'espèces différentes attirent l'attention. Les Gardner, qui ont enseigné un langage symbolique à des chimpanzés en les intégrant à leur famille parlaient de « cross-fostering families» dans lesquelles des membres d'une espèce éduquent les petits d'une autre espèce. Plus répandues qu'on ne l'imagine chez l'animal (y compris en y incluant des humains comme on a pu le voir avec les enfants loups), les familles polyspécifiques constituent plutôt la norme que l'exception chez l'humain. Jusqu'où la famille humaine peut-elle donc ainsi s'étendre et se recomposer avec du non humain et est-elle si différente des principes fondamentaux
Les discussions sur la famille se restreignent souvent à des familles exclusivement humaines. Jusqu'où peut-on étendre la notion de famille sans qu'elle explose ? Une véritable phylogenèse de la famille s'est exprimée chez de multiples espèces animales dans des systèmes d'une très grande diversité. La question des familles animales doit cependant moins servir à illustrer des lieux communs qu'à les mettre en difficulté. Une colonie de fourmi, par exemple, peut-elle être considérée comme une famille monoparentale ? Dans cette perspective, les familles qui se composent d'agents d'espèces différentes attirent l'attention. Les Gardner, qui ont enseigné un langage symbolique à des chimpanzés en les intégrant à leur famille parlaient de « cross-fostering families» dans lesquelles des membres d'une espèce éduquent les petits d'une autre espèce. Plus répandues qu'on ne l'imagine chez l'animal (y compris en y incluant des humains comme on a pu le voir avec les enfants loups), les familles polyspécifiques constituent plutôt la norme que l'exception chez l'humain. Jusqu'où la famille humaine peut-elle donc ainsi s'étendre et se recomposer et est-elle si différente des principes fondamentaux qui régissent les familles animales ? Dans les dessins animés comme ceux de Walt Disney, il n'est pas rare de rencontrer des familles animales, copies conformes de familles américaines WASP idéalisées. Papa, maman, les enfants ; parfois les grand-parents ou les cousins, oncles et tantes. Souvent papa travaille et maman fait la vaisselle. Nul n'y cherchera bien évidemment la moindre vérité éthologique, mais on peut néanmoins se poser la question de savoir si certains animaux vivent dans des associations sociales qu'on pourrait qualifier de « familiale ». Pour éviter de heurter d'emblée les esprits forts qui sont prêts à cracher de l'anthropomorphisme au moindre faux pas, donnons-en une définition de travail préalable : on appellera « famille » un agencement particulier constitué autour d'un ou plusieurs éléments reproducteurs et composée d'individus appartenant à des générations différentes qui vivent ensemble. Indiquons donc tout de suite ce qui va m'intéresser ici ; non point tant de savoir si de telles familles existent chez certains animaux que l'extension possible de la notion de famille animale ce qui n'est pas exactement la même question. C'est moins la notion de famille qui m'intéresse ici que le verbe, encore inexistant qui est composé à partir de lui : Jusqu'où « familie-t-on » ? Jusqu'où peut-on le faire ? Peut-on introduire dans de telles familles des membres d'une autre espèce ou des artefacts ? Des familles à problèmes Si Shakespeare avait appris l'éthologie, c'est-à-dire la science des comportements animaux, il aurait trouvé une inspiration morbide chez les membres d'un certain nombre d'espèces plus ou moins connues du grand public et des psychiatres. La famille, telle que je l'ai grossièrement caractérisée dans l'introduction, tourne autour de la reproduction. Quoiqu'a priori évidente, une telle orientation est loin d'aller de soi, en particulier parce que les conditions de cette reproduction sont d'une diversité à laquelle nous ne sommes pas suffisamment accoutumée. On pense en général que cette reproduction s'effectue en effet naturellement autour d'un (ou plusieurs) couple reproducteur – en particulier un mâle et une femelle. Cette dichotomie elle-même est plus que problématique, et ces difficultés auront une importance au cours de ma discussion comme on s'en rendra vite compte. Sans rechercher la moindre exhaustivité, je veux indiquer trois problèmes : celui de savoir pourquoi il existe des mâles et des femelles, c'est-à-dire tout bonnement une sexualité ; comment on peut caractériser une femelle et enfin comment on pourrait aborder la question du genre de façon intéressante. · On peut légitimement se demander pourquoi il existe des mâles et des femelles. Evoquer mâles et femelles est d'ailleurs déjà une façon de parler un peu contestable ; à ce stade, il faudrait plutôt parler d'individus sexués et compatibles. Certains organismes ont d'ailleurs des relations sexuelles avec eux-mêmes – et ils n'ont pas disparu à tout jamais de la surface de la planète par ailleurs. Certains se portent même plutôt bien. La paramécie, qui n'est pas vraiment considérée comme une espèce en voie de disparition, recycle ses gènes à l'intérieur de son propre corps ; elle teste ainsi de nouvelles combinaisons génétiques – sans qu'aucune sexualité ne soit jamais requise en préalable. Evoquer la variation génétique pour expliquer la sexualité n'est pas aussi convaincant qu'on le dit souvent. Les individus de certaines espèces peuvent d'ailleurs échanger des gènes sans être sexués pour autant. Par ailleurs, quelques espèces le sont sans que ce que nous considérons comme étant les caractéristiques classiques du féminin et du masculin n'apparaissent clairement. Chez certaines algues, chez les bactéries ou chez les champignons, la taille des gamètes masculines est par exemple comparable à celle des gamètes féminines. · Il n'est pas très facile de déterminer la femelle. C'est la fertilisation interne qui constitue vraiment une spécificité de la femelle quand elle existe. Mais même quand le zoologue peut distinguer des mâles et des femelles, ce n'est pas toujours le cas. Poissons et grenouilles mâles se contentent ainsi de jeter un nuage de sperme sur les oeufs déposés. La fécondation interne introduit une contrainte forte supplémentaire qui conduit à une responsabilité inédite en ce sens que la femelle garde l'accès aux oeufs. Le rapport potentiel de cette femelle à ses petits est déjà très différent de celui que pourra jamais avoir le mâle. Chez de nombreuses espèces, être femelle n'est pas un statut qui est donné une fois pour toute. Au sein de plusieurs d'entre elles, la distinction en mâles et femelles ne signifie pas pour autant qu'un même individu restera toute sa vie mâle ou femelle. Il peut fusionner avec l'autre sexe jusqu'à constituer une créature sexuée quasi-asexuée. C'est le cas du poisson-grenouille mâle qui commence comme un jeune poisson de surface, en tout point semblable aux autres. Sa croissance le conduit cependant à se cramponner de façon permanente à une femelle qu'il rencontre – jusqu'à littéralement devenir une partie de cette dernière puisque les systèmes circulatoires de l'un et de l'autre finissent par fusionner et que le mâle devient totalement dépendant de la femelle. « Lisant » les messages hormonaux du sang de cette dernière, il lâche son nuage de sperme au moment ad hoc. Le mâle est ainsi devenu une pure fonctionnalité pour la femelle. · Le genre comme position dans un dispositif topologique. L'individu peut aussi revêtir simultanément les deux sexes, en endosser la spécificité de l'un un jour et de l'autre un autre jour (c'est par exemple le cas des crevettes Pandalus.), ou changer de sexe à un moment ou à un autre de sa vie, en fonction de sa propre histoire personnelle ou des circonstances auxquelles il aura été confronté. Les Labroides dimidiatus, qui sont des poissons nettoyeurs de la Grande Barrière Australienne, entrent dans cette catégorie. Dans chaque ‘station', un mâle domine une demi-douzaine de femelles. Il peut copuler une fois par jour avec chacune. Le mâle disparu, ce n'est pourtant pas un mâle voisin qui profite de l'aubaine et s'approprie le ‘harem' ainsi délaissée, mais la femelle la plus âgée qui se transforme en mâle et ‘honore' chaque jour avec virilité chacune de ses ex-consoeurs. A noter que la situation inverse existe également chez les poissons-clowns, Amphiprion, dont les mâles (qui s'occupent d'ailleurs des petits) se transforment en femelles quand la femelle dominante disparaît. Le changement de sexe présente un avantage économique certain sur l'hermaphrodisme simultané car il est coûteux de maintenir deux systèmes sexuels à la fois. Les mites du genre Pyemote font même plus étranges encore puisqu'elles ont la particularité de naître adultes. Le sexe est déterminé chez ces animaux par l'ordre de naissance. Les premiers qui arrivent deviennent des mâles qui s'empressent immédiatement de jouer les obstétriciens en insérant leurs jambes, comme des pinces, dans leurs mères pour tirer leurs soeurs... et s'empresser de copuler avec elle. Un mâle peut ainsi systématiquement renouveler cet inceste avec ses 20 soeurs. Il y a mieux. Ou pire. Chez une autre mite (Adactylium spp.), fils et filles, pour émerger, doivent commencer par manger leur mère de l'intérieur, et frères et soeurs commencent même à copuler lorsqu'ils sont encore dans la matrice de leur mère. C'est donc dans leur grand-mère même que certains de ces petits seront conçus ! On dira sans doute que chez ces créatures pour le moins primitives nous ne sommes pas encore dans le cirque familial. En vérité, qu'en savons-nous vraiment ? La famille comme topologie complexe et dynamique des sexes et des âges Les familles animales se déclinent selon une étonnante diversité. A une extrémité du spectre des possibles, on trouve par exemple les colonies de certaines espèces de fourmis. Toutes les fourmis y sont biologiquement liées entre elles puisqu'elles sont toutes les filles de la même mère (la reine) même si rares sont celles qui sont d'un même père, et tous les mâles, qui sont sans pères, sont les fils des ouvrières du nid. Les colonies polygynes (à plusieurs reines) sont plus complexes puisque des fourmis coexistant dans le même nid peuvent avoir des pères et des mères différentes. Toutes les colonies sont cependant des organisations familiales dans un sens assez classique – celui qui mêle structure sociale et structure génétique. Il est en effet audacieux de considérer que les sociétés humaines sont les seules qui soient structurées par des règles de parenté élaborées. Sur ce point, Robin Fox estimait en 1978 et à propos des primates non-humains, qu'aucune espèce ne possède des « systèmes de parenté » qui comportent les éléments des systèmes humains de parenté, combinés de la façon qui est propre à l'humain. La parenté n'est pourtant pas seulement une affaire de catégorie. R.Fox défendait une thèse précise : il suggérait que les deux piliers sur lesquels reposent les structures de parenté chez l'humain, la filiation et l'alliance, sont présents chez les singes, mais ne coexistent jamais dans le système d'une même espèce. Par conséquent, le caractère unique du système humain ne repose pas sur l'invention d'une nouveauté, mais plutôt sur la combinaison de ces deux éléments de façon à ce que le mode de filiation lui-même détermine le type d'attribution des partenaires reproducteurs, c'est-à-dire l'exogamie. Fox évoquait en particulier des études sur des macaques japonais (Macaca fuscata) et rhésus (Macaca mulatta) qui montraient que dans de nombreuses circonstances sociales, les membres d'un lignage matrilinéaire n'agissent pas entre eux comme ils le font à l'égard des non-membres. On sait aujourd'hui que le système social de quelques autres espèces que l'humain repose aussi sur la filiation et l'alliance, comme chez les chimpanzés. Fox posait néanmoins ainsi la question fondamentale de la famille : quels types d'associations permet-elle donc autour de la reproduction ? Avec qui ou avec quoi fournit-elle la possibilité d'associer qui ou quoi ? La notion même de famille fait appel à une topologie des sexes et des âges qui s'organise autour du renouvellement des membres du groupe. Elle apparaît comme un noeud fondamental par lequel s'agencent le biologique et le social autour de la reproduction de l'espèce. Ce mélange constant des affiliations et des apparentements, des filiations et des alliances qu'on observe chez de nombreuses espèces rend extrêmement difficile de penser la famille. Comme dans toute topologie, nous devons définir une proximité. Ce fut sans doute l'une des intuitions majeures de la sociobiologie qui en restreignit cependant considérablement la porté en en faisant une caractéristique purement génétique. Le philosophe canadien Michael Ruse a justement décrit le darwinisme comme une histoire de famille. Non seulement nous sommes tous cousins, mais nous sommes tous des cousins de cousins. Une telle idée doit être prise à deux niveaux. Nous n'avons pas seulement tous un ancêtre commun mais nos modes de vie sont fondamentalement familiaux. Tout être vivant est avant tout une excroissance de sa propre famille – pour le meilleur et pour le pire. Il me semble néanmoins important de la concevoir non seulement dans le contexte d'une parenté biologique mais aussi dans celui d'une parenté plus élective, qu'on pourrait appeler sociale si on veut, mais qui est certainement aussi beaucoup plus. Si on ne choisit jamais ses parents ni sa progéniture, on choisit fréquemment son conjoint. Enfin, il m'apparaît essentiel d'étendre l'espace de la famille de façon radicale. C'est précisément ce dont je veux parler dans cette conférence. Portrait d'une famille « typique » : les dauphins La structure familiale d'une espèce dépend de multiples facteurs et on peut en observer une très grande variabilité en fonction des espèces. J'ai évoqué les fourmis ; à une autre extrémité du spectre, il me semble intéressant de décrire une famille « typique » chez les mammifères, et se rendre compte que même là, de tels agencements sont plus problématiques que ce à quoi on aurait pu initialement s'attendre. On pourrait évoquer les « familles » chez les loups, les éléphants, les suricates ou les primates mais j'ai choisi l'exemple des dauphins. Chez ces mammifères marins, certaines structures sociales semblent se rapprocher beaucoup de celles des structures familiales humaines . A Sarasota, chez les dauphins Tursiops truncatus (ceux comme Flipper qui ont un nez en forme de bouteille) la famille constitue un agencement a priori très soudée. Cet agencement s'inscrit lui-même dans des associations sociales plus larges. Le taux d'émigration est très faible chez ces animaux puisqu'il concerne seulement deux à trois pour cent des animaux du groupe. Sur vingt-deux veaux femelles et seize veaux (c'est le terme consacré pour parler des petits des dauphins) mâles nés et élevés par leur mères à Sarasota, et qui ont survécu à la séparation avec la mère, tous sont restés dans la communauté. Huit de ces femelles ont donné naissance à des petits dans la communauté. Ces petits représentent la quatrième génération d'un lignage maternel observé à Sarasota par les cétologues. Les dauphins ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir adopté une organisation de ce style. On retrouve par exemple une telle philopatrie chez les orques (Orcinus orca). Chez les populations résidentes du Pacifique Nord Est (environ 289 individus en 1998), aucun individu de sexe mâle n'a quitté le groupe en vingt et un ans et aucune immigration n'a par ailleurs été enregistrée. Un aspect particulièrement intéressant de ces groupes de mammifères marins s'exprime dans des agencements familiaux très particuliers autour d'une solidarité très forte qui lie les femelles les unes aux autres. Cette solidarité des femelles à l'intérieur de la solidarité du groupe est suscitée par la nécessité dans laquelle elles se trouvent de se défendre contre les agressions, celles des prédateurs comme le requin (qui est, rappelons-le, la première cause de mortalité chez les dauphins après l'homme) mais aussi contre celle des mâles qui les harcèlent sexuellement. A Shark Bay, en Australie Occidentale la plupart des femelles appartiennent à des bandes de femelles. Les femelles solitaires restent rares car un tel choix est finalement très coûteux : la probabilité qu'un petit atteigne son développement adulte est plus forte s'il est élevé par une mère en bande que par une mère solitaire. En revanche, les femelles ne se lient pas pour défendre des ressources et les partager mais seulement pour se protéger et protéger leurs petits. Cette solidarité est familiale parce qu'elle inclut des générations différentes. Outre les mères et leurs petits, celles des orques et des globicéphales, par exemple, incluent des femelles post-reproductives, qui vivent plus de vingt ans après la naissance de leur dernier petit, et qui jouent un rôle de véritables grand-mères sociales dont la présence est plutôt rare chez les mammifères. Des données physiologiques et démographiques indiquent de façon non équivoque une ménopause . Quel est donc le rôle de ces femelles particulières ? La fonction de la ménopause elle-même est mal connue. Plusieurs explications adaptatives ont été proposées pour l'expliquer, sans qu'aucune ne soit réellement satisfaisante. L'hypothèse de l'arrêt précoce de la fécondité suggère que les femelles qui s'engagent dans un investissement maternel extensif peuvent avoir de plus grands succès reproductifs en cessant de se reproduire et en élevant de façon efficace leur dernier petit et les petits de leur propre progéniture. Ce qui sera connue sous le nom ‘d'hypothèse de la grand-mère' est proposée en 1998. Elle suggère qu'une longue vie post-ménopausale favorise l'extension du partage de nourriture entre mères et petits et permet à de plus vieilles femelles d'accroître la fertilité de leurs filles en investissant directement dans des grand enfants et d'autres membres proches de la ‘famille '. La famille comme espace d'agencements multiples et affinités électives En partant de cet exemple des mammifères marins, on comprend que la famille animale constitue une organisation sociale particulière à l'intérieur du groupe et qu'elle s'organisent autour de trois caractéristiques centrales qu'on va retrouver chez d'autres espèces de mammifères : la famille est une organisation parmi d'autres au sein du groupe, elle suscite des attachements affectifs très forts et elle fonctionne en partie comme une PME inter-générationnelle pour l'élevage et la protection des petits. · La famille est une organisation sociale parmi d'autres dans les sociétés animales. La société des femelles éléphants est complexe et en est un exemple particulièrement frappant. Elle consiste en relations qui partent du lien mère/petit et s'étendent à travers des unités familiales, des liens de groupe et des clans. Dans l'éléphant, l'unité sociale de base est composée d'une ou de plusieurs femelles adultes qui sont liées entre elles et leur petit immature. Cette unité sociale peut comprendre de un à trente individus. Ian Douglas-Hamilton note que des relations privilégiées lient certaines familles avec d'autres. Cynthia Moss montre qu'elles ne sont pas forcément apparentées. La notion de clan y a une utilité incontestable. · Des attachements affectifs très forts. Chez les espèces cognitivement les plus complexes, ce qui frappe est que la famille apparaît aussi comme un espace où se produisent des attachements d'une singulière force. L'attachement de certains animaux vis-à-vis de certains apparentés est littéralement étonnant. Les rapports mère/enfant sont particulièrement frappants de ce point de vue, comme les partages entre mères et enfants chez les chimpanzés ont été décrits pour la première fois par Jane Lawick-Goodall (1968) à Gombe. A propos des éléphants africains, Cynthia Moss a décrit l'attachement exceptionnel d'une mère pour son petit qui était né handicapé. Le lien mère/enfant n'est pas le seul à pouvoir être aussi fort. Il est intéressant de signaler à cet égard que des « lunes de miel » ont été observées entre chimpanzés mâles et chimpanzés femelles qui s'éloignent du groupe. Les données obtenues à Gombe laissent penser que les petits sont conçus pendant ces lunes de miel. Ce « romantisme » est très utile. Le père qui y trouve un avantage en s'assurant de la paternité qui en résulte . La mère craint moins la violence subséquente du mâle vis-à-vis de son petit. · La famille constitue une PME pour l'élevage et la protection des petits. Cette caractéristique qu'on a vu chez les dauphins, les chimpanzés et les éléphants se retrouvent chez de nombreuses autres espèces. Chez les coyotes de Grand Teton National Park, près de Jackson, dans le Wyoming, des coyotes aident les parents sans l'être eux-mêmes, et peuvent prendre soin des petits en défendant des territoires ou des sites de terrier ou en faisant du baby-sitting quand les parents sont partis chasser. On sait que ces aides, qui ont initialement été décrits par Alexander Skutch à propos des oiseaux, accroissent considérablement la survie de la progéniture, au moins dans leur enfance, et pas seulement chez les coyotes, mais également chez les nombreuses espèces où existe de telles associations. Dans ces agencements sociaux le mâle a souvent une position qui est très différente de celle de la femelle. Il convient cependant de rester prudent et de réaliser que tout peut changer d'une espèce à une autre. Pour revenir un peu aux primates, leur potentiel paternel est très limité, sauf chez les callitrichidés sud-américains chez qui les mâles participent aux tâches « familiales » . En règle générale, parler d'une division des tâches serait pourtant audacieux, même s'il existe souvent une complémentarité des activités. La famille comme espace dangereux Tout n'est pourtant pas rose dans la vie familiale de l'animal. J'ai évoqué la protection des petits. La situation est loin d'être simple de ce point de vue. La famille n'est pas seulement un lieu au sein duquel se multiplient affinités électives et agencements surdéterminés, mais aussi comme un espace d'évitement et d'élimination. La famille est souvent un espace dans lequel s'exprime une très grande violence entre membres d'une même fratrie et entre ceux de générations différentes. · Fratricide. Comme chez les dramaturges classiques, la famille peut être le théâtre de passions extrêmes. Racine aurait adoré les hyènes tachetées qui conçoivent habituellement des jumeaux très particuliers. Chaque bébé naît en effet avec des dents de devant pleinement fonctionnelles, longues et perforantes. Ses yeux sont ouverts, son cou et ses mâchoires très puissants. Les jumeaux qui cherchent d'emblée à mordre se tuent entre eux dans un fratricide routinier. Les attaques peuvent commencer avant même la sortie du sac amniotique. C'est parfois le cadet qui gagne, mais c'est le plus souvent le plus faible qui meurt, ayant été incapable d'avoir accès au lait de la mère. Dans la réserve de chasse Mara des Masaï, ¼ des bébés hyènes sont tués par leur frère jumeau. Toutes les rivalités entre des frères n'impliquent cependant pas des rivalités dures. Les hyènes sont particulièrement sordides, mais les conflits fratricides sont assez communs chez d'autres espèces aussi. Chez les rouge-gorges américains, des petits se positionnent eux-mêmes mieux que leurs frères pour avoir plus de nourriture de leurs parents et ils peuvent se battre à mort. Ce qui arrive aussi chez les aigles noirs, les égrettes de bétail, les grands hérons bleus et quelques autres. · Infanticide. Tuer des petits est un comportement très répandu chez de nombreuses espèces. Observé d'abord dans les années 1960, il passe alors pour un comportement anormal. Il fut d'abord suggéré que les humains qui interagissaient avec ces animaux étaient responsables de ces infanticides. La réalité est plus sordide. L'infanticide est un comportement routinier chez de nombreuses espèces de poissons, d'oiseaux et d'insectes. Pourquoi ? L'enfant devient nourriture et sa mort accélère la disponibilité sexuelle de la mère (une mère allaitante est inféconde). A Serengiti, ¼ des enfants lions sont ainsi sacrifiés par des mâles. Dian Fossey découvrit un jour le cadavre d'un bébé gorille, Godi. C'était la première trace d'infanticide qui fut repérée à Visoke. En 1989, sur 50 enfants gorilles morts, 38 % avaient moins de trois ans et 37 % au moins l'avaient été au cours d'un infanticide. On considère aujourd'hui qu'une femelle gorille a un de ses enfants tué au moins une fois dans sa vie. La majorité des enfants qui ne sont pas protégés par un silverback, par un grand mâle dominant, finissent par être tués. La femelle dont le bébé a été tué rejoint en général la troupe de son meurtrier et a un enfant avec lui. Le mâle tueur est toujours étranger à la troupe à laquelle appartient alors la mère. · Inceste. L'interdit de l'inceste existe-t-il chez l'animal ? On ne connaît quasiment aucune espèce animale qui pratique l'inceste et des accouplements consanguins réguliers dans des conditions naturelles (Bischof, 1978). Il ne s'agit pas pour autant d'interdits stricto sensu, mais plutôt de mécanismes d'évitement. Dans les sociétés polygynes, les adolescentes sont séparées de leur père à la suite de leur enlèvement par de jeunes mâles. C'est ce qui se passe par exemple chez les zèbres. Chez les babouins Hamadryas, les femelles sont mêmes kidnappées par des mâles non apparentés dès leur enfance. Dans d'autres cas, on peut sans doute parler de « castration psychologique », au cours duquel l'intérêt sexuel disparaît complètement et s'accompagne parfois de transformations somatiques correspondantes. En règle générale, l'inceste apparaît peu fréquent chez l'animal sauf chez les animaux à taux de reproduction élevé (en particulier certains parasites surtout des acariens et des vers), chez les animaux domestiques, et chez les animaux de zoo. J'ai dit que la question qui m'intéressait ici était celle des extensions de la famille. Où commence une famille et où s'arrête-t-elle ? A partir de quand commence-t-on à « familier » et au-delà de quelle limite ne « familie »-t-on plus ? Il me semble prématuré de m'engager sur la voie d'une théorie générale de la famille. La mise en place d'organisations sociales particulières (de protection et d'élimination) autour de la reproduction de l'espèce me semble être une caractérisation fonctionnelle de la famille et sa pratique se retrouve chez un très grande nombre d'espèces – ceux chez qui se perçoit précisément au moins les prémisses d'une vie familiale. On peut aller plus loin pour comprendre les nouveaux visages de la vie de famille de l'animal – car celle-ci se transforme bien évidemment aussi vite (ou presque) que la vie de famille humaine. Deux caractéristiques me semblent particulièrement importantes pour comprendre ce que pourrait signifier ce « familier » que j'invente pour l'occasion: l' identité partagée, d'une part, et les extensions matérielles de la famille, d'autre part. Identité partagée Au sein de ce complexe d'affinités et d'évitements qu'est l'espace familial, on peut considérer que se constitue une identité partagée plutôt qu'une association d'individus plus ou moins autonomes. Font partie de la famille ceux qui entrent dans le cercle de l'identité de ceux qui y participent. Nous adoptons trop souvent une définition psychologique de l'identité qui n'est pas toujours la plus fructueuse. Chaque membre de la famille n'est-il pas être un membre de soi et certains ne sont-ils pas plus membres de soi que d'autres ? Quand un individu ne peut plus vivre et se laisse mourir à la disparition d'un proche, on peut justement se poser la question. Quand les deux membres d'un couple ne se quittent plus, comme on le voit chez certains oiseaux, on peut aussi s'interroger sur l'individuation de chacun d'eux : n'est-ce pas le couple lui-même qui constitue alors l'individualité pertinente à prendre en compte ? · Etre lié jusqu'à la mort. Les associations familiales de l'animal ne sont pas seulement fonctionnelles ; elles sont souvent très émotionnelles chez les mammifères et même aller jusqu'à la mort, ce qui en constitue l'une des manifestations les plus spectaculaires. Jane Goodall a ainsi observé Flint, un jeune chimpanzé qui s'est mis à part de son groupe, a cessé de se nourrir et est mort d'un arrêt cardiaque après que sa mère, Flo, soit morte. Flint est devenue de plus en plus léthargique, a refusé la nourriture et avec son système immunitaire affaibli, s'est senti malade. Flint est resté pendant plusieurs heures près de Flo, a lutté un peu plus, s'est roulé en boule et n'a plus jamais bougé. On estime qu'entre 50 % et 70 % d'enfants gorilles orphelins captifs vont probablement mourir. La mort ne rompt d'ailleurs pas toujours le lien. Joyce Poole a également décrit très précisément comment des éléphants montrent des comportements d'attachement très forts vis-à-vis des ossements de leurs proches. · Monogamie. La prétendue monogamie de nombreux oiseaux – plus de 90 % espèces sont supposées l'être – peut être comprise comme une extension de leur identité. Des oies qui sont faiblement liées ne produisent pas autant de petits que des oies qui sont fortement liées. Chez les mouettes, les mâles et les femelle qui se retrouvent d'une année sur l'autre ont un taux de reproduction plus élevé…L'amour « romantique » peut également être inféré de la tristesse profonde que les individus montrent quand leur partenaire sexuel disparaît ou meurt. Certaines oies mâles ne copulent plus après la disparition de leur partenaire sexuel. Elles agissent comme si elles ne pouvaient surmonter cette épreuve. Des familles aussi fusionnelles que celles qui viennent d'être décrites paraissent symbiotiques par essence. J'ai déjà dit que la famille était un noeud entre le biologique, le psychologique et le social. Se pourrait-il qu'elle mime comportementalement des symbioses plus franchement biologiques ? Ces questions conduisent naturellement à se demander ce qui distinguerait vraiment la famille de formes plus biologiques de symbioses. Un élément de réponse se trouve dans la façon dont les divers éléments des agencements en cause sont liés les uns aux autres. La symbiose peut être caractérisée comme une relation rigide, dont les agencements constitutifs s'expriment toujours de la même façon, autour de la stabilité de l'espèce. La famille est plutôt constituée d'agencements en équilibre constant. La famille est une fragilité qui se constitue autour de la reproduction de l'individu. La symbiose est un verrou, alors que la famille est une serrure. La symbiose est appelée à rester fermée alors que la famille tend constamment à s'ouvrir. Pourquoi n'éclate-t-elle donc pas constamment ? Parce qu'elle s'inscrit dans une matérialité qui la lie et qui est constamment sous-estimée. Extensions matérielles de la famille Comme nous restons avec une conception très « walt disneyenne » de la famille, nous négligeons ce qui pourrait constituer des extensions matérielles de la famille. Sans doute à tort. Le nid fait-il partie de la famille de l'oiseau ? Le terrier fait-il partie de celle du renard ? Le territoire fait-il partie de celle du loup ? Qu'il faille peut être prendre le nid de l'oiseau comme extension matérielle de la famille est une idée qui m'est venue à la suite d'une observation de Bernd Heinrich (1999) qui était arrivé à la conclusion que c'était l'état du nid du corbeau plutôt que la condition de la femelle qui conduisait à l'accouplement. Le nid joue donc un rôle majeur dans un comportement qui n'engage a priori que le mâle et la femelle. A la suite de cette prise de conscience, d'autres comportements, abondamment commentés mais toujours très étonnants, ont pu prendre une signification éclairante. Les oiseaux à berceaux de Nouvelle-Guinée qui font des nids remarquables pour attirer les femelles, font plutôt ces nids comme faisant déjà partie de la famille qu'ils veulent constituer avec la femelle. Plutôt que de choisir une habitation à son goût, la femelle choisirait alors une famille à sa convenance, chacune ayant des caractéristiques matérielle qui lui sont propres. Ces comportements sont d'ailleurs non seulement génétiquement déterminés mais de surcroît culturellement acquis, comme le dialecte des oiseaux. Durant une longue adolescence, les oiseaux à berceau de plusieurs espèces prennent beaucoup de temps à observer des adultes qui construisent des berceaux. Leurs premières constructions sont très rudimentaires. Ce n'est qu'avec l'entraînement qu'ils deviennent plus experts en construisant et en décorant leurs berceaux . Le nid fait vraiment partie de la famille. De la même façon, le territoire du coyotte fait partie de la famille. Un mâle observé par Marc Bekoff, Bernie, est resté pendant trois ans dans sa meute pour aider à élever des petits. Bernie ne pouvait pas se reproduire quand son père était présent et aider tenait lieu de substitut à la reproduction. Quand son père a quitté la meute, Bernie a hérité du territoire de la meute, et a copulé avec une femelle qui a rejoint la meute après que la mère de Bernie soit partie. Bernie et sa partenaire ont reçu de l'aide pour l'élevage de ses petits de ceux dont Bernie s'était auparavant occupés quand ils étaient petits . Portrait de l'humain comme ‘pater-familias universel'. La matérialité de la famille et le rôle de l'identité partagée qu'elle suscite et autour de laquelle elle se constitue sont importants parce que ces ingrédients manipulés conduisent parfois à d'étonnantes recompositions familiales. Plus que jamais, les questions de savoir qui fait partie de la famille et où passent les frontières de la famille acquièrent une actualité d'autant plus troublantes que ces frontières s'avèrent très largement manipulables. La question de l'extension de la famille de l'animal s'avère particulièrement intéressante quand l'humain entre en jeu. Les expériences sur les « singes parlants » qui ont commencé vraiment aux USA dans les années 1960 ont poussé très loin ces pratiques en conceptualisant l'idée initialement exprimée par les Gardner de la « cross-fostering family » - la famille dans laquelle les membres d'une espèce élèvent les petits d'une autre espèce. Dans ces situations qui sont propres aux cultures occidentales, les humains élèvent vraiment les petits d'autres espèces, puisqu'il ne s'agit pas seulement de les aider à vivre mais également leur permettre de pénétrer dans le monde du symbolique à travers la maîtrise d'un authentique langage. La véritable « vie de famille » que constituent ces communautés hybrides homme/animal de partage de sens, d'intérêts et d'affects ne surgit pas de nulle part . Elle s'inscrit au contraire dans une tendance très profonde de l'histoire du vivant qui a cependant été très largement négligé par les historiens de la culture. La domestication peut être vue, fondamentalement, comme une manipulation très efficace des familles animales par l'humain et l'animal de compagnie est sur-domestiqué. L'historien James Serpell en défend la pratique contre ses détracteurs qui trivialisent ou dénigrent les relations affectives qu'hommes et animaux peuvent entretenir dans notre culture. Ces sarcasmes, il est vrai, profitent d'un terrain mal connu et peu fréquenté. Pourquoi les pratiques de l'animal de compagnie ont-elles reçu si peu d'attention en sciences sociales ? Aux USA, par exemple, il y a autant de chats et de chiens que de postes de TV, et les gens tendent à traiter leurs animaux familiers comme s'ils étaient leurs enfants. On a évoqué le parasitisme social à propos de ces relations. Comme les coucous. Il faudrait plutôt dire que l'humain a une propension profonde à jouer un rôle de « parent honoraire » vis-à-vis de nombreuses espèces animales, en s'occupant de petits animaux vis-à-vis desquels ils se sentent investis des mêmes responsabilités que vis-à-vis de leurs petits enfants, et vis-à-vis desquels ils ont un engagement affectif proche. Ces pratiques peuvent même atteindre une intimité parfois étonnante comme dans le cas de ces femmes qui sont décrites par l'ethnologue Jacqueline Millet et qui allaitent au sein des petits animaux qu'elles ont recueillis ou que les hommes du village ont ramenés de leurs chasses en forêts. L'universalité de ces pratiques, qui constituent la norme plutôt que l'exception chez les chasseurs-cueilleurs problématique. L'adoption d'animaux de compagnie n'est pas un phénomène rare chez de nombreux peuples autour du monde. Au 19e siècle, le naturaliste Bates, qui voyage en Amazonie, envoie à Galton une liste de 22 espèces de quadrupèdes dont il a observé l'apprivoisement dans les campements indiens. Les Guyanais nourrissent de nombreux animaux comme leurs propres enfants. Les Caraja du Brésil du sud-est sont pareillement dévoués à leurs enfants et à leurs animaux favoris. Les indiens Kalapalo du Brésil se spécialisent dans l'apprivoisement de l'oiseau avec lesquels ils entretiennent des rapports spéciaux. Les femmes sont les principaux apprivoiseurs d'animaux de compagnie, mais certains hommes, en particulier les chamans, s'y impliquent également avec une virtuosité remarquable. On cite même des cas où des indiens amazoniens traitent leurs animaux familiers ou leur volaille avec plus d'attention que leurs propres enfants. Quant aux Dayacks de Borneo et aux Indiens subarctiques, ils incluent ces animaux dans un système de nomination dans lequel les parents sont appelés d'après l'un de leurs enfants. La représentation occidentale moderne de la famille n'a aucun monopole. Il serait faux de conclure à la facilité des procédures mobilisées à partir de la multiplicité des exemples relevés. Ces agencements homme/animal s'appuient sur des manipulations parfois extrêmement subtiles. Pour ne donner qu'un seul exemple, les Fulani d'Afrique sont connus pour la façon dont ils utilisent leur connaissance des signaux de dominance du bétail et les comportements d'affiliation des animaux qui le composent pour s'introduire eux-mêmes dans les troupeaux comme dominants sociaux et leaders . La domestication pourrait-elle fondamentalement être comprise comme un phénomène d'extension de la sphère familiale au-delà de l'espèce ? Les historiens de la domestication se demandent encore comment l'humain a commencé à domestiquer les premiers animaux et pourquoi une telle pratique est devenue si courante. Je ferais l'hypothèse qu'il faut chercher ce phénomène extraordinaire dans les dérives de la famille. Ces animaux qui sont justement appelés familiers se sont tout simplement introduits dans les familles humaines et ces dernières leur ont donné une place au sein de leurs familles. Le chat de la famille, comme on dit, est d'abord un chat de famille. C'est parce que l'animal est un animal de famille qu'il peut étendre cette dernière à l'humain. Rappelons-nous que deux caractéristiques de la famille animale m'ont semblées particulièrement importantes : l'identité partagée, d'une part, et ses extensions matérielles, d'autre part. Nous les retrouvons totalement dans la domestication. Celle-ci inclut en effet une matérialité qui fait partie de la famille (comme la laisse, la niche ou le panier) et le partage d'identité est ce qui frappe tout observateur extérieur d'un couple homme/animal. « Docteur, nous avons mal au ventre », dit la dame en amenant son chien chez le vétérinaire. On peut certainement sourire de cette confusion des genres, mais on peut surtout se demander s'il n'y a pas là quelque chose de très vrai qui est le fait qu'à force de vivre ensemble, le chien et sa maîtresse ont fini par partager une « identité communiquante ». Je n'ai pas rappelé les bases biologiques de la famille pour rien. Elles me semblent toujours tout aussi importantes pour expliquer pourquoi un animal et un humain peuvent devenir si attachés l'un à l'autre – et pourquoi l'arrivée d'un enfant dans la famille peut être perçue comme une menace ou un concurrent direct par l'animal. Même dans le cas des animaux d'élevage intensif, une telle responsabilité ne laisse pas l'homme insensible, comme l'a très bien montré un film récent de Manuela Frasil. Les humains ne se contentent d'ailleurs pas d'introduire des animaux non humains dans leur propre famille ; ils manipulent de surcroît les familles animales elles-mêmes. Les chiens de berger, comme les patous, qui doivent protéger les moutons contre les loups sont élevés avec les moutons avec lesquels « ils font famille ». Ces chiens se croient moutons et communiquent de façon privilégiée avec les ovins qu'ils doivent garder. Ouverture J'ai suggéré que de nombreux animaux étaient beaucoup plus sensibles à une topologie des procédures qu'à une psychologie sensu stricto – et que les familles animales constituaient des noeuds auxquels l'animal était particulièrement attentif. L'éthologue Konrad Lorenz s'est rendu célèbre à la suite de ses expériences sur l'empreinte. Pour Lorenz, l'oie ou le canard par exemple, sont prêts à reconnaître comme mère le premier mobile qu'ils rencontrent à condition toutefois que cet événement se produise au cours d'une fenêtre temporelle très précise de quelques heures ou moins. Tout le monde a vu ces célèbres images sur lesquelles on voit l'éthologue barbu adopté comme mère par les petits canards ou les petites oies. L'éthologue fait d'ailleurs si bien partie de la famille que l'oiseau devenu pubère cherchera à s'accoupler avec … des éthologues barbus ! Et c'est bien protection, affection et identité que l'animal recherche avec l'humain avec lequel il vit. Les expériences de Lorenz sont assez troublantes, parce qu'elles suggèrent non seulement que n'importe qui peut faire partie de la famille de l'animal, mais que n'importe quoi peut également être adopté de cette façon à condition d'être au bon moment au bon endroit. Les agencements homme/animal, sans être pour autant symétriques, sont néanmoins réversibles. C'est ce que montrent à l'envi les histoires d'enfant-loups, et plus généralement d'enfants humains adoptés par des familles animales. L'écrivain anglais Rudyard Kipling a popularisé la figure de l'enfant-loup avec Mowgli, le héros du « Livre de la Jungle ». Ce n'est pas seulement une belle histoire. L'anthropologue belge Lucienne Strivay a fait une remarquable étude historique des enfants loups . A-t-on jamais observé des enfants-loups vivant dans leur famille exotique ? Pas à ma connaissance. Il existe en revanche un tel témoignage, très intéressant et peu connu, de l'explorateur Jean-Claude Armen, à propos d'un enfant humain qui a été adopté par des gazelles qui constituaient sa famille au Sahara Espagnol. L'un des aspects les plus intéressants de l'enfant-gazelle concernait son « engazellement », c'est-à-dire son appropriation des caractéristiques comportementales des gazelles qui l'avaient recueilli. Le petit d'homme, pour parler comme Kipling, se déplaçait par bonds puissants, flairait constamment autour de lui, cou tendu face au vent, avec un nez constamment agité de petits soubresauts entraînant le troupeau à sa suite ou au contraire se laissant entraîner par le troupeau. Il reniflait en permanence « le flanc des bêtes, des brindilles, des bouts d'épineux, des fleurs, des baies, des dattes tombées, des billes de crottin, des traces d'urine » – et même l'arrière-train des gazelles ! Ce n'est pas tout. Jean-Claude Armen décrit en détail comment l'enfant-gazelle frémissait également « des oreilles et du cuir chevelu au moindre bruit suspect ou insolite, muscles tendus et spasmodiques » - comme une authentique gazelle. Le jeune garçon communiquait de surcroît avec ses compagnes herbivores comme elles, par « souffles, rots, petits cris et surtout signes de tête ou de pattes ». Plus tard, et après de plus longues observations, Armen affine sa perception de la complexité des communications qui liaient l'enfant aux gazelles : coups de talons ou de sabots frappés, torsion de col, coups de tête, remuements rythmés de queue, d'oreilles, de cornes, de poignets ou de doigts. Il se roulait comme elles dans des dépressions argileuses pour se protéger de la chaleur et du soleil. Il coupait même sur une paroi verticale de rocher un chou du désert d'un coup de dents arasées d'herbivore. Enfin, il participait avec les autres gazelles à tous ces signes d'affection qui liaient les animaux les uns aux autres : flairements, échanges de coups de langue rapides, « susurrements ». Et quand tombait le crépuscule, l'enfant s'endormait sous le cou d'une grande gazelle. Même endormi, il se « gazellifiait » d'ailleurs : il frémissait des oreilles malgré un sommeil profond, dressait la tête au moindre bruit insolite, humait les alentours, les paupières mi-closes. Tout ne relevait cependant pas de l'imitation. L'enfant gazelle avait des caractéristiques inconnues de ses compagnes. Il grimpait à quatre « pattes » sur des palmiers-dattiers. Inversement, nombre d'expressions humaines semblaient lui faire totalement défaut. Il ne pleurait pas, il ne riait pas, et il ne se mettait pas en colère
… J'ai insisté sur les transformations comportementales et physiologiques de l'enfant qui vivait dans une famille de gazelles. C'est un point qui me semble essentiel. Nous avons souvent tendance à considérer que les « familles » animales sont purement biologiques alors que les familles humaines seraient essentiellement sociales et culturelles. Je pense que les unes et les autres sont à la fois biologiques (toute famille se constitue autour de la reproduction de l'individu, même si on peut constituer des associations très familiales qui n'ont pourtant rien à voir avec la famille) et sociales, et que c'est l'une des raisons qui rendent si difficile toute caractérisation de la famille. L'animal domestique lui-même, celui qui entre dans la famille de l'homme, subit d'importantes transformations biologiques. Une sélection sur de nombreuses générations peut encore accentuer les différences. Les travaux de l'éthologue hongrois Adam Miklosi sur le chien le montrent amplement. Comparant les capacités cognitives du loup et du chien, il met en évidence la capacité de ce dernier à pouvoir communiquer avec l'homme par l'intermédiaire d'échanges visuels et de signes gestuels qui restent hors de porté du premier. Le chien, conclut-il, a été sélectionné pendant des centaines d'années pour devenir un bon interlocuteur de l'homme. J'ai commencé cet exposé en rappelant quelques bizarretés de la reproduction chez l'animal, et la difficulté à trouver une explication satisfaisante à l'apparition de la sexualité et sur les formes étonnantes qu'en prend parfois l'expression chez certaines espèces. Il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler les conditions de la reproduction. Celles-ci sont sans aucun doute biologiques, mais elles sont également et fondamentalement sociales et matérielles même chez l'animal. Les familles hybrides homme/animal sont incontestablement reproductives, à cette différence près, mais somme toute assez secondaire, du point de vue qui m'intéresse, que cette reproduction s'établit peu entre l'homme et l'animal. Je dis peu et non qu'elle ne s'établit jamais, non pas parce que je veux choquer les âmes sensibles ou faire de la provocation, mais parce que l'humain joue souvent un rôle non négligeable dans la reproduction de l'animal – ce qui est normal puisqu'il fait partie de la famille. Dans le contexte des sexualités baroques de l'animalité, l'invention de la famille telle que je l'ai caractérisée apparaît comme une étape significative et le passage par l'humain n'est pas aussi absurde qu'on aurait pu initialement le croire mais en constitue au contraire une extension somme toute assez raisonnable. La famille reconstituée serait plutôt la norme que l'exception, et dans une extension beaucoup plus radicale que ce qu'on était prêt à imaginer a priori. Reste à savoir jusqu'où la famille va pouvoir s'étendre. Un film récent de Steven Spielberg est intéressant de ce point de vue : AI raconte comment une machine intelligente vient s'installer dans une famille humaine sous la forme d'un enfant « parfait ». la vogue des tamagushis nous avaient déjà mis la puce électronique à l'oreille : après l'animal de compagnie, nous sommes prêts à accepter des artefacts dans le cercle familial.
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
