|
| |
|
|
 |
|
NEUROSCIENCES COGNITIVES |
|
|
| |
|
| |
LES NEUROSCIENCES COGNITIVES
LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
DE L'HOMME - ET DE LA FEMME - PRÃHISTORIQUES |
|
|
| |
|
| |
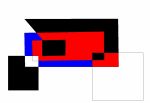
Texte de la 11ème conférence de l'Université de tous les savoirs réalisée le 11 janvier 2000 par Claudine Cohen
De l'homme (et de la femme) préhistorique
En 1883, l'anthropologue français Gabriel de Mortillet publie Le Préhistorique, une somme du savoir accumulé de son temps sur la préhistoire. Savoir tout neuf encore : seulement deux décennies plus tôt, Boucher de Perthes avait produit, aux yeux de ses contemporains d'abord sceptiques, puis émerveillés, les preuves de l'ancienneté de l'Homme, et démontré que des êtres humains avaient cohabité, en des temps dont aucune écriture n'a conservé la mémoire, avec des animaux aujourd'hui éteints - le Mammouth, l'Ours des Cavernes, le Rhinocéros laineux survivant par des froids glaciaires dans la profondeur des grottes, et armé de frustes "casse-têtes" de silex taillés.
Mortillet s'était employé à donner plus de rigueur à la science commençante, et avait classé selon un ordre typologique et évolutif les cultures humaines de cet homme, que déjà on n'appelait plus "antédiluvien". En 1865 John Lubbock avait forgé les termes de "Paléolithique" pour désigner les cultures de la pierre taillée, les plus anciennes, celles des chasseurs-cueilleurs, et "Néolithique" pour nommer les plus récentes, de la pierre polie et de la terre cuite propres aux premiers temps de la sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage.
L'étude de l'Homme préhistorique de Mortillet se nourrissait des recherches de Boucher de Perthes dans la basse vallée de la Somme, et des magnifiques découvertes de Lartet et Christy dans la vallée de la Vézère et de la Dordogne. S'inspirant de l'évolutionnisme darwinien (ou de ce qu'il croyait en savoir) il avait décrit le devenir linéaire et progressif de l'Homme et de ses cultures, depuis les primitifs bifaces de l'Acheuléen et du Chelléen, jusqu'aux industries de l'Homme de Néandertal (le Moustiérien) et aux cultures solutréennes et magdaléniennes, caractéristiques d'Homo sapiens. Cette progression de la lignée humaine culminait avec l'Homme de Cro-Magnon, un Homme semblable à nous, au front haut et à la stature robuste, découvert en 1868 dans la vallée de la Vézère. Aux racines de cette brillante lignée, Mortillet avait forgé la fiction d'un ancêtre mi-singe mi-homme, l'Anthropopithèque, auquel on attribua une petite industrie de silex éclatés trouvés à Thenay, dans le Loir et Cher, qui devaient bientôt se révéler être de vulgaires cailloux aux cassures naturelles.
Aujourd'hui, en l'an 2000, l'image de l'Homme préhistorique a beaucoup changé. Les idées sur l'évolution se sont modifiées, la Nouvelle Synthèse depuis les années 1930 a récusé l'image d'une évolution comprise comme progrès linéaire, mettant l'accent sur la variation, le buissonnement des formes, et la notion d'une histoire contingente, et imprévisible. D'innombrables découvertes ont enrichi notre vision du passé préhistorique de l'Homme, et ce n'est plus seulement dans le Loir-et-Cher, la vallée de la Somme et de la Vézère, que l'on va chercher ses origines, mais au Moyen Orient et en Europe centrale, aux confins de l'Afrique, de l'Indonésie, de la Chine...
Le regard sur la préhistoire est devenu plus directement ethnologique, et la volonté de mieux connaître dans leur réalité les premières sociétés humaines s'est marquée par de nouvelles exigences de rigueur dans les recherches de laboratoire et de terrain. Celles-ci font appel à un arsenal méthodologique nouveau - fouilles très fines, décapage horizontal des sites, remontages d'outils, méthodes quantitatives pour reconstituer la vie. La préhistoire expérimentale, par la taille et l'utilisation d'outils, en reproduisant les gestes du sculpteur ou du peintre, s'emploie à retrouver les pensées et les démarches opératoires des Hommes de ce lointain passé. Cette approche expérimentale et cognitive vise à livrer une vision plus vivante, plus vraie, plus humaine du passé lointain de notre espèce. Enfin, la vision de l'Homme préhistorique s'est diversifiée, complexifiée, et laisse aujourd'hui la place à une réflexion sur le rôle, les rôles possibles de la femme dans la préhistoire.
Généalogie d'Homo sapiens
"L'Homme descend du Singe", affirmait Darwin, et déjà Lamarck avant lui. La théorie de l'évolution, née au XIXème siècle, a conduit à penser l'origine de l'Homme, non comme création, mais comme filiation, qui enracine notre espèce dans l'ensemble du règne animal. Dès lors, reconstituer la généalogie de l'Homme, c'est réunir et tenter de donner un sens évolutif à tous ces vestiges osseux, baptisés Ardipithecus Ramidus, Australopithecus, Homo habilis, ergaster, rudolphensis, erectus, neandertalensis, sapiens... - qui dessinent, depuis le lointain de la préhistoire africaine, la constellation de nos ancêtres ; c'est interroger la configuration des événements complexes - biologiques, culturels, environnementaux - qui ont eu lieu depuis plus de 5 millions d'années.
La multiplicité des espèces d'Hominidés fossiles connues dès les époques les plus anciennes rend désormais impossible toute conception finaliste et linéaire de ce devenir. C'est un schéma arborescent, buissonnant même, qui rend le mieux compte de la profusion des espèces d'hominidés, parfois contemporaines entre elles, qui nous ont précédés. A lidée dune progression graduelle, on a pu opposer la possibilité de processus évolutifs plus soudains et contingents : ainsi Stephen Jay Gould a pu réaffirmer, après les embryologistes du début du siècle, l'importance pour l'évolution humaine de la néoténie : celle-ci consiste dans la rétention, à lâge adulte, de caractéristiques infantiles ou même fStales, qui peut faire apparaître dans une lignée des formes peu spécialisées qui seront à lorigine de groupes nouveaux. LHomme pourrait bien être un animal néoténique, et dériver dun ancêtre du Chimpanzé qui aurait conservé à lâge adulte les traits du jeune... Un des caractères particuliers de lHomme est en effet le retard de la maturation et la rétention des caractères juvéniles : ce retard se manifeste par certains traits anatomiques : régression de la pilosité, bras courts, tête volumineuse par rapport au reste du corps, gros cerveau, front redressé, régression de la face... - , mais aussi dans sa psychologie et son comportement : longue durée de léducation, goût du jeu, plasticité du système nerveux et capacité de lapprentissage jusque tard dans la vie.... L'acquisition chez l'homme de ces traits, et leur corrélation même, pourrait être explicable par un processus simple (et accidentel) du développement.
A la quête des origines de l'Homme s'est longtemps associée celle du "berceau" de l'humanité, dont Teilhard de Chardin se plaisait à dire qu'il était "à roulettes". On l'a recherché en Asie, en Europe, mais cest l'Afrique qui aujourd'hui s'impose comme le lieu d'enracinement le plus probable de la famille des Hominidés et du genre Homo. Les découvertes des hominidés les plus primitifs connus, les Australopithèques, faites d'abord en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Est conduisent à penser que le berceau de la famille des Hominidés se situe dans ces régions.
La Vallée du grand Rift africain doit elle être considérée comme le lieu d'origine le plus probable de la famille des Hominidés ? Cette thèse est débattue aujourd'hui. Il se peut en effet que les découvertes nombreuses et spectaculaires dans ces sites - ainsi, celle de "Lucy", une Australopithèque très primitive datée de 3 millions d'années, dont les restes presque complets ont été découverts dans le site de Hadar, en Éthiopie en 1974 - s'expliquent plutôt par d'extraordinaires conditions de préservation des fossiles, et des conditions géologiques particulièrement favorables à ce genre de trouvailles. Aujourd'hui, le schéma de "L'East Side Story" selon lequel les premiers Hominidés seraient d'abord apparus à l'est de la Rift Valley, après le creusement de cette faille il y a 7 millions d'années, semble devoir être révisé : une mandibule d'Australopithèque découverte par le paléontologue français Michel Brunet à quelque 2500 km à l'ouest la Rift Valley, au Tchad et contemporaine de Lucy, suggère que l'histoire humaine à cette époque très reculée met en jeu des facteurs environnementaux et comportementaux plus complexes que ceux supposés jusqu'alors. Cette découverte a fait rebondir la question du berceau de l'humanité : elle oblige à penser très tôt en termes de dispersions et de migrations, et à considérer que dès ces époques lointaines du Pliocène, il y a quelque 3 millions d'années, les Hominidés étaient déjà répandus dans une grande partie du continent africain.
Selon les constructions de la biologie moléculaire, c'est entre 5 et 7 millions d'années avant le présent qu'il faut situer l'enracinement commun des Hominidés et des Grands Singes. Les restes d'Ardipithecus ramidus, découverts en Éthiopie, ont été classés en 1994 dans un genre nouveau, que son ancienneté (4,4 millions d'années) semble situer tout près de l'origine commune des grands Singes africains et des premiers Hominidés.
Le tableau de lévolution de la famille humaine inclut de nombreuses espèces d' Australopithèques, ces Hominidés dallure primitive, au front bas, à la démarche bipède, qui ont coexisté en Afrique pendant de longues périodes et dont les vestiges sont datés entre 3,5 et 1 million d'années avant le présent.
Quant aux premiers représentants du genre Homo, ils sont reconnus à des périodes fort anciennes : à Olduvai (Tanzanie) Homo habilis, à partir de - 2,5 millions d'années, a été désigné comme le plus ancien représentant du genre auquel nous appartenons, mais il coexiste peut-être en Afrique avec une deuxième espèce du genre Homo, Homo ergaster.
A partir de -1,7 millions d'années Homo erectus apparaît en Afrique, puis va se répandre dans tout l'Ancien monde : Homo erectus est un Homme de taille plus élevée, au squelette plus lourd et dont le crâne, plus volumineux et plus robuste, a une capacité d'environ 800 cm3. Il va bientôt se répandre dans les zones tempérées du globe, dans le Sud-Est asiatique, en Asie orientale, dans le continent indien et en Europe. Culturellement, il s'achemine vers des sociétés de plus en plus complexes : il développe les techniques de la chasse, domestique le feu, et autour d'1,5 millions d'années invente le biface, qui pour la première fois dans l'histoire humaine manifeste le sens de la symétrie et de l'esthétique.
Les Néandertaliens (Homo neandertalensis) semblent apparaître il y a environ 400 000 ans en Europe occidentale, mais on les trouve aussi au Proche Orient, en Israël et en Irak, entre 100 000 et 40 000 avant le présent. Ces Hominidés au front bas, à la face fuyant en museau, à la carrure massive, mais au crâne dont la capacité cérébrale est proche de la nôtre, parfois même supérieure ont prospéré en Europe de l'Ouest, au Paléolithique moyen (jusqu'il y a 35 000 ans environ), avant d'être brusquement, et de façon encore mal comprise, remplacés par des hommes de type moderne au Paléolithique supérieur. Au Proche-Orient, les choses paraissent plus complexes. Au Paléolithique moyen, les Néandertaliens semblent bien avoir été les contemporains, dans les mêmes lieux, des sapiens archaïques. Pendant plusieurs dizaines de millénaires, ils ont partagé avec eux leurs cultures. Dans ces sites du Proche-Orient, la culture "moustérienne" est associée, non pas comme en Europe aux seuls Néandertaliens, mais à tous les représentants de la famille humaine. En particulier, la pratique de la sépulture est associée non à tel type biologique d'hominidé mais à ce qu'on peut appeler la culture moustérienne, qui leur est commune.
Histoire d'amour, de guerre ou... de simple cohabitation? Sapiens et Néandertaliens ont-ils pu coexister dans les mêmes lieux, avoir, à quelques variantes près, la même culture et les mêmes rituels funéraires, sans qu'il y ait eu d'échanges sexuels entre eux ? Pour certains, il pourrait s'agir de deux races d'une même espèce, donc fécondes entre elles, et les Néandertaliens auraient pu participer au patrimoine génétique de l'homme moderne. D'autres refusent cette hypothèse, sur la foi de l'étude récente d'un fragment d'ADN de Néandertalien, qui paraît confirmer - mais de manière encore fragile - la séparation des deux espèces, et donc l'impossibilité de leur interfécondité.
Les avancées de la génétique et de la biologie moléculaire ont conduit à poser en termes nouveaux la question de l'origine d'Homo sapiens et de la diversité humaine actuelle. Au milieu du XXème siècle, Franz Weidenreich, se fondant sur l'étude des Hominidés fossiles de Chine, les "Sinanthropes", considérait qu'"il doit y avoir eu non un seul, mais plusieurs centres où l'homme s'est développé ". Selon lui, la part trop importante faite aux fossiles européens avait masqué l'existence d'importantes particularités locales chez les Hominidés du Paléolithique inférieur (par exemple entre les Sinanthropes et les Pithécanthropes de Java). Au cours de l'évolution parallèle de ces groupes isolés les uns des autres par des barrières géographiques, les différences déjà présentes à ce stade ont pu se perpétuer jusqu'aux formes actuelles. Ces idées restent aujourd'hui à la source des approches "polycentristes" qui tentent de reconstituer le réseau complexe des origines des populations humaines actuelles, héritières selon eux de formes locales d'Homo erectus, remontant à 500 000 ans, voire 1 million d'années. Cette approche, qui privilégie l'étude des fossiles asiatiques, se donne pour une critique des mythes "édéniques" en même temps que de l'eurocentrisme qui a longtemps prévalu dans l'étude de la diversité au sein de l'humanité actuelle et fossile.
Face à ces positions "polycentristes", les tenants du "monocentrisme" défendent la thèse d'un remplacement rapide des formes d'hominidés primitifs par des Homo sapiens anatomiquement modernes : ils s'efforcent, à partir de l'étude des différences morphologiques, mais aussi des données de la biologie moléculaire, de reconstituer l'origine unique de toutes les populations humaines. Ces études ont abouti à un calcul des "distances génétiques" entre les populations actuelles, et avancé l'hypothèse d'une "Ève africaine" qui serait la "mère" commune de toute l'humanité
La thèse de l'origine unique et africaine de l'espèce Homo sapiens, il y a quelque 200 000 ans, irait dans le sens d'une séparation récente des populations humaines actuelles, et d'une différence très faible entre elles. Mais elle demande à être confirmée, non seulement par de nouvelles expériences et un échantillonnage rigoureux, mais aussi par les témoignages paléontologiques, rares à cette époque dans ce domaine géographique.
La mise en place de l'arbre généalogique de la famille humaine au cours de l'histoire de la paléoanthropologie et de la préhistoire reste aujourd'hui encore l'objet de discussions, qui concernent tant les schèmes évolutifs et les processus environnementaux que les critères biologiques et culturels qui y sont à l'Suvre. Lhistoire de la famille humaine apparaît fort complexe dès ses origines : aux racines de l'arbre généalogique, entre 4 millions et 1 million d'années, les Hominidés se diversifient en au moins deux genres (Australopithecus et Homo) et un véritable buissonnement d'espèces, dont certaines ont été contemporaines, parfois dans les mêmes sites. La multiplication des découvertes, l'introduction des méthodes de classification informatisées, et les bouleversements des paradigmes de savoir, ont abouti à rendre caduque la recherche d'un unique "chaînon manquant" entre l'Homme et le singe. L'espèce Homo sapiens a été resituée dans le cadre d'une famille qui a connu une grande diversification dans tout l'Ancien Monde. Que la plupart des espèces d'Hominidés se soient éteintes est un phénomène banal dans l'histoire du vivant, et ne signifie certainement pas que la nôtre fût la seule destinée à survivre. Plusieurs dizaines de milliers d'années durant, les Néandertaliens ont prospéré et parfois même cohabité avec notre espèce - et ils se sont éteints, comme d'ailleurs la plupart des espèces vivantes, il y a seulement un peu plus de 30 000 ans, pour des raisons qui restent inconnues. Mais ils auraient pu survivre, et la vision que nous avons de nous-mêmes en eût sans doute été fortement modifiée...
Le devenir des cultures humaines
"L'évolution [humaine] a commencé par les pieds"... aimait à dire par provocation André Leroi-Gourhan, insistant sur le fait que l'acquisition la bipédie précède dans l'histoire humaine le développement du cerveau.
De fait, des découvertes récentes ont montré que la bipédie a sans doute été acquise très tôt dans l'histoire de la famille humaine, il y a 3 ou 4 millions d'années. Les études menées sur la locomotion des Australopithèques ont conclu que ceux-ci marchaient déjà sur leurs deux pieds, même s'il leur arrivait parfois de se déplacer par brachiation - en se suspendant à l'aide de leurs bras. Les traces de pas découvertes en 1977 à Laetolil (Tanzanie ) et datées de 3,6 millions d'années sont bien celles de deux individus parfaitement bipèdes, marchant côte à côte... Elles ont confirmé le fait que la station redressée et la marche bipède étaient déjà acquises par ces Hominidés primitifs, - bien avant que la taille du cerveau n'atteigne son développement actuel.
Le développement du cerveau est certainement le trait le plus remarquable de la morphologie humaine. Des moulages naturels d'endocrânes fossiles - comme celui de lenfant de Taung, découvert en 1925 - ou des moulages artificiels obtenus à partir de limpression du cerveau sur la paroi interne du crâne dautres Hominidés fossiles ont permis de suivre les étapes de cette transformation du volume cérébral, de l'irrigation et de la complexification des circonvolutions cérébrales au cours de l'évolution des Hominidés. La question reste cependant posée du "Rubicon cérébral" - elle implique qu'il existerait une capacité endocrânienne au-delà de laquelle on pourrait légitimement considérer qu'on a affaire à des représentants du genre Homo, dignes d'entrer dans la galerie de nos ancêtres... La définition, longtemps discutée, d'Homo habilis comme premier représentant du genre humain, a fait reculer cette frontière à 600 cm3... et peut-être même encore moins : il faut donc bien admettre que le développement du cerveau n'a pas été l'unique "moteur" du développement humain : il s'associe à d'autres traits anatomiques propres à l'homme, station redressée, bipédie, morphologie de la main, fabrication et utilsation d'outils, usage d'un langage articulé...
La main humaine a conservé le schéma primitif, pentadactyle, de l'extrémité antérieure des Vertébrés quadrupèdes. La caractéristique humaine résiderait dans le fait que chez l'Homme le membre antérieur est totalement libéré des nécessités de la locomotion. Mise en rapport avec le développement du cerveau, la libération de la main ouvre à l'Homme les possibilités multiples de la technicité. L'avènement d'une "conscience" proprement humaine se situerait donc du côté de ses productions techniques.
L'outil est-il autant qu'on le pensait naguère porteur de la différence irréductible de l'homme ? Éthologistes, préhistoriens et anthropologues ont cherché à comparer, sur le terrain archéologique ou expérimental les "cultures" des Primates et celles des premiers Hominidés fossiles. Ils proposent des conclusions beaucoup plus nuancées que les dichotomies abruptes de jadis. Si l'outil définit l'Homme, l'apparition de l'Homme proprement dit ne coïncide plus avec celle de l'outil. Certains grands Singes savent utiliser et même fabriquer des outil. L'étude fine de la technicité des Panidés a également conduit à en observer des formes diversifiées dans différents groupes géographiquement délimités, et certains chercheurs n'hésitent pas à parler de "comportements culturels" chez ces Singes. D'autre part, les premières industries de pierre connues sont probablement l'Suvre des Australopithèques : ces hominidés au cerveau guère plus volumineux que celui d'un gorille sont-ils les auteurs des "pebble tools" ou des industries sur éclats vieilles d'environ 2,5 millions d'années - qui ont été trouvés associées à eux dans certains sites africains ? Beaucoup l'admettent aujourd'hui ... mais d'autres restent réticents à attribuer ce trait culturel à un Hominidé qui ne se situe pas dans notre ascendance ! Il a donc fallu repenser les "seuils" qui naguère semblaient infranchissables, non seulement entre grands Singes et premiers Hominidés, mais aussi entre les différents représentants de la famille humaine.
L'Homme seul serait capable de prévision, d'intention : Il sait fabriquer un outil pour assommer un animal ou découper ses chairs -et, plus encore, un outil pour faire un outil. Instrument du travail, l'outil est lui-même le produit d'un acte créateur. Si les vestiges osseux sont rares et se fossilisent mal, d'innombrables silex taillés, des primitifs "galets aménagés" aux élégantes "feuilles de laurier" solutréennes et aux pointes de flèches magdaléniennes permettent de suivre à la trace les chemins qu'ont empruntés les Hommes, d'évaluer leurs progrès dans la conquête et la maîtrise de la nature, de percevoir la complexité croissante de leurs échanges et de leurs communications.
Les "cultures" préhistoriques ont dans le passé été caractérisées, presque exclusivement, par l'outillage lithique qui les composent. Le Moustérien, le Solutréen, le Magdalénien, ce sont d'abord des types d'outils et de techniques lithiques décrits, inventoriés, étudiés dans leur distribution statistique. Cependant les approches contemporaines tendent à élargir cette notion de "cultures" en mettant en lumière d'autres traits culturels importants, inventions techniques essentielles comme celle du feu, de l'aiguille et du poinçon, de la corde, et du tissage, structures d'habitat, organisation du groupe social, division du travail...
Aux périodes les plus récents du Paléolithique supérieur, l'art, mobilier ou rupestre, traduit le fait que l'homme a désormais accès au symbolique, à la représentation. Innombrables sont les objets en ivoire, en os ou en bois de renne, sculptés ou gravés découverts sur les sites préhistoriques, et témoignant de la fécondité artistique des chasseurs cueilleurs de la préhistoire, et de ce que ces primitifs du Paléolithique avaient un talent et une sensibilité dartistes, très proches en somme de celles de lHomme daujourdhui.
Devant ces figurations animales et humaines ou ces signes abstraits, le problème se pose de leur signification : labbé Breuil nhésitait pas à prêter un sentiment religieux à ses auteurs, et à interpréter les figures et les symboles sculptés, gravés, dessinés ou peints du Paléolithique comme la manifestation de cultes animistes et de rituels chamaniques, que l'on retrouverait chez certains peuples actuels. La thèse du chamanisme a fait l'objet d'importantes critiques, elle a pourtant été récemment reprise par le préhistorien français Jean Clottes et l'anthropologue sud-africain David Lewis-Williams, qui proposent d'interpréter les symboles de l'art paléolithique en s'inspirant de ceux du chamanisme, lisibles selon eux dans l'art rupestre des Bushmen d'Afrique australe. Cette interprétation, étayée aussi par des arguments neuro-physiologiques, ne laisse pas d'être fragile, précisément par l'universalité qu'elle suppose, excluant les lectures de cet art qui viseraient à prendre en compte son contexte particulier et son symbolisme propre
La faculté symbolique dont témoigne l'art est sans aucun doute liée aux possibilités de l'échange et de la parole. On sait que certaines régions du cerveau humain sont dévolues à la parole et le développement de ces aires cérébrales a pu être observé, dès Homo habilis, voire même peut-être chez les Australopithèques. Certaines caractéristiques des organes de la phonation (larynx, apophyses de la mandibule pour linsertion de la langue, résonateurs nasaux) sont également invoquées, mais beaucoup dincertitudes subsistent : le grognement, le cri, le chant, ont-ils été les formes primitives de l'expression humaine ? Le langage "doublement articulé" - au niveau phonétique et sémantique - existe-t-il déjà aux stades anciens du genre Homo, voire dès Australopithecus, ou apparaît-il seulement avec l'Homme moderne ? Le langage humain résulte-t-il d'un "instinct" déterminé génétiquement qui dès les origines de la famille humaine nous distingue déjà des autres primates ? ou faut-il le considérer comme un produit de la société et de la culture, contemporain de la maîtrise des symboles de l'art ?
Nouveaux regards sur la femme préhistorique
Le XIXème siècle n'avait pas donné une image très glorieuse de la femme préhistorique. Le héros de la préhistoire, de Figuier à Rosny, cest l'Homme de Cro-Magnon, armé d'un gourdin, traînant sa conquête par les cheveux pour se livrer à d'inavouables orgies dans l'obscurité de la caverne& La sauvagerie des "âges farouches" est alors prétexte à des allusions à la brutalité sexuelle, au viol. Cet intérêt pour les mSurs sexuelles des origines est sans doute l'envers de la pruderie d'une époque. Il rejoint celui que l'on commence à porter aux ténèbres de l'âme, aux pulsions primitives, inconscientes, qui s'enracinent dans les époques primitives de l'humanité.
Notre regard aujourdhui semble se transformer. Notre héros de la préhistoire, c'est une héroïne, Lucy, une Australopithèque découverte en 1974 dans le site de Hadar en Ethiopie et qui vécut il y a quelque 3 millions d'années. Innombrables sont les récits qui nous retracent les bonheurs et les aléas de son existence. Signe des temps : la femme a désormais une place dans la préhistoire.
Les anthropologues ont renouvelé l'approche de la question des relations entre les sexes aux temps préhistoriques en mettant l'accent sur l'importance, dans le processus même de l'hominisation, de la perte de l'oestrus qui distingue la sexualité humaine de celle des autres mammifères. Tandis que l'activité sexuelle chez la plupart des animaux, y compris les grands Singes, est soumise à une horloge biologique et hormonale, celle qui détermine les périodes de rut - la sexualité humaine se situe sur le fond d'une disponibilité permanente. Cette disponibilité fut sans doute la condition de l'apparition des normes et des interdits qui dans toutes les sociétés limitent les usages et les pratiques de la sexualité. Peut-être a-t-on vu alors naître des sentiments de tendresse, s'ébaucher des formes de la vie familiale, de la division du travail - et s'établir les règles morales, l'interdit de l'inceste et les structures de la parenté dont les anthropologues nous ont appris quils se situent au fondement de toute culture.
Depuis environ trois décennies, des travaux conjugués d'ethnologie et de préhistoire ont remis en cause les a priori jusque là régnants sur linanité du rôle économique et culturel des femmes dans les sociétés paléolithiques. Les recherches des ethnologues sur les Bushmen dAfrique du Sud ont ouvert de nouvelles voies pour la compréhension des modes de vie et de subsistance, des structures familiales et de la division sexuelle du travail chez les peuples de chasseurs-cueilleurs. Dans ces groupes nomades, les femmes, loin d'être passives, vouées à des tâches subalternes, immobilisées par la nécessité délever les enfants, et dépendantes des hommes pour l'acquisition de leur subsistance, jouent au contraire un rôle actif à la recherche de nourriture, cueillant, chassant à loccasion, utilisant des outils, portant leurs enfants avec elles jusquà lâge de quatre ans, et pratiquant certaines techniques de contrôle des naissance (tel que l'allaitement prolongé). Ces études ont conduit les préhistoriens à repenser l'existence des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, à récuser les modèles qui situaient la chasse (activité exclusivement masculine) à lorigine de formes de la vie sociale, et à élaborer des scénarios plus complexes et nuancés, mettant en scène la possibilité de collaborations variées entre hommes et femmes pour la survie du groupe.
La figure épique de Man the Hunter, le héros chasseur poursuivant indéfiniment le gros gibier a vécu. Il faut désormais lui adjoindre celle de Woman the gatherer, la femme collectrice (de plantes, de fruits, de coquillages). Larchéologue américain Lewis Binford est allé plus loin en insistant sur l'importance au Paléolithique des activités, non de chasse, mais de charognage, de dépeçage, de transport et de consommation de carcasses d'animaux morts, tués par d'autres prédateurs. Des preuves dactivités de ce type se trouveraient dans la nature et la distribution des outils de pierre sur certains sites de dépeçage, et dans la sélection des parties anatomiques des animaux consommés. Si tel est le cas, des femmes ont pu participer à ces activités, et être, tout autant que les hommes, pourvoyeuses de nourriture.
Il se peut aussi que, contrairement aux idées reçues, les femmes aient été très tôt techniciennes, fabricatrices d'outils quelles se soient livrées par exemple à la taille des fines industries sur éclats qui abondent à toutes les époques du Paléolithique -, qu'elles aient inventé il y a quelque 20 000 ans, la corde et l'art du tissage de fibres végétales, dont témoignent les parures et les vêtements qui ornent certaines statuettes paléolithiques : la résille qui coiffe la "dame à la capuche" de Brassempouy, le "pagne" de la Vénus de Lespugue, les ceintures des Vénus d'ivoire de Kostienki, en Russie&
Ces Vénus paléolithiques nous donnent-elles pour autant une image réaliste de la femme préhistorique ? Si tel était le cas, il faudrait croire, comme le disait avec humour Leroi-Gourhan, que la femme paléolithique était une nature simple, nue et les cheveux bouclés, qui vivait les mains jointes sur la poitrine, dominant sereinement de sa tête minuscule lépouvantable affaissement de sa poitrine et de ses hanches &Ces Vénus ont suscité une multitude d'interprétations - tour à tour anthropologiques, physiologiques, voire gynécologiques, religieuses, symboliques. Certains, s'appuyant sur l'abondance dans lart paléolithique des images sexuelles et des objets réalistes - vulves féminines ou phallus en érection, scènes d'accouplement, corps de femmes dont les seins, les fesses et le sexe sont extraordinairement soulignés, y ont vu l'expression sans détour de désirs et de pratiques sexuels, en somme l'équivalent paléolithique de notre pornographie&
Des études féministes ont mis en cause le fait, jusque là donné pour une évidence, qu'il puisse s'agir d'un art fait par des hommes et pour des hommes. Chez les Aborigènes australiens, l'art sacré est en certaines occasions réservé aux femmes. Si on admet que l'art paléolithique a pu avoir une fonction rituelle et religieuse, ses figurations et ses objets pourraient avoir été destinés, plutôt qu'à un usage exclusivement masculin, à l'usage des femmes ou à l'initiation sexuelle des adolescentes. L'ethnologue californienne Marija Gimbutas a reconnu dans ces Vénus paléolithiques des images de la "Grande Mère", figure cosmogonique, symbole universel de fécondité, qui se retrouve au Néolithique et jusqu'à l'Age du Bronze dans toute l'Europe : ces sociétés dont les religions auraient été fondées sur le culte de la "Grande Déesse" auraient connu, de manière continue jusqu'à une époque relativement récente, des formes de pouvoir matriarcales et des formes de transmission matrilinéaires, avant d'être remplacées par des structures sociales à dominance masculine et des religions patriarcales. Cette construction, qui reprend la thèse du matriarcat primitif à lappui de thèses féministes, reste pourtant fragile : lhistoire ultérieure ne nous montre-t-elle pas que le culte de la mère peut exister dans des religions à dominance masculine, et dans des sociétés comportant une bonne part de misogynie ?
Quoi quil en soit, limage de la femme du Paléolithique a changé. Sil reste souvent à peu près impossible de désigner précisément ce qui dans les rares vestiges de la préhistoire, ressortit à lactivité de lun ou lautre sexe, ces nouvelles hypothèses et ces nouveaux savoirs, qui ne sont pas sans liens avec les transformations de nos sociétés, nous livrent une image plus vivante, plus colorée, plus ressemblante peut-être, de la femme des origines.
Conclusion
Comme tous les savoirs de l'origine, la préhistoire est un lieu inépuisable de questionnements, de rêves et de fantasmes. Elle représente un monde à la limite de la rationalité et de l'imaginaire, où peut s'exprimer le lyrisme, la fantaisie, l'humour, l'érotisme, la poésie. Mais l'imagination, en ce domaine, ne saurait être réduite à une combinatoire de thèmes fixés, archétypes ou lieux communs. Elle invente, elle crée, elle se renouvelle en fonction des découvertes et des événements, mais aussi des représentations prégnantes en un moment et dans un contexte particulier.
La préhistoire est une science interdisciplinaire, qui mobilise la géologie, la biologie, l'archéologie, l'ethnologie, l'histoire de l'art& et qui s'enrichit des développement de tous ces savoirs. Mais elle est avant tout une discipline historique, dont les documents sont pourtant beaucoup plus pauvres que ceux de l'histoire : ce sont des traces, des vestiges fragmentaires et muets, auxquels il faut donner sens, et dont l'interprétation est un lieu privilégié de projection de nos propres cadres mentaux et culturels.
Cest pourquoi on peut prophétiser sans risque que l'humanité préhistorique du XXIème siècle ne ressemblera pas à celle du XIXème ou du XXème siècle. Non seulement parce que des découvertes, suscitées ou inattendues, surgiront du terrain ou du laboratoire. Mais aussi parce que nos sociétés elles-mêmes, et la conscience que nous en avons, changeront elles aussi. Car l'Homme préhistorique a une double histoire : la sienne propre, et celle de nos représentations.
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Entretien avec luc steels : une machine peut-elle parler ? |
|
|
| |
|
| |

Entretien avec luc steels : une machine peut-elle parler ?
Gautier Cariou dans dossiers 18
daté juin-juillet 2016 -
Grâce à des travaux originaux à la croisée de la robotique, de l'informatique, de la psychologie et de la linguistique, Luc Steels, chercheur en intelligence artificielle, entend donner parole à la machine.
La Recherche. Vous développez des méthodes d'intelligence artificielle (IA) pour décrypter les mécanismes de l'intelligence, et en particulier du langage. Quelles réponses l'IA peut-elle apporter
à un champ déjà tant balayé par les sciences sociales et les neurosciences ?
Luc Steels Pour étudier l'acquisition du langage et le développement des capacités sensorielles et motrices chez l'enfant, les linguistes, les psychologues et les neuroscientifiques n'ont que deux outils à leur disposition : des expériences de pensée et des observations du comportement ou du cerveau. Mais aucun de ces outils ne leur permet de créer des modèles formels qui rendent compte des mécanismes d'acquisition de ces capacités cognitives. À la fin des années 1980, avec mon collègue Rodney Brooks, fondateur de la société américaine iRobot, nous avons donc eu l'idée de fabriquer des systèmes artificiels - des robots - et de les utiliser comme plates-formes expérimentales pour tester différents mécanismes pouvant expliquer l'émergence de comportements intelligents chez les espèces vivantes. Bien sûr, cette approche ne garantit pas à 100 % que les principes utilisés sont transposables aux systèmes vivants mais cette méthodologie est une source importante de progrès pour appréhender au plus près l'extraordinaire complexité des phénomènes observés dans la cognition humaine. En d'autres termes, c'est par la construction de systèmes artificiels que l'on peut espérer comprendre au mieux l'intelligence réelle.
Quels mécanismes de l'intelligence avez-vous mis en évidence ?
L'un de ces mécanismes est l'« auto-organisation ». Il m'a été inspiré par le groupe d'Ilya Prigogine, Prix Nobel de chimie en 1977. Il étudiait alors les systèmes complexes : les colonies de fourmis, le vol des oiseaux, etc., et se demandait comment l'ordre et l'organisation peuvent émerger du chaos. De fait, dans ces systèmes, aucun programme central ne commande quoi que ce soit. Il n'y a pas une fourmi chef d'orchestre qui donne des ordres à ses congénères ; et pourtant, au fil des interactions entre chaque fourmi, en échangeant des phéromones, un comportement collectif intelligent émerge. J'étais convaincu que ce phénomène d'auto-organisation pouvait devenir un mécanisme clé de l'intelligence des machines. C'est ce que nous avons démontré avec Rodney Brooks (1). Plutôt que de doter un robot d'un programme central complexe, nous avons créé des robots dont l'intelligence est distribuée entre plusieurs modules, chacun programmé pour une action simple : éviter un obstacle, revenir en arrière si le robot est coincé, revenir vers une station de rechargement avant que la batterie soit épuisée. Toutes ces actions élémentaires donnent lieu à un comportement global intelligent de la part du robot sans qu'il soit programmé à l'avance pour ce comportement. Cette approche constituait un changement de paradigme : nous passions d'une IA « classique », avec un programme central dédié à une tâche bien définie comme le pilotage des avions, la planification du trafic ferroviaire - ce que l'on appelle les systèmes experts -, à une robotique qui se programme elle-même, en fonction des interactions avec son environnement.
Vous vous êtes ensuite intéressé au langage...
Oui, pendant mes études au laboratoire d'IA du MIT, je suivais en parallèle le cours de linguistique de Noam Chomsky, figure la plus emblématique du domaine. Dans les années 1980, j'étais imprégné des idées nouvelles de l'IA, et il était pour moi très clair qu'il fallait trouver une autre voie que celle des sciences sociales pour avancer dans l'étude et la compréhension du langage. Je me disais que si les mécanismes d'auto-organisation pouvaient faire émerger des comportements intelligents, alors ces mêmes mécanismes devaient également être utiles pour expliquer une autre forme d'intelligence : le langage.
En quoi l'auto-organisation aide-t-elle à comprendre le langage ?
Prenons l'exemple des oiseaux migrateurs. Lorsqu'ils volent, ils suivent une trajectoire aléatoire au départ puis s'influencent mutuellement et, de proche en proche, ils finissent par s'aligner. Chaque oiseau pris individuellement n'a pourtant pas de vision d'ensemble et ne reçoit pas d'ordre mais, collectivement, le groupe devient cohérent. J'étais persuadé que l'émergence des mots au sein d'une population humaine utilisait le même principe. On peut imaginer, par exemple, que deux personnes se mettent d'accord pour nommer un objet « stylo ». Chacun d'eux va ensuite parler avec deux autres personnes et ainsi de suite. Le choix du mot initial étant aléatoire, il est fort probable qu'un autre groupe utilise plutôt le mot « Bic » ou n'importe quel autre mot pour désigner le même objet. Au début, de nombreux mots coexistent dans la population. Puis, par interactions successives, de plus en plus d'individus emploient le mot « stylo » et le lexique se stabilise.
Avez-vous testé la validité de cette hypothèse ?
Oui, en 1999. J'étais alors directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Sony, à Paris. J'avais mis en place une expérience pour étudier le phénomène de propagation des mots dans une population d'agents artificiels. Par agent artificiel, j'entends une entité informatique capable de se télécharger dans un robot. Les robots impliqués étaient de simples « têtes parlantes », des systèmes dotés d'un micro, d'un haut-parleur, d'une caméra mobile et d'un ordinateur de bord connecté à Internet, installés sur plusieurs sites : à Paris, à Londres, à Tokyo... Dans chaque ville, deux robots étaient positionnés devant un tableau blanc sur lequel étaient représentées des formes géométriques de couleurs différentes. Téléchargés dans ces robots, les agents artificiels étaient programmés pour se prêter à un jeu de langage. L'un d'entre eux (l'enseignant) devait choisir une figure et la faire deviner à l'autre agent (l'apprenant) en prononçant à voix haute un mot produit à partir de sons élémentaires puisés dans sa mémoire de travail. L'apprenant devait alors interpréter la signification du mot prononcé en pointant sa caméra vers la figure qu'il pensait correspondre au mot prononcé. En cas d'erreur, l'enseignant pointait sa caméra en direction de la bonne figure et l'apprenant enregistrait cette information. Pour toute nouvelle partie, les agents pouvaient changer de rôle et se télécharger dans n'importe quel robot à travers le monde. Après un demi-million d'interactions entre un millier d'agents artificiels, un vocabulaire commun a émergé et a été adopté par l'ensemble des agents.
Le mécanisme d'auto-organisation est-il suffisant pour comprendre le langage ?
Non. Il ne rend compte que du phénomène de propagation et de partage d'un vocabulaire commun mais n'explique en aucun cas la création et l'évolution du langage. Pour explorer cette question, je me suis inspiré de la science de l'évolution qui essaie de déterminer les mécanismes à l'origine de l'apparition des espèces. J'avais l'intuition que le langage faisait l'objet d'un processus évolutif analogue : les mots, les groupes de mots, la grammaire et la syntaxe sélectionnés sont ceux qui sont les plus efficaces pour que les individus puissent se comprendre. Pour vérifier la pertinence de ce mécanisme, j'ai implémenté un algorithme qui incite les robots à sélectionner les stratégies de communication qui, à la fois maximisent le succès de la communication et minimisent l'effort cognitif à fournir.
Quels résultats avez-vous obtenus ?
Dotés des mécanismes de sélection culturelle et d'auto-organisation, des robots qui n'avaient aucune grammaire au départ, en viennent à partager et à adopter des règles grammaticales communes, pourvu qu'ils interagissent suffisamment longtemps (2). La grammaire en question n'est pas celle des langues humaines, mais un ensemble d'outils à partir desquels les machines peuvent créer leur propre grammaire (3).
À chaque nouvelle expérience, une grammaire différente émerge. C'est le principe même de l'évolution : il n'est pas possible de prévoir les étapes de l'évolution mais on peut comprendre comment ça marche. Faire émerger une grammaire chez des robots, c'était une première à tous les points de vue. En reproduisant des expériences analogues à celles des têtes parlantes, nous avons mis en évidence qu'elle n'apparaît pas d'un seul coup, mais en plusieurs étapes et gagne en complexité de façon graduelle.
Aujourd'hui, vous continuez d'étudier la grammaire avec ces outils d'intelligence artificielle, un domaine baptisé « linguistique évolutionnaire ». Quel genre d'expériences menez-vous ?
À l'Institut de biologie évolutive de Barcelone, mon équipe et moi-même examinons certains aspects spécifiques de la grammaire. Par exemple, en français, il existe des phrases nominales, des phrases verbales, des phrases principales, etc. Or, avec des robots, on voit émerger ce genre de structure hiérarchique, ce qui nous permet d'étudier les mécanismes de leur apparition. Nous étudions également le phénomène d'accord sujet-verbe, ou encore les processus d'apparition et d'évolution des cas comme l'accusatif, le datif, etc. (4) À titre d'exemple, au XIIIe siècle, la langue anglaise comportait un système de cas, avec la même complexité que le latin, avant de disparaître. L'anglais a évolué et c'est désormais l'ordre des mots dans la phrase qui s'est substitué au cas. C'est ce genre de problèmes très concrets que l'on étudie aujourd'hui.
Sur le plan théorique, qu'apporte l'ensemble de vos travaux aux sciences humaines ?
En linguistique, deux théories s'affrontent pour expliquer notre capacité pour le langage. Selon la première, proposée par Noam Chomsky dans les années 1950, les hommes sont dotés d'une capacité innée pour le langage. Il existerait une « grammaire universelle » ancrée dans le cerveau dès la naissance et un organe biologique dédié au langage. Une autre théorie, dite « constructiviste », considère au contraire que l'acquisition du langage est le fruit d'un apprentissage. En interagissant avec son environnement, l'enfant acquerrait le langage de façon graduelle. Sans nier le rôle central du cerveau dans cette capacité langagière, la théorie constructiviste s'oppose à l'idée d'un organe spécifique au langage. De mon point de vue, le langage est un système dynamique, évolutif, émergent et non pas un système fixe et inné comme le prétend Chomsky : les mécanismes que j'ai testés indiquent clairement que les robots n'ont pas de programme dédié au langage. Ils sont seulement dotés de mécanismes généraux qui leur permettent de créer leur propre vocabulaire et règles grammaticales.
Pensez-vous que vos travaux closent le débat inné/acquis ?
Aujourd'hui, nous avons des expériences reproductibles qui valident un certain nombre de mécanismes. Malgré tout, nous sommes encore dans une phase d'écriture de livres et de débats et les résistances sont encore fortes de la part des chercheurs en sciences humaines. Pour eux, ces expériences ne sont pas pertinentes. Et pour cause, la méthode que nous employons constitue un changement de paradigme qui nécessite de redéfinir ce que l'on accepte comme preuve. En sciences humaines, un chercheur écrit un livre, puis un autre chercheur donne sa réponse. La matière du débat est l'histoire des idées, et les preuves sont des références à des figures d'autorité. Dans notre approche de linguistique évolutionnaire, l'autorité ne joue pas. Seules les preuves mathématiques comptent. J'essaie de me battre pour que ces preuves formelles soient mieux comprises et acceptées dans les sciences humaines. Mais pour l'heure, c'est un choc des cultures !
DOCUMENT la recherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
L'inconscient au crible des neurosciences |
|
|
| |
|
| |

L'inconscient au crible des neurosciences
François Ansermet,Pierre Magistretti dans mensuel 397
Existe-t-il un point de rencontre pour les neurosciences et la psychanalyse ? Un nouveau paradigme émerge : considérer les bases biologiques de l'inconscient à travers le mécanisme de plasticité du réseau neuronal. Grâce à ce mécanisme, le cerveau est ouvert au changement, tout en gardant une trace des événements passés.
Un rapprochement entre neurosciences et psychanalyse est-il possible ? Freud n'en doutait pas, qui pensait que la biologie parviendrait un jour à prouver les concepts de base de la psychanalyse. « Nous devons nous souvenir que toutes nos idées provisoires en psychologie seront probablement basées un jour sur une infrastructure organique », écrivait-il en 1914 [1] . Quelques années plus tard, il ajoutait : « Les insuffisances de notre description s'effaceraient sans doute si nous pouvions déjà mettre en oeuvre, à la place des termes psychologiques, les termes physiologiques ou chimiques [2] . » Sous ces propos, pointait la notion d'un possible recouvrement entre fait biologique et fait psychique, le second résultant du premier. Il n'empêche que, durant les décennies suivantes, la neurobiologie et la psychanalyse ont été le plus souvent considérées comme des domaines absolument séparés dans leurs fondements, car de logique différente. Tout dialogue était donc impossible.
Un retournement de situation est toutefois perceptible depuis quelques années : les tenants de la neuropsychanalyse proposent de considérer le fait psychique comme un phénomène émergeant du fait biologique. Dans cette optique, il s'agit, pour les neurosciences, de démontrer la psychanalyse, et pour la psychanalyse, de prendre en compte les avancées des neurosciences. Aux yeux du neurobiologiste Eric Kandel, Prix Nobel de physiologie et de médecine en 2000 : « La psychanalyse sortirait revigorée d'un rapprochement avec la biologie en général, et les neurosciences cognitives en particulier [3] . »
Intersection des champs
Mais à travers ce type de rapprochement, neurosciences et psychanalyse se retrouveraient indissolublement liées, au risque de perdre, chacune, leurs fondements. Aussi proposons-nous une autre démarche, qui est de considérer le fait biologique et le fait psychique comme fondamentalement différents, et d'explorer leurs éventuelles intersections.
Il ne s'agit pas ici d'étudier les mécanismes que les neurobiologistes regroupent sous le nom d'« inconscient cognitif », que nous préférons qualifier de « non conscients », pour les différencier de l'inconscient freudien. En effet, ce dernier n'a rien à voir avec un arc réflexe, un automatisme ou une mémoire procédurale lire « L'inconscient cognitif n'est pas freudien », p. 39. L'idée freudienne de l'inconscient va de pair avec l'idée de traces laissées par l'expérience, des traces qui, par leur existence même et surtout les associations qu'elles réalisent entre elles, participent à la constitution de la singularité du sujet. Or, les avancées les plus marquantes de la neurobiologie moderne portent elles aussi sur la notion de traces : en l'occurrence, il s'agit des modifications que toute expérience laisse dans l'agencement du réseau neuronal. De notre point de vue, la notion de traces laissées par l'expérience constitue donc un champ privilégié d'interrogation du rapport entre neurosciences et psychanalyse.
L'hypothèse, puis la démonstration de ce que l'expérience laisse des traces dans le réseau neuronal découlent entre autres des travaux du neurohistologiste Santiago Ramon y Cajal à la fin du XIXe siècle, de ceux du psychologue canadien Donald Hebb dans les années 1940, et enfin de ceux d'Eric Kandel et de nombreux autres neurobiologistes dès les années 1970. La conclusion générale de ces travaux est que le réseau neuronal n'est pas une structure déterminée une fois pour toutes. Il est au contraire soumis à un changement permanent. En effet, les synapses, sites des transferts d'information entre les neurones, sont constamment remodelées au gré de l'expérience : c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique [4] . L'activité simultanée de neurones interconnectés renforce les connexions synaptiques entre ces neurones, tant sur le plan structurel que fonctionnel : la forme et la taille des synapses changent, et de nouvelles synapses se forment [fig. 1] .
Bien sûr, certaines de ces modifications sont et demeurent en relation directe avec l'expérience visuelle, auditive, tactile ou autre qui leur a donné naissance : c'est sur elles que reposent les phénomènes de mémorisation. Ainsi, des modifications des synapses ont par exemple été mises en évidence lors d'expériences de conditionnement chez le rat. Nous proposons d'aller plus loin : les mécanismes de plasticité seraient également à l'origine de la construction d'une réalité interne inconsciente, par le biais d'un réarrangement d'une partie des traces mnésiques initiales.
Perception et réalité
Cette notion de réarrangement des traces a des conséquences importantes. En particulier, cela signifie que la réalité interne inconsciente est dissociée de la perception initiale, et n'est pas un reflet de la réalité externe. Il en résulte le paradoxe suivant : au niveau de l'inconscient, l'inscription de l'expérience sépare de l'expérience. On retrouve ici la contradiction intrinsèque à la théorie psychanalytique concernant la question de la perception. Pour Freud, d'un côté « toutes les représentations sont issues de perceptions » [5] . Et de l'autre, les processus de la vie psychique et de l'inscription de l'expérience vécue « rendent impossible la découverte de la connexion originelle » [6] . À l'aune de la plasticité, il est clair en tout cas que l'inconscient n'est pas un système de mémoire !
Une question essentielle se pose concernant la constitution de la réalité interne inconsciente : les traces laissées par la perception des stimuli sensoriels externes entrent-elles seules en ligne de compte ? Ou les stimuli internes provenant du corps lui-même sont-ils également impliqués ?
À la fin du XIXe siècle, le psychologue William James avait postulé qu'un stimulus externe a deux types d'effets. D'une part, il active le système de perception sensorielle concerné. D'autre part, il déclenche une réponse somatique - par exemple, un changement du rythme cardiaque. Autrement dit, à toute perception est associé un état somatique, dont James pensait en outre qu'il provoquait les émotions ressenties par le sujet : « Quelle sensation de peur resterait-il, si l'on ne pouvait ressentir ni les battements accélérés du coeur, ni le souffle court, ni les lèvres tremblantes, ni les membres faibles, ni le mal de ventre ? » disait-il [7] . Le neurologue de l'université de l'Iowa Antonio Damasio, qui a réactualisé la théorie de James au cours des dix dernières années, parle quant à lui de « marqueurs somatiques », autrement dit de « marqueurs de l'état du corps » [8] . Selon Damasio, ces marqueurs somatiques font que l'évocation de souvenirs s'accompagne de la résurgence de sensations liées à des états du corps.
L'amygdale et l'insula
D'après les travaux de Damasio et du neurobiologiste Joseph LeDoux, de l'université de New York [9] , deux systèmes neuronaux jouent un rôle central dans cette association : il s'agit de l'amygdale, une structure cérébrale située à la face interne du cortex temporal [fig. 2] , et de l'insula, localisée dans le cortex somato-sensoriel pariétal. En simplifiant à l'extrême, on peut dire que l'amygdale est un transducteur de signal. En amont, elle est activée par les différents systèmes sensoriels vision, audition..., sur un mode que l'on qualifie de direct car le signal n'est pas préalablement traité par le cortex sensoriel. En aval, elle déclenche les réponses somatiques, en envoyant des signaux aux systèmes neurovégétatif et endocrinien qui gèrent le rythme cardiaque, la transpiration, la libération de telle ou telle hormone, etc. L'insula, quant à elle, permet au cerveau de détecter ces changements physiologiques. Elle est un relais du système neuronal dit intéroceptif, qui informe en permanence le cerveau de l'état du corps. Une première boucle est ainsi bouclée, qui permet au cerveau de percevoir l'état somatique associé à la perception d'un stimulus externe. Le fait que l'amygdale et l'insula soient toutes deux connectées au cortex préfrontal, impliqué dans certaines formes de mémoire, permet de boucler une seconde boucle, celle du souvenir : il suffit que l'individu se remémore la situation source du stimulus, pour qu'il ressente à nouveau les sensations physiques associées.
Pour notre part, nous postulons que les mêmes mécanismes entrent en jeu quand l'inconscient freudien est activé : des états somatiques sont associés à chacune des traces ou associations de traces qui le constituent. L'état somatique est véhiculé tout au long de la chaîne de réaménagement des traces, et se retrouve finalement associé à l'un des éléments constitutifs de la réalité interne inconsciente, un fantasme donné par exemple. De ce point de vue, l'amygdale jouerait un rôle central dans la constitution de la réalité interne inconsciente. C'est donc l'une des voies par lesquelles un stimulus externe pourrait activer un scénario fantasmatique et l'état somatique qui lui est lié.
Rétablir l'équilibre physiologique
En tout état de cause, le cerveau réagit aux modifications de l'équilibre physiologique interne en tentant de le rétablir, via des signaux qu'il envoie par exemple au coeur ou aux glandes sécrétrices d'hormones. C'est en quelque sorte l'organe suprême du maintien de la constance du milieu intérieur. Or, selon les circonstances, l'état somatique est soit un état de plaisir, soit un état de déplaisir [10] . Sous cet angle, le rétablissement de l'équilibre physiologique peut être considéré comme le correspondant biologique du principe de plaisir/déplaisir freudien : il s'agit de rétablir l'état somatique de plaisir, ou, du moins, d'échapper au déplaisir. On rejoint ici le concept freudien de la pulsion [11] , lui aussi à l'interface entre le somatique et le psychique, la pulsion ayant pour but de décharger un état de tension en revenant à un état basal, ce qui produit la satisfaction. La fonction de la pulsion, centrale dans la théorie psychanalytique, a donc une portée physiologique claire dans le champ des neurosciences.
À travers l'association entre les traces laissées par l'expérience et des états somatiques, les concepts psychanalytiques d'inconscient et de pulsion se trouvent ainsi avoir une résonance biologique. Autrement dit, le modèle issu de la psychanalyse se révèle ici pertinent pour les neurosciences. Aussi parions-nous sur le fait que les données contemporaines issues de la neurobiologie gagneraient à être intégrées au modèle psychanalytique. À nos yeux, le cadre psychanalytique constitue en effet le cadre conceptuel le plus approprié pour guider les neurosciences dans la neurobiologie de l'inconscient : précisément parce qu'il est théorique, il pourrait permettre aux neurosciences de construire une théorie globale du cerveau qui n'exclut pas la dimension propre au sujet. Neurosciences et psychanalyse se rencontrent ainsi de façon inattendue autour de l'incontournable question de l'émergence de l'individualité.
EN DEUX MOTS Depuis une dizaine d'années, la « neuropsychanalyse » tente de réconcilier la psychanalyse et les neurosciences, en cherchant à démontrer la première par les secondes. Une autre approche se dégage aujourd'hui : explorer d'éventuelles intersections entre ces domaines. À cette aune, neurosciences et psychanalyse se rencontrent autour de la notion de « traces ». Les traces qu'une expérience laisse dans le psychisme et celles qu'elle laisse dans le réseau neuronal via la réorganisation des connexions entre les neurones. De ces traces résulte la réalité interne inconsciente du sujet.
[1] S. Freud, Pour introduire le narcissisme 1914, in La Vie sexuelle, PUF, 1969 réédition 2002, collection « Bibliothèque de psychanalyse ».
[2] S. Freud, Au-delà du principe de plaisir 1920, in Essais de psychanalyse, Payot, « Petite Bibliothèque », 2001.
[3] E. R. Kandel, Am. J. Psychiatry, 156 4, 505, 1999.
[4] S. Laroche, « Comment les neurones stockent les souvenirs », Les Dossiers de La Recherche, février-avril 2006, p 28.
[5] S. Freud, La négation 1925, in Résultats, idées, problèmes II, p. 137, PUF, 1985.
[6] S. Freud, Manuscrit M du 25.5.1897, in Naissance de la psychanalyse, p. 181, PUF, 1956 réédition 2002, collection « Bibliothèque de psychanalyse ».
[7] W. James, The Principles of Psychology 1890, New York, Dover, 1950.
[8] A. Damasio, L'Erreur de Descartes, Odile Jacob, 1994.
[9] J. LeDoux, Le Cerveau des émotions , Odile Jacob, 2005.
[10] A.D. Craig, Nat. Rev. Neurosci., 3 , 655, 2002.
[11] S. Freud, Pulsions et destin des pulsions 1915, in Métapsychologie, p. 11-44, Gallimard, 1976.
IDENTITE : À CHACUN SON CERVEAU
Le fait que l'expérience laisse des traces dans le cerveau par le biais de la plasticité synaptique, et que ces traces soient sans cesse remodelées, ouvre un questionnement sur l'identité du sujet. En effet, la plasticité démontre que le réseau neuronal est ouvert au changement, à la contingence : il est modulable par l'événement. Autrement dit, au-delà des déterminations qu'implique son bagage génétique, chaque individu se révèle unique et imprédictible. La plasticité remaniant constamment les circuits neuronaux, un stimulus identique peut donner des réponses chaque fois différentes en fonction de l'état du cerveau. Nous serions ainsi biologiquement déterminés pour ne pas être biologiquement déterminés. Nous serions biologiquement déterminés pour être libres. Voilà qui implique de revisiter d'une façon complètement nouvelle la question du déterminisme. D'une certaine façon, la question n'est plus de savoir comment nous pouvons changer, mais plutôt de comprendre pourquoi nous ne changeons pas plus !
PROCESSUS : L'INCONSCIENT COGNITIF N'EST PAS FREUDIEN
le neurobiologiste et prix nobel Eric Kandel propose que l'étude de la nature des processus mentaux inconscients est l'un des domaines où biologie et psychanalyse pourraient se rejoindre. C'est un fait, les neurosciences cognitives ne cessent de fournir de nouvelles connaissances sur quantité d'opérations mentales qui s'effectuent sans que nous en ayons conscience [1]. Historiquement, ces processus ont d'abord été mis en évidence chez des patients dont le cerveau avait subi une lésion, tel l'emblématique patient H.M. Atteint d'épilepsie, il subit en 1953 l'ablation bilatérale de la partie du lobe temporal, où est localisé l'hippocampe. L'épilepsie disparut, mais sa capacité à restituer consciemment de nouveaux souvenirs aussi. Pourtant, il était encore capable d'apprentissage non conscient : dans une expérience célèbre, Brenda Milner, la psychologue canadienne qui l'a suivi pendant des années, a montré que sa capacité à effectuer correctement une certaine tâche augmentait de jour en jour, comme chez un sujet sain, alors même qu'au début de chaque session d'entraînement il prétendait être confronté à cette tâche pour la première fois. Nettement moins extrêmes, testables chez n'importe lequel d'entre nous, les effets d'amorçages témoignent eux aussi de processus non conscients de traitement de l'information. Par exemple, l'identification d'un objet donné parmi plusieurs autres est plus rapide si le sujet a préalablement vu l'objet en question. Enfin, on peut bien évidemment citer les innombrables actions que l'on effectue sur un mode « automatique ». Notamment, conduire une voiture : point n'est besoin, à chaque instant, de réfléchir aux gestes à accomplir. La mémoire dite « procédurale » est à l'oeuvre, qui nous permet de conduire sans y penser. Regroupés sous le terme d'« inconscient cognitif », ces processus n'ont rien à voir avec l'inconscient freudien.
[1] A. Cleeremans, « Ces zombies qui nous gouvernent », La Recherche , juillet-août 2003, p. 36 ; A. Berthoz, « Au commencement était l'action », La Recherche , juillet-août 2003, p. 74.
DOCUMENT la recherche.fr |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
