|
| |
|
|
 |
|
Ultrasons biomédicaux |
|
|
| |
|
| |

Ultrasons biomédicaux
Sous titre
Une révolution médicale en cours
Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui engendrent des oscillations dans les milieux qu’elles traversent. Les signaux qui sont créés peuvent être exploités dans un objectif diagnostique (échographie, écho-Doppler, élastographie) ou thérapeutique (lithotripsie, phacoémulsification…). Ils sont d'ores et déjà utilisés pour traiter certains cancers, les fibromes utérins ou encore le glaucome. En outre, les importants progrès technologiques accomplis depuis plusieurs années ouvrent de nombreuses perspectives pour le développement de nouveaux dispositifs puissants et précis, dans des domaines d’applications variés : cardiologie, neurologie, psychiatrie...
Mickaël Tanter, directeur de l’unité Physique des ondes pour la médecine (unité 979 Inserm/CNRS/ESPCI Paris/Paris Sciences et Lettres Université) et directeur de l’Accélérateur de recherche technologique Inserm Ultrasons biomédicaux, lauréat du Prix Opecst-Inserm 2014.
Comprendre les ultrasons et leurs exploitations biomédicales
Comme les ondes sonores, les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui se matérialisent par la mise en vibration des molécules constituant la matière. Si la fréquence des ondes du champ des sons audibles est comprise entre 20 Hz pour la fréquence la plus grave et 20 000 Hz pour la plus aiguë, celle des ultrasons est supérieure, comprises entre 20 kHz et 10 THz. Au-delà débute le domaine des hypersons.
Les ondes ultrasonores engendrent l’oscillation autour de leur point d’équilibre, des molécules du milieu qu’elles traversent. Cette oscillation se diffuse de proche en proche, dans une direction donnée à partir du point d’initiation. Selon la densité du milieu traversé, les ultrasons se propagent à une vitesse plus ou moins élevée : la résistance d'un matériau est qualifié par son impédance acoustique (notée Z et mesurée en Pascal seconde par mètre) qui influence cette vitesse. Par ailleurs, une onde ultrasonore traversant un milieu donné rebondit et revient en écho lorsqu’elle arrive à l’interface d’un nouveau milieu dont l’impédance acoustique est différente du premier. Ainsi, en analysant le signal rétrodiffusé, il est possible d’obtenir des informations sur le milieu analysé.
Dans le domaine médical, les ultrasons présentent un certain nombre d’avantages :
* Ce sont des ondes qui ne présentent pas de danger (pas de radiations ionisantes, notamment).
* Elles peuvent être mises en œuvre grâce à un appareillage peu volumineux et peu onéreux.
* Elles permettent l'obtention d'images observables et interprétables simultanément à l’examen.
La révolution ultrasonore – Entretien avec Mickaël Tanter, directeur de l'ART Ultrasons biomédicaux de l'Inserm, implanté à l'ESPCI Paris – 3 min 34 – 2016
La France, berceau des techniques ultrasonores
Le domaine des ultrasons est un champ dans lequel la France a été à l’avant-garde : l’aventure a commencé avec Pierre Curie qui a théorisé la piezoélectricité permettant de créer des ultrasons à partir d’un courant électrique, en 1880. Une trentaine d’années après, son élève Paul Langevin a mis au point le premier dispositif émetteur et récepteur d’ultrasons, aboutissant à une première utilisation militaire durant la Seconde Guerre mondiale (sonar).
Le développement de l’usage des ultrasons dans le domaine médical a émergé ensuite, notamment à travers l’échographie développée par des britanniques. Dans le courant des années 1950, la première sonde échographique est mise en point, suivie de la première échographie 2D au début des années 1970, qui seront toutes deux utilisées en obstétrique. Le développement et l’utilisation de l’échographie Doppler dans l’évaluation du débit sanguin et de la résistance vasculaire ont, quant à eux, été menés par un chercheur pionnier, Léandre Pourcelot, directeur de l’unité Inserm 316 "Système nerveux du fœtus à l’enfant" à la faculté de médecine de Tours (de 1988 à 2003).
Les techniques d’imagerie diagnostique
L’exploitation des ondes ultrasonores dans le domaine diagnostique repose sur la formation d’images à partir des signaux rétrodiffusés par les tissus (échographie), ou bien sur la mesure du flux sanguin (écho-Doppler).
Échographie d'un fœtus de 14 semaines. ©Mirmillon
L’échographie consiste à émettre des ultrasons en direction des tissus et organes à observer, puis à recueillir et analyser les échos des ultrasons selon la distance et l’impédance des milieux sur lesquels ils ont rebondi.
Dans l’échographie classique, en deux dimensions (2D), un balayage (manuel, mécanique, électronique) permet d’émettre simultanément plusieurs lignes de tir, dans différentes directions. Un traitement informatique des échos recueillis permet de représenter les milieux traversés en fonction de leur impédance, pour recréer une image en deux dimensions représentant un plan de coupe de la zone analysée :
Dans ce dispositif, les ondes mécaniques sont émises par des matériaux piézoélectriques : il s’agit de matériaux ayant la capacité de se déformer lorsqu’ils sont soumis à une contrainte électrique. Cette déformation se traduit par une onde mécanique qui est focalisée en direction des tissus à analyser. Une sonde permet ensuite de recueillir l’écho des ondes.
Le gel classiquement utilisé lors de la réalisation d’une échographie externe permet d’éviter les interférences que l’air pourrait engendrer entre la sonde et la peau, puisqu’il possède une impédance comparable à celle de cette dernière.
Plus récemment, l’échographie 3D a été développée et permet, comme son nom l’indique, d’obtenir une image tridimensionnelle. Dans ce cas, un balayage mécanique ou électronique permet d’accumuler les informations obtenues sur différents points d’échos depuis différents points d’émission. Leur traitement informatique permet de créer l’image 3D.
L’amélioration des sondes piézoélectriques et des capacités de calcul et d’acquisition permettent d’envisager une imagerie 4D, c’est-à-dire une 3D au cours du temps. De telles méthodes sont déjà utilisées dans des laboratoires de recherche, et leur développement pourrait prochainement offrir une méthode d’acquisition ultrarapide, permettant d’observer les organes ou le fœtus avec une précision inégalée.
L’échographie Doppler est quant à elle très utilisée dans l’examen non invasif des vaisseaux sanguins. Elle repose sur l’effet Doppler : lorsqu’une source d’onde (ou son observateur) est en mouvement, la fréquence de l’onde qu’elle émet varie selon le sens et la vitesse de direction. Un exemple emblématique de l’effet Doppler est le son de la sirène d’une voiture qui passe des aigus aux graves en s’approchant puis en dépassant un observateur fixe. Appliqué au flux sanguin, ce principe permet de mesurer la fréquence réfléchie et de la comparer à la fréquence émise, selon la vitesse de déplacement des globules rouges dans le vaisseau.
Qu'est-ce que l'effet Doppler – animation pédagogique – 4 min 28 – © CEA
Les ultrasons thérapeutiques
Par rapport à l’échographie à but diagnostique, les ultrasons thérapeutiques utilisent des ondes de plus haute intensité, qui sont délivrées en continu en un point précis du tissu. Elles engendrent un échauffement thermique et des modifications locales (création de bulles de gaz, nécrose
nécrose
Mort incontrôlée d’une cellule, entraînant la mort des cellules voisines.
, coagulation) qui vont participer à l’effet thérapeutique recherché. Les ultrasons sont ainsi utilisés pour détruire des lésions bénignes ou malignes (tumeurs, calcifications, calculs…).
Utilisations thérapeutiques des ultrasons
Les ultrasons focalisés de haute intensité (High Intensity Focused Ultrasound ou HIFU) permettent de répéter le traitement, sans risque de dose limite comme avec les traitements ionisants, et d’atteindre des organes même profonds sans nécessiter d’incision, contrairement aux traitements par radiofréquence ou par laser. Cependant, certains tissus sont moins accessibles que d’autres, selon la nature de ceux qui doivent être préalablement franchis (os notamment). Actuellement, les HIFU sont principalement utilisés dans le traitement de certains cancers (foie, prostate), des fibromes utérins, ou du glaucome. Ils sont couplés à un monitorage précis de la destruction tissulaire, en temps réel, grâce au suivi par IRM des modifications locales de température.
La lithotripsie est une technique se fondant sur l'utilisation d'ultrasons pour briser des calculs rénaux ou biliaires : des ondes de chocs émises à intervalle réguliers créent localement des bulles de gaz qui s’agglomèrent pour imploser à la surface du calcul (phénomène de cavitation). Elles le désagrègent progressivement en fragments inframillimétriques, éliminés ensuite par les voies naturelles.
Sur le même principe, la phacoémulsification permet de détruire le cristallin opacifié lors du traitement de la cataracte. Les fragments sont ensuite évacués par un système d’irrigation-aspiration.
Quels sont les paramètres des ondes déterminant leur utilisation ?
Une onde est caractérisée par plusieurs paramètres : son amplitude, la durée du tir (ou burst de signal) et le nombre de répétition de ces tirs.
En imagerie, l’amplitude des ondes utilisées est de l’ordre du mégapascal, émis pendant une microseconde. En thérapeutique (HIFU), l’amplitude est la même mais le burst dure plusieurs secondes, créant une intensité et une énergie acoustique élevée. Enfin, dans la lithotripsie, l’amplitude doit être beaucoup plus élevée, afin d’offrir une puissance suffisante pour détruire une calcification de façon mécanique, mais très courte, afin qu’elle ne chauffe pas.
Des bursts plus longs, mais d’amplitude limitée permettent de moduler l’activité des neurones. Et en utilisant des ultrasons émis sur une courte durée (100 microsecondes), on peut aussi créer une palpation à distance des tissus (élastographie).
Représentation du système microvasculaire du cerveau d’un rat à partir des vitesses des bulles qui le parcourent. L’échographie ultrarapide permet de réaliser de l’élastographie par ondes de cisaillement et de l’imagerie fonctionnelle du cerveau par ultrasons. ©ESPCO/Inserm/CNRS
Les enjeux de la recherche dans le domaine des ondes ultrasonores
Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des ondes ultrasonores surviennent à une vitesse exponentielle. De nombreuses évolutions scientifiques et technologiques sont apportées aux méthodes conventionnelles, pour augmenter leurs performances. Elles permettent l'obtention d'images de plus en plus précises, plus quantitatives et plus fonctionnelles des tissus. À plus longue échéance, la miniaturisation des systèmes échographiques permettra même de proposer une neuromodulation par implantation de sondes. Parallèlement, le coût des appareillages devrait diminuer, permettant leur large diffusion.
Vers de nouvelles applications diagnostiques
Dans un premier temps, les progrès se sont notamment concentrés sur la rapidité d’acquisition et de traitement de l’information. Grâce à un nouveau principe de transmission des ondes ultrasonores (l'holographie acoustique par ondes planes), les images sont acquises à un rythme bien plus rapide qu’auparavant (de 50 à 10 000 images par seconde) : l’imagerie ultrasonore ultrarapide offre non seulement les informations habituelles de l’échographie, mais elle en apporte également d’autres, telles que la dureté des tissus.
Cette méthode, dite d’élastographie, permet d’ores et déjà d’améliorer le diagnostic ou l’évaluation de maladies du foie ou de la thyroïde de façon non invasive. De fait, la place des ultrasons dans l’imagerie ne cesse d’être redéfini grâce aux progrès techniques franchis régulièrement. Ainsi, ces méthodes sont évaluées dans de nouveaux domaines, comme l’évaluation de la dureté des tumeurs à visée pronostique. La dureté du tissu cardiaque constitue un autre champ d’investigation : la rigidité cardiaque est un paramètre jusqu’à présent inaccessible par d’autres techniques d’évaluation. Sa mesure permettrait pourtant de faciliter le diagnostic de l’insuffisance cardiaque chez près de la moitié des personnes touchées, pour lesquelles aucune mesure directe n’est possible.
L’ultrafast Doppler améliore énormément la sensibilité de l’écho-Doppler classique, permettant d’étudier des vaisseaux de plus petit calibre. La cadence ultrarapide offre une meilleure sensibilité et permet d’observer les vaisseaux dans lesquels le flux sanguin n’est plus assez rapide pour être mesurable par le Doppler classique. Elle constitue ainsi une nouvelle méthode d’exploration in vivo de la dynamique du réseau vasculaire, depuis les plus gros vaisseaux jusqu’à ceux de plus petit calibre, au niveau desquels a lieu le couplage neurovasculaire (interface entre artérioles et neurones). Cet outil peut notamment offrir de nouvelles modalités d’exploration fonctionnelle et des mesures d’évaluation dans les pathologies neurovasculaires. La preuve de concept
preuve de concept
Démonstration de l’intérêt d’une invention ou d’une technologie.
a d’ores et déjà été apportée et son utilisation clinique dans l’évaluation de la fonction cérébrale des nouveaux-nés devrait se développer dans les prochaines années.
Utilisations diagnostiques des ultrasons
La super-résolution a également permis de développer une méthode de microscopie ultrasonore, qui offre le moyen d’évaluer le réseau des capillaires humains, dont le diamètre n’est que de quelques microns, à plusieurs centimètres de profondeur et de façon non invasive . Dans cette approche, les microbulles de gaz créées par les ultrasons permettent aux ondes d’être renvoyées dans toutes les directions. Couplée à une acquisition ultrarapide, cette approche permet de détecter la position de chaque bulle indépendante à chaque instant, pour offrir une cartographie des microvaisseaux jusqu’à une échelle microscopique depuis la surface du corps. Les perspectives sont nombreuses dans la recherche en neurosciences, en oncologie, dans le diabète (où l’atteinte des microvaisseaux est une préoccupation majeure) ou dans le domaine cardiovasculaire. L’intérêt de cette approche serait d’améliorer la compréhension des mécanismes physiopathologiques précoces qui ne sont actuellement identifiés qu’à un stade plus avancé de la maladie, au niveau des plus gros vaisseaux.
Vers de nouvelles applications thérapeutiques
Plusieurs approches thérapeutiques innovantes, mettant en œuvre différents types d’ondes ultrasonores, sont en développement :
Dans le domaine de la psychiatrie, des ondes dont la puissance est intermédiaire à celles utilisées en imagerie et en thérapie pourraient permettre une neuromodulation ultrasonore, en alternative à la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) aujourd’hui utilisée dans le traitement de la dépression résistante aux médicaments.
Par ailleurs, à l’image de ce qui se pratique déjà avec la lithotripsie des calculs rénaux, la combinaison des ultrasons diagnostiques et thérapeutiques à travers un même appareillage est une approche en cours de développement pour observer et traiter les pathologies des valves cardiaques et les sténoses
sténoses
Modification anatomique qui donne lieu à un rétrécissement d’une structure.
aortiques liées à leur calcification : cette approche permet de localiser les zones calcifiées et d’appliquer simultanément des ondes de chocs permettant leur destruction. La preuve de concept a été apportée par des chercheurs de l'Institut Langevin et conduit à la création d'une start-up (Cardiawave). Cette méthode pourrait devenir une alternative non invasive simple à la chirurgie conventionnelle, délicate à mettre en œuvre chez les personnes âgées (qui constituent la majorité des patients concernés). Les premiers essais cliniques sont planifiés. Une approche similaire est également développée dans la prise en charge des thrombus veineux (phlébite).
Enfin, la délivrance d’un médicament au niveau de tissus cibles est une approche thérapeutique émergente utilisant indirectement les ultrasons : Des microgouttelettes transportant un médicament encapsulé sont administrées dans la circulation sanguine. Une fois le tissu cible atteint par le produit, le phénomène de cavitation lié à des bulles de gaz créées par les ultrasons est utilisé pour déclencher la libération du médicament. L’approche est particulièrement étudiée dans le domaine du traitement du cancer, où l’objectif est de limiter la toxicité associée au traitement sur les cellules saines, tout en optimisant l’activité thérapeutique au niveau de la tumeur.
Cette approche est en outre intéressante pour rendre certains tissus plus accessibles aux médicaments, en particulier pour permettre le passage de la barrière hématoencéphalique (BHE). Cette structure, dont le rôle est de limiter le passage de toxiques depuis la circulation vers le tissu cérébral, rend le traitement des maladies du système nerveux central
système nerveux central
Composé du cerveau et de la moelle épinière.
(notamment tumorales) difficile. Grâce aux oscillations mécaniques qu’elles provoquent, les ondes ultrasonores pourraient temporairement perméabiliser la BHE, autorisant le passage de médicaments. La délivrance localisée d’un traitement (biothérapie, thérapie génique) par ultrasons, associée à un contrôle visuel par IRM, fait actuellement l’objet de travaux chez l’animal. Elle permettrait de disposer d’une procédure non invasive pour traiter certaines pathologies cérébrales.
L’accélérateur de recherche technologique (ART) : une structure Inserm inédite pour booster le passage de la recherche sur les ultrasons à leur application
L’Inserm a inauguré son premier accélérateur de recherche technologique (ART) en novembre 2016, dédié aux ultrasons biomédicaux. Cette nouvelle forme d’organisation vise à rapprocher physiciens, biologistes, cliniciens d’une équipe d’ingénieurs, afin d’accélérer le développement d’appareillages ou techniques prototypes et leur utilisation par des laboratoires de recherche et des centres hospitaliers partenaires.
Installé au sein de l’ESPCI Paris, l’ART a jusqu’à présent développé une quinzaine de prototypes uniques au monde, dont l’utilisation vise le domaine des maladies cardiovasculaires, des neurosciences et du cancer. Certains sont d’ores et déjà déployés en recherche clinique, comme l’élastographie ultrasonore ou la neuroimagerie fonctionnelle.
Cette structure permet d’accélérer le développement et la dissémination de technologies de pointe auprès des laboratoires et des services hospitaliers partenaires, leur offrant une avance importante sur le plan international.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
MÃMOIRE |
|
|
| |
|
| |
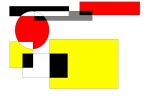
Mémoire
Sous titre
Une affaire de plasticité synaptique
La mémoire permet d'enregistrer des informations venant d'expériences et d'événements divers, de les conserver et de les restituer. Différents réseaux neuronaux sont impliqués dans de multiples formes de mémorisation. La meilleure connaissance de ces processus améliore la compréhension de certains troubles mnésiques et ouvre la voie à des interventions auprès des patients et de leur famille.
Dossier réalisé en collaboration avec Francis Eustache, directeur de l'unité 1077 Inserm/EPHE/UNICAEN, Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine
Comprendre le fonctionnement de la mémoire
La mémoire est la fonction qui nous permet d’intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Elle fournit la base de notre identité.
Cinq systèmes interconnectés
La mémoire se compose de cinq systèmes interconnectés, impliquant des réseaux neuronaux distincts :
* La mémoire de travail (à court terme) est au cœur du réseau.
* La mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont deux systèmes de représentation consciente à long terme.
* La mémoire procédurale permet des automatismes inconscients.
* La mémoire perceptive est liée aux différentes modalités sensorielles.
On rassemble parfois toutes les mémoires autres que celle de travail sous le nom générique de mémoire à long terme. Par ailleurs, on distingue souvent les mémoires explicites (épisodique et sémantique) des mémoires implicites (procédurale et perceptive).
La mémoire de travail
La mémoire de travail (ou mémoire à court terme) est la mémoire du présent. Elle permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d’une tâche ou d’une acticité.
Cette mémoire est sollicitée en permanence : c’est elle qui permet par exemple de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter, ou de retenir le début d’une phrase le temps de la terminer. Elle utilise une boucle phonologique (répétition mentale), qui retient les informations entendues, et/ou un calepin visuospatial, qui conserve les images mentales.
Elle fonctionne comme une mémoire tampon : les informations qu’elles véhiculent peuvent être rapidement effacées, ou stockées dans la mémoire à long terme par le biais d’interactions spécifiques entre le système de mémoire de travail et la mémoire à long terme.
7, le nombre magique
On estime que le nombre de chiffres, de lettres, ou de mots qu’une personne peut restituer immédiatement dans l’ordre proposé est égal à 7, plus ou moins deux (on parle de l'empan verbal). Il peut être augmenté en regroupant les données (une série de 8 chiffre est plus facile à retenir lorsqu’ils sont groupés par 2 que lorsqu’ils sont pris isolément). Par ailleurs, une série de mots est d’autant plus facile à retenir qu’ils sont courts ou qu’ils sont proches phonologiquement ou sémantiquement.
La mémoire sémantique
La mémoire sémantique est celle du langage et des connaissances sur le monde et sur soi, sans référence aux conditions d'acquisition de ces informations. Elle se construit et se réorganise tout au long de notre vie, avec l’apprentissage et la mémorisation de concepts génériques (sens des mots, savoir sur les objets), et de concepts individuels (savoir sur les lieux, les personnes…).
La mémoire épisodique
La mémoire épisodique est celle des moments personnellement vécus (événements autobiographiques), celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l’espace et, ainsi, de se projeter dans le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux.
La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans. Elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment, à terme, en connaissances générales.
La mémoire procédurale
La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo ou jouer de la musique sans avoir à réapprendre à chaque fois. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c’est-à-dire inconsciente : la personne ne peut pas vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur ses skis ou descend sans tomber. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés.
La constitution de la mémoire procédurale est progressive et parfois complexe, selon le type d’apprentissage auquel la personne est exposée. Elle se consolide progressivement, tout en oubliant les traces relatives au contexte d’apprentissage (lieu, enseignant…).
La mémoire perceptive
La mémoire perceptive s’appuie sur nos sens et fonctionne la plupart du temps à l’insu de l’individu. Elle permet de retenir des images ou des bruits sans s’en rendre compte. C’est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude, grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux.
Avec la mémoire procédurale, la mémoire perceptive offre à l’humain une capacité d’économie cognitive, qui lui permet de se livrer à des pensées ou des activités spécifiques tout en réalisant des activités devenues routinières.
Mémorisation : De l’organisation cérébrale….
Il n’existe pas "un" centre de la mémoire dans le cerveau. Les différents systèmes de mémoire mettent en jeu des réseaux neuronaux distincts, répartis dans différentes zones du cerveau. L’imagerie fonctionnelle (tomographie
tomographie
Technique d’imagerie cérébrale permettant de reconstituer le volume en coupes d’un objet, tel que le cerveau.
par émission de positons, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) permet aujourd’hui d’observer le fonctionnement cérébral normal impliqué dans les processus cognitifs.
Ainsi, le rôle de l’hippocampe et du lobe frontal semble particulièrement déterminant dans la mémoire épisodique, avec un rôle prépondérant des cortex préfrontaux gauche et droit dans son encodage et sa récupération, respectivement. La mémoire perceptive recrute des réseaux dans différentes régions corticales, à proximité des aires sensorielles. La mémoire sémantique fait intervenir des régions très étendues, et particulièrement les lobes temporaux et pariétaux. Enfin, la mémoire procédurale recrute des réseaux neuronaux sous-corticaux et au niveau du cervelet.
La phase de stockage de l’information nécessite des étapes répétées de consolidation. L’hippocampe semble constituer un élément important dans le processus. Enfin, la restitution d’un souvenir, quelle que soit son ancienneté, reposerait également sur cette structure cérébrale, en interaction avec différentes régions néocorticales. Pour autant, il serait moins sollicité lorsque le rappel provient de la mémoire sémantique plutôt que de la mémoire épisodique.
...à la plasticité synaptique
La mémorisation résulte d’une modification des connexions entre les neurones d’un système de mémoire : on parle de "plasticité synaptique". Les différentes formes de mémoire fonctionnent en interaction, selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique, implicite ou explicite. Ainsi, un souvenir se traduit par l’intervention de neurones issus de différentes zones cérébrales et assemblés en réseaux. Ces connections interneuronales évoluent constamment au gré des expériences et sont responsables de la persistance d’un souvenir à long terme ou non, selon les cas (importance de l’évènement, contexte environnemental et émotionnel…).
Pris isolément, le souvenir correspond à une variation de l’activité électrique au niveau d’un circuit spécifique formé de plusieurs neurones interagissant par le biais des connexions synaptiques (les synapses
synapses
Zone de communication entre deux neurones.
étant les points de contacts entre les neurones). Sa formation repose sur le renforcement ou la création d’une connexion synaptique temporaire, stimulée par le biais de protéines produites puis transportées au sein des neurones, comme le glutamate
glutamate
Neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central.
, le NMDA ou la syntaxine qui va elle-même moduler la libération du glutamate.
Le souvenir est ensuite consolidé ou non en fonction la présence de médiateurs cellulaires au niveau du réseau neuronal impliqué dans les heures suivantes. L’activation régulière et répétée de ce réseau permettrait de renforcer ou de réduire ces connexions et, par conséquent, de consolider ou oublier ce souvenir. Sur le plan morphologique, cette plasticité est associée à des changements de forme et de taille des synapses, des transformations de synapses silencieuses en synapses actives, la croissance de nouvelles synapses.
Le maintien à long terme d’un souvenir repose sur la modification de la cinétique d’élimination ou de renouvellement de certains médiateurs. La phosphokinase zêta (PKM zêta) joue un rôle prépondérant dans ce mécanisme en favorisant la persistance des mécanismes impliqués dans la stabilisation et la consolidation des souvenirs. Elle possède pour cela deux propriétés spécifiques : elle n’est soumise à aucun mécanisme d’inhibition et elle s'auto-réplique.
Au cours du vieillissement, la plasticité des synapses diminue et les modifications des connexions sont plus éphémères, ce qui pourrait expliquer des difficultés croissantes à retenir des informations.
La réserve cognitive, soutien de la mémoire
Les capacités de maintien de la mémoire et d’adaptation en cas de lésions semblent variables d’un individu à l’autre. En effet, il a été décrit qu’à lésions cérébrales équivalentes en imagerie, tous ne présenteraient pas les mêmes altérations cognitives. Ces capacités dépendraient de la réserve cérébrale, relative au tissu cérébral, et de la réserve cognitive, qui repose sur sa fonctionnalité.
Selon différentes études, un volume cérébral accru, ou un nombre élevé de neurones ou de synapses est associé à une survenue plus tardive de démence. À lésions équivalentes, ceux qui présentent une réserve cérébrale plus importantes présenteraient des troubles moins sévères. Cette réserve cérébrale serait sous l’influence de paramètres génétiques et probablement environnementaux.
La réserve cognitive correspond à l’efficacité des réseaux neuronaux impliqués dans la réalisation d’une tâche et celle du cerveau à mobiliser ou mettre en place des réseaux compensatoires en cas de lésions pathologiques ou de perturbations physiologiques liées à l’âge. Elle se traduit également par une variabilité, d’un sujet à l’autre, de la tolérance des lésions cérébrales identiques. En effet, les données disponibles suggèrent que la richesse des interactions et le niveau d’éducation sont associés à une survenue plus tardive des troubles cognitifs ou des démences Alzheimer ou apparentées. À l’inverse, l’évolution du déclin cognitif chez ces derniers serait plus rapide une fois installé : elle s’expliquerait par le fait que les symptômes sont identifiés à un stade où les lésions sont plus nombreuses et importantes.
La constitution de la réserve cognitive pourrait dépendre:
* de l’importance des apprentissages
* du niveau d’éducation
* d’une stimulation intellectuelle tout au long de la vie
* de la qualité des relations sociales
* de l’alimentation
* du sommeil
* des paramètres génétiques seraient également probablement impliqués
Hygiène de vie et mémoire
Des expériences ont montré que dormir améliore la mémorisation, et ce d’autant plus que la durée du sommeil est longue. A l’inverse, des privations de sommeil (moins de 4 ou 5 heures par nuit) sont associées à des troubles de la mémoire et des difficultés d’apprentissage. Par ailleurs, le fait de stimuler électriquement le cerveau (stimulations de 0,75 Hz) pendant la phase de sommeil lent (caractérisée par l’enregistrement d’ondes corticales lentes à l’encéphalogramme) améliore les capacités de mémorisation d’une liste de mots. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène : pendant le sommeil, l’hippocampe est au repos, évitant les interférences avec d’autres informations au moment de l’encodage du souvenir. Il se pourrait aussi que le sommeil exerce un tri, débarrassant les souvenirs de leur composante émotionnelle pour ne retenir que l’informationnelle, facilitant ainsi l’encodage. Pour en savoir plus, consulter le dossier Sommeil.
Le sommeil n'est pas le seul paramètre d’hygiène de vie qui influence notre capacité de mémorisation : l’alimentation (bénéfice du régime méditerranéen), l’activité physique et les activités sociales jouent également un rôle important.
Mémoire et émotions : de l’amélioration mnésique à la pathologie
Il est démontré que les émotions peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée, l’émotion renforçant ponctuellement l’attention. Ainsi, une émotion positive peut se traduire par une amélioration ponctuelle des performances mnésiques. Il apparaît également que la consolidation, et donc la rétention d’une information est favorisée par l’émotion : le rappel d’un souvenir émotionnel après un long intervalle est souvent plus important que lorsque ce souvenir est neutre. L’imagerie fonctionnelle montre d’ailleurs que le rappel des souvenirs est proportionnel à leur intensité émotionnelle qui peut être observée par l’activation de l’amygdale, siège des émotions. Enfin, la récupération d’un souvenir est aussi améliorée par la présence d’une émotion positive. Chez les personnes présentant un trouble cognitif, les expériences montrent un effet protecteur des émotions positives sur les capacités résiduelles de mémoire. Ce mécanisme existe cependant uniquement dans les premiers stades de la maladie. Ensuite, l’incapacité de l’amygdale à remplir son rôle rend ce mécanisme compensatoire inefficace.
Il existe un pendant pathologique à ce processus : en effet, une émotion trop intense, notamment traumatique, entraîne une distorsion de l’encodage. L’état de stress post-traumatique (ESPT) des personnes victimes ou témoins d’un évènement dramatique en est l’illustration type. Le souvenir est mémorisé sur le long terme, avec à la fois une amnésie de certains aspects et une hypermnésie d’autres détails qui laissent la personne hantée durablement par cet événement. Il s’accompagne d’une décharge de glucocorticoïdes
glucocorticoïdes
Hormones stéroïdiennes ayant une action sur le métabolisme protéique et glucidique.
(hormone du stress), dans l’hippocampe au moment de l’événement. Cette distorsion profonde de l’encodage des événements, au contraire d’un souvenir normal, rend le souvenir persistant au cours du temps sans qu’il ne perdre de son intensité ou de sa spécificité. La victime a ainsi le sentiment de revivre continuellement la scène traumatisante, même des années après.
Dans d’autres situations ayant également trait à une émotion vive (stress, agression...), certains sujets développent plus volontiers une amnésie dissociative : véritable stratégie défensive adaptative, développée de façon inconsciente, elle repose sur l’oubli d’une partie des souvenirs autobiographiques ou sémantiques, ainsi que de l’évènement l’ayant déclenchée. Ces souvenirs peuvent être réactivés, progressivement ou brutalement, à l’issue d’une conscientisation de l’évènement déclencheur.
Sur le plan thérapeutique, la compréhension des mécanismes de stabilité des souvenirs et de l’influence émotionnelle offrent les moyens d’envisager la prise en charge thérapeutique de certaines pathologies : ainsi, le développement d’approches psychothérapeutiques fondées sur la dissociation entre les souvenirs et les émotions peut permettre de réduire le handicap lié à des maladies comme certaines formes d’anxiété ou l’état de stress post-traumatique.
Mémoire et oubli : du physiologique au pathologique
Depuis une vingtaine d’années, la prévalence
prévalence
Nombre de cas enregistrés à un temps T.
croissante des troubles de la mémoire tel que la maladie d’Alzheimer, a fait de l’oubli un symptôme. Pourtant, l’oubli est aussi un processus physiologique, indispensable au bon fonctionnement de la mémoire.
En effet, l’oubli est nécessaire pour l’équilibre du cerveau, permettant à ce dernier de sélectionner les informations secondaires qu’il est possible d’éliminer afin de ne pas saturer les circuits neuronaux. L’oubli est un corollaire de la qualité de la hiérarchisation et de l’organisation des informations stockées. Ainsi, certaines personnes souffrent d’hypermnésie idiopathique
idiopathique
Qui existe par soi-même, indépendamment d’une autre maladie.
, une pathologie de l’abstraction et de la généralisation du souvenir dans laquelle l’oubli des détails est aboli. Ces personnes rencontrent des difficultés de vie quotidienne liées à l’incapacité d’organiser leurs souvenirs en fonction de leur significativité et de leur importance.
Cependant, l’oubli peut aussi correspondre à la disparition involontaire de souvenirs acquis par apprentissage volontaire ou implicite, alors que son codage a été réalisé correctement. Ce phénomène reste physiologique tant qu’il est sporadique. Il concerne plus souvent la mémoire épisodique que la mémoire sémantique, procédurale ou sensorielle. Il devient pathologique, et prend plus volontiers le nom d’amnésie, lorsqu’il concerne des pans entiers de mémoire sémantique ou épisodique.
Les multiples troubles de la mémoire
Certaines situations entraînent des incapacités sévères et des amnésies durables. Les causes possibles sont :
* un traumatisme physique entraînant des lésions cérébrales
* un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique
* une tumeur du cerveau
* ou encore une dégénérescence neuronale comme la maladie d’Alzheimer
Dans d’autres cas, les troubles sont moins sévères et le plus souvent réversibles. Les causes possibles sont :
* des maladies mentales comme la dépression
* le stress et l’anxiété, ou la fatigue
* un événement traumatisant (deuil)
* des effets indésirables de médicaments comme des somnifères, des anxiolytiques (d’autant plus fréquent que la personne est âgée)
* l’usage de drogues
Les troubles de la mémoire ont différentes origines biologiques, comme un déficit en certains neuromédiateurs ou une faible connectivité entre les réseaux cérébraux.
Les manifestations de ces troubles sont extrêmement variables selon leur origine et les localisations cérébrales des processus pathologiques. Ainsi, des patients atteints d’une démence sémantique, dans laquelle des mots ou des informations sont oubliés, perdent également des souvenirs anciens alors qu’ils continuent à mémoriser de nouveaux souvenirs épisodiques (souvenirs "au jour le jour"). Ces troubles sont associés à une atrophie des lobes temporaux. Chez d’autres patients, notamment ceux souffrant de la maladie d’Alzheimer, les troubles concernent la mémoire épisodique : chez eux, les souvenirs les plus anciens sont épargnés plus longtemps que les plus récents. D’autres types de déficiences existent : celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire procédurale peuvent engendrer la perte de certains automatismes, comme chez les personnes atteintes par la maladie de Parkinson ou de Huntington. Celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire du travail, peuvent quant à elles donner des difficultés à se concentrer et à faire deux taches en même temps.
Il existe également des troubles de la mémoire sévères mais transitoires, comme l’ictus amnésique idiopathique : survenant le plus souvent entre 50 et 70 ans, il s’agit d’une amnésie soudaine et massive pendant laquelle le patient est incapable de se souvenir de ce qu’il vient de faire, sa mémoire épisodique est annihilée. Mais sa mémoire sémantique est intacte : il peut répondre à des questions de vocabulaire et évoquer des connaissances générales. Cette amnésie disparaît souvent après six à huit heures.
Les enjeux de la recherche
La mémoire et ses troubles donnent lieu à de nombreuses recherches qui font appel à des expertises variées dans un cadre pluridisciplinaire : génétique, neurobiologie, neuropsychologie, électrophysiologie, imagerie fonctionnelle, épidémiologie, différentes disciplines médicales (neurologie, psychiatrie…), mais aussi sciences humaines et sociales.
Ma mémoire et celle des autres
La mémoire a longtemps été considérée comme individuelle et étudiée comme telle. Cette approche est aujourd’hui caduque, ou du moins incomplète. Le souvenir se situe en effet à l’interface entre l’identité personnelle et les représentations collectives : il se constitue à partir des interactions entre la personne, les autres et l’environnement. Il ne peut être détaché du contexte social dans lequel il prend place. Les interactions, mais aussi les représentations sociales et les stéréotypes influencent le fonctionnement de notre mémoire.
On parle de cognition sociale : elle permet, par exemple, d’adapter son comportement selon le contexte dans lequel on se trouve, et cela grâce à la mémorisation et l’analyse des expériences passées. L’empathie découle également de cette notion interindividuelle de la mémoire : elle utilise notamment les informations de la mémoire épisodique afin de permettre un "voyage de l’esprit" se traduisant en capacité à partager la détresse de l’autre. Aussi appelée "théorie de l’esprit", cette capacité à se mettre à la place de quelqu’un et à imaginer et interpréter ses pensées fait appel à nos mémoires dont nous décentrons l’objet. Sur le plan médical, la dégénérescence des neurones au niveau frontotemporal, retrouvée dans certaines démences (Alzheimer et apparentées), se caractérise par une diminution de la cognition sociale : le malade peut présenter des troubles du comportement ou des dysfonctionnements sociaux.
Par ailleurs, sur un plan plus large, il existe aussi une mémoire collective ou culturelle, celle qui prend place autour des évènements historiques (autour de leur évocation ou de leur commémoration) et des évènements contemporains médiatisés. Il s’agit d’une mémoire partagée constituée des différentes représentations de l’évènement par l’ensemble des personnes.
Ce domaine de recherche est particulièrement novateur et rapproche les expertises en neurosciences et en psychologie de celles en sociologie, en histoire, en philosophie ou en éthique. En termes thérapeutiques, cette transdisciplinarité peut également apporter un intérêt : l’état de stress post-traumatique correspond par exemple à une hypermnésie des perceptions et émotions liées à l’évènement, à une amnésie des aspects contextuels, ainsi qu’à une perturbation de la mémoire autobiographique. À la suite d’un évènement traumatisant, une prise en charge appropriée de la charge émotionnelle associée pourrait être d’autant plus efficace que l’évènement en question est inscrit dans le cadre social, à la fois familial et professionnel. Il en serait d’autant plus question dans le cadre d’un évènement inscrit dans la mémoire collective.
Sonder la mémoire individuelle et collective des attentats
Le programme 13-Novembre, mené par des chercheurs de l’Inserm et du CNRS, associe différents volets de recherche transdisciplinaire autour du témoignages recueillis sur les attentats du 13 novembre 2015. Il cherche à évaluer comment le souvenir traumatique des attentats évolue dans les mémoires individuelles et collectives, comment les deux fonctionnent en interaction et quels sont les facteurs de vulnérabilité face à l’ESPT. À quatre reprises durant dix ans, les témoignages et les éventuels troubles (ESPT, images envahissantes, dépression…) de 1 000 personnes volontaires seront analysés selon leur proximité avec les attentats : cette cohorte rassemble des personnes exposées directement (survivants, témoins, familles), indirectement (habitants des quartiers des attentats) ainsi que des habitants franciliens ou non franciliens. Ces données seront recueillies parallèlement à une analyse de l’opinion des français sur le sujet, ainsi qu’une analyse du discours et de la textométrie des informations télévisuelles ou radiophoniques liés à ces évènements, afin d’en identifier les interactions.
La mémoire au futur
Selon le contexte, nos propres aspirations, nos projets, nous avons une capacité à élaborer des scénarios plausibles pour le futur, constitués de pensées, d’images et d’actions. Ceux-ci ne peuvent prendre forme que sur la base des représentations du passé. La mémoire du futur fait donc appel à notre mémoire épisodique et sémantique, contrairement aux idées reçues ou aux conceptions habituelles de la mémoire, traditionnellement associées au passé. Ainsi, l’imagerie permet de vérifier que l’évocation d’un souvenir autobiographique ou l’imagination d’un scénario futur font intervenir des régions cérébrales très proches les unes des autres. Par ailleurs, les études montrent que les amnésiques ne peuvent se projeter dans le futur.
La capacité à remplir une tâche à une date ou un jour précis entre aussi dans le cadre de la mémoire du futur : on l’appelle alors plus volontiers mémoire prospective, articulée autour de différents volets selon la nature des tâches à effectuer : "mémoire prospective propre" pour les actions ponctuelles (poster une lettre, aller à un rendez-vous…), "mémoire prospective habituelle" pour toutes les tâches routinières, "monitoring" pour l’attention portée à la fin d’une tâche tandis qu’une autre est en cours (penser à arrêter le four à la fin d’une cuisson, par exemple).
Cette notion de mémoire du futur peut avoir des applications thérapeutiques. Ainsi, des "thérapies orientées vers le futur" ont été développées et testées auprès de patients souffrant de dépression majeure ou de schizophrénie : menées à travers plusieurs séances réparties sur quelques semaines, elles consistent à sensibiliser les sujets sur l’importance des projections mentales dans le futur, la façon dont celles-ci peuvent être améliorées en luttant contre des mécanismes personnels de résistance, puis, progressivement à leur proposer des activités de pleine conscience et, enfin, à travailler sur l’évocation de leurs propres valeurs, leurs objectifs, et les moyens d’y arriver. Les premières études montrent que cette approche peut être plus efficace que les thérapies cognitivo-comportementales
thérapies cognitivo-comportementales
Traitement des difficultés du patient dans « l’ici et maintenant » par des exercices pratiques centrés sur les symptômes observables au travers du comportement.
conventionnelles.
Mémoires externes
Il semble clair aujourd’hui que notre mémoire interne et nos capacités de projection sont influencées par la mémoire externe : les supports de mémoire collective (livres, films…) sont un élément utile pour modeler notre mémoire du futur. La multiplication des dispositifs électroniques de stockage d’information dans notre quotidien est cependant décrite comme modifiant l’organisation et la puissance de notre mémoire, que nous sollicitons par conséquent moins. Cet équilibre entre mémoire interne et externe constitue un enjeu majeur pour l’avenir.
Sur le plan thérapeutique, les supports externes de stockage sont aujourd’hui testés sous forme d’implants cérébraux dans la prise en charge de patients amnésiques. De façon plus futuriste, l’idée de greffe de mémoire artificielle fait également l’objet de développements actuels.
Modifier la mémoire grâce à l'optogénétique
Outre l’imagerie fonctionnelle, qui fait aujourd’hui partie des modes d’exploration incontournables de l’organisation mnésique, d’autres approches sont plus récentes et en pleine évolution. C’est notamment le cas de l’optogénétique, qui est une technique alliant génétique et optique : elle consiste à modifier génétiquement des cellules afin de les rendre sensibles à la lumière et, grâce à cette dernière, d’en moduler le fonctionnement. Ainsi, l’optogénétique permet d’activer ou d’inhiber expérimentalement des groupes spécifiques de neurones dans le tissu cérébral et d’en évaluer l’impact.
Elle permet aussi de développer des méthodes de manipulation de la mémoire (implantations de faux souvenirs, oubli expérimental…). Ces travaux permettent d’envisager des approches thérapeutiques intéressantes dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Paludisme |
|
|
| |
|
| |

Paludisme
Sous titre
Une maladie parasitaire essentiellement transmise par le moustique
Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par un moustique, se manifestant par de la fièvre et des troubles digestifs mais pouvant entraîner des complications importantes, voire le décès du malade. Au niveau mondial, la mortalité associée à cette maladie ne se compare qu’à celle associée à la tuberculose ou au sida. L’enjeu immédiat est d’élargir l’accès des populations vivant dans les zones endémiques à des traitements efficaces et aux moyens de prévention existants. La recherche travaille à la mise au point de nouveaux traitements préventifs, curatifs et/ou de vaccins, qui permettront peut-être un jour d’éradiquer la maladie.
Dossier réalisé en collaboration avec Dominique Mazier (unité de recherche 1135 Inserm/UPMC, Centre d'immunologie et des maladies infectieuses, Paris)
Comprendre le paludisme
Il existe cinq espèces de Plasmodium différentes infectant l’homme : Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium knowlesi. Elles se différencient par la zone géographique où elles sévissent et par le profil de symptômes auxquelles ils exposent.
* P. falciparum est le parasite qui provoque le plus de cas graves et la majorité des décès liés au paludisme. On le trouve dans les zones tropicales et subtropicales du monde entier.
* P. vivax sévit surtout en Asie et en Amérique latine, ainsi que dans certaines régions d’Afrique. Il est nettement moins virulent que P. falciparum, mais le nombre de décès liés à P. vivax semble augmenter ces dernières années.
* P. ovale sévit surtout en Afrique de l’Ouest. Les symptômes qu’il provoque sont généralement modérés.
P. vivax et P. ovale, contrairement à P. falciparum, peuvent persister dans le foie sous forme dormante. La maladie peut dont ré-émerger régulièrement au cours de la vie d’un individu infecté, provoquant chaque fois l’apparition des symptômes typiques du paludisme.
* P. malariae, moins fréquemment rencontré, est répandu dans le monde entier.
* P. knowlesi touchait initialement le singe, mais il est reconnu responsable de nombreux cas humains recensés en Asie du Sud Est depuis quelques années.
Les pays du Sud, premières victimes
Le paludisme sévit depuis des milliers d’années dans les zones marécageuses de l’ensemble du globe. A partir du 20e siècle, les pays occidentaux ont asséché ces territoires humides, ce qui a permis de diminuer fortement les populations de moustiques vecteur du parasite dans ces pays au climat peu favorable à la transmission.
Dans les pays du Sud, en revanche, la lutte contre le paludisme est une gageure. Pour autant, l’action des organisations internationales, le financement des moyens de lutte par le Fonds mondial et l’implication d’ONG et d’acteurs locaux ont permis un certain nombre de succès ces dernières années : même si les chiffres liés à la maladie restent impressionnants, ils sont en régression régulière. Ainsi, entre 2000 et 2013, le nombre d’infections au niveau mondial est passé de 227 à 198 millions et le nombre de décès en découlant de 882 000 à 584 000. Près de 80 % des cas et 90 % de la mortalité concernent l’Afrique. Les autres cas se concentrent dans les régions d’Asie du Sud-Est et d’Asie Centrale (Inde), et plus faiblement en Amérique du Sud amazonienne.
Des symptômes pseudo-grippaux au risque vital
Les premiers symptômes du paludisme se manifestent 9 à 30 jours après l’infection, selon l’espèce de Plasmodium impliquée. Pour P. falciparum (le plus fréquent), cette période d’incubation dure 9 à 14 jours. Lorsque la maladie est dite "simple", le patient souffre essentiellement de fièvre, de frissons, de céphalées et de douleurs musculaires, à l’image d’un syndrome grippal. Souvent, des troubles digestifs (anorexie, nausées, vomissements, diarrhée) et une asthénie (fatigue) apparaissent simultanément.
Le paludisme due à P. falciparum (et dans une moindre mesure à P. vivax) peut être compliqué par l’atteinte d’un organe vital : on parle alors de paludisme grave. Il apparaît d’emblée ou par absence/retard de traitement. Le patient peut alors souffrir de prostration, de détresse respiratoire, de perte de conscience, d’insuffisance rénale… Il peut aussi présenter des complications neurologiques (troubles du comportement, convulsions, coma), qui peuvent entraîner la mort ou laisser des séquelles durables, notamment chez les enfants.
Une personne vivant dans une zone d’endémie stable peut souffrir de plusieurs crises de paludisme à la suite de piqûres répétées. Cependant, la maladie étant partiellement immunisante, les symptômes sont de moins en moins sévères après 3 à 4 ans d’accès. Le risque de paludisme grave concerne donc d’abord les enfants (qui n’ont pas encore été infectés) et les voyageurs qui se rendent pour la première fois dans ces régions. Par ailleurs, les personnes originaires d’une zone endémique qui quittent leur pays durant plusieurs années perdent leur immunisation naturelle et peuvent à nouveau souffrir d’une crise grave de paludisme.
Les femmes enceintes peuvent souffrir de complications spécifiques (anémie aggravée). Elles ont en outre un risque important d’avortement spontané ou de mettre au monde un enfant de faible poids.
Etablir le diagnostic
Pour les voyageurs revenant d’une zone d’endémie, le diagnostic est orienté face à la présence des symptômes typiques du paludisme, puis confirmé par l’observation d’un échantillon de sang au microscope.
Dans les zones d’endémie, des tests d’orientation diagnostique rapide sont disponibles et proposés dès que l’on suspecte un cas de paludisme : une goutte de sang prélevée au bout du doigt est déposée sur une bandelette réactive qui change de couleur en cas d’infection par un Plasmodium.
Un parasite aux multiples visages
Dans l'insecterie, on élève et surveille les moustiques anophèles, dans le cadre des études sur le paludisme. Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, laboratoire UPR 9022 : lutte contre le paludisme et développement du plasmodium chez l'anophèle. © Inserm, P. Latron
Le cycle de vie du Plasmodium est extrêmement complexe et sa forme extrêmement variée selon son stade de développement. C’est la raison pour laquelle il reste encore difficile de développer un vaccin approprié.
Schématiquement, après son introduction dans l’organisme via une piqûre de moustique porteur, le Plasmodium migre en quelques minutes dans les cellules du foie, en empruntant la circulation sanguine. Là, il se multiplie intensément pendant plusieurs jours sans provoquer de symptômes. C’est la phase dite "pré-érythrocytaire". Dans certains cas (P. vivax ou P. ovale), le parasite peut persister dans le foie sous une forme latente, et provoquer des récidives de paludisme des mois ou des années après le premier accès palustre.
Arrive ensuite la phase érythrocytaire, au cours de laquelle apparaissent les symptômes : les milliers de parasites formés sortent des cellules du foie puis pénètrent les globules rouges. Les Plasmodium s’y multiplient à nouveau et détruisent chaque fois les cellules dans lesquelles ils se trouvent avant d’en infecter de nouvelles.
Une partie du cycle de reproduction du parasite se déroule chez le moustique : lorsqu’un anophèle pique une personne malade, il ingère des formes mâles et femelles du Plasmodium présentes dans le sang. Les parasites se reproduisent dans le tube digestif de l’insecte, et passent ensuite dans ses glandes salivaires, via lesquelles ils pourront infecter d’autres personnes à l’occasion d’une prochaine piqûre.
La prévention, outil indispensable de maîtrise de la transmission du paludisme
La prévention est très importante pour lutter contre le paludisme. Elle consiste en premier lieu en des mesures environnementales : assainissement des zones humides, lutte anti-moustique par épandage d’insecticides, protection des habitations par des moustiquaires, notamment les lits dans la chambre à coucher avec des moustiquaires imprégnées d’insecticide (le moustique piquant surtout durant la nuit). A titre individuel, l’utilisation de produits répulsifs anti-moustiques et de vêtements couvrants est nécessaire pour limiter le risque de piqûre.
La prophylaxie médicamenteuse est le second volet important de la prévention. Elle consiste à prendre des médicaments antipaludiques, dont la quinine et la chloroquine sont les plus anciennement connus. Si leur large utilisation pendant de nombreuses années a favorisé l’émergence de résistances, il existe aujourd’hui de nouveaux traitements pour pallier ce problème : artémisinine, artéméther, artésunate, méfloquine, halofantrine, luméfantrine, pipéraquine… Comme pour les antibiotiques, le bon usage de ces molécules doit être favorisé : on doit systématiquement associer une artémisinine à un autre traitement pour éviter l’apparition de nouvelles résistances.
Dans les pays endémiques, la prévention médicamenteuse large à faible dose hebdomadaire a été préconisée il y a quelques années pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Elle n’est plus recommandée car elle a favorisé l’apparition de résistances. Seuls des traitements préventifs intermittents à dose curative sont encore prescrits aux femmes enceintes des zones épidémiques et aux enfants de moins de 5 ans dans les zones de paludisme saisonnier.
L’ensemble de ces précautions ne suffit pas toujours à prévenir le paludisme. En cas de symptômes, le traitement consiste à utiliser ces mêmes molécules durant plusieurs jours, la durée totale dépendant du médicament utilisé. L’enjeu est principalement de les prescrire suffisamment tôt pour éviter toute évolution vers une forme grave de la maladie. Cet enjeu est particulièrement important chez les enfants qui paient le plus lourd tribu à la maladie en termes de nombre de décès. De gros efforts ont été réalisés dans le monde entier, et plus particulièrement en Afrique, pour progresser en ce sens : la mortalité des moins de cinq ans a ainsi diminué de près de 53% depuis 2000.
Les enjeux de la recherche
Les progrès réalisés à travers le monde dans la lutte contre le paludisme sont significatifs. Le maintien de ces efforts, conduisant à l’élargissement de la mise à disposition des moyens préventifs, devrait encore réduire significativement les chiffres liés à la maladie.
Par ailleurs, du côté de la recherche, de nouveaux médicaments antiparasitaires sont en développement pour contrer les résistances qui pourraient apparaître. Les chercheurs étudient en outre l’intérêt d’autres molécules qui, en association au traitement antipaludique proprement dit, pourraient aussi réduire la transmission du parasite à d’autres personnes par le biais des piqûres de moustique.
Une autre approche consiste à s’attaquer au moustique vecteur du parasite : des chercheurs ont ainsi réalisé une modification génétique de l’anophèle qui la rend résistante au Plasmodium en bloquant son cycle de réplication. Il reste à évaluer comment un tel moustique OGM pourrait se comporter dans l’environnement naturel.
La lutte contre P. vivax ou P. ovale demande en outre la mise au point de traitements ciblant les formes dormantes du parasite présentes dans le foie des personnes infectées. Le concept Wake and Kill dans ce but : il associe une molécule capable de réveiller la forme dormante et un traitement habituel du parasite qui permet de l’éliminer dans le même temps.
Le paludisme est provoqué par quatre parasites du genre Plasmodium. Il se développe d'abord chez le moustique (anophèle), qui infecte ensuite l'être humain par piqûre. Un gène appelé TEP1 est à l'origine de la résistance au paludisme chez certains moustiques. © Inserm, Marina Lamacchia
Malgré tout cela, seule la mise à disposition d’un vaccin protecteur à plus de 80% permettra d’envisager la complète éradication du paludisme. En pratique, un tel développement est rendu difficile par la complexité du cycle de vie du parasite et les multiples visages qu’il adopte au cours de celui-ci. Par ailleurs, les essais conduits jusqu’à présent montrent l’extrême adaptabilité du parasite et sa capacité à développer des mécanismes d’échappement aux défenses immunitaires induites par les vaccins expérimentaux. Enfin, l’existence de formes dormantes pour certaines espèces de Plasmodium complique encore la mise au point d’un vaccin : difficile de dire s’il sera possible de l’atteindre au cœur des cellules du foie. Malgré toutes ces difficultés, les recherches ne faiblissent pas. Une centaine de pistes sont aujourd’hui suivies, qui diffèrent selon la phase du cycle parasitaire ciblée : certaines cherchent à empêcher le parasite de pénétrer dans les cellules du foie, d’autres dans les globules rouges, d’autres encore cherchent à limiter la transmission du parasite au moustique. Bien qu’incomplètement efficace, un premier vaccin - le RTS,S - devrait prochainement être disponible : il réduit pour l’heure le risque de paludisme de 30%.
Les chiffres cités dans ce dossier sont issus du Rapport 2014 sur le paludisme dans le monde (OMS)
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Identification de marqueurs précoces de maladies neurodégénératives chez des personnes à risque |
|
|
| |
|
| |
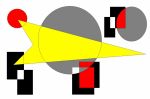
Identification de marqueurs précoces de maladies neurodégénératives chez des personnes à risque
COMMUNIQUÉ | 12 DÉC. 2017 - 15H32 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une étude promue par l’AP-HP a montré pour la première fois que des individus asymptomatiques risquant de développer une dégénérescence fronto-temporale (DFT) ou une sclérose latérale amyotrophique (SLA), car porteurs de la mutation c9orf72, présentent des altérations cognitives, anatomiques et structurelles très précoces, avant l’âge de 40 ans.
L’identification de ces marqueurs avant l’apparition des symptômes de la maladie est une découverte majeure car de tels marqueurs sont essentiels pour la mise au point d’essais thérapeutiques et le suivi de leur efficacité.
Cette étude menée à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière – Inserm / CNRS / UPMC – à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, par le Dr Isabelle Le Ber, Anne Bertrand et Olivier Colliot (chercheur CNRS), a bénéficié d’un financement dans le cadre du programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S).
Ses résultats ont été publiés le 02 décembre 2017 dans JAMA Neurology.
Les dégénérescences fronto-temporales (DFT) et la sclérose latérale amyotrophique (SLA) sont des maladies neurodégénératives pouvant avoir une cause génétique commune, dont la plus fréquente est une mutation du gène c9orf72. Certains développements précliniques ciblant ce gène offrent des perspectives thérapeutiques encourageantes. Afin de pouvoir tester l’efficacité de ces thérapeutiques potentielles, l’identification de marqueurs pour détecter l’apparition des lésions au stade précoce et suivre l’évolution de la maladie est indispensable.
En effet, il est maintenant établi que les maladies neurodégénératives causent des modifications biologiques et morphologiques plusieurs années avant l’apparition des premiers symptômes de la maladie. Ces stades pré-symptomatiques représentent probablement la meilleure fenêtre d’intervention thérapeutique pour stopper le processus neurodégénératif avant qu’il ne cause des dommages irréversibles au niveau du cerveau. L’objectif de ce travail est donc d’identifier des marqueurs du début du processus lésionnel, de la conversion clinique, c’est-à-dire de l’apparition des premiers symptômes cliniques et de la progression de la maladie.
Cette étude multimodale a été réalisée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, sur une large cohorte de 80 personnes asymptomatiques porteuses de la mutation c9orf72, donc à risque de développer une DFT ou une SLA dans quelques années. Ces personnes ont été suivies pendant 36 mois (analyses neuropsychologiques, structurelles et micro-structurelles de la substance blanche du cerveau, du métabolisme cérébral, examens biologiques et cliniques) afin d’identifier des marqueurs cliniques, biologiques, de neuroimagerie, de métabolisme cérébral…
Les résultats de cette étude ont montré pour la première fois des altérations cognitives et structurelles très précoces chez des sujets de moins de 40 ans, qui sont détectables en moyenne 25 ans avant le début des symptômes. Des troubles praxiques (difficultés dans la réalisation de certains gestes) apparaissent de façon précoce. Ce ne sont pas des symptômes classiques des DFT, et l’une des hypothèses est qu’ils pourraient être dus à une modification précoce du développement de certaines régions cérébrales, peut-être liée à la mutation. De façon intéressante, des altérations de la substance blanche du cerveau, détectées précocement par l’IRM, prédominent dans les régions frontales et temporales, les régions cibles de la maladie, et pourraient donc constituer l’un des meilleurs biomarqueurs de la maladie. Dans son ensemble, cette étude apporte une meilleure compréhension du spectre de la maladie causée par des altérations de c9orf72.
La mise en évidence de biomarqueurs à des stades très précoces est un premier pas vers le développement d’outils nécessaires à l’évaluation de nouveaux traitements. En effet, afin de prévenir l’apparition de la maladie il est nécessaire d’administrer des médicaments aux stades présymptomatiques et donc de développer des outils qui permettent de savoir quand commencer le traitement et de mesurer son efficacité.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
