|
| |
|
|
 |
|
Environnement de travail de faible luminosité : remettre à lâheure son horloge biologique, câest possible ! |
|
|
| |
|
| |
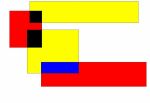
Environnement de travail de faible luminosité : remettre à l’heure son horloge biologique, c’est possible !
COMMUNIQUÉ | 30 JUIL. 2014 - 10H05 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Des chercheurs de l’Inserm dirigés par Claude Gronfier (Unité Inserm 846 “Institut cellule souche et cerveau”) ont mené pour la première fois une étude, dans des conditions réelles, sur l’horloge biologique des membres de la station scientifique polaire internationale Concordia. Les chercheurs ont montré qu’une lumière artificielle particulière est capable d’assurer la bonne synchronisation de leurs rythmes biologiques malgré l’absence de lumière solaire. Un résultat qui prend tout son sens quand on sait que le dérèglement de cette horloge biologique entraîne des troubles du sommeil, de la vigilance, des problèmes cardiovasculaires et même la dépression.
Ces résultats publiés dans Plos-One, pourraient être transformés rapidement en applications pratiques dans des environnements de travail de luminosité faible à modérée (stations scientifiques polaires, centrales thermiques et nucléaires, centres spatiaux, bureaux aveugles, etc.). Ils pourraient favoriser l’élaboration de stratégies lumineuses destinées à maintenir la santé, la productivité, et la sécurité des personnels.
On appelle “horloge biologique” (ou “rythme circadien”), le système qui permet à notre organisme de réguler un certain nombre de fonctions vitales sur une période d’environ 24 heures. Située au cœur du cerveau, elle est composée de 20 000 neurones dont l’activité pulsatile contrôle le cycle éveil/sommeil, température corporelle, le rythme cardiaque, la délivrance d’hormones etc. Le cycle imposé par l’horloge interne dure spontanément entre 23h30 et 24h30, selon les individus. Pour fonctionner correctement, elle se base donc sur des signaux qu’elle reçoit de l’extérieur et qu’elle interprète comme autant d’indicateurs pour se resynchroniser en permanence sur 24 heures.
C’est ainsi que l’ingestion de nourriture, l’exercice physique et la température extérieure par exemple sont qualifiés de ” donneurs de temps”. Mais le plus important des “donneurs de temps” est la lumière. Une exposition inappropriée à la lumière et toute votre horloge biologique se détraque avec des conséquences sur les fonctions cognitives, le sommeil, la vigilance, la mémoire, les fonctions cardiovasculaires etc.
Pour la première fois, des scientifiques ont pu étudier dans des conditions réelles l’influence de divers types de lumières artificielles sur la manière dont l’horloge biologique se comporte dans des situations où la lumière naturelle est insuffisante. Pendant 9 semaines d’hiver polaire (pas de lumière du soleil pendant la journée), les personnels de la station polaire internationale Concordia ont été exposés alternativement à une lumière blanche standard ou à une lumière blanche enrichie en longueurs d’ondes bleue (lumière fluorescente particulière, mais perçue comme étant blanche par le système visuel). En pratique les chercheurs ont demandé aux personnels de ne pas changer leurs habitudes quotidiennes notamment leurs heures de coucher et de lever.
Une fois par semaine, des prélèvements salivaires ont été effectués pour mesurer les taux de mélatonine (hormone centrale) secrétée par chacun des individus.
Dans le détail, une augmentation du temps de sommeil, une meilleure réactivité et une plus grande motivation ont été observées pendant les semaines “bleues”. Par ailleurs alors que le rythme circadien avait tendance à se décaler les semaines “blanches”, aucune perturbation de rythme n’a été observée pendant les semaines “bleues”. De plus, les effets ne disparaissent pas dans le temps.
D’une manière générale, l’étude montre qu’un spectre lumineux optimisé, enrichi en longueurs d’ondes courtes (bleu), peut permettre la bonne synchronisation du système circadien et l’activation de fonctions non-visuelles, dans des situations extrêmes où la lumière solaire n’est pas disponible pendant de longues durées.
L’efficacité d’un tel éclairage repose sur l’activation des cellules ganglionnaires à mélanopsine découvertes en 2002 dans la rétine. Ces cellules photoréceptrices sont effectivement essentielles à la transmission de l’information lumineuse vers de nombreux centres du cerveau dits « non-visuels ».
“Si les bienfaits de « la lumière bleue » sur l’horloge biologique ont déjà été montrés par le passé, toutes les études ont été réalisées dans des situations difficilement reproductibles dans des conditions réelles.” Explique Claude Gronfier principal auteur de ce travail.
Ces résultats pourraient déboucher sur des applications pratiques rapidement. Dans des environnements de travail dans lesquels l’intensité lumineuse est insuffisante (stations scientifiques polaires, centrales thermiques et nucléaires, centre spatiaux, bureaux aveugles, etc.), cela pourraient permettre le design de stratégies lumineuses destinées à maintenir la santé, la productivité, et la sécurité des personnels.
“Au-delà d’un contexte professionnel, nous envisageons plus largement cette stratégie comme une approche pratique du traitement des troubles des rythmes circadiens du sommeil et des fonctions non visuelles dans des conditions où l’éclairage n’est pas optimal.” (Claude Gronfier)
Ce qu’il faut retenir de ce travail :
* La lumière blanche enrichie en bleu est plus efficace qu’une lumière blanche standard qu’on trouve dans les bureaux ou les habitations pour synchroniser l’horloge biologique et activer les fonctions non-visuelles essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des lumières bleues, ou bien des LED (diodes électroluminescentes), pour obtenir des effets positifs.
*
* L’efficacité de cette lumière ne nécessite pas des niveaux élevés d’illuminance comme c’est le cas dans les approches actuelles du traitement des troubles des rythmes circadiens du sommeil ou de la dépression saisonnière (on conseille 5000 à 10000 lux dans ces approches.)
*
* L’efficacité de cette lumière ne nécessite pas des sessions d’exposition à la lumière (on conseille 30 min-2h dans les approches photiques citées précédemment). Dans cette étude, la lumière provient de l’éclairage des pièces à vivre.
*
* Les effets de cette approche lumineuse ne disparaissent pas dans le temps. Cette étude montre que les effets sont les mêmes, de la 1ere à la 9 semaine d’observation.
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Electrophotonique et pseudo-traitements : le scandale de la maladie de Lyme |
|
|
| |
|
| |

Electrophotonique et pseudo-traitements : le scandale de la maladie de Lyme
Par Olivier Hertel le 10.05.2017 à 15h34
"Captations photoniques", tests non officiels, essai clinique illégal... L'enquête de Sciences et Avenir a mis au jour des pratiques non validées scientifiquement, voire dangereuses, proposées à de nombreux malades à qui la médecine officielle n’offre que peu ou pas de solutions.
SCIENCES ET AVENIR
Pour Nathalie, les résultats du test sur la machine "d'électrophotonique" ont constitué une excellente nouvelle : " J'ai pu enfin corréler tous mes symptômes avec la maladie de Lyme ! ", affirme cette femme de 37 ans qui cherchait une explication à son mal-être depuis… plus de vingt ans. En effet, les "captations photoniques" (sic) de ses dix doigts, réalisées par la société Électrophotonique Ingénierie à Brens (Tarn), indiqueraient bien la présence de la bactérie Borrelia, l'agent transmis par les piqûres de tiques responsable de la pathologie. Or, jusque-là, les deux tests de dépistage officiels qu'elle avait effectués (Elisa et Western Blot) avaient été négatifs. Résultat : une longue "errance" pour tenter d'expliquer et soulager ses douleurs persistantes et la consultation vaine de près de vingt médecins.
Le cas de Nathalie est celui de dizaines de milliers d'autres malades, acculés dans cette impasse thérapeutique car déclarés eux aussi négatifs par les tests (lire l'encadré ci-dessous). Avec parfois pour seule issue les remèdes "miracles" de médecins et thérapeutes peu scrupuleux.
DIAGNOSTIC. Des test officiels très contestés
Avec près de 70 symptômes possibles, en outre peu spécifiques, le diagnostic de la maladie de Lyme est difficile à poser. Ce, d'autant plus que l'efficacité des deux tests de dépistage officiels (Elisa et Western Blot) est très contestée. Ces tests sont en effet menés sur des échantillons de sang. Or Borrelia, la bactérie responsable de l'infection, s'y trouve très rarement. En outre, les tests sur le marché détectent plusieurs espèces de Borrelia... mais pas toutes. Ils ignorent aussi les autres pathogènes transmis par les tiques et impliqués dans la maladie, comme la bactérie Bartonnella ou encore des rickettsies et le parasite Babesia. Dans le cadre du "plan Lyme", lancé en 2016 par le ministère de la Santé, de nouveaux protocoles de diagnostics et de soins devraient être recommandés d'ici à la fin de l'année.
De graves dérapages lors de conférences publiques
Les "captations photoniques" dont se réjouit aujourd’hui Nathalie sont l’un des risques auxquels sont exposés les malades. Cette technique repose sur l’analyse d’étranges photos révélant un "halo" entourant le bout des doigts du patient. Selon Georges Vieilledent, le PDG de la société Électrophotonique Ingénierie, « la présence ou l’absence de lumière sur certaines zones de ce halo sont révélatrices de la présence de la bactérie dans le corps ». Ainsi, le pouce signalerait le microbe au niveau du cerveau et l’index serait en relation directe avec le rectum ! Cet examen, facturé 250 e par la société tarnaise, permettrait, selon ses concepteurs, de dépister presque 100 % des patients atteints de la maladie de Lyme ! Il est, en outre, couplé à un traitement dit d’électrothérapie délivré par un appareil appelé Vital Harmony, conçu lui aussi par la société de Georges Vieilledent et vendu aux malades près de 700 euros.
Il consiste à délivrer des microcourants grâce à deux électrodes tenues en main par le patient. Pour tenter de prouver l’efficacité de ses deux machines, Georges Vieilledent a réussi à lancer fin 2015 une "étude" (en cours) auprès de quelque 400 malades, supervisée par le Pr Christian Perronne, du CHU de Garches (Hauts-de-Seine), et le Dr Raouf Ghozzi, du centre hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Ces deux médecins sont très appréciés des malades de Lyme car ils ont été parmi les premiers hospitaliers à braver les recommandations en ignorant les résultats "négatifs" des tests officiels pour administrer de longues cures d’antibiotiques, traitement donnant aujourd’hui les meilleurs résultats. Mais en cautionnant de fait l’étude d’Électrophotonique, n’ont-ils pas commis une erreur de jugement ? Au cours de notre enquête, nous avons pu en effet visionner des conférences publiques données par Georges Vieilledent et relever de graves dérapages. Celui-ci affirme par exemple que le Vital Harmony est « au moins aussi bon que les cures d’antibiotiques » pour traiter la maladie de Lyme. Pire ! il affirme que son traitement est efficace « à 100 % contre la sclérose en plaques », qu’il détruit « tous les pathogènes » et devrait bientôt « remplacer les injections d’insuline des diabétiques et les chimiothérapies des cancéreux ».
ANTISEPTIQUE F84. Un essai clinique sur l’homme réalisé en toute illégalité
Nous avons pu établir qu’un essai clinique sur des malades de Lyme a été organisé en dehors de tout cadre légal par Judith Albertat, fondatrice de l’association Lyme sans frontières, avec la complicité de certains médecins. Cet essai a consisté en l’injection d’un ammonium quaternaire (antiseptique) appelé F84, à une date que nous n’avons pas pu déterminer : « Oui, nous l’avons essayé […] dans l’illégalité la plus totale, nous a confié cette naturopathe, ancienne commandant de bord à Air France. Nous avons joué avec des “trucs” avec lesquels nous n’avons pas le droit de jouer. » Selon Judith Albertat, également vice-présidente d’un fonds pour la recherche appelé I for Lyme, le F84 aurait « guéri définitivement » des malades du sida lors d’un obscur essai clinique mené en Afrique en 1994 par un médecin militaire français. Ce dernier aurait ensuite fait produire le F84 en grande quantité, Judith Albertat ayant récupéré une partie du stock « aujourd’hui périmé » pour l’utiliser dans l’essai.
Nous avons montré ces enregistrements à Christian Perronne et Raouf Ghozzi, qui reconnaissent n’avoir jamais eu connaissance de tels propos. « Nous avions effectivement des doutes sur la machine de dépistage, explique Raouf Ghozzi. Mais, concernant le Vital Harmony, nous nous sommes fiés à la parole des patients qui nous ont rapporté une amélioration de leurs symptômes. Ces retours étaient positifs pour plus de 30 % d’entre eux, soit un effet supérieur à ce que l’on accorde au placebo. C’est ce qui nous a poussé à accepter de superviser cette étude. » Une appréciation biaisée par une confusion sur l’effet placebo, comme l’explique Nicolas Pinsault, chercheur au laboratoire Techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité de l’université Grenoble-Alpes. « Cette règle des 30 % n’existe pas. L’effet placebo est présent chez 100 % des personnes testées puisqu’il est lié au fait de recevoir un traitement, que celui-ci soit efficace ou pas. Même lorsque l’on teste un “vrai” médicament, une partie de ses effets est due à la molécule active, mais une autre au placebo. »
D’où l’importance dans un essai clinique de toujours comparer le traitement à un placebo, ce qui n’est pas le cas dans l’étude menée par la société de Georges Vieilledent. Il sera donc impossible de déterminer si le Vital Harmony est plus efficace… qu’un granule de sucre. Et à y regarder de près, les allégations d’Électrophotonique Ingénierie ne relèvent aucunement de la science. En effet, il faut ici bien distinguer les deux appareils de l’usage qui en est fait. Dans le cas du dépistage, la machine de la société tarnaise reproduit un phénomène bien connu des physiciens sous le nom d’« effet couronne ». Celui-ci apparaît lorsqu’on applique une forte tension électrique à un objet - ici les doigts des patients - posé sur une électrode. Mais se servir de ces images comme outil de dépistage n’a pas de sens. « Ces images ne sont pas reproductibles et ne veulent rien dire, car le phénomène est trop sensible. Un changement infime de la pression du doigt sur l’électrode, de sa température, de l’humidité à sa surface… sont autant de facteurs qui modifient le halo capturé sur l’image », explique Jérôme Kasparian, physicien spécialiste de l’effet couronne à l’université de Genève (Suisse).
ANALYSES DE SANG. Le test non validé du professeur Montagnier
Sur une ordonnance datant de 2010 que nous nous sommes procurée auprès d’un malade de Lyme, le médecin a inscrit : "Test Montagnié" (sic), suivi des coordonnées d’un laboratoire d’analyses médicales. Contacté, celui-ci nous a expliqué expédier les échantillons de sang prélevés sur les malades à Jamal Aissa, collaborateur du professeur Luc Montagnier au sein de la société Nanectis (Yvelines), dont le prix Nobel 2008 est le P-DG. C’est là que le test est réalisé, suivant le principe jamais démontré de la "mémoire de l’eau" qui affirme qu’une molécule peut être détectée dans un échantillon d’eau, même si elle n’y est plus, grâce à son rayonnement électromagnétique. Luc Montagnier prétend ainsi détecter la présence de la bactérie Borrelia, à l’origine de la maladie de Lyme, à partir des ondes électromagnétiques émises par son ADN dans le sang du patient. Or ce test n’a jamais fait la preuve de son efficacité. Et serait facturé au malade entre 300 et 400 € selon différents témoignages. Mais selon Luc Montagnier, il s’agirait d’un "don libre" accordé à sa fondation, l’Institut de recherche Luc-Montagnier, et donc en partie déductible des impôts. Un montage financier singulier qui n’explique pas comment la société Nanectis finance ces tests depuis 2010.
Inspiré d’un appareil des années 1920
L’idée d’associer effet couronne et diagnostic n’est pas nouvelle. Déjà, dans les années 1970, cette pratique était en vogue dans le milieu de la parapsychologie sous le nom de "photographies Kirlian" à partir desquelles certains prétendaient lire "l’état énergétique" des personnes dans ce qu’ils appelaient alors l’« aura ». Si Georges Vieilledent préfère aujourd’hui le terme plus "scientifique" de "captations photoniques", l’idée demeure la même. D’ailleurs, le concepteur de sa machine, Raymond Herren, ingénieur CNRS du laboratoire de Chimie physique de l’université Paris-Sud (Orsay, Essonne), avait déjà élaboré des années plus tôt des machines du même genre pour un certain Georges Hadjopoulos. Ce dernier, véritable "pionnier de l’électrophotonique", se disait spécialiste de l’interprétation thérapeutique des photos Kirlian. L’ingénieur du CNRS ne s’est pas contenté de mettre ses compétences au service dudit Hadjopoulos. Il en a cautionné les dérives en cosignant avec lui et le dentiste suisse Nicolas Stelling l’ouvrage intitulé Établir un bilan bioénergétique dans lequel, déjà, des photographies Kirlian de doigts et d’orteils permettaient de « dépister » leucémie, cancer du sein, autisme ou schizophrénie…
Quant à la machine thérapeutique Vital Harmony, elle a - elle aussi - été conçue par Raymond Herren. Elle est inspirée d’un appareil mis au point dans les années 1920 par l’Américain Royal Raymond Rife, déjà censé soigner à peu près tous les maux par la variation de fréquence de champs électriques. « Selon quels critères ces fréquences sont-elles choisies ? Comment expliquer que cela fonctionne de la même manière pour chaque individu ? », s’interroge Lluis Mir, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire européen associé des Champs électriques pulsés appliqués en biologie et en médecine (LEA Ebam). « Ce sont des allégations extraordinaires, sans que la moindre preuve en soit publiée dans une revue scientifique », affirme de son côté Rodney O’Connor, spécialiste du traitement électrique au laboratoire d’Oncoélectronique de l’école des Mines de Saint-Étienne.
Aussi peu scientifiques soient-elles, les allégations de la société Électrophotonique Ingénierie peuvent rapporter gros : si les 400 personnes actuellement testées se sont vu offrir la séance de "dépistage", la plupart ont acheté l’appareil. Ce qui, même avec la remise de 10 % consentie, représente un gain potentiel… de près de 200 000 €.
DOCUMENT sciencesetavenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les promesses de lâimmunologie |
|
|
| |
|
| |
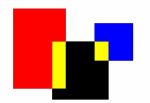
Les promesses de l’immunologie
09.07.2015, par Louise Mussat
Auteur d’un récent ouvrage sur l’immunologie, Philippe Kourilsky, professeur émérite au Collège de France et ancien directeur de l’Institut Pasteur, évoque les succès, les échecs et les espoirs de cette discipline dont il est l’un des grands spécialistes mondiaux.
L’immunologie existe au moins depuis le XIXe siècle. Pourtant, dans votre livre Le Jeu du hasard et de la complexité, vous parlez de la « nouvelle science de l’immunologie ». Pourquoi ?
Philippe Kourilsky1 : J’y souligne que la biologie n’est pas que la science de la vie. C’est aussi la science de la survie. Il ne suffit pas de naître et de vivre. Il faut survivre face aux innombrables hasards qui peuvent nous détruire. Pour moi, il faut élargir l’immunologie à l’ensemble des défenses naturelles de l’homme. Il ne s’agit plus seulement d’étudier celles qui combattent les agents pathogènes (virus, bactéries, champignons…), mais également celles qui s’attaquent incessamment aux « ennemis de l’intérieur », à savoir, aux innombrables erreurs commises par nos cellules au sein de l’organisme. Les plus communes, mais ce ne sont pas les seules, se produisent dans les cellules lors de la réplication de leur ADN. Ces mutations peuvent conduire au développement de cancers.
La plupart du temps, cette surveillance fonctionne plutôt bien…
P. K. : Notre organisme est une machine particulièrement robuste et performante en effet. Il est très probable que nous développions régulièrement (tous les mois, peut-être ?) des mini-cancers et toutes sortes d’infections bénignes. Nous ne nous en rendons pas compte parce que notre système immunitaire parvient la plupart du temps à s’en débarrasser, grâce à toutes sortes de contrôles de qualité qui corrigent les défaillances. Ainsi, on n’observe la tumeur cancéreuse que lorsque le système a échoué. C’est un peu comme dans l’aviation : on remarque les failles de l’ingénierie lorsqu’il y a un crash, mais on a tendance à oublier à quel point les systèmes de contrôles des avions sont efficaces. L’avion est le plus sûr des moyens de transport.
Alors pourquoi le système échoue-t-il de temps en temps, face à ces « ennemis de l’intérieur », notamment dans les cancers ?
P. K. : Parce que le système peut être débordé, ou contourné, et qu’il peut lui-même commettre des erreurs. Il faut en général une bonne demi-douzaine de mutations pour qu’une cellule parvienne à échapper à tout contrôle et se multiplie de façon anarchique. Une mini-tumeur se développe alors. L’organisme peut parvenir à s’en débarrasser. Mais si, par hasard encore une fois, de nouvelles mutations se produisent au sein de cette tumeur, cela facilite son échappement. Dans un jeu du chat et de la souris, elle va chercher à déjouer le système immunitaire, à produire des cellules plus agressives et à leurrer son environnement afin de grandir davantage. Si le cancer reste si difficile à soigner, c’est aussi parce qu’il ne s’agit pas d’une seule et même maladie. Parler « du » cancer est un abus de langage. Il y a quasiment autant de cancers que de types cellulaires. Pour chacun, il faut donc apporter une réponse spécifique. Cela implique de bien connaître le cancer auquel on a affaire. Ce qui est très loin d’être aisé…
Si le cancer reste si
difficile à soigner,
c’est aussi parce
qu’il ne s’agit pas
d’une seule et
même maladie.
La chimiothérapie et les rayons ne sont pas très spécifiques…
P. K. : C’est pour cela que l’on développe d’autres techniques. L’immunothérapie, par exemple, vise à stimuler les défenses immunitaires du patient. Cela consiste à lui administrer des anticorps spécifiques, dirigés contre telle ou telle catégorie de tumeur. On peut aussi procéder en prélevant, dans les tumeurs cancéreuses, des lymphocytes T porteurs du récepteur adéquat et capables d’éliminer les cellules cancéreuses. On fait ensuite proliférer ces cellules tueuses par milliards in vitro, dans des environnements hyperstériles. Cette technique est parfois couronnée de succès, mais elle est compliquée et très coûteuse. Une nouvelle approche est en train d’émerger, qui permet de faire proliférer les bonnes cellules tueuses au sein même du corps humain. Les travaux sont en cours.
On compte désormais plusieurs cas de rémission totale de cancers grâce à l’immunothérapie…
P. K. : Attention, ne donnons pas de faux espoirs aux gens. Cela fait depuis quinze à vingt que l’on parvient à guérir les souris du cancer avec ce type d’approche. Mais il est très compliqué de remporter le même succès chez l’homme, dont le corps est plus volumineux et plus complexe. Certes, des équipes (notamment celle de Carl June, à l’université de Pennsylvanie), ont récemment obtenu une proportion impressionnante de rémissions complètes dans le cadre d’essais cliniques portant sur assez petit nombre de patients atteints de certains cancers. Mais nous n’en sommes encore qu’à la phase expérimentale. Cette précaution prise, je dois avouer que cela fait des années que je n’ai pas vu de résultats aussi prometteurs…
Les avancées pour contrer certains agents infectieux, les ennemis de l’extérieur, sont moins spectaculaires. Pourquoi n’est-on toujours pas parvenu par exemple à élaborer un vaccin contre le VIH ?
P. K. : Les vaccins que l’on a mis au point jusqu’à maintenant étaient peut-être les plus faciles. Désormais, on s’attaque aux plus coriaces. Ceux contre les virus ou les parasites qui ont la faculté de muter très rapidement et pour lesquels il faut sans cesse adapter la réponse, comme le paludisme, la grippe (pour laquelle on ne sait pas encore proposer de vaccin universel) et le VIH… Ce dernier cumule deux casse-tête : non seulement il est en constante mutation, mais en plus il a la particularité de s’attaquer au système immunitaire. La vérité, c’est qu’avec le VIH une partie de la communauté scientifique est retournée au tableau noir afin de reprendre les fondamentaux du virus, car aucun des prototypes de vaccins préventifs n’a jusqu’à ce jour abouti. La perspective de vacciner massivement les populations, notamment en Afrique, est donc très lointaine. C’est pour cette raison qu’une autre partie de la communauté préfère se consacrer à la confection d’un vaccin non pas préventif, mais thérapeutique, qui complète, allège ou remplace le traitement par les médicaments antirétroviraux.
Vous parlez de l’immunologie comme d’une science fascinante. Pouvez-vous me dire ce qui vous surprend le plus dans le système immunitaire ?
P. K. : Beaucoup de mécanismes et de phénomènes liés à l’immunité et aux défenses naturelles me sidèrent. Ils proviennent de « découvertes évolutives » majeures. Par exemple, la faculté qu’ont nos lymphocytes B, ceux qui ont pour fonction de produire des anticorps, à combiner aléatoirement des morceaux de gènes pour dépasser la limite des 25 000 gènes que compte notre génome afin de produire des centaines de millions d’anticorps différents. L’organisme parvient ainsi à se doter d’une « couverture » anti-infectieuse quasi complète, puisqu’il est ainsi capable de répondre à l’immense variété des antigènes, qui évoluent sans cesse. Bien entendu, chaque catégorie de cellule B productrice d’un anticorps particulier n’est présente qu’en petit nombre dans l’organisme. Ce nombre est insuffisant pour pouvoir neutraliser les éléments pathogènes. Ce qui se passe, c’est que, lorsque l’anticorps reconnaît l’antigène, les lymphocytes porteurs de cet anticorps spécifique prolifèrent. Prodigieux ! Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), pour la découverte duquel le professeur Jean Dausset a reçu le prix Nobel de médecine, est également tout aussi fascinant.
Beaucoup de
mécanismes et de
phénomènes liés à
l’immunité et aux
défenses naturelles
me sidèrent.
De quoi s’agit-il ?
P. K. : Les cellules du CMH ont pour fonction de présenter un morceau d’antigène (le plus souvent un bout de protéine, un peptide) que les cellules T vont, ou non, reconnaître grâce à leur récepteur. Mais, pour reconnaître les corps étrangers – virus, bactéries, etc. – rassemblés sous le terme de « non soi », et les attaquer, l’organisme doit d’abord apprendre à reconnaître ses propres constituants, pour les épargner. On dit que le système immunitaire doit apprendre à tolérer le soi. Cet apprentissage se fait notamment pendant la vie fœtale, par sélection : parmi les lymphocytes T, une bonne partie de ceux dont les récepteurs sont capables de se lier avec des molécules provenant de l’organisme lui-même sont éliminés. Ce qui permet d’écarter des cellules susceptibles de déclencher une réaction auto immune.
Mais ce système n’est pas infaillible…
P. K. : En effet, notamment parce que les agents infectieux ne cessent de développer des stratégies pour tromper le système immunitaire. Tel virus peut par exemple mimer telle protéine de l’organisme, de sorte que ce dernier ne se met pas en ordre de bataille, il ne se défend pas, car il n’a pas reconnu l’ennemi, il n’a pas reconnu le « non-soi ». Mais, quand il le reconnaît, les conséquences peuvent également être dramatiques. Certains virus peuvent en effet provoquer des désordres auto-immuns. Dans un premier temps, l’organisme s’attaque à un agent infectieux qui ressemble au soi. Ainsi dupé, il va ensuite prendre le soi pour du non-soi et ainsi déclencher une réponse auto-immune, c’est-à-dire s’attaquer à lui-même. C’est ainsi qu’apparaissent les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, le diabète, etc.
Une question plus personnelle pour terminer : pourquoi avez-vous choisi de vous tourner vers l’immunologie ?
P. K. : Je dois vous dire la vérité : c’est grâce à mon frère François. Au moment où j’ai commencé la recherche, en génie génétique, il était immunologiste avant de devenir directeur général du CNRS (entre 1988 et 1994, ndlr). Il m’a conseillé d’isoler par clonage et d’étudier les gènes du système HLA. De fil en aiguille, je suis ainsi devenu immunologiste… Je tiens à souligner que, même si j’ai fini par quitter le CNRS pour devenir professeur au Collège de France, je suis très reconnaissant envers l’organisme, qui m’a soutenu durant de très nombreuses années.
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS |
|
|
| |
|
| |

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Sous titre
Un enjeu d’envergure de la recherche
Les perturbateurs endocriniens regroupent une vaste famille de composés, capables d'interagir avec le système hormonal. Ainsi, ces composés affectent potentiellement différentes fonctions de l’organisme : métabolisme, fonctions reproductrices, système nerveux...
Les sources d'exposition sont nombreuses et difficiles à maîtriser. Les conséquences biologiques de ces expositions sont quant à elles encore mal appréhendées et complexes à étudier. C'est pourquoi l'étude des perturbateurs endocriniens représente aujourd'hui un enjeu majeur pour le corps médical et les pouvoirs publics.
*

*

*

* TEMPS DE LECTURE 15-20 min
DERNIÈRE MISE À JOUR 02.10.18
DIFFICULTÉ 3 sur 5
*
Dossier réalisé en collaboration avec Robert Barouki (unité 1124 Inserm/Université Paris Descartes, Toxicologie, pharmacologie et signalisation cellulaire, Paris)
Comprendre la perturbation endocrinienne
Il existe de nombreuses définitions pour décrire ce que sont les perturbateurs endocriniens. Celle qu'a établie l'Organisation mondiale de la santé en 2002 est la plus acceptée : un perturbateur endocrinien est "une substance exogène ou un mélange qui altère la/les fonction(s) du système endocrinien
système endocrinien
Comprend tous les organes qui sécrètent des hormones.
et, par voie de conséquence, cause un effet délétère sur la santé d’un individu, sa descendance ou des sous-populations".
C'est quoi la perturbation endocrinienne ?
C’est quoi la perturbation endocrinienne ? – Interview - 1 min 14 - vidéo extraite de la série C’est quoi ? (2015)
Le système hormonal sous le feu des perturbateurs endocriniens
Le système endocrinien regroupe les organes qui sécrètent des hormones : thyroïde, ovaires, testicules, hypophyse… Il libère ces médiateurs chimiques dans la circulation sanguine, pour agir à distance sur certaines fonctions de l'organisme comme la croissance, le métabolisme, le développement sexuel, le développement cérébral, la reproduction… Il s’agit donc d’un système de communication entre organes. Les perturbateurs endocriniens altèrent le fonctionnement de ce système en interagissant avec la synthèse, la dégradation, le transport et le mode d’action des hormones. Ces molécules se caractérisent donc par un effet toxique non pas direct, mais indirect, via les modifications physiologiques qu'elles engendrent.
Historiquement, les perturbateurs endocriniens ont commencé à attirer l'attention des chercheurs dès les années 1950. Mais c'est l'affaire du distilbène qui, dans les années 1970, a fait exploser le sujet sur la scène scientifique et médiatique, alors même que le terme de perturbateur endocrinien n’était pas encore utilisé (voir encadré). Depuis, on connaît plus précisément les mécanismes d'actions de ces substances. Selon le produit considéré, ils vont :
* modifier la production naturelle de nos hormones naturelles (œstrogènes, testostérone) en interférant avec leurs mécanismes de synthèse, de transport, ou d'excrétion
* mimer l'action de ces hormones en se substituant à elles dans les mécanismes biologiques qu'elles contrôlent
* empêcher l'action de ces hormones en se fixant sur les récepteurs avec lesquels elles interagissent habituellement
En découle un certain nombre de conséquences potentielles pour l'organisme, propres à chaque perturbateur endocrinien : altération des fonctions de reproduction, malformation des organes reproducteurs, développement de tumeurs au niveau des tissus producteurs ou cibles des hormones (thyroïde, sein, testicules, prostate, utérus…), perturbation du fonctionnement de la thyroïde, du développement du système nerveux et du développement cognitif, modification du sex-ratio…
Aujourd'hui, la définition du champ d'action des perturbateurs endocriniens tend à s'élargir. Certains organes clés, qui ne sont pas considérés comme des glandes endocrines à proprement parler, produisent des messagers qui apparaissent elles-aussi comme des cibles potentielles pour les perturbateurs endocriniens : la leptine du tissu adipeux
tissu adipeux
Tissu contenant les adipocytes, cellules spécialisées dans le stockage de la graisse.
qui intervient dans la régulation du métabolisme, l'IGF-1 produite par le foie qui agit comme un facteur de croissance…
A ce stade, il convient toutefois de préciser que la plupart des substances qualifiées de perturbateurs endocriniens sont le plus souvent seulement suspectées d’avoir ce type d’activité. Il existe en effet très peu de perturbateurs endocriniens avérés à ce jour. Cela est dû à la grande difficulté de démontrer qu’un composé exerce sa toxicité par la perturbation du système endocrinien. Cette toxicité découle souvent d’effets à long terme, qui peuvent n’apparaître que lorsque l’exposition a eu lieu à des moments précis du développement.
Distilbène, l'histoire à retardement d'un médicament hormonal
Au début des années 1970, un chercheur américain, Arthur L Herbst, a observé la recrudescence d'une forme rare de cancer gynécologique chez des adolescentes et de jeunes adultes. L'analyse de ces cas a montré que ces femmes étaient nées de mères qui avaient pris du distilbène, un œstrogène de synthèse, prescrit à l'époque pour prévenir les fausses couches durant la grossesse. Rapidement, le lien entre l'exposition du fœtus au distilbène et l'altération de ces organes reproducteurs (cancers, stérilité) a été établi. Depuis, il est apparu que les enfants nés de cette génération exposée in utero ont, eux aussi, un sur-risque de pathologies gynécologiques.
Air, eau, aliments… : les sources d'exposition sont multiples
Il existe une grande diversité parmi les perturbateurs endocriniens, et les sources de contamination auxquelles hommes et animaux sont exposés sont également nombreuses. En effet, ces composés peuvent être présents dans des produits manufacturés ou des aliments d'origine végétale ou animale. Ils sont pour la plupart issus de l'industrie agro-chimique (pesticides, plastiques, pharmacie…) et de leurs rejets. Beaucoup sont rémanents : ils persistent dans l'environnement de longues années et peuvent être transférés d'un compartiment de l'environnement à l'autre (sols, eau, air…) de longues années après qu'ils aient été produits.
Les hormones naturelles ou de synthèse constituent une source importante de perturbateurs endocriniens : œstrogènes, testostérone, progestérone
progestérone
Hormone stéroïde secrétée par l'ovaire à certaines phases du cycle, et par le placenta durant la grossesse. Chez les deux sexes, les glandes surrénales et le cerveau en produisent également
... et les produits de synthèse mimant leurs effets sont souvent utilisés en thérapeutique (contraception, substitution hormonale, hormonothérapie). Elles entraînent un risque indirect en rejoignant les milieux naturels, après avoir été excrétées dans les rejets humains ou animaux.
Le bisphénol, voleur d'identité
Le bisphénol, voleur d’identité – Communiqué de presse vidéo – 2 min 33 – vidéo extraite de la série Histoires de recherche (2012)
Un second groupe de perturbateurs endocriniens, bien plus large, rassemble tous les produits chimiques et sous-produits industriels qui peuvent interférer avec le système endocrinien de l'homme ou de l'animal. Il comporte à l'heure actuelle plus d'un millier de produits, de nature chimique variée. Parmi les plus fréquents, on peut citer:
* des produits de combustion comme les dioxines, les furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)…
* des produits industriels ou domestiques comme :
* les phtalates, ou le bisphénol A utilisés dans les plastiques
* les parabènes, conservateurs utilisés dans les cosmétiques
* les organochlorés (DDT, chlordécone…) utilisés dans les phytosanitaires
* l'étain et dérivés utilisés dans les solvants
Les enjeux de la recherche
L'étude des perturbateurs endocriniens est aujourd'hui très importante pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Mais, cette recherche doit relever plusieurs défis, liés aux particularités de ces substances, notamment en raison d'incertitudes qui persistent.
Le premier défi se rapporte aux doses d'exposition à ces substances : les effets d’une exposition à une dose forte ne sont pas forcément les mêmes que ceux associés à une exposition chronique à dose faible. Il devient alors difficile de faire des extrapolations d’une dose à l’autre. Il est possible que même si une exposition à une dose unique d’un produit soit sans risque pour l'organisme, la répétition de cette exposition au cours du temps puisse perturber le système hormonal. Et le délai d'apparition des effets délétères des perturbateurs endocriniens, parfois prolongé, complique encore l'analyse !
Inserm
Une dent contre le Bisphénol
Un dent contre le bisphénol – Communiqué de presse vidéo – 2 min 35 – vidéo extraite de la série Histoires de recherche (2013)
La seconde difficulté tient aux périodes de vulnérabilité des êtres vivants face au risque toxique : un organisme ne subit pas les mêmes effets lorsque le contact avec un perturbateur endocrinien a lieu in utero, avant ou après la puberté. L'effet transgénérationnel de certains d'entre eux montre aussi que le risque sanitaire ne concerne pas uniquement la personne qui est exposée, mais aussi sa descendance.
Enfin, l'effet cocktail des perturbateurs endocriniens est complexe à mettre en évidence : il découle parfois de l'addition des effets délétères de plusieurs composés à faibles doses, qui agissent sur les mêmes mécanismes biologiques. Ensemble, ils peuvent perturber l'organisme sans que chacun, pris isolément, n'ait d'effet. Par ailleurs, il peut y avoir des interactions entre perturbateurs endocriniens agissant par des mécanismes différents (synergiques ou antagonistes
antagonistes
Molécule se fixant sur un récepteur à la place du messager habituel et inhibant ainsi l'activation de ce récepteur.
).
A côté de la spécificité liée aux substances incriminées, la complexité du système hormonal rend la recherche encore plus complexe : en effet, les régulations endocriniennes ne font pas intervenir une mais plusieurs hormones interagissant entre elles. Il peut donc être particulièrement difficile de prédire l'ensemble des conséquences biologiques d'un perturbateur endocrinien.
Inserm
Cohorte SEPAGES, les bébés alertés
Cohorte SEPAGES, les bébés alertés – reportage – 8 min 28 – vidéo extraite de la série Des idées plein la tech’ (2015)
Malgré toutes ces difficultés, les pouvoirs publics et les chercheurs déploient plusieurs niveaux de vigilance pour réduire les risques d'exposition et repérer les perturbateurs endocriniens potentiels :
* Les études écotoxicologiques, conduites en milieu aquatique, et les études épidémiologiques, conduites au sein d'une population, sont utiles pour corréler certains événements, parfois rares, à l'exposition à certaines substances. Le lien de causalité suspecté à travers de telles études doit cependant être apporté par des études conduites in vitro et/ou in vivo.
Des cohortes nationales pour mieux évaluer l'exposition des populations vulnérables
La cohorte ELFE (pour Etude longitudinale française depuis l’enfance), a été lancée en 2011, sous la coordination de l’unité mixte Ined-Inserm-EFS Elfe : elle suit aujourd'hui 20 000 enfants, nés en 2011. Son objectif principal est l’étude les déterminants environnementaux et sociétaux qui, de la période intra-utérine à l'adolescence, peuvent impacter le développement et la santé des enfants. Un volet de cette étude a permis de collecter des échantillons biologiques chez 8 000 mères. Ils pourront aider à repérer d'éventuelles corrélations entre événement de santé et une imprégnation par des perturbateurs endocriniens in utero.
La cohorte PELAGIE (pour Perturbateurs endocriniens : étude longitudinale sur les anomalies de la grossesse, l’infertilité et l’enfance) suit, depuis 2002, 3 500 couples mères-enfants habitant en Bretagne. Conduite par l'équipe Evaluation des expositions et recherche épidémiologique sur l'environnement, la reproduction et le développement de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset, unité Inserm 1085), PELAGIE vise à étudier l'impact de contaminants environnementaux sur le développement intra-utérin, puis sur celui de l'enfant. D'ores et déjà, elle a montré plusieurs corrélations, comme l'exposition à certains polluants organiques (DDT, PCB
PCB
Composés aromatiques chlorés utilisés jusqu'en 1987 dans les transformateurs électriques, encres, peintures
) sur le délai de conception d'un enfant, ou l'exposition à un herbicide du maïs et le retard de croissance intra-utérin. L'étude est toujours en cours.
* les études toxicologiques in vitro permettent d'appréhender la toxicité des composés chimiques considérés comme suspects. Pour parfaire ce travail, différents systèmes de cellules en culture sont utilisés : cellules de l'hypophyse, du foie, cellules mammaires, cellules reproductrices... De nouvelles approches utilisant des cellules cultivées en 3D sont testées. Depuis 2007, la législation européenne impose aux fabricants de soumettre chacun de leurs produits chimiques à des tests toxicologiques différents selon la nature du produit (système REACH). Afin d'améliorer l'efficacité de cette mesure, un programme de recherche européen vise à identifier les tests les plus pertinents pour détecter les risques parmi les produits chimiques émergents et identifier les mélanges chimiques les plus préoccupants.
* Des modèles d'études in vivo (chez l'animal) sont indispensables pour appréhender l'effet toxique global d'un perturbateur endocrinien. Toutefois, des techniques récentes utilisant le haut débit et la biologie des systèmes tentent de remplacer, de réduire le plus possible, voire d’éliminer l’utilisation d’animaux.
Une stratégie nationale
En 2014, le gouvernement a adopté la première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Elle vise à articuler recherche, surveillance et réglementation pour prévenir et limiter l'exposition de la population à ces substances, et en particulier les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants). Elle s'inscrit maintenant dans le troisième plan national santé-environnement (PNSE3). Cette stratégie comporte quatre axes principaux :
* l'information des citoyens
* le soutien à la recherche sur les perturbateurs endocriniens et sur le développement d'alternatives non toxiques à ces produits. Pour accélérer ce mouvement, le gouvernement souhaite proposer une plateforme public-privée des méthodes d'évaluation et de validation de test des substances pour que l'évaluation de nouveaux composés devienne précoce, systématique et formalisée
* la programmation d'expertises conduites par les institutions en charge de la sécurité sanitaire (ANSM, ANSES) afin de statuer annuellement sur plusieurs substances suspectées à risque.
* la mise en place d'une réglementation spécifique. La France est, avec le Danemark, l'un des pays les plus engagés pour la régulation relative aux perturbateurs endocriniens. C'est dans le cadre de cette stratégie qu'ont été récemment adoptés le contrôle des phtalates dans les jouets ou l'élimination du bisphénol A des tickets de caisse.Le gouvernement entend soutenir cette stratégie au niveau de l'Europe, en appuyant la définition d'une législation européenne spécifique.
Une nouvelle stratégie nationale est en cours d’élaboration.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
