|
| |
|
|
 |
|
Une plongée vertigineuse dans la diversité du monde vivant |
|
|
| |
|
| |
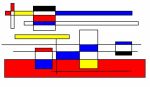
Une plongée vertigineuse dans la diversité du monde vivant
27 décembre 2016 RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
L’ensemble des liens de parenté entre espèces forme ce que l’on appelle l’« arbre de la vie. » En raison du nombre considérable d’espèces connues – plusieurs millions –, la représentation de cet arbre constitue un véritable défi. Damien de Vienne, au Laboratoire de Biométrie évolutive de Lyon, propose un outil interactif et intuitif, Lifemap, qui permet de se « promener » dans l’arbre de la vie, et d'en visualiser les niveaux hiérarchiques et les relations entre espèces. Cette étude a été publiée le 22 décembre 2016 dans la revue PLoS Biology.
L’évolution des espèces depuis plus de 3.5 milliards d’années a conduit à la biodiversité que nous connaissons aujourd’hui. Cette « histoire évolutive » peut être représentée sous forme d’un arbre, nommé « arbre de la vie » (Tree of Life en anglais), où chaque feuille représente une espèce et chaque nœud un ancêtre, à la manière des arbres généalogiques.
De nombreuses recherches sont menées pour tenter de reconstruire cet arbre, grâce notamment aux techniques toujours plus efficaces de séquençage des génomes et d’analyses bioinformatiques. Mais il n’existe aujourd’hui aucune méthode satisfaisante pour visualiser cet arbre dans sa globalité, de façon interactive et intuitive.
La très grande quantité d’information à représenter (plus de 2 millions d’espèces actuellement !) et la nature hiérarchique de l’organisation des espèces évoquent les données cartographiques : de même qu’une rue fait partie d’une ville, qui fait partie d’un département, qui fait partie d’une région, qui fait partie d’un pays, une espèce fait partie d’un genre, d’une famille, d’un ordre, d’une classe, d’un règne et d’un domaine. Partant de ce constat, Damien de Vienne a développé Lifemap, un outil web d’exploration de l’arbre de la vie qui permet de s’y déplacer comme on le fait sur une carte routière
avec OpenStreetMap ou Google Maps®.
Deux caractéristiques majeures permettent à Lifemap de proposer, pour la première fois, une exploration aisée de l’intégralité de l’arbre de la vie. En premier lieu, Lifemap repose sur une nouvelle façon de visualiser des données hiérarchiques : chaque groupe d’espèces (ou clade) est représenté par un demi cercle, contenu dans un demi-cercle plus grand représentant le clade de niveau hiérarchique supérieur. Cette représentation permet d’une part de s’assurer que les branches de l’arbre ne se croisent jamais, d’autre part de respecter la structure particulière de l’arbre de la vie où le nombre de clades contenus dans un clade de niveau hiérarchique supérieur est variable. En second lieu, Lifemap détourne des outils développés dans le cadre du projet OpenStreetMap et utilise une astuce qui fait la puissance des outils de cartographie actuels : le système de tuiles. L’image vue à l’écran est une mosaïque de plus petites images (les tuiles) qui sont stockées sur un serveur informatique distant.
Lifemap existe sous plusieurs versions, selon le public visé et les données représentées (plusieurs classifications existent). Une version en particulier est à destination du grand public. Elle ne comprend « que » 800 000 espèces, et propose des informations relatives à chaque nœud et à chaque feuille de l’arbre, auxquelles on accède par un clic. Ces informations (images, descriptions) sont directement issues des pages Wikipédia correspondantes, si elles existent. Par ailleurs il est possible de rechercher et de visualiser des « chemins » dans l’arbre, pour identifier l’ancêtre commun le plus récent de deux espèces particulières ou pour suivre le trajet reliant une espèce donnée au dernier ancêtre universel (LUCA).
Lifemap, est un outil qui devrait être important, non seulement pour les chercheurs travaillant dans le domaine de l’Évolution, en facilitant l’observation de l’arbre de la vie et l’accès depuis Lifemap aux bases de données spécialisées dédiées, mais aussi à un public plus large, comprenant les étudiants et enseignants du secondaire et du supérieur, voire le grand public intéressé par l’Évolution. Une application pour téléphones et tablettes (Android), Lifemap – Tree of Life, est spécifiquement destinée à cette dernière catégorie.
En savoir plus
* Lifemap: Exploring the Entire Tree of Life.
de Vienne DM.
PLoS Biol. 2016 Dec 22;14(12):e2001624. doi: 10.1371/journal.pbio.2001624.
Contact
Damien De Vienne
04 72 43 29 09
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Edith Heard ou la révolution épigénétique |
|
|
| |
|
| |

Edith Heard ou la révolution épigénétique
19.02.2019, par Laure Cailloce
La biologiste s'est notamment illustrée par ses travaux sur l'inactivation du chromosome X chez les mammifères femelles - un processus 100 % épigénétique.
Ed ALCOCK/M.Y.O.P
Chacune de nos cellules contient l’intégralité de notre code génétique. Pourtant, certaines deviennent des cellules de peau, de muscle ou des neurones ! C’est le tour de force de l’épigénétique. Rencontre avec Edith Heard, spécialiste mondiale de la discipline, qui a pris en janvier la direction du prestigieux European Molecular Biology Laboratory, à Heidelberg.
C’est une discipline en plein boom depuis le début des années 2000 et qui fait couler beaucoup d’encre de par les espoirs, mais aussi les fantasmes, qu’elle suscite. L’épigénétique participe à la régulation de l’expression de nos gènes, via les marques épigénétiques. Ces modifications chimiques de l’ADN aident les cellules de notre corps à acquérir leur identité au cours du développement et, surtout, à la conserver. Mais elles sont aussi réversibles, ce qui ouvre des perspectives pour la guérison de certaines maladies impliquant notre épigénome. Spécialiste mondialement reconnue de l’épigénétique, la biologiste Edith Heard a pris en janvier la direction du prestigieux European Molecular Biology Laboratory (EMBL), organisme intergouvernemental de recherche impliquant 29 pays. Elle nous en dit plus sur ses travaux et ses nouvelles fonctions.
D’où vient ce terme d’épigénétique ?
Edith Heard : Il a été inventé en 1942 par le biologiste britannique Conrad Waddington pour réconcilier le monde de la génétique (les gènes ont été découverts au début du XXe siècle) et celui de l’embryologie. Les généticiens s’occupaient de l’hérédité et des traits transmis aux générations suivantes, tandis que les embryologistes se posaient la question de leur mise en place lors du développement. Waddington voulait créer une nouvelle discipline qui réunirait ces questions d’embryogenèse (aussi appelée épigenèse depuis le XVIIe siècle) et de génétique. Le terme épigénétique rassemble ces deux mots : épigenèse et génétique. La notion a ensuite évolué. Depuis l’apparition du terme, on a découvert l’ADN et on a constaté, avec une certaine incrédulité au début, que toutes les cellules de notre corps avaient le même ADN que dans l’œuf fécondé. Rien à voir pourtant entre une cellule du foie, de muscle ou un neurone, par exemple. Puisque l’intégralité du code ADN est conservée dans les cellules, la question des scientifiques est donc devenue : comment les cellules acquièrent-elles leur identité propre, et comment celle-ci se maintient-elle au cours des divisions cellulaires ? C’est là que nous arrivons à la définition moderne, actuelle, de l’épigénétique.
L’épigénétique désigne tout changement d’expression des gènes qui n’implique pas de changement dans la séquence ADN, qui est stable mais demeure réversible.
Et quelle est cette définition ?
E. H. : L’épigénétique désigne tout changement d’expression des gènes qui n’implique pas de changement dans la séquence ADN, qui est stable mais demeure réversible. On le sait aujourd’hui, les cellules acquièrent leur identité, et elles la conservent, grâce aux marques épigénétiques : des modifications chimiques de l’ADN qui n’altèrent en aucun cas la séquence de l’ADN, mais permettent de lire certains gènes et d’autres pas. L’épigénétique, c’est donc une sorte de mémoire cellulaire, transmissible aux générations suivantes de cellules. Mais c’est une mémoire qui peut s’effacer, d’où le terme de réversibilité.
Un chercheur nommé Peter Jones en a fait par hasard l’expérience au début des années 1980. Il cultivait dans une boîte de Petri des cellules de la peau (fibroblastes) de souris, auxquelles il avait ajouté une molécule, 5-azacytidine. Quelques jours plus tard, surprise : des cellules étaient apparues dans la culture, qui avaient un tout autre aspect… Il a d’abord cru à une contamination de son échantillon par des champignons, mais il s’agissait en réalité de myotubes, des cellules musculaires. La molécule 5-azacytidine avait effacé les marques épigénétiques des cellules embryonnaires et reprogrammé celles-ci en cellules de muscle !
D’où l’idée, lue ici et là, que l’épigénétique met fin au règne du « tout-génome », ce déterminisme implacable imposé par notre code génétique ?
E. H. : C’est une idée séduisante, mais en partie fausse : car c’est bien le code génétique qui décide de lire ou de ne pas lire certains gènes, grâce aux protéines appelées « facteurs de transcription » ! La machinerie épigénétique arrive juste après : les marques épigénétiques qui viennent s’accoler aux gènes ont pour mission de figer ce choix et de le maintenir au fil des divisions cellulaires.
Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser à l’épigénétique, vous qui avez une formation de généticienne pure et dure ?
E. H. : Après mes études à Cambridge, j’ai fait ma thèse sur le cancer, au sein de l’Imperial Cancer Research Fund, à Londres. Je voulais savoir pourquoi dans certaines cellules cancéreuses, certaines parties du génome étaient amplifiées, c’est-à-dire qu’il existait plusieurs copies des mêmes gènes. Pour regarder le génome, on le coupait avec des enzymes de restriction provenant de bactéries, mais cela ne marchait pas quand il y avait des marques épigénétiques. C’est comme cela que je me suis intéressée à l’épigénétique, pour des raisons purement techniques ! J’ai trouvé cet article de Peter Jones et j’ai commandé la molécule 5-azacytidine, pour me débarrasser des marques épigénétiques et pouvoir découper le génome à ma guise. C’est ainsi que je suis tombée dans le monde des modifications chimiques, via les manipulations.
Vous parliez de la spécialisation des cellules en cellules de peau, de muscle, etc. À l’inverse, des cellules du corps peuvent redevenir des cellules souches après effacement des marques épigénétiques, comme l’a démontré Shinya Yamanaka, Prix Nobel de médecine en 2012…
E. H. : C’est la preuve absolue que le code génétique est intégralement conservé dans les cellules somatiques (les cellules de notre corps, NDLR) ! Pour autant, ce changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Même si on utilise les produits adéquats, il faut trois semaines pour effacer les marques épigénétiques portées sur l’ADN des cellules de peau et obtenir des cellules pluripotentes induites (IPS), semblables aux cellules souches embryonnaires. Les marques épigénétiques font pour ainsi dire de la résistance. C’est ce que j’appelle la « barrière épigénétique », la barrière au changement d’identité de nos cellules qui protège les phénotypes (l’apparence) des êtres multicellulaires que nous sommes.
L’épigénétique suscite beaucoup de fantasmes. Les notions de réversibilité et d’héritabilité, notamment, donnent lieu à bon nombre d’interprétations. Les marques épigénétiques pourraient être influencées par notre environnement – l’alimentation, l’air que nous respirons, le stress que nous subissons – et être transmissibles à nos enfants et à nos petits-enfants… Quelle est votre position de chercheuse sur cette question ?
E. H. : J’imagine que vous faites référence à cette étude conduite par des épidémiologistes sur les conséquences de la famine vécue aux Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. Les enfants, et peut-être les petits-enfants, des femmes enceintes qui, à l’époque, avaient passé plusieurs semaines à ingérer quelques centaines de calories par jour seulement, auraient aujourd’hui des problèmes de santé liés à un métabolisme dysfonctionnel. La faute, selon cette étude, à des changements intervenus dans les modifications épigénétiques du fait de la malnutrition, qui auraient été transmis aux enfants, puis aux petits-enfants de ces femmes dénutries.
Aujourd’hui, la science en est toujours à établir les bases moléculaires de l’épigénétique. C’est du 100 % fondamental. Tous les fantasmes autour de l’épigénétique sont stimulants pour nous, et handicapants car ils induisent des attentes auxquelles nous ne pouvons pas toujours répondre.
Autre exemple : certaines personnes vont jusqu’à affirmer que le stress subi par les survivants de la Shoah se serait transmis aux générations suivantes via les marques épigénétiques. Mais il n’y a à ce jour aucune preuve solide de cela au niveau de la biologie moléculaire. Et l’on sait tous que le comportemental, la façon dont on tisse des liens avec nos descendants, est un puissant vecteur de transmission. Tous ces fantasmes autour de l’épigénétique sont à la fois stimulants pour les chercheurs, car ils montrent l’intérêt de la société pour nos travaux, et handicapants, car ils induisent des attentes auxquelles nous ne pouvons pas toujours répondre et qui pourraient créer de la frustration par rapport à notre discipline. Aujourd’hui, la science en est toujours à établir les bases moléculaires de l’épigénétique. C’est du 100 % fondamental.
On entend pourtant régulièrement parler d’« épidrogues », qui aideraient à la guérison de certains cancers. Qu’en est-il ?
E. H. : Dans tous les cancers, on remarque que la distribution des modifications épigénétiques est anormale. Pendant longtemps, il a même été postulé que les gènes impliqués dans l’initiation d’une tumeur étaient modifiés épigénétiquement. D’où cet intérêt pour les épidrogues : ces molécules, connues depuis plusieurs dizaines d’années déjà (elles étaient utilisées en chimiothérapie avant même que l’on connaisse leur fonctionnement), agissent en effet sur les modifications épigénétiques, notamment sur la plus courante d’entre elles, la méthylation de l’ADN. Grâce au séquençage à haut débit des génomes de tumeurs, nous avons aujourd’hui compris que la plupart des tumeurs sont dues à des mutations affectant directement la séquence ADN des gènes dits « drivers », en anglais, c’est-à-dire conduisant à la formation d’une tumeur. La surprise, c’est que certaines de ces mutations affectent aussi les gènes impliqués dans les processus épigénétiques. Cela explique la généralisation des modifications épigénétiques dans les tumeurs.
Le problème, avec le cancer, c’est que rien n’est simple : le génome est modifié, avec des mutations de gènes, et l’épigénome est modifié aussi, sans que l’on sache si ces changements sont liés et dans quel sens ils opèrent. L’utilisation des épidrogues pose elle aussi des questions, car elles n’agissent pas de façon ciblée, sur un gène ou deux, mais sur l’ensemble des marques épigénétiques de l’individu, avec des conséquences que l’on ne maîtrise pas encore complètement. Voilà où on en est aujourd’hui, sur le cancer et l’épigénétique. Ce sont des recherches qui suscitent beaucoup d’espoir, mais qui n’avancent pas très vite. À nouveau, cela demande de faire énormément de recherche fondamentale. Contrairement au génome, qui lui a été décrypté entièrement, on ne connaît pas encore tout sur notre épigénome, en particulier dans le contexte du cancer.
Les marques épigénétiques varient d’un individu à l’autre. Même les jumelles monozygotes (issues du même œuf) ne sont pas identiques de ce point de vue.
D. FRANZ/BARCROFT USA via GETTY IMAGES
Partager
Vous êtes mondialement connue pour vos travaux sur l’inactivation du chromosome X. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?
E. H. : Comme vous le savez, les mammifères femelles portent deux chromosomes X, hérités de chacun de leurs parents, tandis que les mâles ont un chromosome Y hérité de leur père et un chromosome X hérité de leur mère. Problème : le Y porte très peu de gènes, une centaine à peine qui sont importants pour les caractères sexués masculins, et le X plus d’un millier ! Pour compenser ce déséquilibre entre mâles et femelles, un processus de désactivation de l’un des deux chromosomes X s’est donc mis en place chez les femelles. C’est un programme 100 % épigénétique qui éteint un chromosome entier !
Contrairement au génome, qui lui a été décrypté entièrement, on ne connaît pas encore tout sur notre épigénome, en particulier dans le contexte du cancer.
Quelles implications cette inactivation du chromosome X a-t-elle, concrètement ?
E. H. : Chez la plupart des mammifères, dont les humains, le choix du chromosome X à inactiver est totalement aléatoire d’une cellule à l’autre au cours du développement. Cela signifie que la femme est une véritable mosaïque pour l’expression des gènes du X. Dans chaque tissu (le cerveau, le sang, les reins, etc.), la proportion de cellules qui activent le X paternel par rapport au X maternel peut être différente, et varie également d’un individu à l’autre. Même les jumelles monozygotes (issues du même œuf) ne sont pas identiques de ce point de vue.
Cela a des conséquences bien concrètes. On sait par exemple que des gènes portés par le chromosome X sont impliqués dans un certain nombre de maladies neurologiques. C’est le cas du syndrome de Rett, un syndrome d’autisme aigu qui compromet la survie des personnes qui en sont atteintes. Ce syndrome est dû à une mutation d’un gène du X : les garçons qui portent cette mutation meurent très jeunes, car leur cerveau fonctionne mal. Les filles, elles, réagissent différemment à la maladie selon la proportion de X mutés et de X sains exprimés dans leurs cellules. Aujourd’hui, mon espoir et celui de mon équipe est d’arriver à réactiver les gènes du X silencieux en jouant sur les marques épigénétiques, et d’aider un jour à la guérison de ces femmes. Mais la route est encore longue.
Depuis le 1er janvier, vous êtes la nouvelle directrice générale de l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Est-ce à dire que vous allez mettre vos recherches sur le X entre parenthèses ?
E. H. : Absolument pas. Je suis partie à Heidelberg, au siège de l’EMBL, avec six personnes de mon ancienne équipe de l’Institut Curie qui ont accepté de m’accompagner en Allemagne. En me sélectionnant pour prendre la tête de cet organisme, le comité a décidé de choisir un chercheur en pleine activité, qui va continuer à mener ses recherches pendant le temps de son mandat, qui est de cinq ans, renouvelable.
Pourquoi avoir accepté ce poste à l’EMBL ?
E. H. : L'EMBL est un organisme intergouvernemental mis en place en 1974 pour soutenir la recherche en biologie moléculaire en Europe et pour garder les chercheurs sur le sol européen. Aujourd’hui, 29 pays y contribuent. Son rôle est double : faire de la recherche fondamentale, grâce à ses 1 700 chercheurs et à ses 6 instituts situés à Heidelberg, Barcelone, Hinxton, près de Cambridge, Rome, Hambourg et Grenoble ; et, enfin, offrir des technologies de pointe à tous les chercheurs des pays membres pour stocker la data, l’analyser, etc. Diriger cet organisme est bien sûr un honneur pour moi, et j’ai accepté pour trois raisons. Premièrement, l’EMBL se focalise sur la recherche fondamentale et l’excellence : c’est essentiel pour faire avancer les recherches en biologie. Ensuite, le poste a été proposé à une femme, et c’est important quand une opportunité de ce genre se présente de l’accepter ; si les femmes ne font pas cet effort, quels que soient les sacrifices personnels que ce type de poste demande, les choses ne changeront jamais ! Enfin, à cause de l’état de l’Europe. La crise grecque, le vote pour le Brexit ont beaucoup affaibli ce bel édifice. Or je suis profondément européenne, britannique par mon père, grecque par ma mère, mariée à un Français et j’ai travaillé en France depuis le début de ma carrière : je dois faire quelque chose pour l’Europe !
En quoi va consister votre mission à la tête de cet organisme ?
E. H. : L’EMBL est un organisme souple, qui sait être réactif et adapte régulièrement ses priorités de recherche. Un nouveau programme de recherche est d’ailleurs mis sur pied tous les cinq ans. Le programme en cours, qui dure jusqu’en 2021, s’appelle Digital Biology et se focalise sur le fonctionnement de la cellule jusqu’à l’organisme complet. En arrivant à Heidelberg, mon premier rôle va être de réfléchir au prochain programme pluriannuel. Cela va demander un gros travail de diplomatie et de consultation des pays membres. Je tiens ici à préciser que l’EMBL est indépendant de l’Union européenne, et que le Royaume-Uni continuera d’en faire partie après le Brexit. De même, les chercheurs étrangers qui travaillent dans notre unité de Hinxton, près de Cambridge, ne seront en aucun cas affectés par le Brexit.
Vous êtes britannique, comment votre situation personnelle se trouve-t-elle affectée par le Brexit ?
E. H. : Je vous l’ai dit, je suis profondément européenne, et cette idée du Brexit me navre. Néanmoins, je dois m’y préparer ; c’est pour cette raison que je suis en train de faire les démarches pour obtenir la nationalité française, après presque trente ans passés dans l’Hexagone.
Vous codirigez depuis 2017 le programme Pause, animé par le Collège de France, où vous êtes professeure depuis 2012. Ce programme mis en place par le gouvernement précédent consiste à mieux accueillir sur le sol français les chercheurs étrangers en exil. Pourquoi cet engagement ?
E. H. : Je suis de culture internationale et j’ai travaillé presque toute ma vie en France sans que l’on me pose la moindre question. Je suis par ailleurs scientifique, un métier où l’on est amené à collaborer avec des personnes de toutes les nationalités et à voyager sur toute la planète. L’idée que des confrères ne puissent plus avoir cette liberté me dérange énormément. Depuis plusieurs années déjà, il existait des programmes d’accueil des scientifiques en exil aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais rien en France. Le programme Pause veut réparer ce manque en permettant aux scientifiques en danger dans leur pays de continuer leurs travaux dans l’Hexagone dans les meilleures conditions possible. Généralement, ils ont déjà des contacts sur place, dans des universités et des laboratoires de recherche. L’idée est de faciliter leur accueil en accordant des financements incitatifs aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche publics projetant de les accueillir, mais également de les accompagner dans leurs démarches, pour obtenir un visa, un titre de séjour ou un logement en France. Cent quarante chercheurs venus de Syrie, de Turquie, d’Irak, du Yémen, du Venezuela, d’Afghanistan, du Burundi… ont déjà pu bénéficier de ce dispositif. C’est pourquoi je suis fière d’aider à en faire la promotion.
DOCUMENT CNRS LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le cerveau sous toutes ses formes |
|
|
| |
|
| |

Le cerveau sous toutes ses formes
lundi 5 mars 2018
Décrypter le fonctionnement du cerveau est l'un des défis majeurs de la recherche en ce début de siècle. Et quel défi ! Le cerveau humain est d'une incroyable complexité : il comprend environ 100 milliards de neurones connectés par des millions de kilomètres de « connecteurs » (axones) et de 10 000 à 100 000 milliards de « contacts » (synapses). Un défi que les neuroscientifiques sont en train de relever. Grâce notamment aux progrès des technologies d'imagerie, ils dévoilent aujourd'hui les mystères du fonctionnement du cerveau, ce gigantesque réseau qui orchestre nos mouvements, nos prises de décision, qui interprète ce que perçoivent nos sens et qui est le siège de notre conscience. Il s'agit d'un enjeu considérable pour la société, car le cerveau est l'objet de dysfonctionnements et de maladies avec un fort impact sur la santé voire l'économie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies du système nerveux constituent plus du tiers de toutes les maladies dans les pays riches, et chaque année en Europe, elles représentent un coût de près de 800 milliards d'euros. Hors du domaine de la santé, les connaissances acquises dans le domaine des neurosciences ont des applications potentielles en robotique ou dans les sciences de l'éducation.
Conférences, visites de laboratoires, ateliers, projections de films… de nombreux événements seront proposés lors de cette 20e édition de la Semaine du cerveau durant laquelle les scientifiques viendront à la rencontre du public pour présenter leurs dernières avancées mais aussi débattre de leurs enjeux et de leurs implications pour notre société.
Retrouvez toutes les manifestations du CNRS sur un site internet dédié et les informations complètes de l'évènement sur le site de la Semaine du cerveau.
Par ailleurs, ce mois-ci, deux ouvrages grand public rédigés par Olivier Houdé, directeur du Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant (CNRS/Université Paris Descartes), sont l'occasion de faire le point sur les recherches menées dans le domaine des sciences cognitives dédiées à l'éducation. Le premier « L'école du cerveau », publié mi-mars aux éditions Mardaga, est une véritable boîte à outils pour s'initier à la neuropédagogie et à la neuroéducation : portraits historiques (Montessori, Freinet, Piaget), exemples d'expériences et piste pratiques sont mis à disposition des professeurs, parents, éducateurs et psychologues. Le deuxième, « Mon cerveau », co-signé avec Grégoire Borst et paru le 1er mars aux éditions Nathan, est quant à lui destiné aux enfants dès 7 ans pour découvrir, en 32 questions/réponses, le fonctionnement et l'importance du cerveau. Enfin, un troisième ouvrage récent, impliquant des chercheurs CNRS, s'intéresse lui aux apprentissages. Paru en librairie en février 2018 (éditions Dunod) il s'intitule « Psychologie cognitive des apprentissages scolaires ».
Liste d'experts :
Le bureau de presse du CNRS tient à votre disposition une liste d'experts sur le cerveau : T 01 44 96 51 51 | presse@cnrs.fr
Nos dernières actualités sur le cerveau :
Des logiciels experts en diagnostic médical
Dans la tête des bébés
Et le blog du CNRS le Journal « Aux frontières du cerveau »
Ressources visuelles
Un album photos « spécial cerveau » à la Photothèque du CNRS
Une sélection de films à la Vidéothèque du CNRS (dossier cerveau)
Télécharger le communiqué de presse :

Contacts :
Presse CNRS l Alexiane Agullo l T 01 44 96 51 51 l presse@cnrs.fr
DOCUMENT cnrs LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
MUTATION, ÃVOLUTION ET SÃLECTION |
|
|
| |
|
| |
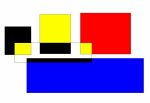
MUTATION, ÉVOLUTION ET SÉLECTION
Mutation, Evolution et Sélection.
Par Miroslav Radman
Texte de la 427e Conférence de l'Université de Tous les Savoirs donnée le 6 juillet 2002
De nouvelles perspectives d'application pour les sciences de l'évolution.
Depuis quelques années, la science de l'évolution, traditionnellement très théorique, abstraite, académique, donne lieu à de très grandes nouveautés expérimentales et a même des implications en biotechnologie et en biomédecine. On peut ainsi utiliser des méthodes directement inspirées de l'évolution naturelle pour faire évoluer des molécules d'intérêt industriel ou pharmaceutique. On est également aujourd'hui capable d'observer l'évolution de populations bactériennes en temps réel ou encore la dynamique des gènes dans des embryons. Dans une phrase célèbre, Dobzhansky explique que la biologie n'a de sens qu'à la lumière de l'évolution. L'idée est que le but unique de la vie c'est la vie elle-même, la survie et que la grande stratégie de la survie, c'est l'évolution. Nous aimerions donc apprendre de l'évolution cette stratégie, pour connaître mieux la vie mais aussi pour pouvoir mettre en place une évolution qui nous sera utile et bénéfique.
« Imperfection », efficacité et robustesse des stratégies évolutives.
Tout être vivant, de la bactérie jusqu'à l'homme doit, pour survivre, éviter de se faire manger de l'extérieur, par les prédateurs ; il doit également éviter de se faire manger de l'intérieur par les parasites, éviter de perdre la compétition avec ses congénères et, lorsqu'il a évité toutes ces sources de mort, développer une robustesse de l'organisme face à un environnement physique souvent très agressif. Cette robustesse constitue la clé de la survie à long terme. Les stratégies de l'évolution ont une origine moléculaire qui date de près de 4 milliards d'années. On trouve des séquences dans les génomes, des bactéries jusqu'à l'homme, qui sont des preuves très convaincantes d'une origine commune de tous les organismes vivants. En cherchant à savoir comment la simplicité originelle a pu donner naissance à des individus complexes comme l'homme, on ne trouvera toutefois pas la beauté, la perfection, la finesse que notre esprit pourrait être tenté d'anticiper mais plutôt l'efficacité.
Taux d'erreur lors de la synthèse de l'ADN, des ARN et des protéines.
Les protéines sont les macromolécules responsables de quasiment tout le travail cellulaire. Le taux d'erreur dans la synthèse des protéines est de l'ordre de 1-3 10-4. Dans l'espèce humaine, on a pu estimer expérimentalement que 30% des protéines sont dégradées après leur synthèse parce que le système de contrôle qualité les a détectées - à tort ou à raison - comme défectueuses. On imagine mal un tel taux d'erreur dans une chaîne de production automobile, mais on verra plus loin l'intérêt de cette imperfection naturelle. Le taux d'erreur dans la transcription synthèse d'ARN messager est cohérent avec ce taux d'erreur en aval dans la traduction, de l'ordre de 10-5. Le taux d'erreur dans la réplication de l'information génétique (copie d'ADN en ADN) est par contre de l'ordre de 10-10, ce qui en fait un processus 1 million de fois plus fidèle que la synthèse des protéines. On pourrait en fait faire mieux pour les protéines. Ainsi, les bactéries qui résistent à l'antibiotique streptomycine ont une mutation qui leur confère une fidélité plus haute dans la synthèse des protéines. Il y a cependant un coût à cette fidélité, ces bactéries poussant beaucoup moins vite. L'efficacité est donc privilégiée par rapport à la fidélité.
Stress prévisible et stress imprévisible.
Certains stress sont « prévisibles », par exemple, pour les bactéries, le choc osmotique, le choc thermique (chaud et froid), le choc oxydatif (créé par des macrophages, par exemple). Il y a dans le génome des bactéries des éléments de programme qui permettent de faire face à ces stress, qui ont été rencontrés à de nombreuses reprises au cours de l'histoire évolutive. Les bactéries qui ont survécu aux stress du passé sont aujourd'hui capables de détecter ces stress prévisibles : quand un stress prévisible apparaît, les bactéries activent un mécanisme de survie approprié. Le système d'évolution inductible, le système SOS est mis en action lorsque l'ADN ne peut pas se répliquer car il porte trop de lésions. Le système SOS déclenche la synthèse de polymérases peu fidèles qui sont capables de copier l'ADN défectueux et permettent de sortir du blocage initial, au prix de quelques mutations.
Pour survivre des milliards d'années, une adaptation à des stress imprévisibles est également nécessaire. Le futur est complètement imprévisible, surtout pour les bactéries. Du point de vue des stratégies moléculaires, à l'opposé des mécanismes très spécialisés, efficaces et fragiles (peu robustes) développés face au stress prévisible, les bactéries ont adopté des mécanismes généralistes, flexibles, qui permettent de faire face à l'incertitude inhérente au stress imprévisible. Concrètement, les bactéries créent alors de la diversité aveugle, gaspillent et payent ainsi une sorte d'assurance « tout risque ». On peut en déduire que dans ces conditions, s'il y a un « Grand Concepteur », ce n'est pas le concepteur des produits de l'évolution, c'est le concepteur de la méthode, de la stratégie de l'évolution. Le dernier retrait de Dieu !
Mutation, sélection et biodiversité.
La stratégie de base pour faire face à l'adversité inconnue, est représentée à la figure 1 Le schéma est général et s'applique à l'évolution des tumeurs, des bactéries, des immunoglobulines, des espèces. Dans une population de bactéries, avec un taux d'erreur de 10-10, une bactérie sur 300 environ porte une nouvelle mutation (le génome d'une bactérie typique fait environ 5 106 paires de bases). Normalement, lorsqu'on discute la biodiversité, il y a une connotation politiquement correcte, on respecte la biodiversité. Dans la vie, la biodiversité devient utile au moment où elle va être réduite à presque rien. Par exemple, si on part d'une population de un milliard de bactéries qui sont issues d'une seule bactérie et qu'on les frappe de sélection létale, avec un antibiotique comme l'ampicilline, si la population porte des mutations, un petit nombre de bactéries (1, 2 ... 10) résistantes seront sélectionnées parce qu'elles portaient par hasard une mutation qui leur confère la résistance à l'antibiotique et pourront survivre. Si on laisse pousser ces quelques bactéries, et qu'on frappe les milliards de bactéries qui en sont issues avec un autre antibiotique quelconque, une de ces bactéries aura, par hasard, reçu une mutation qui lui permettra de survivre et développé ainsi deux résistances. Les stratégies évolutives visent essentiellement à mettre en place des mécanismes adaptatifs de survie aux stress. Dans le cas des tumeurs, ce n'est pas une sélection létale, c'est plutôt une sélection compétitive (partie droite de la figure 1) : une cellule qui acquiert une mutation relâchant un des nombreux freins présents au cours du cycle cellulaire, se divise à chaque génération un peu plus vite que les autres et finit par s'imposer au sein de la tumeur. Ce type de sélection compétitive a aussi lieu chez les bactéries dans la nature, en l'absence d'antibiotiques. La biodiversité apparaît ainsi comme le substrat pour la sélection, les mutations sont comme une « assurance-Vie » qui permet de gagner la survie lorsque la population entière est frappée par une sélection létale. Les espèces évoluent de la même façon. La biodiversité permet ainsi à la vie de perdurer malgré de grandes catastrophes. La biodiversité est issue de l'imperfection des mécanismes de réplication de l'ADN, ainsi que des transferts génétiques horizontaux entre espèces proches (création d'individus mosaïques par ajout de blocs de gènes étrangers à l'espèce ayant évolué de manière indépendante des gènes existants). Le danger des monoclones est ainsi l'absence de robustesse liée à l'absence de biodiversité.
Paradigmes lamarckien, darwinien et bactérien.
Il y a deux grands paradigmes historiques dans l'évolution : le paradigme darwinien et le paradigme lamarckien. La figure 2 représente la biodiversité par une courbe en cloche. Le paradigme lamarckien dit que si l'environnement change et qu'une version (allèle) A d'un gène ne permet plus la survie, il y a une évolution intelligente : on construit à partir d'un allèle A un allèle B qui permet la survie. Le paradigme darwinien dit qu'il y a une grande diversité naturelle dans la population ; si B est préexistant dans cette diversité, les bactéries qui portent cet allèle survivent ; si B n'est pas préexistant dans la diversité, la population entière s'éteint simplement. Ainsi le paradigme darwinien exclut l'intelligence, le choix « à la carte ».
Le paradigme « bactérien », encore appelé néo-darwinien, que j'ai élaboré avec mes collègues François Taddei et Ivan Matic, est intermédiaire entre le paradigme lamarckien et le paradigme bactérien. Il n'inclut pas l'intelligence du lamarckisme, mais inclut le stress, qui active des gènes de sauvetage, de survie, jusque là éteints, silencieux. Grâce à ces gènes, le système commence à muter davantage : en cas de catastrophe, avant de mourir, on « essaye une dernière opération génétique désespérée » et on fait exploser la biodiversité : au lieu des taux d'erreurs de 10-10, on augmente le taux d'erreur de 1000 fois, à 10-7. Le résultat est plutôt bon : même si on n'a pas l'intelligence de pouvoir construire B sur mesure, cette évolution inductible multiplie par 1000 la probabilité que l'allèle B soit présent dans la population.
Les mutateurs.
La figure 3 illustre le phénomène de la sélection du deuxième ordre. Cette expérience démontre l'énorme adaptabilité génétique des bactéries : comme disait le célèbre évolutionniste Steven G Gould, les bactéries sont de loin les organismes ayant le plus de succès sur la terre, adaptées à tout, vivant dans toutes sortes de conditions horribles, jusqu'aux eaux bouillantes des geysers. Cette adaptabilité des bactéries à une énorme variété de milieu est précisément notre problème lorsque les bactéries sont pathogènes. On étale des bactéries sur une boîte de Pétri, un tapis qui en contient de l'ordre de 10 milliards. On transfère ces bactéries sur une boîte de gelose qui contient l'antibiotique ampicilline. Seule une bactérie sur 10 à 100 millions survivra. On laisse pousser ces bactéries survivantes 24 heures, chacune donne naissance à environ 10 millions de bactéries. On met ensuite la boîte en contact avec une deuxième boîte, qui contient un autre antibiotique, différent. On sélectionne ainsi une deuxième résistance. On itère l'opération pour sélectionner une troisième propriété : la capacité à se nourrir de lactose. On évalue ensuite le taux de mutation dans les clones bactériens à chaque étape. On observe alors qu'une bactérie sur 100 000 mute 100 à 1000 fois plus vite que les autres. On appelle ces bactéries des mutateurs. Après la première sélection, 1% des bactéries sont des mutateurs, après la deuxième sélection, 50% en sont et après la troisième sélection, toutes les bactéries sont des mutateurs. Ainsi par le biais de cette sélection qui visait trois capacités spécifiques (résistance à deux antibiotiques distincts, capacité de métaboliser le lactose) les bactéries n'ont pas seulement « appris » cette triple capacité, elles ont appris une méthode qui leur permet de muter plus vite, et donc les prépare à faire face beaucoup plus efficacement à des problèmes nouveaux.
Le défaut des bactéries mutateurs est expliqué à la figure 4 Il y a trois types de mécanismes pour maintenir la fidélité au cours de la réplication, chez les bactéries comme chez l'homme. Le premier est un nettoyage des lésions chimiques apparaissant naturellement dans l'ADN qui va être copié, à cause du métabolisme oxydatif ou des radiations par exemple. Les lésions chimiques sont réparées, coupées à gauche et à droite et remplacées, par l'activité d'une ADN polymérase. Un deuxième mécanisme s'occupe des nucléotides, A, T, G, C, substrats de base pour la synthèse de l'ADN ; il assure un taux d'erreur de l'ordre de 10-7 dans ces briques de base. Un dernier mécanisme est un système de contrôle qualité de ce qui vient d'être fabriqué. Ce système compare systématiquement la copie et l'original. A chaque fois que la copie n'est pas conforme à l'original, la copie est corrigée conformément à l'original. Ce système est efficace à 99.9%, et assure donc un taux d'erreur global de l'ordre de 10-10. La majorité des mutateurs perd ce mécanisme, ce qui explique qu'ils ont 1000 fois plus de mutations que la moyenne de la population. En outre, les mutateurs ont des taux de recombinaison plus élevé que la normale et sont donc plus susceptibles que les bactéries sauvages de donner lieu à des individus mosaïques. Avec Ivan Matic, nous avons analysé des bactéries issues d'environnements naturels (hôpitaux, etc.) et calculé que 1% des bactéries naturelles sont des mutateurs. La figure 5 montre une autre expérience. On prend une bactérie Escherichia coli cultivée depuis 1922 en laboratoire. Ces bactéries n'ont donc pas poussé depuis longtemps dans leur milieu naturel, l'intestin d'un mammifère. On introduit ces bactéries identiques dans des souris qui sont stériles, qui ne contiennent au départ aucune bactérie. Rapidement, il y a 20 % des souris ne contenant que les bactéries mutatrices.
Si on met en compétition des bactéries normales et des mutateurs dans ces souris, qui sont pour elles un milieu nouveau, on observe à chaque fois que ce sont les bactéries mutateurs qui s'imposent et s'adaptent le plus rapidement. Si on part d'un ratio mutateurs / sauvage de 1, au bout de quelques jours, il y a 100 000 fois plus de mutateurs que de sauvages. La figure 6 montre le résultat de simulations. En ordonnée, le fitness, la valeur sélective, concrètement la vitesse de survie. On voit qu'au cours du temps la vitesse de croissance augmente au gré de l'acquisition de mutations qui relâchent des freins, et atteint finalement une asymptote, fitness maximale du génome dans l'environnement. La simulation montre que les mutateurs atteignent cette vitesse de croissance maximale beaucoup plus vite que les autres. Ceci se fait au prix de quelques morts, mais n'affecte pas la mortalité générale. Etre un mutateur peut être un inconvénient pour l'individu, et un avantage pour la population. On peut à ce titre comparer les mutateurs à des « expériences pilotes ». A court terme, face à n'importe quel défi évolutif (antibiotiques...) on observe que les mutateurs gagnent face aux bactéries normales. Par exemple, des chercheurs madrilènes on observé que dans les poumons de patients atteints de mucoviscidose et traités en permanence avec des antibiotiques, la moitié de la population est constituée de mutateurs. A terme, les mutateurs paieront le prix des erreurs qui ont permis leur succès.
Nous avons cherché, dans le génome des bactéries, des traces qui prouveraient que dans le passé elles ont évolué à deux vitesses : quand la vie est dure, un taux de mutation élevé et quand la vie est facile, un taux de mutation faible. La figure 7 présente l'espace des séquences observé au gré des mutations. En l'absence de sélection létale, les bactéries vivent une marche sûre et lente vers un fitness amélioré. Les mutateurs au contraire accumulent les mutations beaucoup plus vite, s'adaptent vite, mais la létalité associée à l'érosion de leur génome les condamne à long terme. On a observé que la sexualité des bactéries, les échanges de gènes, permettent à des mutateurs de redevenir non mutateurs. Des mutateurs adaptés peuvent aussi transmettre le gène qui a permis leur succès à des non mutateurs. Disposer d'une fraction de mutateurs est alors un avantage pour la population toute entière.
Conclusion.
Du point de vue de la vitesse d'évolution, de mutation, la vie se passe entre deux extrêmes mortels. Le premier, un conservatif total, avec aucune mutation, condamne les bactéries dès qu'une série de stress importants apparaissent. Le second extrême - trop de mutation - a été fabriqué en laboratoire et ceci n'est pas viable même à court terme : des levures ou des bactéries mutatrices modifiées pour produire 100 000 fois plus de mutations que des cellules normales.
Ainsi le taux de mutation optimal est une fonction de l'environnement : si la vie est facile, le taux de mutation optimal est zéro : le génome est parfaitement adapté, l'environnement ne change pas et on ne change pas le génome ; si la vie est très difficile, le taux de mutation optimal peut devenir énorme (exemple du virus du SIDA).
On pense pour finir au principe de la Reine Rouge de Lewis Caroll : la Reine Rouge est en train de courir tout le temps. Lorsqu'elle arrive au pays de la Reine Rouge, pour pouvoir lui parler, Alice doit courir aussi. Au bout de vingt minutes Alice est épuisée par sa course et interpelle la Reine car elle se rend compte qu'elle est toujours en face du même arbre qu'au départ. La Reine lui explique alors que dans son pays, pour simplement rester sur place il faut courir. C'est en quelque sorte ce que font les bactéries depuis des milliards d'années : elles « courent » génétiquement tellement vite qu'elles réussissent à s'adapter à tout environnement et à tous les antibiotiques que nous avons fabriqués.
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
