|
| |
|
|
 |
|
droits de l'homme |
|
|
| |
|
| |
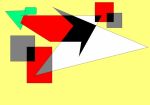
droits de l'homme
Cet article fait partie du dossier consacré aux droits de l'homme et du dossier consacré à la Révolution française.
Les droits de l'homme, et les libertés dont ils s'accompagnent, sont ceux dont tout individu doit jouir du fait même de sa nature humaine. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui marque l'avènement théorique d'un État de droit dotant l'individu du pouvoir de résistance à l'arbitraire et lui reconnaissant des droits naturels, dits fondamentaux. La notion de « déclaration des droits » découle de deux idées : celle de l'existence de droits individuels et celle de la nécessaire affirmation de ces droits par une autorité légitime, en l'occurrence le pouvoir constituant en 1789, c'est-à-dire l'État. Matrice de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948, le texte de 1789 est l'aboutissement d'une réflexion qui a commencé avec la Grande Charte d'Angleterre de 1215 et qui passe par l'institution de l'habeas corpus en 1679.
→ charte.
Il appartient à l'État de droit de respecter les libertés fondamentales de l'individu, que le concept de « libertés publiques » traduit en termes constitutionnels. La persistance de nombreux cas de violations des droits de l'homme dans l'histoire contemporaine impose de garantir leur protection à l'échelon international. Non seulement celle-ci suppose l'existence de mécanismes juridiques autorisant des organes internationaux à exercer un contrôle sur l'application des normes relatives aux droits de l'homme, mais encore l'action d'organisations indépendantes des États, qui se révèlent aussi de la première importance.
Trois siècles d'histoire des droits de l'homme
Ce sont les philosophes du xviiie s., parmi lesquels Jean-Jacques Rousseau, qui élaborent le concept de « droits naturels », droits propres aux êtres humains et inaliénables, quels que soient leur pays, leur race, leur religion ou leur moralité. La révolution américaine de 1776, puis la révolution française de 1789 marquent la reconnaissance et la formulation explicite de ces droits.
Dès 1689, en Angleterre, a été proclamé le Bill of Rights. Les colons établis en Amérique en retournent les principes contre leur roi. La Déclaration d'indépendance américaine, le 4 juillet 1776, affirme la primauté des droits et libertés. Au cours de la décennie suivante, par l'entremise du marquis de La Fayette et de Thomas Jefferson, elle éclaire les révolutionnaires français, notamment sur la notion de souveraineté du peuple.
Les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont discutés et votés entre le 20 et le 26 août 1789, alors que l'Assemblée constituante est en conflit avec le roi. Destinée à préparer la rédaction de la première Constitution écrite française, en la fondant sur l'énonciation des principes philosophiques qui doivent former la base de la société, elle proclame les droits « naturels et imprescriptibles » de l'homme, c'est-à-dire ceux que chacun doit exercer par le fait qu'il est homme et sans distinction de naissance, de nation ou de couleur. Après une définition générale de la notion de liberté, la Déclaration précise un certain nombre de libertés particulières : liberté de conscience et d'opinion, liberté de pensée et d'expression, droit à la propriété. L'égalité est la deuxième grande notion de la Déclaration : égalité des droits, égalité devant la loi et la justice, égalité devant l'impôt, égale admissibilité aux emplois publics. L'État nouveau, édifié sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur la notion de souveraineté du peuple, devient le garant des droits.
Au xixe s., la Déclaration de 1789 inspire le mouvement politique et social en Europe et en Amérique latine. Avec l'industrialisation grandissante, l'essor du pouvoir capitaliste et financier, la revendication des droits s'enrichit en effet de la notion de droits sociaux, et particulièrement de droit au travail, sous l'influence du socialisme à la française, puis du socialisme marxiste. Mais les génocides, l'esclavage, qui ne sera aboli que lentement et inégalement, le colonialisme, le travail des enfants, la sujétion des femmes, dont l'émancipation – quand elle aura lieu – sera tardive, sont autant d'obstacles historiques sur la voie d'une reconnaissance pleine et entière des droits de l'homme. La France et les États-Unis eux-mêmes rechigneront souvent à montrer l'exemple, malgré la création d'associations philanthropiques et la lutte pour la prise en compte des droits sociaux (droit de grève, amélioration des conditions de travail, réduction du temps de travail).
Selon l'article 55 de la Charte des Nations unies de 1945, l'O.N.U. doit favoriser le respect universel et effectif des droits de l'homme avec le concours des États membres. Mais la politique des blocs, l'un sous influence américaine, l'autre sous influence soviétique, perturbe pendant plusieurs décennies les débats. Tandis que les Américains insistent sur la notion de droits politiques, les démocraties libérales d'Europe défendent celle de droits sociaux. Compte tenu des deux options, les Nations unies tentent de réaliser leur mission à travers l'action de la Commission des droits de l'homme, créée en 1946. Ceux-ci deviennent une valeur internationalisée en 1948. Il est reconnu que l'homme détient un ensemble de droits opposables aux autres individus, aux groupes sociaux et aux États souverains. Les droits de l’homme sont par la suite étendus à l’enfant : le 20 novembre 1989, les Nations unies adoptent la Convention des droits de l'enfant, afin de protéger l'enfance de la famine, de la maladie, du travail, de la prostitution et de la guerre.
→ droits de l'enfant.
Les droits de l'homme face au principe de souveraineté
Le principe des droits humains, tout comme la notion de paix, fait partie de ces thèmes a priori consensuels et irréfutables sous peine de placer le réfractaire en marge de la communauté internationale. L'humanité entière est révulsée par la barbarie, et un régime criminel ne peut, moralement, asseoir sa légitimité sur la seule souveraineté de l'État.
Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg (1945) et de Tokyo (1946) ont manifesté la valeur de ce raisonnement. Dès 1950, l'Assemblée générale des Nations unies a créé un comité chargé de rédiger le projet de statut d'une juridiction pénale internationale permanente. Mais la guerre froide a eu raison de ces vœux pieux. Le fait que ce projet n'ait pris forme qu'en 1998 témoigne – de même que ses limites – de la résistance opiniâtre des États : aucun d'eux ne cherche spontanément à promouvoir une justice supranationale à laquelle il serait soumis et devant laquelle des citoyens, nationaux ou étrangers, pourraient le traduire. C'est la même attitude qui a freiné les progrès de l'arbitrage international depuis les conférences de la Paix de 1899 et 1907, et limité, malgré deux guerres mondiales, les prérogatives de la Société des Nations puis de l'O.N.U. En réalité, l'opinion publique, alertée par les médias et les organisations non gouvernementales, est un acteur extrêmement important de ces évolutions. C'est à elle qu'il revient de dénoncer les abus de pouvoir, en l'occurrence les crimes commis par les dictateurs, l'altération du principe d'égalité, la négation des droits sociaux, ou encore la corruption des élites dirigeantes. Mais la seule sanction morale ne suffit pas à faire reculer les États coupables. La Déclaration universelle des droits de l'homme exige, par conséquent, pour ne pas être qu'un leurre, que la communauté internationale soit dotée de juridictions qui permettent de se saisir des cas de violation de ces droits.
Voir les articles justice internationale : TPIR, TPIY.
Les institutions au service des droits de l'homme
La Commission des droits de l'homme de l'O.N.U.
Créée en 1946, la Commission se réunit pour la première fois en 1947 pour élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rédigée en un an, celle-ci est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Depuis lors, la date du 10 décembre est célébrée tous les ans en qualité de « Journée des droits de l'homme ».
Jusqu'en 1966, les efforts de la Commission sont essentiellement de nature normative, attendu que, dans une déclaration de 1947, elle estime « n'être habilitée à prendre aucune mesure au sujet de réclamations relatives aux droits de l'homme ». Ses travaux aboutissent, en 1966, à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; ces deux pactes forment, avec la Déclaration universelle, la Charte internationale des droits de l'homme.
En 1967, le Conseil économique et social autorise la Commission à traiter des violations des droits de l'homme. Aussi met-elle au point des mécanismes et procédures afin de vérifier le respect par les États du droit international relatif aux droits de l'homme et de constater les violations présumées de ces droits par l'envoi de missions d'enquête. En outre, la Commission met de plus en plus l'accent sur la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit au développement et le droit à un niveau de vie convenable. Elle s'intéresse de près, comme le démontre la Déclaration de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en 1993, à la protection des droits des groupes sociaux vulnérables, des minorités et des peuples autochtones, ainsi qu'à la promotion des droits de l'enfant et des femmes. La démocratie et le développement sont considérés comme deux facteurs nécessaires à l'épanouissement des droits de l'homme.
Décrédibilisée par la présence en son sein de pays critiqués pour leurs propres atteintes aux droits de l’homme, elle est dissoute en 2006, et remplacée par le Conseil des droits de l’homme. Cet organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies est notamment chargé d’effectuer un examen périodique de tous les pays au regard des droits de l'homme, et de formuler aux États concernés des recommandations.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Établie par le Conseil de l'Europe en 1950 et entrée en vigueur en 1953, la Convention européenne se situe dans la continuité de la Déclaration universelle de 1948. Chaque État qui adhère au Conseil de l'Europe est tenu de la signer et de la ratifier dans un délai d'un an. Les États signataires s'engagent alors à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction certains droits civils et politiques et certaines libertés définis dans la Convention. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, un individu qui s'estime lésé dans ses droits peut entamer des procédures à l'encontre de l'État contractant qu'il tient pour responsable. Un État contractant peut également intenter une procédure contre un autre État contractant : c'est ce que l'on appelle une requête interétatique.
Le fait que des États souverains acceptent qu'une juridiction supranationale remette en cause les décisions de juridictions internes et qu'ils s'engagent à exécuter ses jugements a représenté une étape historique dans le développement du droit international. La théorie selon laquelle les droits de l'homme ont un caractère fondamental les plaçant au-dessus des législations et des pratiques nationales a été appliquée. Cela revient à reconnaître qu'il ne faut pas laisser un État décider lui-même de l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fonction de considérations politiques nationales.
La Convention a instauré une Cour européenne des droits de l'homme, chargée d'examiner les requêtes individuelles et interétatiques. Les juges de la Cour, totalement indépendants, sont élus par le Parlement européen. Le Conseil des ministres surveille l'exécution des arrêts de la Cour. Le droit de recours individuel est automatique, ainsi que la saisine de la Cour dans le cadre des requêtes individuelles et interétatiques.
LES GRANDES ÉTAPES INSTITUTIONNELLES DE LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
1215 : la Grande Charte d'Angleterre (Magna Carta) énumère, après les excès de Jean sans Terre, un certain nombre de dispositions tendant à protéger l'individu contre l'arbitraire royal en matière de taxes ou de spoliation de biens, et assure à chaque sujet un procès équitable dans le cadre de l'égalité de traitement devant la loi.
1679 : l'habeas corpus, en Angleterre, garantit le respect de la personne humaine et la protège d'arrestations et de sanctions arbitraires. Le roi est ainsi privé du pouvoir de faire emprisonner qui il veut selon son bon plaisir.
1689 : la Déclaration des droits (Bill of Rights), adoptée par la Chambre des lords et la Chambre des communes, réduit le pouvoir royal en Angleterre, en proclamant notamment la liberté de parole au sein du Parlement et le droit pour les sujets d'adresser des pétitions au monarque.
4 juillet 1776 : la Déclaration d'indépendance américaine, rédigée par Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et John Adams, et inspirée de la philosophie des Lumières, est signée à Philadelphie par les délégués des treize colonies et promulgue un contrat social fondé sur l'indépendance, l'égalité, la liberté et la recherche du bonheur (« We hold these truths to be self-evident; that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness »).
26 août 1789 : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, destinée à devenir l'archétype des déclarations ultérieures, est adoptée par l'Assemblée constituante.
3 septembre 1791 : la première Constitution écrite française garantit pour chacun « des droits naturels et civils ».
26 juin 1945 : la Charte des Nations unies, signée à San Francisco, internationalise le concept de droits de l'homme.
10 décembre 1948 : la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'O.N.U. est la première référence aux libertés fondamentales communes à tous les peuples de la Terre. Aux obligations morales liées à l'universalité du message s'ajoutent, pour les pays signataires, de réelles obligations juridiques qui sont censées instituer autant de garanties pour les peuples concernés.
4 novembre 1950 : la Convention européenne des droits de l'homme est signée à Rome sous l'égide du Conseil de l'Europe ; elle entre en vigueur en 1953.
1er août 1975 : l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.), signé à Helsinki, fait figurer le « respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales » parmi les principes de base qui régissent les relations mutuelles des 35 États participants.
Les organismes de défense des droits de l'homme
La Ligue des droits de l'homme
La Ligue est le plus ancien organisme de défense des droits et des libertés. Elle est fondée, en février 1898, par l'ancien ministre de la Justice Ludovic Trarieux et quelques amis, à l'occasion du procès intenté à Émile Zola qui venait de faire paraître dans le journal l'Aurore son célèbre réquisitoire « J'accuse ». Après l'affaire Dreyfus, la Ligue poursuit son engagement en prenant position sur les grands débats contemporains. Ainsi, en 1905, elle se déclare en faveur de la séparation des Églises et de l'État ; en 1909, son président réclame le droit de vote pour les femmes et leur éligibilité à la Chambre et au Sénat. La Ligue suit de près l'évolution de la vie politique et, en 1935, c'est à son siège qu'est signé le programme du Front populaire par les socialistes, les radicaux et les communistes.
En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, reprend largement le projet du représentant français René Cassin, membre de la Ligue des droits de l'homme. Par la suite, celle-ci joue un rôle dans les protestations contre l'utilisation de la torture lors de la guerre d'Algérie, dans les revendications étudiantes de mai 1968, dans les actions qui amènent, en 1973, la modification de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ou encore en faveur de l.’abolition de la peine de mort. Plus récemment, elle s’est engagée dans les années 1990 contre la montée du racisme, et pour l’extension des droits des étrangers, ainsi que pour la régularisation des sans-papiers.
La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (F.I.D.H.)
Fondée en 1922, la Fédération est la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme au plan international. Elle a son siège en France. Organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique, elle se déclare également apolitique, non confessionnelle et non lucrative. Elle se voue à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme en informant l'opinion publique et les organisations internationales par le biais de lettres, de communiqués et de conférences de presse. Comme Amnesty International, la F.I.D.H. bénéficie du statut d'observateur auprès des instances internationales (Nations unies, Unesco, Conseil de l'Europe, Commission africaine des droits de l'homme).
Amnesty International
C'est en 1961, à l'initiative de Peter Benenson (1921-2005), avocat britannique, qu'un groupe d'avocats, de journalistes, d'écrivains, choqués par la condamnation de deux étudiants portugais à vingt ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté dans un bar, lance un appel pour l'amnistie (Appeal for Amnesty). L'acte de naissance officiel du mouvement Amnesty International peut être daté du 28 mai 1961, lorsque le supplément dominical du London Observer relate l'histoire de six personnes incarcérées pour « raisons de conscience » – parce qu'elles ont exprimé leurs croyances religieuses ou politiques – et exhorte les gouvernements à relâcher de tels prisonniers. Amnesty International, organisation indépendante à caractère non gouvernemental, mène depuis lors une action vigoureuse de défense des droits de l'homme, à l'adresse des gouvernements qu'elle fustige dans son rapport annuel et de l'opinion publique internationale. Au cours des années 1970, Amnesty International s'est vu confier le statut d'observateur pour le compte des Nations unies. En 1977, son action a été récompensée par le prix Nobel de la paix, titre qui n'impressionne pas forcément tous les gouvernements.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
cathédrale Notre-Dame |
|
|
| |
|
| |
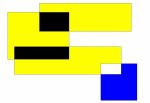
cathédrale Notre-Dame
À Paris, église métropolitaine, située dans l'île de la Cité.
1. Avant Notre-Dame
Dans l’Antiquité, au ier siècle de notre ère, il existe déjà à la pointe orientale de l’île de la Cité une sorte de temple élevé à Jupiter par les bateliers (les « nautes ») parisiens. La pierre votive (Pilier des nautes, conservé aujourd’hui au musée de Cluny-musée national du Moyen Âge, à Paris) en fut retrouvée en 1711, sous le chœur de Notre-Dame.
Sur cet emplacement, les chrétiens à leur tour construisent une basilique. Elle est indiquée comme déjà existante au ive siècle, et Childebert Ier, roi des Francs, la réédifie deux cents ans plus tard (son plan mérovingien apparaît lors de fouilles en 1965). On élève ensuite une autre église, plus petite, toute proche de la première, et ce sont ces deux édifices, dédiés l’un à saint Étienne, l’autre à sainte Marie (ou Notre-Dame), ainsi qu’un baptistère, qui constituent le premier groupe épiscopal de Paris. On suppose qu’après les invasions normandes et la destruction de Sainte-Marie par un incendie, l’église Saint-Étienne sert pendant longtemps seule de cathédrale.
2. Histoire du bâtiment
2.1. Deux siècles de construction
Au cours du xiie siècle, en France, les évêchés très liés au pouvoir royal se dotent de cathédrales modernes c’est-à-dire obéissant aux nouvelles règles de l’architecture « ogivale » (ou gothique). Ainsi, vers 1160, l’évêque de Paris Maurice de Sully décide d’édifier une nouvelle église pour son diocèse parisien. La première pierre est posée en 1163 par le pape Alexandre III et le roi Louis VII. Le chœur est achevé en 1177, le transept et la nef vers 1196. À la fin du xiie siècle, le culte est déjà sans doute célébré dans l’édifice inachevé.
Le chantier de Notre-Dame de Paris est poursuivi sous le règne de Saint Louis (entre 1226 et 1270). La façade et les tours sont terminées dans le deuxième quart du xiiie siècle. Des chapelles, non prévues sur le plan initial, sont ajoutées entre les contreforts de la nef vers 1235-1250. Les maîtres d’œuvre Jean de Chelles et Jean Ravy élèvent les chapelles du tour du chœur (fin du xiiie siècle-début du xive siècle), achevant ainsi la construction de l’édifice médiéval.
La cathédrale appartient donc aux deux premières périodes du style gothique : celui « lancéolé » de Philippe Auguste et celui « rayonnant » de Saint Louis ; elle en est un des plus remarquables spécimens. Si la cathédrale subsiste aujourd’hui, il n’en est pas de même des bâtiments qui la jouxtaient au Moyen Âge : au Nord, le cloître et le baptistère (Saint-Jean-le-Rond) et, au Sud, le palais archiépiscopal ont aujourd’hui disparu.
2.1. Dégradation et restauration
Notre-Dame devient église métropolitaine au cours du xviie siècle, avec la transformation du diocèse de Paris en archidiocèse. Pendant la période révolutionnaire, le monument est dédié au culte de la Raison (1793), puis à celui de l’Être suprême (1794), et, enfin, transformé en magasin de vivres. Une grande partie du mobilier et de la sculpture monumentale est détruite. C’est le cas, en particulier, des statues de la galerie des Rois, qui représentent les souverains de Juda et d’Israël, mais dont on pense à l’époque qu’il s’agit des portraits de rois de France. Les statues sont à ce titre mises à bas en 1793 et destinées à servir de pierres de carrière. On en retrouve de nombreux fragments (dont 21 têtes), par hasard, en 1977, lors de travaux dans la cour d’un hôtel particulier de la rive droite ; elles y avaient été ensevelies en 1796, après leur rachat. Ces fragments sont aujourd’hui conservés au musée de Cluny.
À partir de 1845, de vastes travaux de réhabilitation sont exécutés, sous la direction de Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. Ils vont durer jusqu’en 1879 : les façades extérieures de la cathédrale sont très restaurées, la statuaire reconstruite, voire entièrement revue (c’est le cas des célèbres chimères de la balustrade) et la flèche reconstruite sur un modèle différent de la première (démontée entre 1786 et 1792).
3. La cathédrale aujourd’hui
3.1 L’extérieur
La cathédrale a 130 m de longueur, 48 m de largeur, 35 m de hauteur sous la voûte (69 m au sommet des tours).
La façade principale, donnant vers l’ouest sur la place du Parvis Notre-Dame, de 40 mètres de long, offre une remarquable unité de composition. Trois portes s’y ouvrent : celle de la Vierge (à gauche), celle du Jugement dernier (au centre), et celle de Sainte-Anne (à droite). Des figurines d’anges et de saints remplissent les voussures, tandis qu’aux soubassements s’épanouissent des bas-reliefs consacrés aux Occupations du mois, représentant les Vertus et les Vices.
Les portes sont surmontées des deux galeries – des Rois et de la Vierge. Cette dernière galerie, d’une extrême légèreté, relie les deux tours carrées entre lesquelles s’épanouit une grande rose centrale, flanquée de deux baies géminées. Sur cette façade, toutes les grandes statues datent de la restauration effectuée au xixe siècle. Toutefois, la majeure partie du tympan de la porte Sainte-Anne date du xiie siècle et les deux autres portes conservent des reliefs du xiiie siècle sur les tympans, aux voussures et aux soubassements.
Les deux façades du transept comportent des portails du milieu du xiiie siècle : elles sont l’œuvre de Jean de Chelles (façade nord, vers 1250) et de Pierre de Montreuil (façade sud, face à la montagne Sainte-Geneviève, vers 1260). On peut voir, au trumeau du portail nord, la seule grande statue préservée depuis cette date, une élégante Vierge à l'Enfant. Au portail sud, de curieux bas-reliefs illustrent la vie des étudiants. Contrairement aux fenêtres hautes, les grandes roses de ces deux façades du transept (comme celle de la façade ouest) ont conservé une partie de leurs vitraux anciens, datant du xiiie siècle.
Au-dessus du chœur s’élève la flèche construite au xixe siècle. L’abside, que l’on voit bien surtout de la rive gauche, est un chef-d’œuvre d’élégance et de proportions, grâce à la légèreté des arcs-boutants qu’elle supporte : la vision du chevet de Notre-Dame évoque un navire avec ses cordages, ses mats et ses voiles, ce qui explique la comparaison souvent faite avec un « vaisseau de pierre ».
Le jardin qui entoure le chevet, anciennement dit « de l’Archevêché », occupe l’emplacement de l’ancien palais archiépiscopal, saccagé en 1831. On peut y voir une petite porte rouge entourée de sculptures délicates (c’était celle qui reliait le cloître et le chœur de la cathédrale) et, au centre du jardin, la fontaine Notre-Dame : conçue dans le style gothique des xiiie et xive siècles, elle date toutefois des travaux de restauration exécutés au xixe siècle.
3.2. L’intérieur
La cathédrale comporte des doubles bas-côtés, des tribunes, des voûtes sexpartites et des fenêtres hautes qui furent agrandies au cours du xiiie siècle. L’intérieur se compose, d’une part, d’une nef très large, accompagnée de collatéraux et de trente-sept chapelles latérales, d’autre part du chœur, séparé par une large galerie des chapelles de l’abside. Le chœur est en grande partie fermé par une clôture, dont la face extérieure offre toute une série de bas-reliefs polychrome en pierre, réalisés par Jean Ravy et Jean le Bouteiller (1351). Cette clôture faisait suite au jubé, aujourd’hui disparu, et se continuait sur la partie tournante du chœur.
Il subsiste, en plus de ces parois latérales de la clôture du chœur, des stalles et des grilles datant du xviie siècle, les statues du vœu de Louis XIII dans l'abside et des tombeaux (monument du comte d'Harcourt par Jean-Baptiste Pigalle). On a replacé dans les chapelles une partie des « mays » de Notre-Dame : ces grandes peintures furent commandées chaque année entre 1630 et 1707 (à l'exception des années 1683 et 1684) par la corporation des orfèvres pour être offertes, dans les premiers jours de mai, à la cathédrale de Paris.
3.3 Trésor et cloches
Le trésor de la cathédrale renferme aujourd’hui une relique de première importance pour les chrétiens : il s’agit de la supposée Couronne d’épine achetée par Saint Louis à l’empereur Constantin et pour laquelle le roi de France ordonna la construction d’un monument reliquaire aussi travaillé qu’une châsse : la Sainte Chapelle.
La sonnerie de Notre-Dame de Paris est renouvelée en février-mars 2013, pour l’anniversaire des 850 ans de la cathédrale : huit nouvelles cloches sont installées dans la tour Nord, un nouveau bourdon (nommé Marie) dans la tour sud, aux côtés du bourdon Emmanuel, qui date du xviie siècle.
4. Le cadre d’un chef-d’œuvre
Le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publié en 1831, est un hymne à la gloire de la cathédrale parisienne. En plus d’avoir inspiré l’œuvre, elle en est perçue comme le véritable centre. Les aventures mélodramatiques d’Esméralda, de Quasimodo et de Claude Frollo ont pour cadre le Paris du xve siècle. Victor Hugo offre avec ce grand roman historique une reconstitution vivante, au centre de laquelle trône la cathédrale et qui exalte les beautés de l’art gothique.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
RÃVOLUTION FRANÃAISE |
|
|
| |
|
| |

DOCUMENT larousse.fr LIEN
PLAN
* RÉVOLUTION FRANÇAISE
* Introduction
* 1. Origines et causes de la Révolution
* 1.1. Introduction
* 1.2. « Ce peuple couché par terre, pauvre Job » (Michelet)
* 1.3. La crise économique
* 1.4. Révoltes urbaines et rurales
* 1.5. La bourgeoisie : « une position d'autant plus insupportable qu'elle devenait meilleure […] » (Tocqueville)
* Des petits bourgeois plus riches et plus industrieux que les nobles…
* …mais écartés des meilleures places
* La crise morale
* La monarchie incapable de se réformer
* 1.6. L'aristocratie : l'impossible compromis
* Des nobles encore riches…
* … quoique menacés d'appauvrissement
* … La noblesse de robe : opposée au roi mais conservatrice
* 1.7. La « féodalité d'Ancien Régime »
* La servitude de la terre
* 2. 1789 : de Versailles à Paris
* 2.1. Spécificité de la Révolution française
* 2.2. Les états généraux
* Pourquoi les états généraux ?
* Ouverture des états généraux : des aspirations divergentes
* 2.3. L’Assemblée nationale
* Le tiers état seul représentant de la nation
* Le serment du Jeu de paume
* Le renvoi de Necker
* La prise de la Bastille
* 2.4. La Grande Peur et ses conséquences
* La nuit du 4 août 1789
* La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
* Louis XVI prisonnier du peuple de Paris
* 3. L'Assemblée nationale constituante
* 3.1. Nouveaux principes
* Le mode électoral
* Nouvelle organisation territoriale
* 3.2. La question religieuse
* 3.3. Premiers troubles
* La fête de la Fédération (14 juillet 1790)
* La question financière
* Une multitude de mécontentements
* 3.4. Le déshonneur du roi
* La fuite de la famille royale
* Le mouvement républicain : Jacobins et Feuillants
* 3.5. La montée des périls et la guerre
* La déclaration de Pillnitz (août 1791)
* Les débuts de l'Assemblée législative
* Le recours à la guerre
* L'alliance du peuple en armes et de la Révolution
* 4. Vers la République
* 4.1. La nuit du 10 août 1792 : le renversement de la monarchie
* 4.2. La Commune de Paris
* Les massacres de Septembre
* L'abolition de la royauté
* 4.3. L'exécution du roi
* Rivalités politiques et Contre-révolution
* Le procès du roi
* 5. « La patrie en danger »
* 5.1. Le choc de la « levée en masse »
* L'insurrection vendéenne
* 5.2. Au bord de la guerre civile
* 5.3. La Terreur
* Sus aux suspects de crimes contre-révolutionnaires
* Les excès des sans-culottes
* 5.4. Le Comité de salut public
* L'élimination des hébertistes par Robespierre (mars 1794)
* L'élimination des Indulgents (avril 1794)
* La Révolution morale et le culte de l'Être suprême
* La Grande Terreur
* 5.5. La réaction thermidorienne
* Manœuvres politiciennes contre Robespierre
* La chute de « l'Incorruptible »
* 6. La Révolution à la recherche d’un second souffle
* 6.1. Règlements de comptes : la « Terreur blanche »
* 6.2. Renouveau royaliste
* 6.3. Le Directoire
* 6.4. Un pays épuisé
* Crise financière
* Crise économique et sociale
* 6.5. Complots et coups d’État
* Babeuf et la conspiration des Égaux (mars 1796-mai 1797)
* 6.6. Sectarisme antireligieux
* 6.7. Expansionnisme militaire
* 6.8. Le 18 brumaire
Révolution française (1789-1799)
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Ensemble des mouvements révolutionnaires qui mirent fin en France à l'Ancien Régime.
Introduction
1789 a ébranlé l'Europe et le monde. Des Allemands, comme le philosophe Kant ou l'étudiant Hegel, ont aussitôt perçu l'ampleur de la rupture entraînée par la prise de la Bastille et la Déclaration des droits de l'homme. Leurs œuvres ont témoigné de leur attente d'un monde rénové par l'action politique. Les Anglais et les Américains se sont déchirés sur les enseignements à tirer de ce qui se passait en France : pour le Britannique Edmund Burke, député whig aux Communes (Reflections on the Revolution in France, 1790), l'insurrection populaire a ruiné les fondations historiques de la nation française ; le démocrate anglo-américain Thomas Paine répond à ce violent réquisitoire par The Right of Man (1791-1792), où la Révolution est présentée comme l'annonce d'un monde meilleur bâti par les hommes.
La Révolution de 1789 n'apparaît pas par hasard. La France, comme les nations voisines, est alors traversée par des interrogations politiques sur son devenir. Certains penseurs, dans le sillage du duc de Saint-Simon, souhaitent revenir à un État fondé sur la prééminence des aristocrates, garants des libertés provinciales et porteurs d'une tradition; d'autres, les « philosophes », parmi lesquels Diderot et Voltaire, imaginent de nouveaux rapports entre les hommes, remettant en cause les hiérarchies sociales et même, dans certains cas, les autorités religieuses. Certains ont échafaudé de véritables utopies, modèles possibles de rénovation.
C'est en fonction de ces opinions préétablies que les observateurs ont jugé les événements de 1789. Les partisans des réformes ont accepté et défendu tout ce qui pouvait corroborer leurs espoirs, et dénigré leurs adversaires, qu'ils ont qualifiés d'« aristocrates », d'« esclaves » ou d'« ennemis de la liberté ». Ils ont justifié les répressions les plus terribles par la nécessité de juguler une « contre-révolution » toujours renaissante et toujours plus dangereuse, voire féroce.
Le rejet de la Révolution n'a pas été moins fort de la part de nombreux Français « émigrés » de l'intérieur ou de l'étranger : nobles et membres du clergé, mais aussi toute une partie de la population qui a pris peur ou s'est sentie persécutée. Certains ont lutté ouvertement contre la Révolution, dans les « armées des princes » et dans les journaux ; d'autres plus discrètement, dans les réseaux d'espionnage ou dans une résistance quotidienne.
La réalité de la Révolution n'est ni toute blanche, ni toute noire : la fin de l'année 1794, par exemple, voit des révolutionnaires disqualifiés depuis quelques mois reprendre le pouvoir, envoyer les plus radicaux à la guillotine et nouer des contacts avec certains extrémistes comme avec des modérés, voire des royalistes. Il n'est pas facile de rendre compte, au fil du temps, de ces évolutions complexes et parfois contradictoires.
À propos de ces temps d'extrême tension, tous les arguments, toutes les condamnations ne sauraient être adoptés sans précaution par l'historien. Cependant, précisément parce qu'il y a eu ces conflits d'idées qui nous concernent encore, il n'est pas possible de réduire la Révolution à une suite d'actions aveugles menées par des acteurs inconséquents. C'est en rendant compte du bruit, de la fureur et de leurs conséquences imprévisibles, mais aussi de la confrontation d'idéaux élevés, d'analyses rigoureuses et de projets chimériques, que l'on pourra tenter de faire l'histoire de cet événement majeur.
1. Origines et causes de la Révolution
1.1. Introduction
À remuer les documents d'archives qui disent le pain cher et la révolte des pauvres, les premiers historiens, tel Michelet, virent dans la misère la cause essentielle de la Révolution. « Hommes sensibles, s'écrie Michelet, qui pleurez sur les maux de la Révolution (avec trop de raison sans doute), versez donc aussi quelques larmes sur les maux qui l'ont amenée. Venez voir, je vous prie, ce peuple couché par terre, pauvre Job, entre ses faux amis, ses patrons, ses fameux sauveurs, le clergé, la royauté. Voyez le douloureux regard qu'il lance au roi sans parler. »
Les recherches entreprises par certains historiens spécialistes de la période (→ Albert Mathiez, Georges Lefebvre, Ernest Labrousse, Albert Soboul) confirment le fait, mais ne lui accordent plus la même place dans le déclenchement de 1789. La misère se développe à la fin d'un siècle, qui, dans son ensemble, est marqué par la prospérité. Les bourgeois en profitent. Ils réclament une meilleure place dans la patrie aux aristocrates, qui la leur refusent. Ils la conquièrent.
1.2. « Ce peuple couché par terre, pauvre Job » (Michelet)
À la veille de 1789, le vin, dont la vente permet à chaque paysan d'avoir les quelques sous nécessaires à la vie, est trop abondant pour se bien vendre. À cette abondance néfaste succède le malheur des terres ensemencées. Le climat se détériore et les racines des plantes gèlent à près d'un pied sous terre. Les arbres fruitiers ne portent plus que de maigres et insuffisantes récoltes. En 1785, une formidable épizootie tue peut-être la moitié du bétail du royaume, d'où un enchérissement de la laine, alors que le coton a été consacré aux uniformes des soldats partant en Amérique. De plus, le tout début de la révolution industrielle, et notamment l'introduction de nouvelles machines, rend plus aléatoire le recours au travail dans les manufactures pour les paysans les plus pauvres qui y recherchent un appoint. Enfin, l'année 1788 est marquée par un mauvais été, avec une récolte médiocre, que suivit un « grand hyver » ; le prix du blé monte alors de 50 à 100 % selon les régions entre octobre 1788 et mars 1789. Or, c'est à ce moment-là que sont rédigés les cahiers de doléances.
1.3. La crise économique
Le pouvoir d'achat des paysans s'est érodé durant le demi-siècle qui précède la prise de la Bastille. Les paysans consacrent un peu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat à leur alimentation, à base de céréales. Or, les prix augmentent plus vite que les salaires : 50 % pour les premiers entre 1735 et 1789, contre 20 % pour les seconds. Le prix des céréales a même une tendance nette à croître nettement plus vite que celui des autres marchandises. Un pain de quatre livres vaut, au début du règne de Louis XVI, environ huit sous, mais ce prix double, et augmente même davantage lors de la guerre des Farines (1775). Or, le salaire d'un ouvrier ou d'un journalier agricole est compris entre dix et vingt sous par jour, pour 250 jours travaillés par an. Il apparaît donc que, pour les familles les plus modestes, la question du pain était d'une acuité réelle.
La crise agricole se répercute sur l'industrie et le commerce. Le paysan restreint ses achats au moment même où les riches clients s'adressent aux fournisseurs étrangers, tels les Anglais, qui vendent à meilleur prix dans une France ouverte par un traité de commerce à leurs marchandises.
1.4. Révoltes urbaines et rurales
Les foules rurales et citadines, plus nombreuses qu'au début du siècle, se mettent en branle. Le mouvement se continue à la veille et pendant la réunion des États généraux. Ainsi, à Cambrai, des pauvres assaillent et pillent les marchés ; parmi eux, la justice royale frappe. C'est le cas de Thérèse Leprêtre, « duement atteinte et convaincue d'avoir, le 7 mai, partagé sur le marché de ladite ville un sac de blé qui avait été pillé et d'avoir participé aux excès commis à l'abbaye de Premy, en avançant des pierres aux hommes qui cassaient les vitres ». Elle sera, avec d'autres, condamnée à être frappée de verges, marquée au fer rouge d'une fleur de lis et envoyée dans une maison de force.
La faim est donc le moteur du mouvement de révolte populaire, mais celui-ci aide et pénètre une révolution bourgeoise.
1.5. La bourgeoisie : « une position d'autant plus insupportable qu'elle devenait meilleure […] » (Tocqueville)
Des petits bourgeois plus riches et plus industrieux que les nobles…
La crise intervient dans un pays qui, depuis plus d'un demi-siècle, s'est enrichi. Cette richesse se voit aussi bien dans l'animation des ports de la façade atlantique, qui commercent avec les Indes orientales, qu'à l'intérieur des terres, où les entreprises textiles se multiplient. Ces affaires ont beaucoup rapporté à la bourgeoisie. Un contemporain, le marquis François Claude Amour de Bouillé (1739-1800), note ce que la recherche confirme : « Toutes les petites villes de province devenues plus ou moins commerçantes étaient peuplées de petits bourgeois plus riches et plus industrieux que les nobles. » La hausse de longue durée qui a stimulé la manufacture et le négoce a, certes, d'abord touché les prix agricoles et donné un bénéfice aux possesseurs de rente foncière, parmi lesquels les nobles. Mais le profit industriel a monté beaucoup plus vite que le profit agricole et la rente, le profit colonial plus encore que le profit industriel, à l'exception, toutefois, souligne Ernest Labrousse, du profit minier.
…mais écartés des meilleures places
Majeure économiquement, « la bourgeoisie, remarque un historien, Jean Sentou, est plus que jamais mineure sur le plan politique ». La noblesse accepte de la fréquenter dans les salons, mais elle la rejette de la direction de la cité et entend se réserver les meilleures places. « La bourgeoisie, remarque encore le marquis de Bouillé, avait dans les villes de province la même supériorité que la noblesse ; cependant elle était partout humiliée ; elle se voyait exclue, par les règlements militaires, des emplois de l'armée ; elle l'était en quelque manière du haut clergé par le choix des évêques parmi la haute noblesse et des grands vicaires en général parmi les nobles ; elle l'était de plusieurs chapitres de cathédrale.
La haute magistrature la rejetait également, et la plupart des cours souveraines n'admettaient que des nobles dans leur compagnie. Même pour être reçu maître des requêtes, le premier degré dans le Conseil d'État qui menait aux places éminentes d'intendant, et qui avait conduit les Colbert et les Louvois et tant d'hommes célèbres aux places de ministres d'État, on exigeait dans les derniers temps des preuves de noblesse. » Alors que la bourgeoisie recherche avidement des offices anoblissant, que les rois ont d'ailleurs créés à foison pour soulager leurs finances, les titres de noblesse acquis depuis peu sont annulés à deux reprises – sous Louis XIV et sous Louis XV – renforçant encore, si cela était possible, le caractère de caste du second ordre.
Le roi lui-même est à l'origine d'un mouvement de délégation de son pouvoir, par le biais des nombreux offices – « Pour un peu d'argent, on s'ôta le droit de diriger, de contrôler et de contraindre ses propres agents » (Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution). De nombreux bourgeois se trouvent ainsi investis d'offices peu utiles voire inutiles au fonctionnement de l'État, qu'ils ont achetés et au nom desquels ils revendiquent une part du pouvoir qui leur échappait pourtant tout à fait.
La crise morale
« Une nouvelle distribution de la richesse prépare, comme le soulignera le révolutionnaire Antoine Barnave, une nouvelle distribution du pouvoir. » Les philosophes se sont faits les porte-parole des ambitions bourgeoises ; ils ont réclamé avec la liberté l'égalité des propriétaires. Ils ont aidé à la prise de conscience de la bourgeoisie. Les écrivains sont devenus les principaux hommes politiques du royaume. Leurs œuvres, leurs systèmes, leurs critiques, leurs réfutations sont discutés et participent à l'entretien de l'effervescence réformatrice. Les idées des Lumières pénètrent toutes les parties du royaume et de la société monarchique.
Ainsi, l'abbé de Véri constate que l'idée d'égalité s'insinue jusque dans l'armée, et représente une menace grave pour la monarchie : « Malheur à la nation lorsque les partis opposés voudront s'étayer des troupes. […] Le soldat raisonne et n'obéit plus en machine. Les idées d'égalité et de république fermentent sourdement dans les têtes. » Les loges maçonniques, si elles n'ont pas été un lieu de complot, ont favorisé la diffusion de l'idéal nouveau. Chez l'ensemble des acteurs de la Révolution domine un souhait, qui constitue en quelque sorte l'origine « philosophique » de la Révolution française : donner aux Français un contrat social, redonner ainsi vie à la société française.
La monarchie incapable de se réformer
Une réforme profonde du corps politique est nécessaire ; la monarchie s'y essaie. Elle n'y parvient pas. Son pouvoir s'affaiblit encore par la crise financière : les dépenses publiques sont passées de 200 à 630 millions de 1728 à 1788. Les rentrées d'argent sont faibles ; c'est non seulement le fait d'un mauvais système, mais aussi le résultat d'un état social qui dispense de tout impôt les aristocrates, possesseurs parfois de gros revenus.
L'Administration, complexe et inadaptée, est devenue inefficace ; l'intendant sans appui s'est souvent laissé gagner par la noblesse de la région qu'il contrôlait. L'armée, instrument de répression entre les mains du roi, joue difficilement ce rôle depuis que les mêmes problèmes qui hantent la société civile la préoccupent : les petits nobles rejoignent les bourgeois dans l'opposition à un système qui leur refuse avec l'avancement toutes possibilités d'amélioration sociale ; tandis que, dans la troupe, les citadins, un peu plus nombreux que jadis, contestent la discipline « à la prussienne ».
La monarchie est d'essence aristocratique ; or, les réformes nécessaires passent par la destruction des privilèges aristocratiques. La monarchie ne pourra sortir de cette contradiction.
1.6. L'aristocratie : l'impossible compromis
Des nobles encore riches…
La noblesse qui, avec le haut clergé, se livre à cette réaction aristocratique, à un exclusivisme nobiliaire qui réserve les places dans l'État, est un ordre encore riche. Elle détient une part importante du sol : 22 % dans le Nord, 31 % dans le Pas-de-Calais, 40 % en Brie. Elle possède des seigneuries qui sont un ensemble de droits assurant un prélèvement sur la récolte du paysan. Elle exerce encore parfois un pouvoir de commandement et intervient dans les échanges.
Disposant d'un surplus appréciable de denrées, des nobles réalisent, au cours du siècle, sur un marché à la hausse, où ils vendent les premiers, des profits non négligeables. Certains, comme ceux qui sont établis autour de Toulouse ou dans quelques parties de Bretagne, gèrent bien leurs terres et participent aux affaires de la bourgeoisie. Le comte de Tessé, qui est le plus grand seigneur et le plus grand propriétaire en valeur du futur département de la Sarthe, a aussi des mines, et le revenu de tous ses biens s'élèvent à 202 017 livres ! Le minimum vital d'une famille ouvrière est estimé alors à 500 livres.
Les témoignages ne concourent pas tous pour nous montrer une noblesse effrayée, en son entier, par la perte du privilège fiscal. Certains nobles se rassurent de la prise de position d'une partie de la bourgeoisie, qui reconnaît les droits féodaux comme une propriété ; en tant que telle, ceux-ci ne pourront pas être supprimés, comme des paysans le réclament, sans qu'il y ait rachat.
… quoique menacés d'appauvrissement
Mais cette noblesse connaît aussi, dans son ensemble, un appauvrissement « relatif ». Ses sources de richesses fournissent moins et moins vite que celles de la bourgeoisie. Les dépenses nombreuses, pour qui doit tenir son rang, sont plus élevées. Il y a ainsi dans la noblesse, à côté des riches, des pauvres. Toute « une plèbe nobiliaire » (Mathiez) attachée à des privilèges qui lui permettent seuls de subsister. Les riches, quant à eux, ne songent qu'à utiliser le tiers état pour mieux brider la monarchie. Il ne peut y avoir de compromis à long terme entre les ordres. L'entente ne durera que le temps de la révolte de l'aristocratie.
Après Tocqueville, Albert Mathiez et Georges Lefebvre ont souligné l'importance de cette révolte. Celle-ci bloque toute réforme véritable, résiste victorieusement au roi, mais finit, en ouvrant la voie au tiers état, qui s'en dissocie, par se retourner contre ses promoteurs.
… La noblesse de robe : opposée au roi mais conservatrice
Quant à la noblesse de robe, elle n'obéit plus au roi depuis l'époque de Louis XV, mis à part un intermède de quelques années, lorsque Maupeou a renvoyé le parlement. Or, cette noblesse de robe, qui n'hésite pas à faire grève ou à démissionner en bloc pour protester contre l'autorité royale, monopolise des charges que la machine monarchique se devait d'assumer pour faire respecter le pouvoir du roi dans l'ensemble du royaume.
La fermentation liée au jansénisme et la prétention des cours de représenter le peuple ont amené les parlements à constituer une opposition conservatrice au pouvoir royal. Opposition réelle car les magistrats affirment représenter les sujets pour contrebalancer le pouvoir d'un roi qu'ils jugent trop indépendant, et ils font appel à de très vieux souvenirs, comme ceux des champs de Mars carolingiens, pour démontrer que le roi ne peut se passer d'eux. Opposition conservatrice pourtant, car si les parlements font souvent bloc contre le roi, ils s'élèvent tout autant contre l'idée des états généraux, en tout cas jusqu'à la veille de leur convocation, quand celle-ci devient évidente : ils estiment être les seuls qualifiés pour parler au nom du peuple. Leur opposition devient subversion : par leur capacité à propager leurs propres thèses dans le public, par exemple en publiant sous forme de brochures les remontrances qu'ils adressent au roi lors des enregistrements de textes législatifs, ils répandent de façon efficace l'irrespect du pouvoir monarchique.
1.7. La « féodalité d'Ancien Régime »
Il y a donc coïncidence entre une crise conjoncturelle de l'économie et une crise plus profonde des structures sociales et politiques d'un royaume gouverné par un roi faible.
La « féodalité d'Ancien Régime », selon l'expression de l'historien Albert Soboul, qui veut ainsi marquer la différence avec la féodalité médiévale, opprime l'énergie et les capacités d'invention du tiers état. La bourgeoisie se plaint du système des « métiers », qui entrave les initiatives, interdit la création et empêche le patron de discuter librement avec le compagnon de la rémunération de son travail. Déjà Turgot, en 1775, remarquait que, « dans presque toutes les villes de notre royaume, l'exercice des différents arts et métiers est concentré dans les mains d'un petit nombre de maîtres réunis en communauté qui peuvent, seuls, à l'exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets du commerce particuliers dont ils ont le privilège exclusif ; en sorte que les sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent à l'exercice des arts et métiers ne peuvent y parvenir qu'en acquérant la maîtrise à laquelle ils ne sont reçus qu'après des épreuves aussi longues et aussi pénibles que superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier ou même pour subsister se trouve consommée en pure perte ».
Quant au travail, l'intendant Trudaine reconnaissait, en 1768, que « le juste milieu à prendre ne peut se trouver que dans la libre concurrence entre les maîtres qui achètent le travail et les ouvriers qui le vendent ». Les commerçants dénoncent aussi les barrières douanières qui parsèment le royaume et la gêne apportée par certains seigneurs à la constitution d'un vaste marché.
La servitude de la terre
Mais la « féodalité d'Ancien Régime », c'est surtout la servitude de la terre, sur laquelle pèsent les rentes foncières inaliénables, les redevances perpétuelles, « les lods et ventes » et les dîmes. Or, la France, à l'encontre de l'Angleterre, par exemple, ou des pays de l'Europe de l'Est, est caractérisée par l'existence d'une catégorie nombreuse de paysans qui sont propriétaires de terres et qui ont à payer ces droits. Sont-ils lourds à la veille de la Révolution ?
Appauvris, certains nobles entreprennent une réaction seigneuriale qui, par la révision des « terriers », tend à une mise à jour des droits tombés en désuétude. Pour juger du poids réel de cette « féodalité » sur le paysan, on recourt, de nos jours, à des sources qui ne sont pas toujours les mêmes et qui parfois présentent mieux le poids soutenu par la terre que la dimension sociale du phénomène. Ce qui compte, c'est l'évaluation de la charge par rapport au revenu du paysan. Les réponses ne sont donc pas toujours toutes utilisables. Quand elles le sont, elles donnent l'impression d'une très grande variabilité de région à région et à l'intérieur de chaque région, dans un même terroir. La charge, souvent lourde, est d'autant plus insoutenable en années de disette. C'est pour s'en débarrasser que les paysans vont pénétrer, au côté des populations urbaines, dans une révolution bourgeoise qui, comparée à celle que connurent d'autres pays comme l'Angleterre et l'Amérique, acquiert ainsi sa spécificité.
2. 1789 : de Versailles à Paris
2.1. Spécificité de la Révolution française
En 1955, un Américain, Robert R. Palmer, et un Français, Jacques Godechot, étudiant la Révolution française, ont conclu que, pour mieux la comprendre dans ses origines comme dans son déroulement, il fallait la replacer dans le cadre d'une « Révolution atlantique ». La Révolution française s'inscrit en effet dans une chaîne de révolutions animées à des degrés divers par la bourgeoisie et qui se déroulent presque toutes en Europe occidentale et en Amérique : révolution américaine (1770-1783) ; troubles révolutionnaires en Irlande et en Angleterre (1780-1783) ; révolution aux Provinces-Unies (1783-1787) ; révolution aux Pays-Bas autrichiens (1787-1790) ; révolutions démocratiques à Genève (1766-1768 et 1782) ; révolution en France (1787-1815) ; révolution polonaise (1788-1794) ; reprise de la révolution belge avec l'aide de la France (1792-1795) ; révolution en Allemagne rhénane avec l'aide de l'armée française (1792-1801) ; reprise de la révolution à Genève (1792-1798) ; révolution dans divers États italiens (1796-1799).
Mais la thèse estompe les caractères spécifiques de la Révolution française. Si cette dernière ne peut s'isoler du reste de l'histoire européenne, elle est le produit d'une société particulière. Dans les autres pays, les conditions existent pour que la bourgeoisie parvienne à un compromis avec ses ennemis d'hier, pour que soit ainsi sauvée une partie de l'ancien mode de production et pour que se construise une démocratie favorable aux possédants. En France, au contraire, si « la bourgeoisie se serait contentée d'un compromis qui l'eût associée au pouvoir, l'aristocratie s'y refusa. Tout compromis achoppait à la féodalité » (A. Soboul).
En face de la résistance de la noblesse, il y a aussi la volonté des paysans d'en finir avec les survivances de la féodalité. L'alliance nécessaire de la bourgeoisie avec les populations urbaines et rurales conduit à l'élaboration d'une démocratie plus large et plus ouverte que dans les autres pays où s'était établi ce régime. C'est notamment cette poussée populaire qui fait de la Révolution française la Révolution de la liberté et de l'égalité.
2.2. Les états généraux
Pourquoi les états généraux ?
Lorsque le roi réunit les états généraux à Versailles, à partir du 5 mai 1789, il renoue moins avec une institution tombée en désuétude depuis 1614 qu'il n'ouvre des voies inédites à la vie politique française, tant les habitudes d'organiser une telle assemblée sont oubliées et tant cette réunion entraîne un débat inhabituel dans le pays.
Les représentants des trois corps, ou « états », ont été élus au printemps (mars-avril) – in extremis, le tiers état (les roturiers) a obtenu un nombre de députés double de celui de la noblesse ou du clergé –, mais rien n'a été prévu pour organiser les votes par la suite, et aucune question précise n'a été inscrite à l'ordre du jour. En outre, chaque communauté paroissiale et chaque corps de métier ont été appelés à rédiger des cahiers de doléances, dont les synthèses doivent être apportées à Versailles par les députés, élus au terme d'élections en cascade (suffrage à deux ou trois niveaux). Cependant, toute la société française est alors traversée par l'espoir de changements importants dans la marche du royaume.
La convocation des états généraux a été décidée le 8 août 1788 ; elle consacre en fait l'échec du gouvernement, qui n'a pas pu faire face au déficit croissant du Trésor royal, ni trouver les appuis politiques nécessaires au lancement d'une nouvelle collecte des impôts. L'échec est d'autant plus grave que la crise économique frappe de plus en plus les Français, et que la police ne réussit pas à maintenir le calme dans les rues de Paris. En avril 1789, une émeute subite contre un manufacturier, Réveillon, a causé la mort de plusieurs centaines de personnes, avant que l'ordre ne soit difficilement rétabli (→ affaire Réveillon).
Ouverture des états généraux : des aspirations divergentes
Les quelque 1 150 députés arrivent à Versailles, non sans une certaine angoisse – beaucoup de provinciaux sont ignorants de la cour et de Paris, et ont du mal à trouver où se loger. Ils attendent en général beaucoup de ces états généraux, pour lesquels ils ont été élus au terme de réunions nombreuses, et parfois de luttes vives, qui leur ont donné le sens de leurs responsabilités. Chacun se sent investi d'une mission nouvelle, mais tous ne partagent pas, évidemment, les mêmes objectifs. En Bretagne, les députés du tiers se sont affrontés aux nobles, qui ne voulaient ni modifier l'autonomie de la province ni perdre leur prééminence politique, et qui, après une rixe ayant entraîné mort d'homme (janvier 1789), ont fini par boycotter les élections aux états. Dans le Dauphiné, des mouvements de protestation avaient posé dès 1788 les revendications d'une Constitution écrite et d'une égalité devant l'impôt ; la population des villes avait appuyé ces demandes, manifestant violemment contre les troupes du roi (→ Journée des tuiles, à Grenoble, le 7 juin 1788).
Une partie de la noblesse est venue aux états généraux pour réaffirmer le rôle politique éminent dont elle estime avoir été dépossédée par l'entourage du roi. Elle veut bien accepter des réformes si ses privilèges politiques ne sont pas remis en cause. À l'occasion des élections, elle a déjà rejeté dans le tiers état nombre d'anoblis récents. Certains nobles ont lutté tant qu'ils ont pu contre le doublement des députés du tiers, finalement décidé par le roi et son ministre Necker. Les pamphlets hostiles aux aristocrates ont donc fleuri, comme celui publié par l'abbé Sieyès, Qu'est-ce que le tiers état ? qui réclame que les roturiers soient reconnus comme seuls représentants de la nation.
Les querelles commencent aussitôt entre représentants des divers ordres, qui sont différenciés par leurs habits et par leur place dans la salle des Menus-Plaisirs : les aristocrates sont proches du roi, tandis que les roturiers ne peuvent pas l'entendre. Le mécontentement s'accroît lorsque Louis XVI et ses ministres, négligeant les prétentions réformatrices de nombreux députés, assignent comme objectif essentiel aux états généraux un accroissement des impôts. Les jours suivant la séance d'ouverture, tandis que le roi pleure la mort de son fils, le dauphin Louis (1781-1789), et qu'aucune directive ne vient encadrer les travaux des députés, les antagonismes se fixent sur la vérification des mandats – le tiers voulant une vérification commune qui permette de valider le vote par tête (et non par ordre entier).
2.3. L’Assemblée nationale
Le tiers état seul représentant de la nation
Le blocage est dénoué le 17 juin, lorsque le tiers état se proclame seul représentant de la nation et prend le nom d'« Assemblée nationale », qu'il déclare ouverte aux députés des autres corps. L'Assemblée s'arroge aussitôt le pouvoir de consentir à tous les impôts, déniant au roi le droit d'exercer son veto sur les décisions qu'elle avait prises et qu'elle prendrait par la suite. Devant ce coup de force, qui rallie une majorité des membres du clergé et quelques nobles libéraux, les nobles intransigeants se liguent avec le roi.
Le serment du Jeu de paume
Le 20 juin, les députés du tiers trouvent la porte de leur salle fermée ; ils se réunissent alors dans la salle du Jeu de paume, où ils prêtent serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution au royaume. L'épreuve de force est commencée. Quelques jours plus tard, à la séance du 23 juin, le roi somme les députés de délibérer par ordre, séparément; à l'ordre de dispersion donné par le maître de cérémonies, le comte de Mirabeau répond, selon la légende, par la formule célèbre : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force de baïonnettes ! »
Le renvoi de Necker
Le 27 juin, Louis XVI fait mine de céder en invitant les ordres privilégiés à se joindre à l'Assemblée nationale. Mais, le 26 juin, il fait venir des troupes (20 000 hommes de régiments étrangers) sur la capitale, puis renvoie ses ministres jugés trop libéraux, parmi lesquels Necker, contrôleur des Finances, congédié le 11 juillet. La peur d'une répression militaire gagne les députés et les Parisiens, qui se heurtent dans les jardins des Tuileries aux soldats du régiment Royal allemand commandé par le prince de Lambesc, accusés d'avoir tué des manifestants.
La prise de la Bastille
L'effervescence grandit, les Parisiens vont chercher des armes, en trouvent au Châtelet et viennent, le 14 juillet, se masser aux portes de la prison royale de la Bastille. Après de longues heures d'échanges de coups de feu et de négociations confuses, la foule s'empare de la forteresse redoutée et en tue le gouverneur. Le roi avalise cette violence en se rendant à l'Assemblée, le lendemain 15 juillet, pour annoncer le retrait des régiments étrangers de la capitale ; le 17, il se rend à Paris et accepte la cocarde tricolore des mains du député Bailly, président de l'Assemblée nationale, qui vient d'être élu maire de la Commune de Paris. Pendant ce temps, la renommée des « vainqueurs de la Bastille » gagne la France entière. La force l'a emporté, venant au secours des réformateurs.
2.4. La Grande Peur et ses conséquences
Dans tout le pays, ce choc ébranle les autorités. Les partisans des réformes (qui s'appellent entre eux les « patriotes ») prennent le pouvoir dans les municipalités urbaines et, parfois, chassent les troupes stationnées dans les châteaux royaux. Dans les campagnes, des rumeurs incontrôlées poussent les ruraux à s'armer contre de mystérieux « brigands », accusés de brûler les récoltes. Ils forment des attroupements qui s'en prennent aux propriétaires, détruisent des titres de propriétés, dévastent des logis seigneuriaux, molestent des personnes jusqu’à parfois les tuer.
Les événements parisiens, aussi inquiétants que prometteurs, trouvent manifestement un écho qui témoigne des attentes et des craintes des ruraux français, lesquels espèrent souvent la fin des impôts, celle de la police des blés, et des terres à acheter ! Cette manifestation de psychose collective, que l'on a appelée la « Grande Peur », se répand du 20 juillet au début d'août dans presque toute la France – n'y échappent guère que la Bretagne, l'ouest de l'Aquitaine, la Lorraine et l'Alsace.
Pour en savoir plus, voir l'article la Grande Peur.
La nuit du 4 août 1789
Elle provoque en retour, à Versailles, au sein des ordres privilégiés, le sentiment qu'il faut abandonner d'urgence des principes devenus caducs. Le 4 août, sous la poussée d'une poignée de nobles libéraux (dont le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon), et dans l'effusion générale, l'Assemblée décrète la fin des privilèges et la destruction complète du régime féodal.
D'un seul coup, sans aucune préparation, toutes les habitudes sociales sont jetées à bas dans la confusion. Le clergé perd ses ressources (en l'occurrence son impôt, la dîme), et les seigneurs lâchent leurs droits honorifiques, obtenant toutefois que leurs droits de propriété soient rachetables. Évidemment, l'abolition des privilèges mécontente toute une partie de la noblesse, dont certains représentants éminents (comme les frères du roi) émigrent ; mais elle déçoit également les paysans, qui comprennent que leurs charges ne sont qu'allégées.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Cette liquidation du passé débouche logiquement sur la recherche de nouvelles bases sociales. Une discussion complexe s'engage sur une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (dans le sillage des déclarations adoptées par les États américains quelques années plus tôt) ; elle est votée le 26 août. Placée sous les auspices de l'« Être suprême » (principe supérieur de raison et de vertu), la France admet dorénavant que tous ses habitants sont « libres et égaux en droits » et qu'ils détiennent la souveraineté du pays. Louis XVI devient « roi des Français », la religion catholique perd son statut de religion d'État : l'Assemblée nationale a ainsi réalisé une véritable révolution politique.
Louis XVI prisonnier du peuple de Paris
Pourtant, rien n'est réglé. La cour résiste, la reine Marie-Antoinette jouant un rôle manifeste dans ce refus. Des troupes sont rappelées autour de Paris ; certains officiers sont accusés d'avoir foulé aux pieds la cocarde tricolore – mêlant les couleurs bleue et rouge de la capitale à la couleur blanche de la royauté –, qui est devenue l'emblème des patriotes après le 14 juillet. Dans le camp opposé, les députés de l'Assemblée nationale ont réussi, difficilement, à faire accepter l'idée que le pouvoir législatif soit exercé par une Chambre unique et n'ont accordé au roi qu'un droit de veto « suspensif » par rapport aux décisions de la Chambre (septembre 1789). Le roi repousse la signature des décrets qui promulguent ces changements, alors que la crise économique frappe toujours le petit peuple, qui ne mange pas à sa faim.
Une foule de Parisiens et de Parisiennes se rend au château de Versailles et l'envahit, le 5 octobre, tuant quelques soldats. Au soir du 6, après avoir avalisé les mutations politiques, le roi est contraint de revenir à Paris avec le cortège des émeutiers. Désormais, Louis XVI peut se considérer – c'est le point de vue qu'il adoptera – comme prisonnier du peuple de Paris.
Ainsi, en quelques mois, la violence a fait basculer la France dans une aventure politique dont les enjeux sont énormes et les règles inconnues. À partir d'octobre 1789, les Français vont prendre conscience d'être entrés dans une ère nouvelle, qui dépasse les débats sur la monarchie constitutionnelle : la Révolution.
3. L'Assemblée nationale constituante
3.1. Nouveaux principes
L'Assemblée nationale a été proclamée constituante le 9 juillet 1789 (elle siégera jusqu'au 30 septembre 1791). Ses membres, qui ne se considèrent plus comme les députés de l'« Ancien Régime » – la formule commence à être employée à la fin de 1789 –, appliquent immédiatement leur volonté de modifier l'organisation politique et sociale du royaume : c'est dans cette perspective qu'ils entament la rédaction de la Constitution.
Le principe de la « souveraineté du peuple » étant admis, la question de la division des pouvoirs vient au centre du débat. Les éléments les plus radicaux l'emportent : le projet de la Chambre unique est adopté, contre l'avis des modérés, qui souhaitaient une Chambre haute, à l'image de la Chambre des lords britannique, pour tempérer les changements – proposition rejetée car elle risquait de réintroduire une hiérarchie sociale jugée inacceptable. Par la suite, les députés affirment la supériorité de la Chambre sur le roi. Louis XVI, dorénavant « roi des Français », régnera « par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État ». Le corps législatif, composé de 745 députés, élus pour deux ans, établira et votera le budget et les lois, et décidera avec le roi de la paix et de la guerre ; le monarque ne disposera que d'un droit de veto suspensif, renouvelable deux fois sur une même loi.
Le mode électoral
Les élections seront régies par un système censitaire, ouvert aux hommes de plus de 25 ans payant en impôt l'équivalent de trois journées de salaire ; sont exclues du suffrage les femmes, et toute une population flottante de travailleurs urbains occasionnels et de pauvres journaliers – qui deviennent des citoyens « passifs », par opposition avec les électeurs, citoyens « actifs ». Surtout, ne peuvent être éligibles que les personnes qui paient un minimum de 50 F d'impôts, ou qui possèdent un bien évalué à 150 journées de travail. Ces distinctions, qui mettent en cause le sens même de la Révolution, soulèvent immédiatement un débat national.
Nouvelle organisation territoriale
À partir de 1790, l'organisation administrative, judiciaire et militaire de la nation est remise en chantier. Quatre-vingt-trois départements, de superficie sensiblement équivalente et dénués de tout privilège, remplacent les anciens découpages provinciaux.
Cette mutation touche toutes les dimensions de la vie collective, et bouleverse toutes les organisations préexistantes. Les responsabilités administratives sont attribuées par élection entre candidats compétents, choisis par les citoyens éligibles constitués en « assemblées primaires ».
Une nouvelle hiérarchie judiciaire est mise en place dans les départements, qui déconstruit le réseau complexe et disparate des anciens tribunaux royaux et seigneuriaux au profit d'une organisation uniforme sur l'ensemble du territoire. La réforme judiciaire s'accompagne d'une révision importante de la marche de la justice. Les peines sont mises en relation avec la gravité des délits, et l'usage de la torture et les punitions corporelles sont abolies.
L'organisation religieuse est également profondément touchée : les biens de l'Église sont confisqués (2 novembre 1789) pour être mis à la disposition de la nation. Une telle décision marque la volonté de mettre à contribution l'ordre le plus riche du pays et d'affaiblir les ordres monastiques décriés.
3.2. La question religieuse
Alors que cette attaque contre les ordres monastiques ne provoque pas de véritable réaction, la réorganisation de l'Église – mise en œuvre par la Constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790 – met le feu aux poudres. Privé de ses ressources propres, le clergé est pris en charge par la nation, qui alloue des salaires à ses membres, mais exige en contrepartie la prestation d'un serment de fidélité. La Constituante procède à un redécoupage des paroisses et des évêchés (dont certains disparaissent), pour les mettre en harmonie avec les communes et les départements. Ce sont les citoyens des assemblées primaires qui élisent désormais les clercs ; et les évêques reçoivent l'investiture spirituelle non plus du pape – qui est seulement informé de leur élection –, mais de leur archevêque.
Cette organisation remet en cause unilatéralement le concordat de 1516, au moment où les propriétés du Saint-Siège, en Avignon, sont agitées par une campagne populaire violente en faveur de leur rattachement à la France. Elle installe le régime dans des difficultés internationales graves, même si le pape ne réagit pas dans l'immédiat. Les membres du clergé français ne peuvent trouver de moyen terme : ils doivent tout accepter ou tout refuser. Après des hésitations et de nombreux débats, un peu plus de la moitié des clercs acceptent de prêter serment à la Constitution civile (nombre d'entre eux reviendront sur cette acceptation par la suite), les autres s'y refusant. Pratiquement tous les évêques sont dans ce dernier cas, ainsi que la majorité des prêtres des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, de l'Est et de la bordure méridionale du Massif central.
La rupture ne se fait pas seulement au gré des opinions individuelles, mais aussi, dans de nombreux cas, en fonction de courants collectifs. Dans l'Ouest notamment, les ruraux sont violemment hostiles à la Constitution civile du clergé, qu'ils accusent de provoquer un schisme éloignant d'eux leurs « bons prêtres ». Dans le Midi, où protestants et catholiques cohabitent difficilement,
|
| |
|
| |
|
 |
|
PREMIER EMPIRE |
|
|
| |
|
| |
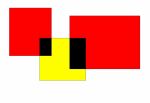
PREMIER EMPIRE
PLAN
* PREMIER EMPIRE
* 1. Les origines
* 2. Le despotisme
* 2.1. Des libertés bafouées
* 2.2. Noblesse d’Empire
* 3. La société
* 3.1. Une France de notables
* L'essor de la bourgeoisie
* La fortune foncière
* Le développement du commerce
* Naissance de l'industrie contonnière et chimique
* 3.2. Paysans et ouvriers
* Essor démographique
* 4. Le Grand Empire
* 4.1. La Grande Armée
* 4.2. L’Europe comme champ de bataille
* 4.3. L'Empire des Bonaparte
* 4.4. L'Empire miné
* 5. La chute de l'Empire
* 5.1. La campagne de Russie ou le début de la fin
* 5.2. « Le vol de l’aigle »
* 5.3. Septième coalition (mars
premier Empire
Régime politique établi en France le 18 mai 1804 par Napoléon Ier et qui dura jusqu'au 6 avril 1814.
1. Les origines
Le coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799) institue le Consulat et porte le général Bonaparte au pouvoir. En théorie, la République continue : elle inscrit son nom sur les pièces de monnaie et sur les documents officiels. Son effigie, ses emblèmes, ses chants, son drapeau demeurent. Mais en cinq ans, la France devient un vaste chantier où les finances, l'administration, l'État, l'économie et la société sont reconstruits. Bonaparte établit la paix à l'intérieur et à l'extérieur ; les Français, d'abord réticents, se rallient à sa personne jusqu'à en faire un nouveau monarque, un empereur, un « roi du peuple ».
L'établissement de la monarchie impériale résulte du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804) [ou Constitution de l'an XII], approuvé massivement par plébiscite (6 novembre), qui confie le gouvernement de la République au Premier consul avec le titre d'Empereur des Français, et proclame la dignité impériale héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte. Le nouveau régime complète ses attributs par le sacre à Notre-Dame de Paris de Napoléon Ier (2 décembre 1804), par la création d'une cour avec sa hiérarchie (grands dignitaires, grands officiers civils et militaires, dont dix-huit maréchaux) et d'une noblesse d'Empire (1806, 1808).
2. Le despotisme2.1. Des libertés bafouées
L'Empire se veut l'aboutissement de la Révolution, désormais close, dont il est chargé de préserver les conquêtes essentielles (égalité civile, respect de la propriété, abolition de la féodalité). Il est la garantie contre le retour de la Contre-Révolution et de l'anarchie jacobine. À ce titre, il justifie la mise en place d'un despotisme centralisateur. Napoléon maintient le système hérité du Consulat qui assure la primauté de l'exécutif sur un législatif impuissant et partagé entre le Conseil d'État, le Corps législatif et le Sénat. Le Tribunat, seule assemblée délibérative, est supprimé en 1807. Les ministres sont de simples agents d'exécution.
La police, confiée à Fouché puis (1810) à Savary, forte de ses multiples informateurs officiels et secrets, est l'instrument du règne par excellence. Elle viole le secret des correspondances, fait comparaître des suspects devant des magistrats serviles ou bien les enferme arbitrairement ; cependant, l'on ne dénombre guère que 2 500 arrestations « politiques » durant tout l'Empire. La liberté individuelle n'est pas respectée.
La liberté d'opinion est abolie : journaux, livres, pièces de théâtre sont objet de censure. La direction des esprits est complétée par la mainmise sur l'Église de France, chargée d'enseigner le catéchisme impérial (publié en 1806) imposant le devoir d'obéissance à l'Empereur (« honorer l’Empereur, c'est honorer et servir Dieu lui-même »), et sur l'enseignement, dont le monopole est donné à l'Université impériale (loi du 10 mai 1806 et décret du 17 mars 1808) qui décerne les grades, baccalauréat et licence, règle la vie et les programmes des professeurs de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, toléré mais surveillé, et doit modeler l'opinion morale de la jeunesse.
2.2. Noblesse d’Empire
La cour impériale, formée des princes membres de la famille de Napoléon, des grands dignitaires, des grands officiers de la couronne, et secondée d'une cohorte d'écuyers, de hérauts d'armes et de pages, est destinée à glorifier l'Empereur aux yeux des Français et des étrangers. Elle est un moyen d'attirer les nobles de l'Ancien Régime et de contrôler les grands de l'Empire. Mais Napoléon échoue dans sa volonté de renouveler les fastes de Louis XIV : la cour, où tout se règle « au tambour et au pas de charge », sue l'ennui.
En 1808, Napoléon crée une noblesse impériale. Aux princes et aux ducs s'ajoutent des comtes, des barons et des chevaliers. Napoléon argumente : la nouvelle noblesse, contrairement à l'ancienne, est largement ouverte au mérite et au talent, elle ne dispose pas de privilèges, hormis ceux, honorifiques, qui marquent l'utilité sociale de quelques-uns, premiers dans une société d'égaux. Le raisonnement ne convaincra qu'à moitié les Français, qui estimeront que Napoléon viole ainsi un des principes fondamentaux de la Révolution. Pour le choix des membres de cette noblesse, les critères appliqués sont la fortune ou le mérite acquis au service de l'État : 59 % des 3 263 personnages annoblis sous l'Empire furent des militaires, 22 % des hauts fonctionnaires, préfets, évêques ou magistrats, 17 % des notables, membres des collèges électoraux, maires ou sénateurs. La part laissée au monde du commerce et de l'industrie fut restreinte, comme le fut celle des artistes et des hommes de lettres. Les milieux sociaux les plus représentés furent la noblesse de l'Ancien Régime, les « comtes refaits » (22 %), et la petite et la moyenne bourgeoisie française, belge ou hollandaise. Cette noblesse est un instrument politique : Napoléon espère de cette manière confondre la noblesse d'Ancien Régime dans la nouvelle ; il cherche là encore à rapprocher l'ancienne et la nouvelle élite. Elle est aussi un outil fidèle et dévoué du despotisme.
Pour en savoir plus, voir les articles Ancien Régime, noblesse.
3. La société
3.1. Une France de notables
L'essor de la bourgeoisie
La bourgeoisie voit sa prépondérance consolidée. Les institutions politiques et universitaires lui réservent l'accès aux fonctions administratives. La multiplication de ces fonctions lucratives, les encouragements donnés par l'Empereur aux industriels, aux négociants, aux financiers, et la prospérité générale concourent à son essor. Les notables, maîtres d'un peuple immense de fermiers et de métayers – en 1812, sur 31 851 000 Français, 22 251 000 sont des ruraux –, d'ouvriers, de domestiques et de fournisseurs, rassemblent des nobles de l'Ancien Régime et des propriétaires jadis roturiers ; les notables remplacent les gentilshommes d'autrefois.
La fortune foncière
La société nouvelle est fondée sur la fortune foncière et, dans une certaine mesure, sur le talent et le mérite. Jusqu'en 1808 et la guerre d'Espagne, les notables seront les piliers du régime ; l'aventure guerrière et la crise économique et religieuse de 1810-1811 rompront leur alliance avec l'Empire. Posséder une propriété foncière importante fait le notable : tradition ancienne ancrée dans les mentalités. Beaucoup d'hommes d'affaires, de négociants et d'industriels disposent d'une partie de leur capital pour l'investir dans la terre. Jusqu'en 1811, les conditions climatiques sont favorables aux récoltes, qui se vendent bien. Il n'y a pas de révolution agricole, les techniques anciennes ne se modifient pas, mais les grands propriétaires mettent plus de soin à gérer leurs domaines. C'est le cas notamment des nobles rentrés d'émigration qui retrouvent pour la plupart leurs biens. Le gouvernement pousse aux défrichements, aux assèchements, à l'amendement des terres. Il incite aussi à l'introduction ou au développement de cultures nouvelles comme le maïs et la betterave à sucre pour suppléer les matières jusqu'alors importées et que le Blocus continental interdit d'acquérir.
Le développement du commerce
Les notables qui, à côté de leurs terres, exploitent des maisons de commerce souffrent du blocus des côtes. Ceux de la façade atlantique, jadis prospère, abandonnent ou bien transfèrent leurs affaires vers Paris, le nord et l'est de la France. Jusqu'en 1809, c'est là que se développe le commerce en relation avec le marché européen : la conquête l'ouvre aux entrepreneurs. Le régime facilite ces échanges par la construction de routes dans le Nord-Est, dans les Alpes ou vers l'Espagne : elles ont un but essentiellement militaire, mais elles désenclavent des régions et rendent plus aisées les communications avec le reste de l'Europe.
Naissance de l'industrie contonnière et chimique
Si le paysage industriel reste encore marqué plus par les petits ateliers que par les usines, celles-ci se multiplient. La guerre continuelle n'interdit pas la croissance de certains secteurs qui connaissent un « démarrage » annonciateur de la révolution industrielle du xixe siècle. C'est le cas de l'industrie cotonnière ou de l'industrie chimique qui lui est en partie liée. Là sont à l'œuvre « les aventuriers du siècle », comme les frères Ternaux, qui ont plusieurs fabriques de draps à travers la France et concentrent dans leurs usines machines à filer le coton, à le tisser et à le blanchir. Richard Lenoir fabrique, à Paris et en Normandie, du coton filé, des calicots, des basins et des piqués. Faisant travailler plusieurs milliers d'ouvriers, il dispose d'un capital de 6 millions de francs et d'un revenu de 50 000 F. Il fait partie du Conseil général du commerce, créé par le régime pour développer l'économie, et participe aux expositions qu'organise le gouvernement.
3.2. Paysans et ouvriers
Les gros fermiers connaissent, pour la plupart, une relative aisance, due à l'achat de biens nationaux et à la hausse du prix du grain. Le nombre des propriétaires ruraux s'est élevé de 4 millions en 1789 à 7 millions en 1810. Mais la plupart des paysans ne possèdent pas leur terre. La culture du blé l'emporte toujours sur la prairie artificielle et l'élevage, d'autant que le prix du blé n'a cessé de monter entre 1800 et 1812. Les journaliers ou les domestiques, grâce à la conscription qui allège le poids des jeunes, trouvent plus facilement que jadis du travail. Mais il suffit qu'une crise survienne et ils sont mendiants.
Les ouvriers, soumis à une législation reprise de celles de l'Ancien Régime et de 1791 (interdiction des grèves et des coalitions, livret ouvrier délivré par la police), améliorent, en revanche, leur condition économique, la hausse des salaires dépassant celle du prix du pain (50 % contre 28 %). Malgré la loi, on fait parfois grève, mais la plupart du temps le « pain du despotisme » n'est pas cher, et chacun l'a sur sa table. Là aussi les besoins de l'armée ont raréfié la main-d'œuvre, ce qui a permis une diminution du chômage et une augmentation des salaires. Quelques compagnons parviennent à gravir l'échelle sociale. Des ouvriers qualifiés réussissent à s'établir à leur compte.
Essor démographique
L'élévation du niveau de vie de l'ensemble de la société se traduit par un accroissement de la population, qui augmente de 1 700 000 habitants. Cet essor démographique contribue à la prospérité économique, que favorisent aussi la stabilité de la monnaie (assurée par la loi du 7 germinal an XI [28 mars 1803] qui fixe le poids du franc), le soutien du gouvernement à l'économie et la politique extérieure de Napoléon.
4. Le Grand Empire
Les objectifs de la politique extérieure napoléonienne sont divers et circonstanciels : abattre la Grande-Bretagne, puissance économique concurrente et animatrice des troisième, quatrième et cinquième coalitions contre la France ; renforcer les frontières naturelles ; construire le Grand Empire par la conquête, qui s'explique par la volonté de puissance de Napoléon, et aussi par l'hostilité de l'Europe des rois envers un homme qui demeure, à ses yeux, le soldat de la Révolution.
4.1. La Grande Armée
La conquête de l'Empire est d'abord l'œuvre de l'armée. L'armée de Napoléon est une armée de conscription. Les jeunes âgés de 20 à 25 ans sont inscrits ensemble (« conscrits ») sur les registres militaires. Tous ne partent pas. Un contingent est fixé chaque année. Les soldats sont les hommes qui ont tiré au sort un mauvais numéro. Ils peuvent, s'ils sont riches, se faire remplacer : il leur en coûte jusqu'à 6 000 F. De 1800 à 1814, on voit partir ainsi 2 millions d'hommes, soit 36 % des mobilisables et 7 % de la population. Napoléon fait de plus en plus appel à des contingents étrangers et l'armée de la campagne de Russie en sera composée pour moitié.
Napoléon n'innove guère : les armes données à l'infanterie comme à l'artillerie sont copiées sur les modèles de l'Ancien Régime. Napoléon n'utilisera ni le ballon d'observation ni le sous-marin de Robert Fulton. L'armée est divisée en corps, mêlant infanterie, artillerie et cavalerie légère, aux ordres des maréchaux. La cavalerie lourde donne les coups de boutoir. La Garde impériale forme une masse de manœuvre de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. On surnomme les gardes les « immortels », car Napoléon ne les utilise qu'en cas de péril extrême.
Les cadres sont instruits dans des écoles militaires. Le temps manque pour accroître le nombre de ces élèves officiers et, à 90 %, les gradés sortent de la troupe, où ils ont fait preuve de courage et d'initiative. Ce sont des hommes jeunes, bons entraîneurs d'hommes, mais de piètres tacticiens.
La tactique de Napoléon est inspirée de celle des stratèges du xviiie siècle et de l'expérience des guerres de la Révolution : tout dépend « du coup d'œil et du moment ». L'armée est comme une gigantesque main s'ouvrant sur le théâtre des opérations et laissant l'ennemi dans l'incertitude sur le point d'attaque. L'action décidée, la main se referme avec rapidité et le poing frappe et écrase. Les deux manœuvres les plus courantes sont celles que résument les batailles d'Ulm – une action sur les arrières de l'adversaire le coupe de ses zones d'approvisionnement et une attaque de flanc le pousse dans une nasse – et d'Austerlitz, où une masse centrale, obtenue en dégarnissant les secteurs secondaires, fractionne l'armée adverse et accable tour à tour ses divers éléments.
Pour en savoir plus, voir l'article Grande Armée.
4.2. L’Europe comme champ de bataille
De 1805 à 1810, après le désastre naval de Trafalgar (21 octobre 1805), la Grande Armée (200 000 hommes en 1805, 900 000 en 1809 dont 160 000 sont fournis par la conscription) remporte les victoires d'Austerlitz (2 décembre 1805), d'Iéna (14 octobre 1806), de Friedland (14 juin 1807), du col de Somosierra (30 novembre 1808) et de Wagram (6 juillet 1809), qui permettent à Napoléon de dominer l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et de s’être fait une alliée de la Russie, après Friedland, lors de l’entrevue de Tilsit (→ traités de Tilsit, 1807).
Mais, dès l’origine, la conquête de l’Espagne tourne au désastre. Napoléon s’est persuadé que les Espagnols accepteraient un roi français. Le 23 mars 1808, Murat entre à Madrid. Le 2 mai , la population se soulève (→ El dos de mayo de 1808. L'armée française réprime la révolte dans le sang. Convoquant à Bayonne la famille royale espagnole et jouant de ses dissensions, Napoléon obtient du roi et de son fils une double abdication. Le 10 juillet, il fait de son frère Joseph un roi d'Espagne et de Murat le roi de Naples. Mais l'armée française est mise en échec par les guérilleros espagnols (capitulation, le 19 juillet, du général Dupont à Bailén) et Joseph Bonaparte se retire derrière l'Èbre.
Après l'entrevue d'Erfurt (septembre-octobre 1808), où il consolide ses liens avec la Russie, Napoléon intervient lui-même en Espagne et réinstalle son frère à Madrid, le 4 décembre 1808. Mais Talleyrand et Fouché complotent contre l'Empereur : l'armée, engagée dans une guerre atroce, est en fait prise dans un guêpier ; la bourgeoisie française commence à se méfier de l'« aventurier corse ».
Le Blocus continental (1806-1807), qui vise à acculer la Grande-Bretagne à la négociation par la ruine économique et à donner à la France l'hégémonie sur le marché européen, est aussi une arme de guerre. Cette politique profite jusqu'en 1808 au commerce français. Mais le Royaume-Uni a des atouts pour vaincre le Blocus : sa flotte de guerre qui protège les vaisseaux qui font de la contrebande, la possession de marchés en Méditerranée, en Extrême-Orient et en Amérique. Il parviendra à surmonter la crise, mais le Blocus entraîne Napoléon dans une guerre perpétuelle contre les États qui sont dans la nécessité de commercer avec Londres. Le Blocus distend l'Empire aux dimensions du continent.
4.3. L'Empire des Bonaparte
En 1811, l'Empire français s'étend de Lübeck à Rome sur 130 départements peuplés de 45 millions d'habitants. Autour de lui gravitent des États vassaux (royaumes d'Italie, d'Espagne, de Westphalie et de Naples, Confédération du Rhin et Confédération helvétique) qui lui fournissent argent, hommes, matières premières.
Ces États vassaux sont gouvernés par des parents ou des serviteurs de Napoléon, ou placés sous la protection de l'Empereur. Napoléon a mis en place un système continental fondé sur des alliances matrimoniales. En 1806, Eugène de Beauharnais, fils d'un premier mariage de l'impératrice Joséphine et adopté par Napoléon, a épousé la fille du roi de Bavière. Eugénie de Beauharnais, la cousine d'Eugène, adoptée elle aussi par l'Empereur, s’est mariée avec l'héritier du duché de Bade. Le royaume de Hollande a été confié à Louis Bonaparte, la Westphalie au plus jeune frère de l’Empereur, Jérôme. Depuis 1805, Élisa Bonaparte est princesse de Lucques et de Piombino. Murat, marié à Caroline Bonaparte, a été fait grand-duc de Berg et de Clèves en 1806.
Ces États appliquent le Blocus continental comme les États alliés (Russie, Prusse, Autriche, Danemark, Suède). Une partie de l'Europe est ainsi soumise au système de gouvernement napoléonien et régie par le Code civil. Le Grand Empire qu'elle forme avec la France semble même devoir se perpétuer avec la naissance du roi de Rome (1811), fils de Marie-Louise d’Autriche et de Napoléon, mariés un an plus tôt après que celui-ci ait divorcé de Joséphine de Beauharnais.
Pour en savoir plus, voir l'article Bonaparte.
4.4. L'Empire miné
Mais l'édifice impérial est un géant aux pieds d'argile. En 1810, Napoléon est maître de l'Europe, mais son pouvoir est miné : à l'intérieur par la crise économique, sociale et religieuse ; à l'extérieur par l'éveil des nations, dont les rois de l'Europe se servent bientôt pour l'abattre. Les premières fissures de l'Empire apparaissent. Crise financière et industrielle en 1810 : des banques font faillite, les entreprises, qui ont trop emprunté, sont aux abois, le marché intérieur se dérobe. Le commerce français en Europe est de plus en plus concurrencé par la contrebande anglaise. En 1811, de mauvaises récoltes appauvrissent les campagnes et la crise se répercute sur le commerce et l'industrie.
Crise religieuse aussi : le pape, spolié de ses États et prisonnier à Savone, refuse de donner l'investiture aux nouveaux évêques et suspend la vie de l'Église. Napoléon, pour tourner le pouvoir pontifical, réunit un concile national des évêques (juin-août 1811) ; c'est un échec : les évêques résistent, certains sont emprisonnés, le pape est déporté à Fontainebleau en 1812. Désormais, le clergé prêche l'insoumission contre le César qui maltraite le pape et la religion. Napoléon voit dans la guerre un dérivatif au mécontentement, un moyen de remplir son trésor de guerre et de rétablir ses finances.
Enfin, la guerre est nécessaire pour soutenir sa politique en Europe. Le tsar Alexandre Ier, poussé par les magnats russes liés aux commerçants britanniques, n'applique pas le Blocus. Il reproche aussi à Napoléon de ne pas tenir ses promesses et de ne pas l'aider à agrandir sa zone d'influence en Europe orientale et méridionale.
5. La chute de l'Empire
À partir de 1811, plusieurs événements (conjoncture économique défavorable, éveil des nationalismes dans les États vassaux, rupture de l'alliance franco-russe, opposition en France de la bourgeoisie à la guerre, hostilité des catholiques à la politique religieuse de Napoléon) se conjuguent donc pour provoquer la chute de l'Empire.
5.1. La campagne de Russie ou le début de la fin
Le 24 juin 1812, Napoléon franchit le Niémen avec 620 000 hommes appartenant à 20 nations. Il pense mener, comme à l'accoutumée, une campagne éclair. Mais l'armée russe se dérobe, jouant de son premier atout : le vaste espace de l'Empire. Deuxième atout du commandement russe : la religion orthodoxe ; l'armée qui se bat commence d'abord par prier, ce qui l’unifie. Enfin, au bord de la Moskova, le général Koutouzov accepte le combat pour protéger Moscou. Du 5 au 7 septembre, Napoléon l'emporte à Borodino, dans une bataille acharnée qui lui coûte 30 000 hommes (→ bataille de la Moskova). Le 14 septembre, il entre à Moscou, mais y attend en vain les envoyés du tsar. Celui-ci dispose d'un troisième atout : le « général hiver » qui approche. Moscou brûle, incendiée sur ordre du gouverneur russe selon les Français, par les soldats français ivres, selon les Russes exaspérés par le ravage de la ville sainte. Napoléon ordonne la retraite. Dans le froid (− 30 °C), sans habits chauds, sans nourriture, harcelée par les cosaques et les paysans, l'armée franchit la Berezina, les 27 et 29 novembre, grâce au sacrifice des pontonniers. Elle a perdu près de 500 000 hommes.
En Europe, les nations s'éveillent. Déjà, de 1806 à 1809, la haine du despotisme français avait agité les populations : dans le Tyrol, par exemple, une révolte paysanne avait été animée par Andreas Hofer. À Berlin, en 1807, Fichte avait appelé la nation allemande à se rebeller. S'appuyant sur ce mouvement pour le contrôler, la Prusse entre en guerre le 17 mars 1813, bientôt rejointe par l'Autriche et la Suède, dont Bernadotte est devenu le prince héritier. À Leipzig, du 16 au 19 octobre 1813, dans la « bataille des Nations », 160 000 Français affrontent 320 000 coalisés et sont obligés de reculer jusqu'au Rhin. En Espagne, en Hollande, partout l'ennemi progresse. En Italie, Murat, par ambition ou fidélité « à ses peuples », se tourne contre son beau-frère. Avec une armée improvisée de 175 000 jeunes, les Marie-Louise, Napoléon mène la campagne de France et y retrouve son génie de capitaine. En vain. Les notables et les ministres complotent. Les maréchaux le pressent d'abdiquer. Il s'y résout le 6 avril 1814. Les Alliés entrent dans Paris et établissent Louis XVIII roi de France. Napoléon n'est plus le souverain que d'une île de la Méditerranée : l'île d'Elbe.
5.2. « Le vol de l’aigle »
Si Louis XVIII est assez habile pour « octroyer » une charte libérale qui reconnaît les acquis de la Révolution, les émigrés de retour choquent les Français par leur volonté de revanche.
Napoléon sait ce retournement de l'opinion et la désunion installée dans le camp des vainqueurs. Avec une petite troupe, il débarque le 1er mars 1815 à Golfe-Juan, et, comme il l'avait prédit, « l'aigle impérial vole de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame ». Il est à Paris le 20 mars, sans avoir fait tirer un coup de feu, l'armée se ralliant et les populations ouvrières acclamant en lui l'héritier de la Révolution. Il ne veut pourtant pas être le « roi de la rue ». Il se tourne à nouveau vers les notables, et Benjamin Constant rédige un Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire qui instaure une monarchie constitutionnelle.
5.3. Septième coalition (mars 1815)
Napoléon croit la paix possible, mais les grandes puissances, toujours occupées au congrès de Vienne à réorganiser l'Europe, se coalisent à nouveau contre lui. Avec une armée de vétérans, il se porte à la rencontre des Anglo-Prussiens. Le 18 juin 1815, il livre bataille à Waterloo, sur la route de Bruxelles, aux troupes de Wellington. Ce dernier a tiré la leçon de ses luttes en Espagne contre les Français : il accroche ses troupes au terrain et multiplie les feux croisés. Napoléon attend pour l'assaut final l'arrivée d'un de ses lieutenants, Grouchy. Celui-ci tarde et ce sont les Prussiens qui apparaissent sur le champ de bataille. On entraîne l'Empereur, tandis que la Garde se sacrifie.
À Paris, Fouché, la Chambre des représentants et les notables le forcent à une nouvelle abdication, le 22 juin. Napoléon demande l'asile aux Britanniques, mais ceux-ci le déportent à l'île de Sainte-Hélène. Il y mourra le 5 mai 1821.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
