|
| |
|
|
 |
|
La huntingtine, un rôle clé dans le développement cérébral |
|
|
| |
|
| |

La huntingtine, un rôle clé dans le développement cérébral
* PUBLIÉ LE : 06/02/2017 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE
*
La huntingtine, protéine dont la mutation est associée à la maladie de Huntington, s’avère jouer un rôle important au cours du développement cérébral. Elle permet en effet la migration correcte des neurones nouvellement générés dans le cortex et elle influence leur morphologie.
La huntingtine joue un rôle important au cours du développement cérébral, et ce rôle est modifié lorsque la protéine est mutée. Ceci suggère que des anomalies seraient présentes dans le cerveau des patients atteints de la maladie de Huntington bien avant l’apparition de leurs premiers symptômes. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une équipe du Grenoble Institut des Neurosciences* qui a étudié la fonction de cette protéine au cours du développement embryonnaire de la souris.
La maladie de Huntington, une maladie rare
La maladie de Huntington est une maladie génétique neurologique à caractère héréditaire et dominant. Cela signifie que toute personne porteuse d’une mutation sur un seul allèle du gène codant pour la huntingtine développera les symptômes de cette maladie. Cette dernière apparait le plus souvent à l’âge adulte, généralement entre 30 et 50 ans, et entraîne des problèmes moteurs, sensoriel et cognitifs. Les patients perdent progressivement leurs capacités physiques et mentales, aboutissant à un état grabataire. La maladie est rare, avec environ 5 cas pour 100 000 individus. Un dépistage génétique est possible.
La huntingtine est une molécule clé pendant le développement
La maladie de Huntington est caractérisée par la dégénérescence de certains neurones du cerveau, en particulier ceux du striatum et du cortex, la région la plus externe du cerveau. Jusqu’à présent les chercheurs se sont surtout focalisés sur le stade auquel apparaît la maladie, c’est-à-dire chez l’adulte, pour tenter d’expliquer ces pertes neuronales. Cependant, la huntingtine est exprimée au cours du développement embryonnaire et elle y joue un rôle essentiel. En effet, des expériences chez la souris ont montré que l’absence de huntingtine provoque une mort in utero précoce. Dans l’étude menée par l’équipe Sandrine Humbert*, les chercheurs ont empêché la production de la huntingtine normale et fait produire la version mutante, responsable de la maladie de Huntington, dans le cortex de souris. C’est alors qu’ils ont observé une série d’anomalies au cours du développement.
Des problèmes de migration neuronale
Le cortex est composé de six couches de cellules neurales aux caractéristiques et fonctions différentes. Ces couches se forment progressivement, de la partie interne vers la partie externe du cortex, grâce à la prolifération et la migration des cellules nerveuses. Pour cela, ces cellules passent d’une forme multipolaire, en étoile, à une forme bipolaire, ovale, afin de s’accrocher à des câbles le long desquels elles migrent. Or, en cas de déficience de la huntingtine, la transition multipolaire/bipolaire se fait mal, empêchant les neurones de bien s’accrocher à leur câble. « Nous observons un défaut de migration neuronale similaire en cas d’absence de la protéine et en cas d’expression de la protéine mutante. Les couches cellulaires sont désorganisées, certaines étant plus minces, en particulier les plus externes. Enfin, ce défaut de migration induit pendant le développement embryonnaire est maintenu à l’âge adulte et associé à des défauts de morphologie neuronale ce qui laisse présager que l’activité de ces neurones pourrait être modifiée », clarifie Sandrine Humbert, responsable des travaux.
Reste à savoir si ces anomalies du développement sont à la base de manifestations cliniques observées chez les patients atteints de la maladie de Huntington. Des travaux en cours dans un autre laboratoire ont montré que l’expression de la huntingtine mutante seulement au cours du développement embryonnaire conduit à certains signes de la maladie de Huntington chez la souris adulte. « Chez l’homme, on peut imaginer que des mécanismes se mettent en place pour compenser ces défauts extrêmement précoces. Ces mécanismes pourraient ensuite influencer la façon dont ces défauts développementaux se manifestent à des stades plus tardifs », suggère Sandrine Humbert.
Note
* Unité 1216 Inserm/Université Grenoble Alpes/CHU de Grenoble, Grenoble Institut des Neurosciences
Source
M Barnat et coll. Neuron du 22 décembre 2016
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des réseaux de neurones humains pour modéliser la maladie de Parkinson |
|
|
| |
|
| |
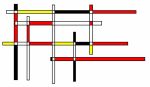
Des réseaux de neurones humains pour modéliser la maladie de Parkinson
14 Jan 2019 | Par Inserm (Salle de presse) | Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
L’agrégation de la protéine alpha-synucléine est à l’origine de la dégénérescence neuronale dans la maladie de Parkinson. En utilisant des cellules souches humaines reprogrammées en cellules nerveuses, des chercheurs du CNRS et de l’Inserm viennent de montrer que les agrégats d’alpha-synucléine se propagent de neurones en neurones. Cette découverte réalisée sur des réseaux de neurones humains, pourrait permettre d’élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques afin de prévenir la multiplication des agrégats d’alpha-synucléine et la dégénérescence des neurones. L’étude est publiée le 10 janvier 2019 dans la revue Stem Cell Reports.
Des recherches publiées en 2015[1] démontraient que des formes altérées et agrégées de la protéine alpha-synucleine se multipliaient dans le cerveau de rongeurs et étaient à l’origine de différents symptômes parkinsoniens.
Dans cette nouvelle étude, les chercheurs[2] ont utilisé des cellules souches humaines, dites pluripotentes, les ont transformées en neurones et ont conçu un réseau de neurones simplifié et robuste, représentatif du cerveau humain. En exposant ces neurones à des formes altérées de l’alpha-synucléine, ils ont observé l’apparition de signes pathologiques caractéristiques de la maladie de Parkinson et de l’atrophie multi-systématisée (AMS), une autre maladie neuro-dégénérative. En effet, pour chacune de ces maladies, l’alpha-synucléine s’agrège différemment formant une « signature » de la pathologie.
Les scientifiques ont également démontré que les neurones « malades » transférent l’alpha-synucléine altérée à des neurones sains, notamment à travers des connexions synaptiques. Ainsi, en passant de neurones en neurones et en se multipliant à la manière de la protéine infectieuse prion, les formes altérées de l’alpha-synucléine affectent l’intégrité et la fonction du réseau neuronal.
Le nouveau modèle de réseau neuronal issu de cellules souches humaines et imaginé par les chercheurs permettra d’étudier l’effet de molécules inédites capables de cibler les formes altérées de l’alpha-synucléine afin d’empêcher leur propagation et donc, la dégénérescence neuronale.
En outre, en étudiant les « signatures », de la maladie de Parkinson et l’AMS, ces travaux pourraient permettre d’améliorer le dépistage de ces maladies.
[1] Communiqué de presse du 10 juin 2015: https://www2.cnrs.fr/presse/communique/4077.htm
[2] Chercheurs de l’Institut des Cellules Souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques (Inserm/Université d’Evry Val d’Essonne/AFM), du Laboratoire de maladies neurodégénératives (CNRS/CEA/Université Paris-Sud) et des laboratoires Adaptation Biologique et Vieillissement (CNRS/Sorbonne Université) et Neurosciences Paris-Seine (CNRS/Inserm/Sorbonne Université), tous deux appartenant à l’Institut de Biologie de Paris-Seine.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
France 2030 : le CNRS et lâInserm lancent un programme pour comprendre comment les cellules choisissent leur destin et parfois déraillent |
|
|
| |
|
| |
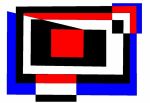
France 2030 : le CNRS et l’Inserm lancent un programme pour comprendre comment les cellules choisissent leur destin et parfois déraillent
22 Nov 2024 | Par Inserm (Salle de presse) | Institutionnel et évènementiel
Organoïde cortical au stade 8 semaines © Alexandre Baffet, Institut Curie
Un organisme humain est constitué de plus de 35 000 milliards de cellules, toutes issues d’une seule cellule initiale. Cette cellule s’est multipliée, et chacune de ses descendantes a ensuite choisi une destinée spécifique. Mais comment les cellules décident-elles de leur destin au cours du développement ? Et peut-on intervenir pour corriger leur trajectoire lorsqu’un dysfonctionnement mène à des pathologies ? C’est ce que le nouveau programme de recherche Cell-ID tentera d’élucider. Porté par le CNRS et l’Inserm, ce programme est financé à hauteur de 50 millions d’euros sur sept ans dans le cadre de France 2030. En alliant pluridisciplinarité et nouvelles technologies, il ambitionne de poser les bases d’une médecine cellulaire dite « d’interception », capable de détecter et corriger les anomalies cellulaires avant qu’elles ne deviennent problématiques.
Bien que toutes les cellules d’un individu contiennent le même code ADN, toutes ne le lisent pas de la même manière. Les différentes manières d’interpréter ce code génétique contribuent donc à définir l’identité des cellules. La communauté scientifique, notamment via l’initiative européenne LifeTime a montré que les anomalies de destins cellulaires sont impliquées dans de nombreuses pathologies, dont le cancer. Les avancées récentes qui permettent d’étudier chaque cellule individuellement ouvrent aujourd’hui la voie à une exploration approfondie de l’identité cellulaire et des mécanismes par lesquels les choix de destinée s’opèrent dans l’espace et dans le temps.
Dans ce contexte, le programme national de recherche Identités et destins cellulaires (Cell-ID) propose de comprendre quand, comment et pourquoi une cellule suit un destin particulier en conditions normales, mais aussi comment elle en dévie lors de pathologies.
Piloté par le CNRS et l’Inserm et incluant de nombreux partenaires (Institut Curie, Institut Pasteur, CEA, universités, hôpitaux et industriels[1]), Cell-ID débute officiellement le 22 novembre 2024, avec un financement de 50 millions d’euros pour une durée de sept ans, financés par le plan d’investissement France 2030.
Le programme fera appel à des méthodes d’imagerie, de génomique fonctionnelle ou encore au développement de modèles de tissus complexes. Enfin, un effort particulier sera déployé dans la modélisation de données : celles-ci seront partagées grâce à une infrastructure dédiée, mise en place dans le cadre de ce programme.
En choisissant de se concentrer sur le développement neural et les cancers pédiatriques du cerveau, Cell-ID vise à permettre un diagnostic précoce de ces pathologies. Les chercheurs et les chercheuses espèrent ainsi pouvoir améliorer le suivi pendant le traitement et prévenir les risques d’évolution grave ou de récidive. En outre, les cancers pédiatriques ont un coût et un impact sociétal fort pour les enfants atteints et les familles. Les avancées scientifiques ambitionnées par Cell-ID pourraient permettre d’agir en amont afin de limiter ces répercussions et améliorer à terme la qualité de vie de ces enfants et celle de leur entourage.
Au sein des forces jointes du CNRS, de l’Inserm et des partenaires du programme, plus de 30 équipes de recherche en France sont impliquées dans ce projet ambitieux. La pluridisciplinarité est de mise puisque Cell-ID combine biologie, physique, sciences informatiques, mathématiques, chimie et médecine. Il s’agit avant tout de mobiliser toutes les compétences scientifiques nationales pour étudier sous tous les angles une cellule donnée. Le programme prévoit également un volet de formation et d’innovation pour les chercheurs et chercheuses de demain. Enfin, au-delà des recherches en laboratoire, un volet de communication vers le grand public et les patients est conçu pour répondre à leurs attentes et s’assurer que les travaux de recherche menés soient compris par la société.
Le programme Cell-ID devrait permettre des avancées technologiques importantes qui pourront être appliquées à divers domaines telles que les maladies infectieuses, cardiovasculaires, inflammatoires chroniques, neurodégénératives et à d’autres types de cancers. À terme, des appels pourraient être lancés pour renforcer les approches et ouvrir à ces autres pathologies.
L’État consacre 3 milliards d’euros de France 2030 pour la recherche à travers des programmes de recherche ambitieux, portés par les institutions de recherche pour consolider le leadership français dans des domaines clés, liés ou susceptibles d’être liés à une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale, et qui sont considérés comme prioritaires au niveau national ou européen.
L’Agence nationale de la recherche (ANR) est l’opérateur pour le compte de l’État des programmes de recherche de France 2030.
À propos du plan d’investissement France 2030
* Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.
* Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).
* Est mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État.
* Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance, et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Plus d’informations sur le site du Gouvernement et @SGPI_avenir
[1] L’ensemble des partenaires sont : l’Université de Montpellier, l’Université de Strasbourg, l’Université Paris Cité, Paris Sciences Lettres, Sorbonne Université, l’Université Toulouse Paul Sabatier, ainsi que l’Institut Curie, l’Institut Pasteur, le CEA, l’École des Mines, l’Institut Gustave Roussy et l’IGBMC Strasbourg.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Imagerie biomédicale à résolution microscopique : la révolution des ultrasons |
|
|
| |
|
| |

Imagerie biomédicale à résolution microscopique : la révolution des ultrasons
27 Nov 2015 | Par Inserm (Salle de presse) | Technologie pour la sante
Une équipe de l’Institut Langevin (ESPCI, CNRS, Inserm) dirigée par Mickaël Tanter, directeur de recherche Inserm à l’ESPCI, vient de franchir une étape déterminante vers l’imagerie médicale très haute résolution utilisant des ondes ultrasonores. Les chercheurs sont parvenus à rendre compte de l’activité vasculaire du cerveau d’un rat in vivo et de manière non invasive, avec une résolution bien meilleure que n’importe quelle technique existante. Loin de l’échographe standard, la technique s’inspire plutôt de la super résolution optique (FPALM) qui avait été récompensée du Prix Nobel de Chimie 2014. Leurs travaux, publiés dans la prestigieuse revue Nature, constituent une véritable révolution pour l’imagerie biomédicale, en offrant la première technique d’imagerie microscopique permettant de voir en profondeur dans les tissus. Les applications potentielles sont immenses, de la détection précoce de tumeurs cancéreuses à d’autres pathologies cardiovasculaires et neurologiques.

Accéder aux détails microscopiques de la matière vivante représente encore aujourd’hui un défi difficile à relever. Quelle que soit la technique utilisée, les chercheurs se heurtent à un obstacle de taille : plus la longueur d’onde est petite, plus l’absorption et la diffusion des ondes dans les tissus sont importantes, diminuant le pouvoir de pénétration du signal. Il faut donc choisir entre pouvoir de pénétration et résolution de l’image. Pourtant depuis une vingtaine d’années des progrès considérables ont été réalisés en imagerie par ultrasons particulièrement adaptée à l’imagerie préclinique et clinique, dont l’équipe de Mickaël Tanter est une des pionnières. Ces scientifiques ont mis au point un échographe ultra-rapide, qui équipe déjà de nombreux hôpitaux dans le monde. Mais cette fois, ils ont poussé la technique encore plus loin, atteignant une résolution spatiale inégalée en imagerie médicale : celle du micromètre (1 millième de millimètre).
Tout commence en 2009, lorsque Mickaël Tanter donne une conférence sur l’imagerie par ultrasons aux États-Unis et assiste à la présentation d’une nouvelle technique de microscopie optique à fluorescence avec une résolution meilleure que la limite de diffraction, barrière pourtant supposée infranchissable. L’invention de cette technique optique vaudra d’ailleurs à ses inventeurs le Prix Nobel de Chimie en 2014. Le chercheur français comprend que le concept des opticiens et chimistes américains, limité à une imagerie de surface, pourrait être transposé dans le monde des ondes ultrasonores en utilisant un des échographes ultrarapides de son laboratoire. Dès son retour en France, il propose à son collègue Olivier Couture, chercheur CNRS dans son équipe, de s’en inspirer pour développer leur propre technique à base d’ultrasons.
Les chercheurs décident alors d’utiliser un agent de contraste, ici des microbulles de 3 µm de diamètre déjà employées dans le domaine médical. Après plusieurs années de recherche en collaboration avec une équipe de neurobiologie (ESPCI/CNRS) dirigée par Zsolt Lenkei, directeur de Recherche Inserm, ils parviennent à injecter ces multitudes de microbulles dans une veine d’un rat. La cadence ultrarapide d’acquisition de 5000 images par seconde permet d’extraire de manière très précise le signal individuel provenant de chaque microbulle du bruit de l’ensemble des signaux rétrodiffusés. Leurs positions uniques peuvent alors être localisées individuellement par ultrasons avec une précision micrométrique lors de leur passage dans le cerveau.
En retraçant la position exacte de chaque bulle à chaque instant, les chercheurs ont réussi à reconstituer une cartographie complète du système vasculaire cérébral du rat vivant en quelques dizaines de secondes. Les détails sont tels qu’ils peuvent dissocier des vaisseaux sanguins séparés de quelques micromètres, alors que la résolution était jusqu’ici de l’ordre du millimètre et limitée par la diffraction.
Plus encore, la vitesse d’écoulement du sang est également mesurée très précisément à chaque instant avec une très grande dynamique allant de quelques dizaines de centimètres par seconde dans les gros vaisseaux jusqu’à moins d’1mm/s dans les plus petits vaisseaux du système vasculaire.
Des applications directes
Le gain en résolution est énorme, d’un facteur 20 en moyenne, d’autant plus que la technique est non invasive et rapide ce qui est très important pour le confort du patient. « Nous pensons être à l’aube d’une nouvelle révolution dans le domaine de l’imagerie médicale, confie Mickaël Tanter. En quelques dizaines de secondes, nous pouvons déjà recueillir des millions de signatures de nos microbulles et atteindre des résolutions microscopiques à plusieurs centimètres de profondeur. Nous pensons pouvoir encore accélérer cette technique pour réaliser ces images en une à deux secondes ouvrant ainsi la voie à l’imagerie fonctionnelle en super-résolution».
La technique sera prochainement évaluée sur l’homme, en particulier pour visualiser la micro-vascularisation hépatique chez des patients atteints de tumeurs du foie, ou encore pour l’imagerie trans-crânienne très haute résolution du réseau vasculaire cérébral chez l’adulte. Les applications potentielles sont très nombreuses, y compris la détection précoce de cancers dont la micro-vascularisation est à ce jour impossible à détecter. En fait n’importe quel organe pourra être imagé en 3D à l’échelle microscopique, via un appareil très peu volumineux.
Alors que la plupart des techniques actuelles de microscopie s’appuient sur des approches optiques limitées à une imagerie en surface, ce sont finalement les ultrasons qui viennent résoudre pour la première fois la question de l’imagerie microscopique en profondeur dans les organes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
