|
| |
|
|
 |
|
Mémoire freudienne, mémoire de l'oubli |
|
|
| |
|
| |

Mémoire freudienne, mémoire de l'oubli
Alain Vanier dans mensuel 344
daté juillet-août 2001 -
Freud pose l'existence d'une mémoire propre à l'inconscient. C'est une mémoire de l'oubli en ce sens que les événements - décisifs - qu'elle enregistre sont complètement oubliés par le sujet, qui les refoule jusqu'à ce que la cure psychanalytique les fasse resurgir. Cette forme de mémoire est la seule à ne pas subir le dommage du temps qui passe.
Retrouver, faire surgir de la mémoire, grâce au traitement, un souvenir d'enfance oublié serait la visée de la psychanalyse et la clé de son efficacité. Cette conception du travail analytique est aujourd'hui encore la plus répandue, elle en constitue la vulgate la plus commune. Il s'agit, pourtant, de ce que Freud et Breuer* nommèrent la méthode cathartique, qui précéda la psychanalyse, en fut le préalable sans doute nécessaire, mais ne se confond pas avec elle1. Le débat actuel sur les psychothérapies et la place que, pour certains, la psychanalyse devrait y avoir, alors qu'elle se distingue radicalement de celles-là, témoigne de la persistance de cette confusion qui manifeste une résistance toujours active de la culture à la découverte freudienne.
Avant la découverte de la psychanalyse proprement dite, Freud et Breuer arrivent à la conclusion que les hystériques* souffrent de réminiscences. Les symptômes des patientes - il s'agit de femmes dans les exemples cliniques rapportés - prennent sens quand ils sont reliés à un souvenir méconnu, oublié, de nature sexuelle. Quand ce souvenir est ramené à la mémoire, le symptôme disparaît. C'est l'étonnante constatation que fait d'abord Breuer avec sa patiente Anna O., que vérifie ensuite Freud avec les femmes dont il relate le traitement. Contre cette représentation sexuelle inconciliable, le sujet organise une défense dont le refoulement* constituera le prototype. Le malade veut oublier quelque chose et il le maintient volontairement hors de la conscience, dans ce que Freud appelle alors l'« inconscience ». Ce souvenir contre lequel le patient se défend est dû à un traumatisme qui s'organise en deux temps. Dans un premier temps, il s'agit d'une scène de séduction opérée par un adulte sur un enfant dans une période prépubertaire. Celle-ci ne provoque chez celui-ci, à ce moment-là, ni excitation sexuelle ni refoulement. Après la puberté, un autre événement possédant quelques traits pouvant être associés au premier, bien que d'apparence souvent très éloignée, déclenche alors un afflux d'excitations internes dues au souvenir de la scène de séduction et produit le refoulement de celui-ci. Dans le traitement peu à peu mis au point en abandonnant l'hypnose et la suggestion, la méthode de libres associations permet la réémergence de ce souvenir qui pourra alors être normalement abréagi*, et produit la disparition du symptôme. Cette disparition n'empêche pas et souvent même s'accompagne de l'apparition d'un nouveau symptôme d'expression différente.
Ainsi, ce qui est refoulé apparaît dans le symptôme de façon déformée, et son sens est méconnu. On saisit d'emblée qu'il y a là une sorte de paradoxe : ce qui est décisif pour le symptôme, pour la pathologie, est ce qui semble le plus radicalement oublié. Ce qui s'est inscrit de la façon la plus forte dans la mémoire, ce qui a été le mieux mémorisé au point de ne pas subir l'usure normale du temps, à la différence des souvenirs que le sujet a sans difficulté à sa disposition, comme la mémoire des apprentissages, est ce qui apparaît comme oublié. Quant au souvenir qui fait retour dans cette première méthode, dite cathartique, sa valeur de vérité, tout comme sa véracité son exactitude ne sont pas distinguables l'une de l'autre, ni mises en cause, alors que la psychanalyse, elle, les séparera.
Complexe d'OEdipe. Vers la fin du mois de septembre 1897, Freud abandonne ce premier état de la théorie2. Il donne à cela plusieurs raisons, dont celle qui conduirait, dans chacun des cas, à accuser le père de perversion. En effet, chaque fois, cette scène de séduction semble avoir été opérée par le père. Or, Freud, comme il l'écrit à Wilhelm Fliess, oto-rhino-laryngologiste berlinois, a acquis « la conviction qu'il n'existe dans l'inconscient aucun "indice de réalité", de telle sorte qu'il est impossible de distinguer l'une de l'autre la vérité et la fiction investie d'affect ». Moins d'un mois plus tard, Freud découvre en lui, dans ce qu'il appelle son auto-analyse, des « sentiments d'amour envers [sa] mère et de jalousie envers [son] père » , sentiments qu'il pense communs à tous les jeunes enfants. On comprend alors « l'effet saisissant d' OEdipe Roi » , car « la légende grecque a saisi une compulsion que tous reconnaissent parce que tous l'ont ressentie » . La découverte du complexe d'OEdipe conduit à situer les scènes de séduction subies par les hystériques comme fantasmatiques, fictions mettant en scène un désir inconscient, viré au compte d'un autre, le père en l'occurrence. Ces fantasmes, qui se présentent alors comme souvenirs, « se produisent par une combinaison inconsciente de choses vécues et de choses entendues » . Au moment où elles ont été perçues, ces choses n'ont pas été comprises, le sens n'en viendra que plus tard, et elles ne seront utilisées qu'après coup.
Ainsi l'appareil psychique proposé par Freud est d'emblée un appareil de mémoire, permettant d'expliquer des phénomènes de mémoire, situés comme symptomatiques. Or, cette mémoire est spécifique, elle oblige à penser plusieurs mémoires. Plus tard, Jacques Lacan proposera de distinguer une mémoire comme propriété définissable de la substance vivante, ou mémoire vitale, de la mémoire freudienne qu'il nomme mémoration puisque c'est par la remémoration qu'elle peut être accessible. Celle-ci n'est « pas du registre qu'on suppose à la mémoire, en tant qu'elle serait la propriété du vivant 3 » , elle est de l'ordre de l'histoire, qui suppose le groupement d'un certain nombre d'événements symboliques définis, avec l'après-coup - notion déjà présente dans la théorie traumatique - comme nécessaire à sa constitution. Lacan la distingue aussi de la réminiscence imaginaire, comme « écho du sentiment ou de l'empreinte instinctuelle » . La mémoire freudienne est une mémoire symbolique, enracinée dans le signifiant. Quel est alors le statut des souvenirs qui apparaissent au cours d'une cure analytique, ces souvenirs qui, rendus à la conscience, prennent la place du symptôme qui les masquait et produisent la guérison ? Levée du symptôme, rendre conscient ce qui est inconscient est, pour Freud, une tâche de la cure.
Hypocrisie sociale. Avec la rectification de 1897, on saisit bien que la valeur de vérité du symptôme comme du souvenir refoulé se trouve disjointe de l'exactitude figurative de l'événement retrouvé. Or, ce moment fondateur de la psychanalyse a été, voici quelques années, contesté. La lecture de la partie inédite de la correspondance de Freud avec Fliess conduisit Jeffrey M. Masson, des Archives Freud, à faire l'hypothèse que le renoncement à la théorie de la séduction était un escamotage. Selon lui, Freud aurait reculé devant l'énormité de sa découverte, la séduction réelle par les pères, pour diverses raisons, dont l'accueil fait à ses hypothèses par les instances académiques mais aussi le désir de protéger le père. Freud se serait soumis à l'hypocrisie sociale et intellectuelle en vigueur, la théorie du fantasme n'étant que le manteau dont il aurait habillé, pour les voiler, les abus sexuels, dont les patientes de Freud auraient été l'objet. Ce débat eut un grand retentissement aux Etats-Unis. Une série d'articles parut dans le New York Times en 1981, puis un livre en 19834. Masson fut licencié des Archives Freud, mais le débat persista. Il prit une dimension supplémentaire en trouvant un écho dans la vague de procès et d'accusations qu'entamèrent, aux Etats-Unis, un certain nombre de personnes contre leurs parents, leur père en particulier, les accusant d'abus sexuels et aboutissant à des condamnations, fondées le plus souvent sur cette certitude qu'un souvenir, s'il était inscrit dans la mémoire du sujet, avait nécessairement un fondement réel voir l'article d'Olivier Blond dans ce numéro. La question se formule alors ainsi : les souvenirs que les sujets retrouvent, ces scènes de séduction précoces, voire le retour ou le dévoilement de ces souvenirs à travers des méthodes psychothérapiques, témoignent-ils d'une inscription intégrale, non déformée, sorte d'engramme d'une scène vue et vécue, dont le re-souvenir garantit l'exactitude ? Mais alors pourquoi l'oubli, et à quel ordre de nécessité correspond-il ? Ou faut-il, en donnant sa place à la notion de défense, concevoir autrement, comme une construction, les souvenirs auxquels la méthode analytique donne accès ? Entre ces deux hypothèses, c'est tout l'enjeu de la psychanalyse, sa validité aussi bien que sa viabilité qui est en jeu.
Signes + et -. Le souvenir de telle scène infantile n'est-il pas suspect de déformations, si l'on admet que son oubli n'est pas fortuit et peut constituer l'une d'elles ? La psychanalyse suppose, nous l'avons déjà indiqué, une mémoire spécifique. Cette mémoire est organisée selon une série de frayages*, d'enregistrements qui restent hors de la conscience.
Freud affirmera que la conscience et cette forme de mémoire s'excluent. Il convient donc de distinguer deux types de mémoire : celle dont on parle habituellement, que l'on peut avoir acquis lors de certaines expériences demeurées conscientes et qui va s'user avec le temps, et celle, particulière, qui constitue la mémoire freudienne où ce qui est retrouvé n'a pas subi le dommage du temps qui passe, est resté aussi vif et actuel que lors de sa première inscription. Cette dernière mémoire pourrait être nommée mémoire de l'oubli puisque ce qui est inscrit demeure inaccessible à la conscience, apparaît comme un oubli dans la vie du sujet, demeure inconscient, mais ne cesse de revenir dans les formations de l'inconscient, le rêve, les souvenirs-écrans, les symptômes, les agirs du sujet dans la répétition. Cette mémoire s'inscrit sur le mode de traces, et ce qui lui donne cohérence et articulation est le langage. Ainsi, dans la figurabilité de ces souvenirs, ce sont des constructions langagières qui apparaissent.
Ce souvenir est un souvenir construit par un travail psychique, selon des mécanismes que Freud décrit. Dans tel rêve où s'articule le regret de Freud de n'avoir pas obtenu la gloire attendue pour son travail sur la fleur de coca, cet élément botanique, apparemment absent du rêve, figure comme herbier à partir duquel des associations conduisent au titre d'un livre aperçu la veille, L'Espèce Cyclamen , qui est la fleur préférée de sa femme, dans le nom du professeur Gärtner jardinier en allemand, et sa femme dont il a trouvé la mine « florissante » croisés également la veille par Freud, etc. Ces fils, avec d'autres, se recoupent autour de ce regret, de cet échec dont sa femme serait la cause5. Cette organisation langagière conduira Lacan à concevoir ce mécanisme d'oubli et de remémoration analytique comme apparenté à la mémoire d'une machine dans laquelle les inscriptions tournent en rond jusqu'à se recomposer et réapparaître dans les symptômes ou dans les formations de l'inconscient à partir d'un travail de cryptage. Ces constructions sont organisées en un système, celui que Saussure voyait comme fondamental pour la langue : la pure différence, un signifiant ne valant que dans sa différence avec un autre. Celle-ci peut se figurer par une série de signes + et - .
La mémoire freudienne peut alors se concevoir comme une succession de petits signes, strictement différenciés, que l'on peut noter + et -, qui tournent6. A la différence, par exemple, de ce qui apparaît dans les hypothèses touchant à l'apprentissage d'actes consciemment mé- morisés, comme dans l'édu- cation, cette mémoire, qui efface de notre souvenir ce qui ne nous plaît pas, n'empêche pas que le sujet répète inlassablement des expériences pourtant douloureuses, conformément à la structure de ses désirs inconscients, qui eux, selon Freud, sont indestructibles et persistent indéfiniment. Ainsi peuvent se comprendre des séries d'échecs amoureux répétés selon des modalités proches émaillant la vie d'un même sujet, les névroses de destinée, etc. Ce qui s'inscrit, le frayage, n'est pas un mode de réaction appris par le sujet, une habitude, quelque chose qu'il va répéter pour trouver une solution à une difficulté, à un problème rencontré dans son environnement, cette répétition se satisfait de quelque chose qui lui est inhérent et qui la fera nommer par Freud compulsion de répétition.
Dans cette perspective, ce qui se figure dans le souvenir est une recomposition de ces traces déposées, sans index temporel, à des époques différentes. Freud propose un terme pour caractériser ces souvenirs d'enfance, le souvenir-écran. Ce souvenir construit fait écran à l'histoire, il en constitue une interruption, tout en restant relié à elle, et contient un fragment de vérité car il est dans sa constitution comparable au symptôme ou à toute autre formation de l'inconscient. Sa construction obéit aux modes de déformation de ce qui passe à la conscience, il est à la fois une rupture dans l'histoire, car il apparaît comme indépassable, et, en même temps contient, de façon cryptée, les éléments de son au-delà.
L'Homme aux loups. A la différence du souvenir traumatique qui s'atteint dans la méthode cathartique, Freud découvrira avec la méthode analytique une limite à la remémoration. Il met cela en évidence à propos du cas de l'Homme aux loups7. Dans ce texte, Freud a le projet en fait de discuter Jung et de montrer qu'il y a dès l'enfance des motifs libidinaux présents et non une aspiration culturelle, qui, précocement, n'est qu'une dérivation de la curiosité sexuelle. Ce texte est en quelque sorte une mise au jour de la théorie du trauma. Il s'agit ainsi d'examiner les rapports entre le fantasme et la réalité. Dans la cure de ce patient russe, un chiffre, une lettre joue un rôle particulier. C'est le chiffre V. A cette heure-là du jour, de façon récurrente, l'Homme aux loups présenta des symptômes physiologiques quand il était enfant, mais aussi quand il aura atteint l'âge adulte. Freud suit à la trace ce chiffre dans les évocations du patient. Il le repère dans la récurrence de ces troubles et leurs dates, mais il le relève aussi dans le fait que lorsque l'Homme aux loups dessine un rêve, le rêve central de son analyse, ce rêve des loups, qui lui donnera son nom, il en annonce un nombre différent du nombre qu'il dessine qui est V. Freud retrouve aussi ce chiffre, cette lettre dans la forme d'un papillon, l'ouverture des jambes d'une femme, un lapsus où le sujet, au lieu de dire Wespe la guêpe, dit Espe le tremble. Ce qui tombe là, c'est le W, c'est-à-dire deux fois le V. Espe, c'est aussi S.P., qui sont les initiales de ce patient. Cette lettre n'a pas à être imaginarisée, elle circule dans toute la vie du patient et dans son traitement, et prend des sens et des significations différents. Elle témoigne de cette inscription littérale, d'une trace dans l'inconscient, inscription sans sens en tant que tel.
Histoire culturelle. Mais la scène traumatique n'a pas été retrouvée par le patient au cours du traitement. Freud en fait l'hypothèse, la construit sous la forme d'une scène primitive, qui aurait eu lieu quand le patient était âgé d'un an et demi. Il aurait assisté à une relation sexuelle entre ses parents. Freud discutera très longuement la question de la réalité de cette scène. La conviction de son patient concernant cette proposition que fait Freud ne lui paraît pas non plus une garantie. Mais cet événement a laissé une empreinte, que le sujet n'a pas pu articuler verbalement, à la différence d'autres souvenirs remémorés dans la cure. Freud à ce point-là proposera l'hypothèse, inspirée de Lamarck*, qu'il s'agit peut-être d'une possession héritée, d'un héritage phylogénétique. Il écrit : « Nous voyons uniquement dans la préhistoire de la névrose que l'enfant recourt à ce vécu phylogénétique là où son vécu propre ne suffit pas. Il comble les lacunes de la vérité historique par une vérité préhistorique, met l'expérience des ancêtres à la place de son expérience propre. » Cette scène, qui n'a pas été symbolisée, a pourtant laissé une trace inscrite, mais ne peut s'atteindre par la remémoration. Il faudra l'intégrer dans le temps historique du sujet pour lui donner une figurabilité. Il y a donc une limite à la remémoration due à une sorte d'entropie qui limite ce retour en arrière. La question de ces dépôts de l'histoire culturelle humaine peut se comprendre dans la manière où le système langagier du sujet, son système verbal, ne lui est pas propre. Il s'agit d'une langue dans laquelle l'histoire fait son travail, c'est là où s'inscrit le sujet. Nous naissons à la langue, dans une langue qui nous fait, nous détermine, avec ces dépôts de la mémoire qui la constituent.
Paradoxalement, Freud a pu faire l'hypothèse que l'inconscient ne connaissait pas le temps, car ce qu'il retrouvait dans l'analyse, dans les symptômes, les formations de l'inconscient n'était marqué d'aucun indice temporel, n'était pas daté. Cette mémoire freudienne est d'autant plus active qu'elle n'est pas indexée temporellement, qu'elle est oubliée. C'est même le fait que le sujet ne saisit pas qu'il agit dans l'actualité du transfert sur quelque chose qui a été mémorisé mais non indexé temporellement qui fait tout le procès de la cure analytique. Il s'agira de faire cette histoire qui ne s'est pas faite en son temps, de remanier, de restituer l'histoire qui s'est racontée pour recouvrir ces lacunes, de produire un savoir de la névrose, savoir que le sujet ne se savait pas savoir. Mais ces blancs de l'histoire sont aussi ce qui meut le sujet, son mouvement même, dans la répétition, dans la quête de retrouvailles avec ce qui a été perdu. Ainsi, l'inconscient, cette mémoire de ce qui a été oublié, est le temps même et la condition de sa conscience.
1 S. Freud et J. Breuer, Etudes sur l'hystérie 1895, trad. A. Berman, Paris, PUF, 1956.
2 Voir S. Freud, La N aissance de la psychanalyse , Lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans 1887-1902, trad. A. Berman, Paris, PUF, 1969.
3 J. Lacan, Ecrits , Paris, Seuil, 1966, p. 42 ; voir aussi J. Lacan, Le M oi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Le Séminaire. Livre II , 1954-1955, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978.
4 J. M. Masson, Le R éel escamoté , trad. C. Monod, Paris, Aubier, 1984 ; voir aussi J. Malcom, Tempête aux archives Freud , Paris, PUF, 1986.
5 S. Freud, L' Interprétation des rêves , 1900, trad. I. Meyerson, Paris, PUF, 1967.
6 J. Lacan, Les P sychoses . Le Séminaire, Livre III , 1955-1956, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981.
7 S. Freud, « Extraits de l'histoire d'une névrose infantile », 1918, in L'Homme aux loups par ses psychanalystes et par lui-même , trad. L. Weibel, C. Heim et J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard, 1980.
NOTES
*Le médecin autrichien Joseph Breuer traita Anna O., et le récit de cette cure ainsi que la méthode originale qu'il utilisa, la méthode cathartique, intéressa Freud. Celui-ci, après un voyage à Paris où il rencontra Charcot, proposera à Breuer la rédaction en commun d'un ouvrage Les Etudes sur l'hystérie qui paraîtra en 1895. Malgré leur éloignement ultérieur, Freud présentera souvent Breuer comme le véritable inventeur de la psychanalyse.
*L'hystérie est une névrose d'expression clinique variée, présentant des symptômes somatiques dans l'hystérie de conversion, phobiques dans l'hystérie d'angoisse, etc. Connue depuis longtemps, elle ne prend la dimension d'une véritable catégorie nosographique qu'avec Charcot. Pour la psychanalyse, l'hystérie est au-delà des signes présentés et constitue une structure commune à ces tableaux divers.
*Le refoulement est synonyme de répression, mot en usage dans la littérature anglo-saxonne.
*Notion issue de la première théorie traumatique de l'hystérie et de son traitement par la méthode cathartique, l'abréaction est la décharge émotionnelle de l'affect lié au trauma psychique. Elle peut avoir lieu spontanément ou plus tardivement au cours du traitement.
*Le frayage est un terme proposé par Freud en 1895. Il s'agit de la diminution permanente d'une résistance, normalement présente, dans le passage de l'excitation d'un neurone à l'autre. Ultérieurement, l'excitation choisira la voie frayée de préférence à celle qui ne l'est pas.
*Le botaniste et zoologue Jean-Baptiste Lamarck a élaboré, vers 1800, la première théorie de l'évolution des êtres vivants. Il a défendu l'idée de l'hérédité des caractères acquis.
DOCUMENT la recherche.fr |
| |
|
| |
|
 |
|
IDENTITÃ PERSONNELLE ET APPRENTISSAGE |
|
|
| |
|
| |
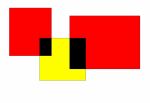
Identité personnelle et apprentissage
Pierre Jacob dans mensuel 344
Notre système cognitif forme des représentations de représentations mentales, les nôtres ou celles d'autrui : des métareprésentations. Cette capacité nous permet d'accumuler des souvenirs autobiographiques. Elle nous permet aussi de mémoriser des énoncés que nous ne comprenons pas, ce qui facilite nos apprentissages.
Comme d'autres animaux, les êtres humains construisent et renouvellent leur représentation du monde à partir de deux sources fondamentales : la perception et la mémoire. Faute de percevoir, un animal ne saurait rien de son environnement. Sans mémoire, un système physique par exemple, un thermostat ou une cellule photoélectrique peut sans doute traiter des informations ; mais il ne peut pas apprendre. Autrement dit, il ne peut pas adapter sa conduite aux changements de l'environnement. Or, un système incapable d'apprendre n'est pas un système cognitif authentique.
Toutefois, dans le règne animal, seuls les êtres humains se soucient de leur mémoire. Ils sont aussi les seuls à posséder la faculté de langage. En un mot, seul un être humain peut faire ce que fait le lecteur du présent article de La Recherche : à savoir, sacrifier plusieurs minutes de sa précieuse existence dans le seul but de comprendre un ensemble de phrases d'une langue naturelle consacrées à la mémoire humaine. Pourquoi nous soucions-nous donc de notre mémoire ? Quelle capacité permet aux humains de s'inquiéter de la fiabilité de leur mémoire ?
Suivant la voie ouverte entre autres par Dan Sperber1, de l'institut Jean-Nicod du CNRS, je défends l'idée que la réponse générale à cette question, c'est que la cognition humaine comporte une dimension fondamentalement métacognitive. Nous nous soucions non seulement de notre mémoire mais de notre équipement cognitif en général parce que notre cognition comporte une dimension métacognitive.
Les recherches menées en logique, en philosophie et en sciences cognitives depuis une trentaine d'années ont mis en évidence l'importance des capacités métareprésentationnelles dans la cognition humaine. Un système cognitif produit et manipule des représentations mentales et linguistiques d'états de choses de l'environnement. Une fois produite, une représentation mentale, linguistique ou picturale peut être à son tour représentée par une représentation d'ordre supérieur ou métareprésentation voir l'encadré « Les métareprésentations ». Par exemple, le titre du tableau de Magritte représentant une pipe Ceci n'est pas une pipe est une métareprésentation linguistique d'une représentation picturale d'une pipe.
Dès lors qu'une créature peut métareprésenter des représentations, elle peut tout à la fois représenter ses propres représentations et celles d'autrui. Si l'existence des capacités métareprésentationnelles n'a aucune incidence sur les capacités perceptives d'un organisme, il n'en va pas de même de sa mémoire. Le fait qu'une créature puisse représenter ses propres représentations lui confère une véritable mémoire autobiographique, c'est-à-dire une identité personnelle. Le fait qu'une créature puisse représenter les pensées d'autrui lui confère des capacités d'apprentissage exceptionnelles dans le règne animal. Les métareprésentations jouent un rôle crucial dans la formation des savoirs culturels humains, notamment des savoirs scientifiques.
Mémoire autobiographique. Grâce à ses capacités métacognitives, un individu peut représenter ses propres pensées présentes ou passées. Grâce aux métareprésentations de ses propres représentations mentales, il acquiert donc une mémoire autobiographique qui lui assure son sentiment d'identité personnelle. Elle nourrit le dossier d'informations grâce auxquelles une personne se rapporte à elle-même comme à l'unité plus ou moins cohérente et fragile d'une succession d'expériences à travers le temps.
Au sein de la mémoire humaine, les psychologues contemporains distinguent plusieurs sous-systèmes2. Depuis les travaux de Daniel Schacter, de l'université Harvard, dans les années 1980, on distingue la mémoire déclarative et la mémoire procédurale grâce à laquelle un animal acquiert des habitudes et fait l'apprentissage des gestes moteurs caractéristiques de son espèce. La forme de la mémoire déclarative humaine la plus directement impliquée dans la construction de l'identité personnelle est ce que le psychologue Endel Tulving, de l'université de Toronto, nomme la mémoire épisodique et qu'il oppose à la mémoire sémantique3. La mémoire épisodique n'est autre que ce qu'en 1890 le philosophe-psychologue américain William James nommait purement et simplement « la mémoire4 ». Comme son nom l'indique, elle concerne des épisodes de vie ou des événements singuliers. Grâce à sa mémoire épisodique, un individu peut revivre des événements qu'il a déjà vécus. Comme le dit Tulving, « Le souvenir épisodique a la forme d'un voyage mental à travers le temps subjectif 5 . » Seules les expériences que j'ai directement vécues sont donc des souvenirs épisodiques. En revanche, ma mémoire sémantique est constituée par l'ensemble des connaissances objectives de faits et d'événements dont je n'ai pas été directement témoin et auxquels je n'ai pas directement participé. Contrairement à la mémoire sémantique qui est une source de connaissance à la troisième personne, la mémoire épisodique est égocentrée : elle reflète la perspective de l'individu sur les événements qu'il a vécus voir l'article de Mark Wheeler dans ce numéro.
Le langage ordinairement utilisé pour décrire le contenu de nos expériences perceptives et de nos souvenirs suggère un parallélisme entre la perception et la mémoire humaines. En français, il existe deux usages des verbes de perception : je peux « voir l'ordinateur » et je peux aussi « voir que l'ordinateur est allumé ». Autrement dit, le complément d'objet direct du verbe « voir » peut être un syntagme nominal ou une proposition. A la fin des années 1960, le philosophe Fred Dretske, de l'université du Wisconsin, a soutenu qu'à cette distinction linguistique correspond une distinction psychologique entre deux niveaux distincts de la perception visuelle : la perception simple ou non épistémique d'un objet particulier et la perception épistémique d'un fait6. La perception non épistémique requiert une relation causale directe entre l'objet perçu et celui qui le perçoit. La perception épistémique requiert un minimum de conceptualisation. Un bébé humain ou un animal dépourvu du concept d'ordinateur ne peut pas percevoir au sens épistémique le fait que l'ordinateur est allumé. Mais s'il est à la bonne distance, si l'éclairage est suffisant et si son système visuel est en bon état de fonctionnement, le bébé peut parfaitement voir, au sens non épistémique, un ordinateur. Enfin, en un sens « super-épistémique », je peux voir que le réservoir de mon automobile est vide sans même voir le réservoir de mon automobile. Il suffit pour cela que je voie la jauge à essence sur le tableau de bord et que je sache que la position de l'aiguille de la jauge à essence indique la quantité de carburant dans le réservoir.
De même, il existe une distinction parallèle entre deux usages du verbe « se souvenir ». Je peux me souvenir du linguiste Noam Chomsky et je peux me souvenir que Noam Chomsky est l'auteur de Syntactic Structures . Dans le premier cas, le verbe « se souvenir » a pour complément d'objet un nom. D'un point de vue psychologique, tout se passe comme si je me souvenais d'une entité particulière que j'ai perçue directement dans le passé. Dans le second cas, le verbe « se souvenir » prend pour complément une proposition. D'un point de vue psychologique, je me rapporte par la mémoire à un fait. L'usage propositionnel du verbe « se souvenir » semble donc correspondre à la mémoire sémantique et non à la mémoire épisodique. Je peux avoir en mémoire le fait que Chomsky est l'auteur de Syntactic Structures sans avoir jamais rencontré Chomsky ni vu le livre.
Mémoire égocentrée. La perception non épistémique d'un objet est égocentrée car elle requiert une relation spatiale, immédiate et causale entre l'observateur et l'objet perçu. En revanche, la perception épistémique d'un fait résulte d'un processus de conceptualisation et d'abstraction à partir de la perception simple. De même, parce que les souvenirs épisodiques sont des souvenirs subjectifs de l'expérience passée, la mémoire épisodique est une mémoire égocentrée. Parce que les informations stockées dans la mémoire sémantique sont des connaissances objectives, la mémoire sémantique est une mémoire plus détachée que la mémoire épisodique. Faut-il conclure du parallélisme entre la perception et la mémoire que la mémoire épisodique est à la mémoire sémantique ce que la perception non épistémique des objets est à la perception épistémique des faits ? Pour deux raisons complémentaires, la réponse à cette question est négative.
En premier lieu, quoique la mémoire épisodique soit égocentrée, les souvenirs épisodiques n'en sont pas moins des souvenirs de faits. La perception visuelle a notamment pour but de servir l'action visuellement guidée. Ainsi, nous pouvons saisir et manipuler des objets fixes ou mobiles dans notre environnement grâce au fait que nous les voyons. Nous pouvons adapter la position de notre corps pour suivre continûment la trajectoire d'un objet en mouvement. Nous percevons donc directement le mouvement d'un objet qui se déroule dans l'espace et dans le temps. Mais nous ne mémorisons pas le mouvement d'un objet : nous mémorisons le fait qu'un objet s'est déplacé. Or, le fait qu'un objet s'est mu dans l'espace et dans le temps n'est pas lui-même dans l'espace et dans le temps. Si j'ai vu le mouvement d'un objet et si je m'en souviens, mon souvenir du mouvement de l'objet peut être un souvenir épisodique. Mais le contenu de mon souvenir épisodique n'est pas identique au contenu de ma perception non épistémique du mouvement de l'objet.
Mémoire réflexive. La deuxième différence entre la perception non épistémique et la mémoire épisodique repose sur le fait que celle-ci est, selon la terminologie de Tulving, autonoétique du grec noesis qui veut dire « savoir » : la mémoire épisodique est une source de connaissance de soi. Comme l'a récemment souligné en d'autres termes le philosophe Jérome Dokic de l'université de Rouen et de l'institut Jean-Nicod, ce qui distingue la mémoire épisodique de la mémoire sémantique, c'est sa réflexivité7. Mon souvenir épisodique de Chomsky a ceci de singulier que son contenu concerne l'origine même de ce souvenir : je me souviens que Chomsky était impitoyable dans le débat public mais chaleureux en tête à tête et que ce souvenir de Chomsky dérive de ma rencontre avec lui. Le contenu de ce souvenir épisodique est réflexif car il porte en partie sur Chomsky et en partie sur lui-même. En vertu du fait qu'il porte sur lui-même, c'est un souvenir métareprésentationnel ou « souvenir de second ordre ». Un souvenir épisodique est autonoétique parce qu'il représente nécessairement le fait qu'il dérive lui-même de l'expérience personnelle du sujet, et non pas du témoignage d'autrui. Cette réflexivité de la mémoire épisodique, qui la distingue fondamentalement de la perception, est une condition de la connaissance de soi et de l'identité personnelle.
Le fait que la mémoire épisodique a une structure métareprésentationnelle permettrait d'expliquer un phénomène abondamment décrit par les psychologues depuis Freud : le phénomène dit de l'« amnésie infantile », c'est-à-dire le fait que la plupart des êtres humains adultes ne conservent aucun souvenir de leur propre expérience enfantine avant l'âge de quatre ans. Or, la psychologie du développement a montré qu'avant l'âge de 4 ans,un enfant humain ne parvient pas à représenter des croyances différentes des siennes. Si un enfant de moins de quatre ans croit à juste titre que la balle bleue est dans le panier, il ne peut pas concevoir qu'une autre personne puisse croire faussement qu'elle est dans le tiroir. Autrement dit, les capacités métareprésentationnelles des enfants de moins de 4 ans ne sont pas complètement opérationnelles voir l'encadré « Les métareprésentations ». Comme l'a fait remarquer le psychologue Josef Perner, de l'université de Salzbourg, il est frappant que les êtres humains ne sont capables de former des souvenirs épisodiques d'événements dont ils ont eu l'expérience directe qu'à la condition de disposer de capacités métacognitives pleinement opérationnelles8.
Contrairement à la mémoire épisodique, la mémoire sémantique est un savoir objectif : Tulving la qualifie de mémoire noétique. Elle n'est ni égocentrique ni réflexive. Elle n'est pas intrinsèquement métareprésentationnelle, mais elle peut contenir des métareprésentations. Il y a, par exemple, dans ma mémoire sémantique une métareprésentation de la célèbre thèse de Chomsky selon laquelle un automate à états finis ne peut pas engendrer toutes les phrases d'une langue naturelle. Tandis que la mémoire épisodique est au coeur de l'identité personnelle, la mémoire sémantique joue un rôle crucial dans l'apprentissage. Or, certains apprentissages culturels proprement humains, notamment scientifiques, dépendent des capacités métareprésentationnelles humaines. Ils dépendent surtout de la capacité de représenter les représentations d'autrui. Pour agir et naviguer dans l'espace, un animal doit former des représentations de son environnement. Pour un prédateur dépourvu de capacités métareprésentationnelles, toute représentation mentale d'un état de choses de l'environnement, par exemple, le fait qu'une proie soit dans un arbre, doit être stockée en mémoire comme la représentation d'un fait. Faute de capacités métareprésentationnelles, une créature traite inflexiblement une représentation mentale d'un fait comme une croyance véridique.
Depuis Bertrand Russell9, les philosophes analysent les représentations mentales humaines comme des « attitudes propositionnelles » : l'état de choses représenté correspond au contenu représenté et l'individu traite ce contenu en fonction d'une attitude particulière. On peut croire, supposer, vouloir, redouter, espérer, déplorer, etc. que George Bush est ou soit le nouveau Président des Etats-Unis. Or, l'épanouissement des capacités de représentation des pensées d'autrui chez l'homme a rendu possibles conjointement un assouplissement des attitudes et un enrichissement des contenus propositionnels représentables.
Voyons d'abord l'assouplissement des attitudes. N'importe quel être humain adulte peut former et stocker dans sa mémoire sémantique une croyance sur une croyance d'autrui sans souscrire à la croyance d'autrui. Je peux former la croyance que Monique croit que les sorcières possèdent des pouvoirs magiques sans souscrire à la croyance de Monique. Pour former cette croyance d'ordre supérieur sur une croyance de Monique, je dois incontestablement être capable de former la pensée que les sorcières possèdent des pouvoirs magiques. Mais il n'est pas requis que je tienne la croyance de Monique pour vraie. Je peux métareprésenter une représentation sans l'accepter ou la croire vraie. Grâce à l'émergence des capacités métareprésentationnelles, le scepticisme et la science deviennent possibles : une créature peut considérer explicitement la question de savoir si elle doit admettre ou rejeter une proposition. Elle peut suspendre son jugement en attendant des preuves supplémentaires.
Voyons enfin l'enrichissement des contenus propositionnels représentables. Grâce à la communication verbale avec ses congénères, une créature douée de capacités métacognitives peut non seulement former et mémoriser des représentations d'états de choses perçus par autrui et non directement par elle-même, mais elle peut de surcroît concevoir et mémoriser des représentations d'états de choses non perceptibles, comme le sont, par exemple, les représentations mathématiques et religieuses.
Incompréhension mémorisée. Imaginons un élève dont le professeur de mathématique vient de soutenir conjointement que l'ensemble des nombres entiers est infini et que l'ensemble des nombres réels est plus grand que l'ensemble des entiers. L'élève ne comprend pas exactement la seconde proposition, ni comment la concilier avec la première. Si deux ensembles sont infinis, comment l'un peut-il être plus grand que l'autre ? Mais l'élève peut avoir de bonnes raisons de tenir son professeur pour une source fiable d'information et donc de tenir pour vrai l'un de ses énoncés. Il ne serait donc pas irrationnel de sa part de stocker dans sa mémoire sémantique à long terme une représentation mentale de la phrase énoncée par son professeur. Quoiqu'il ne sache pas exactement quelle proposition a exprimé son professeur, il peut néanmoins stocker dans sa mémoire sémantique une métareprésentation de ce qu'a dit son professeur. Il pourra ainsi réexaminer ultérieurement le contenu de l'affirmation de son professeur. Nombreux sont probablement les apprentissages scientifiques qui dépendent ainsi des capacités humaines de représentations des représentations mentales et linguistiques d'autrui.
Si le lecteur est parvenu jusqu'à ce stade du présent article de La Recherche , c'est grâce à ce que le psychologue Alan Baddeley, de l'université de Bristol, nomme sa « mémoire de travail10 ». S'il en retire un bénéfice intellectuel, c'est en partie parce qu'il a stocké dans sa mémoire sémantique des métareprésentations des énoncés plus ou moins ésotériques qu'il aura perçus au cours de sa lecture
1 D. Sperber, Le Savoir des anthropologues , Hermann, 1982 ; La Contagion des idées , Odile Jacob, 1996.
2 G. Tiberghien, La Mémoire oubliée , Mardaga, 1997.
3 E. Tulving, Elements of Episodic Memory , Oxford University Press, 1983.
4 W. James, The Principles of Psychology , Dover, 1890/1950.
5 E. Tulving, Episodic vs. Semantic Memory , in The MIT Encyclopaedia of the Cognitive Sciences , édité par R. Wilson et F. Keil, p. 278, MIT Press, 1999.
6 F. Dretske, Seeing and Knowing , Routledge & Kegan Paul, 1969 ; Seeing, Believing and Knowing , in An Invitation to Cognitive Science , vol. 2, Visual Cognition and Action , édité par D. Osherson, A. Kosslyn et J. Hollerbach, MIT Press, 1990.
7 J. Dokic, Dialogue , xxxvi , 527, 1997.
8 J. Perner, Understanding the Representational Mind , MIT Press, 1991.
9 B. Russell, Problèmes de philosophie , Payot, 1912/1989.
10 A. Baddeley, Working Memory , Oxford University Press, 1986.
11 P. Grice, Studies in the Way of Words , Harvard University Press, 1989.
12 D. Premack et G. Woodruff, The Behavioral and Brain Sciences , 1 , 515, 1978.
13 H. Wimmer et J. Perner, Cognition , 13, 103, 1983.
14 S. Baron-Cohen, A.M. Leslie & U. Frith, Cognition, 21 , 37, 1985.
15 S. Baron-Cohen, Mindblindness, An Essay on Autism and Theory of Mind , MIT Press, 1995.
LES MÉTAREPRÉSENTATIONS
Dans ses Conférences William James délivrées à Harvard en 1967, le philosophe Paul Grice, alors à l'université de Berkeley, a jeté les bases d'une approche nouvelle de la communication humaine qui se caractérise par deux traits essentiels11. Premièrement, qu'elle soit verbale ou non verbale, la communication humaine est fondamentalement un processus inférentiel et non pas un processus de décodage. Deuxièmement, à partir d'indices linguistiques ou non linguistiques mis à sa disposition par son congénère, la tâche du destinataire d'un acte de communication est toujours d'inférer l'intention communicative de celui-ci. Il doit donc former une pensée d'ordre supérieur sur une intention d'autrui. Autrement dit, il doit former une métareprésentation d'une représentation mentale d'autrui.
En 1978, les psychologues cognitifs David Premack et G. Woodruff, de l'université de Pennsylvannie, faisaient paraître un article controversé intitulé Les chimpanzés ont-ils une théorie de l'esprit? 12 . La question soulevée était de savoir si les chimpanzés sont capables de reconnaître en eux-mêmes et chez leurs congénères un esprit, c'est-à-dire des représentations mentales. Un être humain adulte possède une « théorie de l'esprit » ou capacité de mentalisation très perfectionnée grâce à laquelle il passe une partie de son temps éveillé à former des croyances sur des croyances, des croyances sur des désirs, des désirs sur des croyances, des désirs sur des désirs, et ainsi de suite. Il forme des croyances et des désirs tant sur ses propres croyances et ses propres désirs que sur ceux d'autrui.
Depuis 1983, de nombreuses équipes de psychologie cognitive qui étudient le développement cognitif du bébé humain ont fait deux découvertes. Premièrement, ils ont découvert qu'avant l'âge de quatre ans, un enfant humain éprouve des difficultés insurmontables à représenter des croyances différentes des siennes. Si un enfant de moins de quatre ans croit qu'un ours en peluche est dans une boîte, il ne peut pas concevoir qu'une autre personne croie faussement qu'il est dans un placard. De nombreuses données expérimentales indiquent qu'après 4 ans, l'enfant réussit sans effort la tâche dite des « croyances fausses13 ». Deuxièmement, ces psychologues ont découvert que l'aptitude qui se manifeste chez l'enfant à partir de 4 ans est altérée chez des enfants autistes plus âgés14. C'est pourquoi le psychologue cognitif de l'université de Londres, Simon Baron-Cohen, qualifie cette pathologie de mindblindness , c'est-à-dire de « cécité mentale » : les autistes ne disposent pas de la faculté de reconnaître un esprit ou de représenter des représentations mentales15.
DOCUMENT larecherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LA THÃORIE DE JEAN PIAGET |
|
|
| |
|
| |

LA THÉORIE DE JEAN PIAGET
Les prémisses
La méthode clinique
Les différents stades
Bas de page
Les prémisses:
Après avoir suivi un cursus universitaire dans le domaine de la biologie, Piaget décida de consacrer sa vie à l'étude de la connaissance; l'épistémologie, selon une perspective diachronique (évolutionniste). L'épistémologie génétique que Piaget introduit à pour objectif d'étudier le mode de construction des connaissances chez l'individu dans le but de pouvoir rendre compte du mode de construction de la connaissance scientifique.
Bien que Piaget ne s'intéressait pas, en premier lieu, aux enfants, il compris que le passage entre les formes peu évoluées de connaissance et des formes de connaissances plus complexes pouvait s'observer au cours de la genèse du développement intellectuel de l'enfant. Ainsi, Piaget voulait rendre compte de l'évolution de la connaissance scientifique à partir de l'étude des mécanismes qui sous tendent la formation des structures opératoires de l'intelligence chez l'enfant (en bref, expliquer la phylogenèse grâce à l'ontogenèse).
La perspective Piagetienne est constructiviste en ce sens qu'elle cherche à expliquer les fonctions cognitives d'une complexité croissante par leur mode de formation successif. En effet, chaque stade du devenir intellectuel est à la fois nouveau par rapport au stade précédent et déterminé par ce dernier.
Piaget à une vision dynamique de la connaissance qui est liée à l'interaction du sujet avec son environnement. La connaissance ne se résume pas à une simple copie du réel car elle est indissociable de l'interaction du sujet avec son milieu. Toute connaissance d'un objet (ou d'un concept) implique l'incorporation de celui-ci à des schèmes d'action (ensuite représentatifs) puisqu'il n'a de signification pour le sujet qu'en fonction de l'action qu'il exerce sur lui.
La Méthode Clinique:
Pour un retour facile à l'index de la page.
Vive PiagetLa méthode d'observation que Piaget utilisa pour dégager la genèse de la connaissance chez l'enfant s'inspire de l'entretien psychiatrique dont elle a gardé l'appellation clinique pour donner la "méthode clinique" (spécifique à Piaget). Elle est fondée sur l'interrogation guidée et a pour but de mettre en évidence les raisonnements utilisés par l'enfant lorsqu'il est confronté à des situations de complexités différentes.
La méthode inventée par Piaget se distingue de la méthode des tests (qui prévalait à son époque) car elle permet de dégager les structures du raisonnement des réponses de l'enfant. Elle se caractérise par sa rigueur méthodologique ainsi que par sa souplesse. En effet, à partir de questions guidées précises, cette méthode mixte (d'observation et d'analyse du contenu verbal) permet d'adapter les expressions et la logique de la "situation - épreuve" aux attitudes et au vocabulaire de l'enfant. Cette méthode consiste en une mise en question systématique des affirmations de l'enfant afin de dégager la structure caractéristique, la logique, d'un certain stade développemental.
Dans leurs recherches, Piaget et ses collaborateurs, interrogeaient des enfants de tranches d'âges successives et dégageaient ce qu'il y avait de commun aux réponses d'un niveau donné et, confrontant les niveaux successifs selon la méthode transversale, ils retraçaient le développement de la connaissance.
Les stades et les périodes du développement constituent des découpages dans l'évolution "phylogénétique" de la connaissance; leur détermination s'effectue en relation avec la formation progressive et l'achèvement des structures cognitives. Ces structures constituent des paliers d'équilibre correspondant à des modes d'adaptation (de plus en plus complexes) du sujet à son environnement. Ainsi, les deux aspects de continuité et de discontinuité dans le développement génétique s'illustrent dans la succession des stades développementaux de l'enfant.
Les différents stadesDécouvrez les stades développementaux avec moi...
Pour un retour facile vers l'index de la page.
Piaget distingue, dans le développement de la logique chez l'enfant, trois stades principaux: Sensori-Moteur, Concret (précédée d'une période Pré-opératoire), et Formel. Chaque stade se caractérise par un plan de connaissance distinct ainsi que par un certain degré de complexité des activités cognitives.
Le stade de l'intelligence sensori-motrice dûre de la naissance à deux ans. On peut s'étonner de l'appellation "intelligence" à ces âges mais dans la perspective Piagetienne il existe une intelligence(pratique) avant le langage mais pas de pensées avant l'avènement de celui-ci. Ainsi, à partir de réflexes simples et d'habitudes acquises, le stade sensorimoteur aboutit à la construction de conduites de plus en plus structurées et complexes. Ce stade est caractérisé par la construction du schème (forme de connaissance qui assimile les données du réel et qui est susceptible de se modifier par l'accommodation à cette réalité), de l'objet permanent et la construction de l'espace proche (lié aux espaces corporels).
Lors des stades suivants, l'enfant reconstruit en pensée et en représentation ce qui lui était acquis lors du stade de l'intelligence sensori-motrice.
Pendant la période pré-opératoire (2 ans - 6;7 ans), la pensée de l'enfant se constitue en tant qu'intelligence représentative qui portant n'englobe pas encore les opérations réversibles. Cette période est caractérisée par l'avènement des notions de quantité, d'espace, de temps, de la fonction symbolique, du langage, etc... Cette période, ainsi que la prochaine, nous intéressera tout particulièrement pour l'analyse de l'épreuve Piagetienne de la Conservation du Nombre.
Entre 6;7-11 ans, l'enfant se situe dans le stade des opérations concrètes et etc. capable de coordonner des opérations dans le sens de la réversibilité ainsi que d'une certaine logique nécessitant encore un support concret.
Avec l'avènement du stade des opérations formelles (11-12 ans avec un équilibre entre 14-15 ans), la connaissance atteint une logique formelle et la pensée procède de façon hypothético-déductive. Ce stade est caractérisé par la présence d'opérations à la seconde puissance, d'instruments logico-mathématiques, d'une combinatoire (sur les événements verbaux et symboliques), etc..
DOCUMENT LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
APPRENDRE ÃA NE SE COMMANDE PAS |
|
|
| |
|
| |

Apprendre ça ne se commande pas !
Pierre Perruchet dans mensuel 366
Volonté, concentration, calme... : indispensables ingrédients pour un apprentissage efficace ? À en croire nos souvenirs d'écolier, oui. Pourtant, nos faits et gestes quotidiens témoignent du contraire. Ainsi, notre langage se conforme souvent à des règles que nous n'avons jamais étudiées. Cet apprentissage implicite est-il pour autant inconscient ?
Lisez « savant aveugle » à haute voix. Une première fois sans faire la liaison. Une seconde fois en la faisant de façon prononcée. Comprenez-vous la même chose ? Non. Dans le premier cas, vous semblez parler d'un savant qui se trouve être aveugle ; dans le second cas, il s'agit d'un aveugle qualifié de savant [1]. Votre compréhension se conforme là à une règle de la grammaire française qui ne souffre aucune exception, formulée ainsi dans la grammaire de Grevisse : « La liaison ne se fait jamais après la consonne finale d'un nom au singulier [2]. »
Ce qui rend le phénomène étonnant, c'est que cette règle, pour aussi clairement formulée qu'elle soit par les grammairiens, ne fait l'objet d'aucun enseignement. Vous ne l'avez jamais étudiée, vous seriez incapable de la verbaliser. Autrement dit, vous avez appris à la respecter, mais de façon implicite. Cet exemple n'est pas isolé. Dans un tout autre domaine, même une personne ne disposant d'aucune éducation musicale particulière est capable d'évaluer quelle note ou quel accord peut constituer une fin acceptable pour une mélodie d'une façon conforme aux règles de la musique tonale occidentale [3]. Comment se fait-il que nous nous conformions à des règles dont nous n'avons, et n'avons jamais eu, aucune connaissance explicite ?
À cette question le postulat fondateur de la psychologie cognitive* apporte une réponse que l'on qualifiera de conventionnelle mais qui, peu à peu, est remise en question. Formulé il y a un peu plus de trente ans, ce postulat stipule que l'esprit humain fonctionne de la même façon qu'un programme d'ordinateur : il traite l'information en effectuant des opérations de nature logico-mathématique. Dans ce cadre, la conscience accompagne simplement le déroulement de certaines opérations, sans y être impliquée. Elle donne seulement accès au produit final d'analyses et de raisonnements inconscients. Comme le rappelait en 1998 Bernard Baars, du Neurosciences Institute de San Diego : « Une métaphore classique pour la conscience est celle d'un faisceau de lumière envoyé par un projecteur sur la scène obscure d'un théâtre. Presque toutes les hypothèses actuelles au sujet de la conscience et de l'attention sélective peuvent être vues comme des variantes de cette idée principale [4]. » Pour expliquer les contenus de la conscience, il faut donc comprendre la pièce qui se joue au plus profond de notre inconscient. Dans ce cadre, les règles grammaticales, musicales ou autres évoquées plus haut sont apprises et utilisées de façon inconsciente, et ces connaissances inconscientes façonnent notre vision consciente du monde.
De nombreux travaux ont cherché à valider cette explication dans des situations de laboratoire. Le principe est de confronter des sujets à des tests qui permettent à l'expérimentateur d'étudier, sur des durées de quelques dizaines de minutes à quelques heures, la façon dont l'apprentissage se déroule au fil des années. Dans de telles expériences, les règles auxquelles sont censés se conformer les sujets sont élaborées par l'expérimentateur, et connues de lui seul. Certes, elles sont infiniment plus simples que la plupart de celles gouvernant notre environnement naturel, mais elles sont néanmoins complexes en regard de la durée limitée de l'apprentissage.
Dans une série d'études publiées dans les années quatre-vingt-dix, et reprises par la suite avec diverses variantes par notre équipe, Ken Richardson et ses collègues du Center for Human Development and Learning Open University, Grande-Bretagne ont montré à des étudiants des dessins de robots différant par de nombreux traits, par exemple la longueur des jambes et la largeur de la tête [5]. Les chercheurs avaient fait en sorte que certains de ces traits soient corrélés. Pour autant, une fois les robots mis côte à côte, cette corrélation n'était pas flagrante, car noyée au milieu de la variation d'autres traits. Après une phase d'observation de ces dessins, les étudiants étaient confrontés à un deuxième groupe de robots. Il leur était alors demandé de désigner ceux qui figuraient dans le premier groupe. Ils en choisissaient immanquablement quelques-uns..., dont aucun ne faisait pourtant partie du premier groupe ! Et pour cause, puisque le second groupe n'incluait en réalité aucun robot du premier groupe.
Dès lors, pourquoi ces choix ? Étaient-ils purement aléatoires ? Pas du tout. Certes, aucun des robots présentés dans le deuxième groupe n'avait été vu antérieurement. Mais certains respectaient les corrélations caractéristiques des robots du premier groupe, et ce sont eux qui étaient préférentiellement « reconnus » par les étudiants. Interprétation : ces derniers avaient inconsciemment abstrait les règles de corrélation entre les traits à partir des robots présentés dans le premier groupe, ce qui les conduisait à reconnaître, dans le deuxième groupe, les robots respectant ces règles. Au long des quinze ou vingt dernières années, des situations très variées, mais construites selon le même principe général, ont été étudiées et ont conduit à des conclusions similaires, semblant ainsi conforter l'explication originale [6].
On pourrait croire l'histoire close. Pourtant, toutes les conclusions de ce type ont été la source de vives polémiques au fur et à mesure de leur publication : dans chaque cas, des explications alternatives à l'abstraction de règle ont été proposées dans les quelques années suivant les publications initiales. Elles varient dans leur formulation, selon les chercheurs et les situations. Mais, de façon générale, elles reviennent toutes à postuler la mise en jeu de processus faisant appel à la mémoire associative : notre cerveau serait sensible à la fréquence avec laquelle tel ou tel événement se produit dans notre environnement, et agirait en se conformant à ce qui est statistiquement marquant.
Reprenons, sous cet angle, l'expérience des robots. Pour expliquer que les sujets reconnaissent à tort certains des robots lors du test, il n'est nul besoin de supposer que la règle de corrélation entre les traits ait été apprise. Il suffit d'imaginer que les robots présentés durant la première phase de l'expérience ont été individuellement mémorisés ou, plus simplement encore, que les associations entre certains de leurs traits l'ont été.
Comment déterminer laquelle de ces deux hypothèses est la bonne ? Supposons que, lors de la phase de reconnaissance, on présente aux sujets deux robots. Le premier ressemble peu aux robots présentés lors de la phase d'apprentissage, mais respecte la « règle » de corrélation. Le second ne respecte pas la règle de corrélation, mais présente plusieurs ressemblances avec l'un des robots présentés. Si les sujets ont abstrait la règle de corrélation, c'est ce paramètre qui primera : le premier robot doit être plus souvent reconnu que le second. Mais si les sujets mémorisent chacun des robots individuellement, c'est le second robot qui sera reconnu.
Chantal Pacteau, alors à l'université Paris V, Jorge Gallego, de l'Inserm, et moi-même avons confronté un groupe d'étudiants à ce test et observé... qu'ils reconnaissaient le second robot. Autrement dit, ils n'avaient pas abstrait de règles, mais fait appel à leur mémoire [7]. Ce résultat est très général : lorsque des conditions expérimentales ont été planifiées de façon à mettre les deux types d'explications en compétition, les résultats s'inscrivent toujours à l'encontre des théories postulant qu'une règle a été abstraite inconsciemment [8]. Dans la plupart des situations, il est beaucoup plus difficile que dans le cas des robots de comprendre comment des processus élémentaires de mémoire et d'apprentissage associatif peuvent simuler l'extraction de règles, et les arguments sont plus complexes. Mais la conclusion s'impose : l'ensemble des expériences visant initialement à démontrer la capacité qu'aurait notre cerveau d'abstraire inconsciemment des règles arbitraires ont en fait conduit à mettre très fortement en doute l'existence de cette capacité.
Outre qu'elle offre une explication à tous les cas où la structure de l'environnement peut être décrite sous forme de règles, l'interprétation qui fait appel à des processus de mémorisation présente l'avantage de s'appliquer aux innombrables autres cas où aucune règle ne décrit les données. Un exemple : quelle orthographe choisiriez-vous spontanément pour écrire le mot - inventé - « bariveau » ou « barivot » ? Sébastien Pacton, de l'université Paris V, a récemment montré que c'est la première solution qui semble la plus correcte aux sujets interrogés [9]. Or, que révèle a posteriori l'analyse du français écrit ? Elle montre qu'en position finale après la consonne « v », le son /o/ s'écrit « eau » dans 71 % des cas et « ot » dans seulement 1,4 % la proportion est inversée après la consonne «l », par exemple. Comme cette association n'obéit à aucune règle grammaticale, impossible d'évoquer un apprentissage implicite par abstraction de règle. En revanche, l'explication faisant appel à la mémoire associative est, elle, parfaitement valable. Comme elle l'est pour expliquer - autre exemple parmi une multitude - la facilité avec laquelle les petits Français apprennent le genre des noms.
Ce changement de perspective a d'autant plus d'importance qu'il s'étend à des structures telles que celles qui gouvernent la compréhension et la production du langage, que la psychologie cognitive considère habituellement comme innées. Depuis les travaux de Noam Chomsky dans les années soixante [10], il est en effet habituel de penser que l'information apportée par l'expérience est trop pauvre pour permettre à ces structures de se mettre en place. À première vue, les travaux récents dont nous venons de parler semblent renforcer le bien-fondé des interprétations innéistes issues des travaux de Chomsky. Ne montrent-ils pas, dans nombre de cas, l'incapacité des sujets à abstraire des règles de façon inconsciente ? Autrement dit, ne mettent-ils pas en évidence une limite à nos capacités d'apprentissage inconscient, limite que seul l'appel à l'inné peut permettre de franchir ? C'est effectivement le cas si l'on ne conçoit l'apprentissage implicite qu'en termes d'extraction de règles. En effet, dans ce cadre conceptuel, la seule exposition à un ensemble d'énoncés corrects, fussent-ils très nombreux, ne peut aboutir à la formulation de règles, car l'élaboration de ces dernières nécessite aussi l'exposition à des énoncés faux et présentés comme tels.
Qu'en est-il si nous changeons de cadre conceptuel, pour nous placer dans celui où l'apprentissage implicite est fondé sur la mémoire d'événements individuels ? Est-il alors indispensable que le sujet soit confronté tant à des énoncés corrects qu'à des énoncés incorrects ? Non. Qui plus est, les énoncés incorrects sont néfastes, car ils sont source de confusion pour la mémoire. L'absence d'information directe sur « ce qui ne peut se produire » devient alors un argument en faveur de la part essentielle de l'apprentissage implicite dans la mise en place des structures cognitives. L'idée selon laquelle la part de l'inné aurait été surestimée gagne aujourd'hui du terrain, notamment dans le champ du langage [11].
Mais c'est sans doute dans notre façon même de considérer la conscience que l'évolution des conceptions concernant les formes implicites d'apprentissage pourrait apporter les changements les plus importants. Le modèle initial du « théâtre de la conscience » postule, nous l'avons dit, que cette dernière est dépourvue de toute fonction dans la dynamique de l'apprentissage implicite. Certes, il est possible de substituer l'extraction de régularités statistiques à l'abstraction de règles sans remettre en cause ce modèle : la conscience ne fournirait toujours qu'un accès aux résultats de calculs inconscients, seule la nature des calculs opérés ayant changé. C'est le point de vue adopté par de nombreux chercheurs aujourd'hui [12].
Toutefois, on peut envisager un scénario radicalement différent. En effet, la mémoire associative est un processus qui, en psychologie, est - d'un point de vue théorique - lié à l'attention. Autrement dit, elle nécessite une perception consciente des caractéristiques de l'environnement : mémoriser un événement est une conséquence de l'expérience consciente que nous avons de cet événement au moment où il se produit.
Partant de ce constat, Annie Vinter et moi-même avons récemment émis l'hypothèse que le contenu de l'expérience consciente s'élaborerait progressivement au cours de la vie d'un individu par un processus d'auto-organisation [13]. Les processus associatifs agiraient directement sur les contenus de la conscience au fil des interactions de l'enfant, puis de l'adulte, avec les propriétés de l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils modifieraient en conséquence ces contenus dans le sens d'un meilleur ajustement au réel, sans qu'il soit nécessaire de supposer l'existence d'une instance inconsciente dotée de capacités de calcul sophistiquées.
La métaphore de la conscience, simple spectateur d'une pièce dont l'inconscient serait l'auteur et le metteur en scène, a-t-elle encore lieu d'être ? Le concept de conscience auto-organisatrice vient appuyer une vision différente du fonctionnement de l'esprit, développée, ces dix dernières années, par des chercheurs de différents horizons. Parmi ceux-ci : Don Dulany, à l'université de l'Illinois, ou encore Daniel Holender, à l'Université libre de Bruxelles, en partie influencés par les écrits du philosophe John Searle. Selon eux, la conscience n'est pas une propriété optionnelle de certaines opérations cognitives destinée à meubler la scène subjective. Elle est constitutive de toute vie mentale : ainsi l'inconscient cognitif, qui raisonne et prend des décisions, n'existe plus. Ces positions sont encore très minoritaires et paraissent inacceptables à beaucoup. Comment s'en étonner ? La remise en question d'une vie mentale inconsciente s'oppose en effet non seulement aux principes fondateurs de la psychologie cognitive, mais, au-delà, à une conception qui est devenue quasi universellement acceptée dans le grand public par la banalisation des conceptions d'inspiration psychanalytique. zz P. P.
Illustrations : Emmanuel Gaffard LE CONTEXTE « Un faisceau de lumière envoyé par un projecteur sur la scène obscure d'un théâtre, celui de l'inconscient » : cette métaphore, couramment employée pour décrire la conscience, découle directement du postulat fondateur de la psychologie cognitive. Selon celui-ci, en effet, les opérations de nature logico-mathématique qui caractérisent le fonctionnement de l'esprit s'effectuent au niveau inconscient. Or, ce postulat est aujourd'hui bousculé par plusieurs chercheurs de différents horizons, pour qui la conscience serait constitutive de toute vie mentale. Les données aujourd'hui disponibles sur nos capacités d'apprentissage implicite viennent étayer cette proposition hardie.
DOCUMENT larecherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
