|
| |
|
|
 |
|
LES FAMILLES ANIMALES |
|
|
| |
|
| |

LES FAMILLES ANIMALES
Les discussions sur la famille se restreignent en général à des familles exclusivement humaines. Jusqu'où peut-on étendre la notion de famille sans qu'elle explose ? Une véritable phylogenèse de la famille s'est exprimée chez de multiples espèces animales dans des systèmes d'une très grande diversité. La question des familles animales doit cependant moins servir à illustrer des lieux communs qu'à les mettre en difficulté. Une colonie de fourmi, par exemple, peut-elle être considérée comme une famille monoparentale ?
Dans cette perspective, les familles qui se composent d'agents d'espèces différentes attirent l'attention. Les Gardner, qui ont enseigné un langage symbolique à des chimpanzés en les intégrant à leur famille parlaient de « cross-fostering families» dans lesquelles des membres d'une espèce éduquent les petits d'une autre espèce. Plus répandues qu'on ne l'imagine chez l'animal (y compris en y incluant des humains comme on a pu le voir avec les enfants loups), les familles polyspécifiques constituent plutôt la norme que l'exception chez l'humain. Jusqu'où la famille humaine peut-elle donc ainsi s'étendre et se recomposer avec du non humain et est-elle si différente des principes fondamentaux
Les discussions sur la famille se restreignent souvent à des familles exclusivement humaines. Jusqu'où peut-on étendre la notion de famille sans qu'elle explose ? Une véritable phylogenèse de la famille s'est exprimée chez de multiples espèces animales dans des systèmes d'une très grande diversité. La question des familles animales doit cependant moins servir à illustrer des lieux communs qu'à les mettre en difficulté. Une colonie de fourmi, par exemple, peut-elle être considérée comme une famille monoparentale ? Dans cette perspective, les familles qui se composent d'agents d'espèces différentes attirent l'attention. Les Gardner, qui ont enseigné un langage symbolique à des chimpanzés en les intégrant à leur famille parlaient de « cross-fostering families» dans lesquelles des membres d'une espèce éduquent les petits d'une autre espèce. Plus répandues qu'on ne l'imagine chez l'animal (y compris en y incluant des humains comme on a pu le voir avec les enfants loups), les familles polyspécifiques constituent plutôt la norme que l'exception chez l'humain. Jusqu'où la famille humaine peut-elle donc ainsi s'étendre et se recomposer et est-elle si différente des principes fondamentaux qui régissent les familles animales ? Dans les dessins animés comme ceux de Walt Disney, il n'est pas rare de rencontrer des familles animales, copies conformes de familles américaines WASP idéalisées. Papa, maman, les enfants ; parfois les grand-parents ou les cousins, oncles et tantes. Souvent papa travaille et maman fait la vaisselle. Nul n'y cherchera bien évidemment la moindre vérité éthologique, mais on peut néanmoins se poser la question de savoir si certains animaux vivent dans des associations sociales qu'on pourrait qualifier de « familiale ». Pour éviter de heurter d'emblée les esprits forts qui sont prêts à cracher de l'anthropomorphisme au moindre faux pas, donnons-en une définition de travail préalable : on appellera « famille » un agencement particulier constitué autour d'un ou plusieurs éléments reproducteurs et composée d'individus appartenant à des générations différentes qui vivent ensemble. Indiquons donc tout de suite ce qui va m'intéresser ici ; non point tant de savoir si de telles familles existent chez certains animaux que l'extension possible de la notion de famille animale ce qui n'est pas exactement la même question. C'est moins la notion de famille qui m'intéresse ici que le verbe, encore inexistant qui est composé à partir de lui : Jusqu'où « familie-t-on » ? Jusqu'où peut-on le faire ? Peut-on introduire dans de telles familles des membres d'une autre espèce ou des artefacts ? Des familles à problèmes Si Shakespeare avait appris l'éthologie, c'est-à-dire la science des comportements animaux, il aurait trouvé une inspiration morbide chez les membres d'un certain nombre d'espèces plus ou moins connues du grand public et des psychiatres. La famille, telle que je l'ai grossièrement caractérisée dans l'introduction, tourne autour de la reproduction. Quoiqu'a priori évidente, une telle orientation est loin d'aller de soi, en particulier parce que les conditions de cette reproduction sont d'une diversité à laquelle nous ne sommes pas suffisamment accoutumée. On pense en général que cette reproduction s'effectue en effet naturellement autour d'un (ou plusieurs) couple reproducteur – en particulier un mâle et une femelle. Cette dichotomie elle-même est plus que problématique, et ces difficultés auront une importance au cours de ma discussion comme on s'en rendra vite compte. Sans rechercher la moindre exhaustivité, je veux indiquer trois problèmes : celui de savoir pourquoi il existe des mâles et des femelles, c'est-à-dire tout bonnement une sexualité ; comment on peut caractériser une femelle et enfin comment on pourrait aborder la question du genre de façon intéressante. · On peut légitimement se demander pourquoi il existe des mâles et des femelles. Evoquer mâles et femelles est d'ailleurs déjà une façon de parler un peu contestable ; à ce stade, il faudrait plutôt parler d'individus sexués et compatibles. Certains organismes ont d'ailleurs des relations sexuelles avec eux-mêmes – et ils n'ont pas disparu à tout jamais de la surface de la planète par ailleurs. Certains se portent même plutôt bien. La paramécie, qui n'est pas vraiment considérée comme une espèce en voie de disparition, recycle ses gènes à l'intérieur de son propre corps ; elle teste ainsi de nouvelles combinaisons génétiques – sans qu'aucune sexualité ne soit jamais requise en préalable. Evoquer la variation génétique pour expliquer la sexualité n'est pas aussi convaincant qu'on le dit souvent. Les individus de certaines espèces peuvent d'ailleurs échanger des gènes sans être sexués pour autant. Par ailleurs, quelques espèces le sont sans que ce que nous considérons comme étant les caractéristiques classiques du féminin et du masculin n'apparaissent clairement. Chez certaines algues, chez les bactéries ou chez les champignons, la taille des gamètes masculines est par exemple comparable à celle des gamètes féminines. · Il n'est pas très facile de déterminer la femelle. C'est la fertilisation interne qui constitue vraiment une spécificité de la femelle quand elle existe. Mais même quand le zoologue peut distinguer des mâles et des femelles, ce n'est pas toujours le cas. Poissons et grenouilles mâles se contentent ainsi de jeter un nuage de sperme sur les oeufs déposés. La fécondation interne introduit une contrainte forte supplémentaire qui conduit à une responsabilité inédite en ce sens que la femelle garde l'accès aux oeufs. Le rapport potentiel de cette femelle à ses petits est déjà très différent de celui que pourra jamais avoir le mâle. Chez de nombreuses espèces, être femelle n'est pas un statut qui est donné une fois pour toute. Au sein de plusieurs d'entre elles, la distinction en mâles et femelles ne signifie pas pour autant qu'un même individu restera toute sa vie mâle ou femelle. Il peut fusionner avec l'autre sexe jusqu'à constituer une créature sexuée quasi-asexuée. C'est le cas du poisson-grenouille mâle qui commence comme un jeune poisson de surface, en tout point semblable aux autres. Sa croissance le conduit cependant à se cramponner de façon permanente à une femelle qu'il rencontre – jusqu'à littéralement devenir une partie de cette dernière puisque les systèmes circulatoires de l'un et de l'autre finissent par fusionner et que le mâle devient totalement dépendant de la femelle. « Lisant » les messages hormonaux du sang de cette dernière, il lâche son nuage de sperme au moment ad hoc. Le mâle est ainsi devenu une pure fonctionnalité pour la femelle. · Le genre comme position dans un dispositif topologique. L'individu peut aussi revêtir simultanément les deux sexes, en endosser la spécificité de l'un un jour et de l'autre un autre jour (c'est par exemple le cas des crevettes Pandalus.), ou changer de sexe à un moment ou à un autre de sa vie, en fonction de sa propre histoire personnelle ou des circonstances auxquelles il aura été confronté. Les Labroides dimidiatus, qui sont des poissons nettoyeurs de la Grande Barrière Australienne, entrent dans cette catégorie. Dans chaque ‘station', un mâle domine une demi-douzaine de femelles. Il peut copuler une fois par jour avec chacune. Le mâle disparu, ce n'est pourtant pas un mâle voisin qui profite de l'aubaine et s'approprie le ‘harem' ainsi délaissée, mais la femelle la plus âgée qui se transforme en mâle et ‘honore' chaque jour avec virilité chacune de ses ex-consoeurs. A noter que la situation inverse existe également chez les poissons-clowns, Amphiprion, dont les mâles (qui s'occupent d'ailleurs des petits) se transforment en femelles quand la femelle dominante disparaît. Le changement de sexe présente un avantage économique certain sur l'hermaphrodisme simultané car il est coûteux de maintenir deux systèmes sexuels à la fois. Les mites du genre Pyemote font même plus étranges encore puisqu'elles ont la particularité de naître adultes. Le sexe est déterminé chez ces animaux par l'ordre de naissance. Les premiers qui arrivent deviennent des mâles qui s'empressent immédiatement de jouer les obstétriciens en insérant leurs jambes, comme des pinces, dans leurs mères pour tirer leurs soeurs... et s'empresser de copuler avec elle. Un mâle peut ainsi systématiquement renouveler cet inceste avec ses 20 soeurs. Il y a mieux. Ou pire. Chez une autre mite (Adactylium spp.), fils et filles, pour émerger, doivent commencer par manger leur mère de l'intérieur, et frères et soeurs commencent même à copuler lorsqu'ils sont encore dans la matrice de leur mère. C'est donc dans leur grand-mère même que certains de ces petits seront conçus ! On dira sans doute que chez ces créatures pour le moins primitives nous ne sommes pas encore dans le cirque familial. En vérité, qu'en savons-nous vraiment ? La famille comme topologie complexe et dynamique des sexes et des âges Les familles animales se déclinent selon une étonnante diversité. A une extrémité du spectre des possibles, on trouve par exemple les colonies de certaines espèces de fourmis. Toutes les fourmis y sont biologiquement liées entre elles puisqu'elles sont toutes les filles de la même mère (la reine) même si rares sont celles qui sont d'un même père, et tous les mâles, qui sont sans pères, sont les fils des ouvrières du nid. Les colonies polygynes (à plusieurs reines) sont plus complexes puisque des fourmis coexistant dans le même nid peuvent avoir des pères et des mères différentes. Toutes les colonies sont cependant des organisations familiales dans un sens assez classique – celui qui mêle structure sociale et structure génétique. Il est en effet audacieux de considérer que les sociétés humaines sont les seules qui soient structurées par des règles de parenté élaborées. Sur ce point, Robin Fox estimait en 1978 et à propos des primates non-humains, qu'aucune espèce ne possède des « systèmes de parenté » qui comportent les éléments des systèmes humains de parenté, combinés de la façon qui est propre à l'humain. La parenté n'est pourtant pas seulement une affaire de catégorie. R.Fox défendait une thèse précise : il suggérait que les deux piliers sur lesquels reposent les structures de parenté chez l'humain, la filiation et l'alliance, sont présents chez les singes, mais ne coexistent jamais dans le système d'une même espèce. Par conséquent, le caractère unique du système humain ne repose pas sur l'invention d'une nouveauté, mais plutôt sur la combinaison de ces deux éléments de façon à ce que le mode de filiation lui-même détermine le type d'attribution des partenaires reproducteurs, c'est-à-dire l'exogamie. Fox évoquait en particulier des études sur des macaques japonais (Macaca fuscata) et rhésus (Macaca mulatta) qui montraient que dans de nombreuses circonstances sociales, les membres d'un lignage matrilinéaire n'agissent pas entre eux comme ils le font à l'égard des non-membres. On sait aujourd'hui que le système social de quelques autres espèces que l'humain repose aussi sur la filiation et l'alliance, comme chez les chimpanzés. Fox posait néanmoins ainsi la question fondamentale de la famille : quels types d'associations permet-elle donc autour de la reproduction ? Avec qui ou avec quoi fournit-elle la possibilité d'associer qui ou quoi ? La notion même de famille fait appel à une topologie des sexes et des âges qui s'organise autour du renouvellement des membres du groupe. Elle apparaît comme un noeud fondamental par lequel s'agencent le biologique et le social autour de la reproduction de l'espèce. Ce mélange constant des affiliations et des apparentements, des filiations et des alliances qu'on observe chez de nombreuses espèces rend extrêmement difficile de penser la famille. Comme dans toute topologie, nous devons définir une proximité. Ce fut sans doute l'une des intuitions majeures de la sociobiologie qui en restreignit cependant considérablement la porté en en faisant une caractéristique purement génétique. Le philosophe canadien Michael Ruse a justement décrit le darwinisme comme une histoire de famille. Non seulement nous sommes tous cousins, mais nous sommes tous des cousins de cousins. Une telle idée doit être prise à deux niveaux. Nous n'avons pas seulement tous un ancêtre commun mais nos modes de vie sont fondamentalement familiaux. Tout être vivant est avant tout une excroissance de sa propre famille – pour le meilleur et pour le pire. Il me semble néanmoins important de la concevoir non seulement dans le contexte d'une parenté biologique mais aussi dans celui d'une parenté plus élective, qu'on pourrait appeler sociale si on veut, mais qui est certainement aussi beaucoup plus. Si on ne choisit jamais ses parents ni sa progéniture, on choisit fréquemment son conjoint. Enfin, il m'apparaît essentiel d'étendre l'espace de la famille de façon radicale. C'est précisément ce dont je veux parler dans cette conférence. Portrait d'une famille « typique » : les dauphins La structure familiale d'une espèce dépend de multiples facteurs et on peut en observer une très grande variabilité en fonction des espèces. J'ai évoqué les fourmis ; à une autre extrémité du spectre, il me semble intéressant de décrire une famille « typique » chez les mammifères, et se rendre compte que même là, de tels agencements sont plus problématiques que ce à quoi on aurait pu initialement s'attendre. On pourrait évoquer les « familles » chez les loups, les éléphants, les suricates ou les primates mais j'ai choisi l'exemple des dauphins. Chez ces mammifères marins, certaines structures sociales semblent se rapprocher beaucoup de celles des structures familiales humaines . A Sarasota, chez les dauphins Tursiops truncatus (ceux comme Flipper qui ont un nez en forme de bouteille) la famille constitue un agencement a priori très soudée. Cet agencement s'inscrit lui-même dans des associations sociales plus larges. Le taux d'émigration est très faible chez ces animaux puisqu'il concerne seulement deux à trois pour cent des animaux du groupe. Sur vingt-deux veaux femelles et seize veaux (c'est le terme consacré pour parler des petits des dauphins) mâles nés et élevés par leur mères à Sarasota, et qui ont survécu à la séparation avec la mère, tous sont restés dans la communauté. Huit de ces femelles ont donné naissance à des petits dans la communauté. Ces petits représentent la quatrième génération d'un lignage maternel observé à Sarasota par les cétologues. Les dauphins ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir adopté une organisation de ce style. On retrouve par exemple une telle philopatrie chez les orques (Orcinus orca). Chez les populations résidentes du Pacifique Nord Est (environ 289 individus en 1998), aucun individu de sexe mâle n'a quitté le groupe en vingt et un ans et aucune immigration n'a par ailleurs été enregistrée. Un aspect particulièrement intéressant de ces groupes de mammifères marins s'exprime dans des agencements familiaux très particuliers autour d'une solidarité très forte qui lie les femelles les unes aux autres. Cette solidarité des femelles à l'intérieur de la solidarité du groupe est suscitée par la nécessité dans laquelle elles se trouvent de se défendre contre les agressions, celles des prédateurs comme le requin (qui est, rappelons-le, la première cause de mortalité chez les dauphins après l'homme) mais aussi contre celle des mâles qui les harcèlent sexuellement. A Shark Bay, en Australie Occidentale la plupart des femelles appartiennent à des bandes de femelles. Les femelles solitaires restent rares car un tel choix est finalement très coûteux : la probabilité qu'un petit atteigne son développement adulte est plus forte s'il est élevé par une mère en bande que par une mère solitaire. En revanche, les femelles ne se lient pas pour défendre des ressources et les partager mais seulement pour se protéger et protéger leurs petits. Cette solidarité est familiale parce qu'elle inclut des générations différentes. Outre les mères et leurs petits, celles des orques et des globicéphales, par exemple, incluent des femelles post-reproductives, qui vivent plus de vingt ans après la naissance de leur dernier petit, et qui jouent un rôle de véritables grand-mères sociales dont la présence est plutôt rare chez les mammifères. Des données physiologiques et démographiques indiquent de façon non équivoque une ménopause . Quel est donc le rôle de ces femelles particulières ? La fonction de la ménopause elle-même est mal connue. Plusieurs explications adaptatives ont été proposées pour l'expliquer, sans qu'aucune ne soit réellement satisfaisante. L'hypothèse de l'arrêt précoce de la fécondité suggère que les femelles qui s'engagent dans un investissement maternel extensif peuvent avoir de plus grands succès reproductifs en cessant de se reproduire et en élevant de façon efficace leur dernier petit et les petits de leur propre progéniture. Ce qui sera connue sous le nom ‘d'hypothèse de la grand-mère' est proposée en 1998. Elle suggère qu'une longue vie post-ménopausale favorise l'extension du partage de nourriture entre mères et petits et permet à de plus vieilles femelles d'accroître la fertilité de leurs filles en investissant directement dans des grand enfants et d'autres membres proches de la ‘famille '. La famille comme espace d'agencements multiples et affinités électives En partant de cet exemple des mammifères marins, on comprend que la famille animale constitue une organisation sociale particulière à l'intérieur du groupe et qu'elle s'organisent autour de trois caractéristiques centrales qu'on va retrouver chez d'autres espèces de mammifères : la famille est une organisation parmi d'autres au sein du groupe, elle suscite des attachements affectifs très forts et elle fonctionne en partie comme une PME inter-générationnelle pour l'élevage et la protection des petits. · La famille est une organisation sociale parmi d'autres dans les sociétés animales. La société des femelles éléphants est complexe et en est un exemple particulièrement frappant. Elle consiste en relations qui partent du lien mère/petit et s'étendent à travers des unités familiales, des liens de groupe et des clans. Dans l'éléphant, l'unité sociale de base est composée d'une ou de plusieurs femelles adultes qui sont liées entre elles et leur petit immature. Cette unité sociale peut comprendre de un à trente individus. Ian Douglas-Hamilton note que des relations privilégiées lient certaines familles avec d'autres. Cynthia Moss montre qu'elles ne sont pas forcément apparentées. La notion de clan y a une utilité incontestable. · Des attachements affectifs très forts. Chez les espèces cognitivement les plus complexes, ce qui frappe est que la famille apparaît aussi comme un espace où se produisent des attachements d'une singulière force. L'attachement de certains animaux vis-à-vis de certains apparentés est littéralement étonnant. Les rapports mère/enfant sont particulièrement frappants de ce point de vue, comme les partages entre mères et enfants chez les chimpanzés ont été décrits pour la première fois par Jane Lawick-Goodall (1968) à Gombe. A propos des éléphants africains, Cynthia Moss a décrit l'attachement exceptionnel d'une mère pour son petit qui était né handicapé. Le lien mère/enfant n'est pas le seul à pouvoir être aussi fort. Il est intéressant de signaler à cet égard que des « lunes de miel » ont été observées entre chimpanzés mâles et chimpanzés femelles qui s'éloignent du groupe. Les données obtenues à Gombe laissent penser que les petits sont conçus pendant ces lunes de miel. Ce « romantisme » est très utile. Le père qui y trouve un avantage en s'assurant de la paternité qui en résulte . La mère craint moins la violence subséquente du mâle vis-à-vis de son petit. · La famille constitue une PME pour l'élevage et la protection des petits. Cette caractéristique qu'on a vu chez les dauphins, les chimpanzés et les éléphants se retrouvent chez de nombreuses autres espèces. Chez les coyotes de Grand Teton National Park, près de Jackson, dans le Wyoming, des coyotes aident les parents sans l'être eux-mêmes, et peuvent prendre soin des petits en défendant des territoires ou des sites de terrier ou en faisant du baby-sitting quand les parents sont partis chasser. On sait que ces aides, qui ont initialement été décrits par Alexander Skutch à propos des oiseaux, accroissent considérablement la survie de la progéniture, au moins dans leur enfance, et pas seulement chez les coyotes, mais également chez les nombreuses espèces où existe de telles associations. Dans ces agencements sociaux le mâle a souvent une position qui est très différente de celle de la femelle. Il convient cependant de rester prudent et de réaliser que tout peut changer d'une espèce à une autre. Pour revenir un peu aux primates, leur potentiel paternel est très limité, sauf chez les callitrichidés sud-américains chez qui les mâles participent aux tâches « familiales » . En règle générale, parler d'une division des tâches serait pourtant audacieux, même s'il existe souvent une complémentarité des activités. La famille comme espace dangereux Tout n'est pourtant pas rose dans la vie familiale de l'animal. J'ai évoqué la protection des petits. La situation est loin d'être simple de ce point de vue. La famille n'est pas seulement un lieu au sein duquel se multiplient affinités électives et agencements surdéterminés, mais aussi comme un espace d'évitement et d'élimination. La famille est souvent un espace dans lequel s'exprime une très grande violence entre membres d'une même fratrie et entre ceux de générations différentes. · Fratricide. Comme chez les dramaturges classiques, la famille peut être le théâtre de passions extrêmes. Racine aurait adoré les hyènes tachetées qui conçoivent habituellement des jumeaux très particuliers. Chaque bébé naît en effet avec des dents de devant pleinement fonctionnelles, longues et perforantes. Ses yeux sont ouverts, son cou et ses mâchoires très puissants. Les jumeaux qui cherchent d'emblée à mordre se tuent entre eux dans un fratricide routinier. Les attaques peuvent commencer avant même la sortie du sac amniotique. C'est parfois le cadet qui gagne, mais c'est le plus souvent le plus faible qui meurt, ayant été incapable d'avoir accès au lait de la mère. Dans la réserve de chasse Mara des Masaï, ¼ des bébés hyènes sont tués par leur frère jumeau. Toutes les rivalités entre des frères n'impliquent cependant pas des rivalités dures. Les hyènes sont particulièrement sordides, mais les conflits fratricides sont assez communs chez d'autres espèces aussi. Chez les rouge-gorges américains, des petits se positionnent eux-mêmes mieux que leurs frères pour avoir plus de nourriture de leurs parents et ils peuvent se battre à mort. Ce qui arrive aussi chez les aigles noirs, les égrettes de bétail, les grands hérons bleus et quelques autres. · Infanticide. Tuer des petits est un comportement très répandu chez de nombreuses espèces. Observé d'abord dans les années 1960, il passe alors pour un comportement anormal. Il fut d'abord suggéré que les humains qui interagissaient avec ces animaux étaient responsables de ces infanticides. La réalité est plus sordide. L'infanticide est un comportement routinier chez de nombreuses espèces de poissons, d'oiseaux et d'insectes. Pourquoi ? L'enfant devient nourriture et sa mort accélère la disponibilité sexuelle de la mère (une mère allaitante est inféconde). A Serengiti, ¼ des enfants lions sont ainsi sacrifiés par des mâles. Dian Fossey découvrit un jour le cadavre d'un bébé gorille, Godi. C'était la première trace d'infanticide qui fut repérée à Visoke. En 1989, sur 50 enfants gorilles morts, 38 % avaient moins de trois ans et 37 % au moins l'avaient été au cours d'un infanticide. On considère aujourd'hui qu'une femelle gorille a un de ses enfants tué au moins une fois dans sa vie. La majorité des enfants qui ne sont pas protégés par un silverback, par un grand mâle dominant, finissent par être tués. La femelle dont le bébé a été tué rejoint en général la troupe de son meurtrier et a un enfant avec lui. Le mâle tueur est toujours étranger à la troupe à laquelle appartient alors la mère. · Inceste. L'interdit de l'inceste existe-t-il chez l'animal ? On ne connaît quasiment aucune espèce animale qui pratique l'inceste et des accouplements consanguins réguliers dans des conditions naturelles (Bischof, 1978). Il ne s'agit pas pour autant d'interdits stricto sensu, mais plutôt de mécanismes d'évitement. Dans les sociétés polygynes, les adolescentes sont séparées de leur père à la suite de leur enlèvement par de jeunes mâles. C'est ce qui se passe par exemple chez les zèbres. Chez les babouins Hamadryas, les femelles sont mêmes kidnappées par des mâles non apparentés dès leur enfance. Dans d'autres cas, on peut sans doute parler de « castration psychologique », au cours duquel l'intérêt sexuel disparaît complètement et s'accompagne parfois de transformations somatiques correspondantes. En règle générale, l'inceste apparaît peu fréquent chez l'animal sauf chez les animaux à taux de reproduction élevé (en particulier certains parasites surtout des acariens et des vers), chez les animaux domestiques, et chez les animaux de zoo. J'ai dit que la question qui m'intéressait ici était celle des extensions de la famille. Où commence une famille et où s'arrête-t-elle ? A partir de quand commence-t-on à « familier » et au-delà de quelle limite ne « familie »-t-on plus ? Il me semble prématuré de m'engager sur la voie d'une théorie générale de la famille. La mise en place d'organisations sociales particulières (de protection et d'élimination) autour de la reproduction de l'espèce me semble être une caractérisation fonctionnelle de la famille et sa pratique se retrouve chez un très grande nombre d'espèces – ceux chez qui se perçoit précisément au moins les prémisses d'une vie familiale. On peut aller plus loin pour comprendre les nouveaux visages de la vie de famille de l'animal – car celle-ci se transforme bien évidemment aussi vite (ou presque) que la vie de famille humaine. Deux caractéristiques me semblent particulièrement importantes pour comprendre ce que pourrait signifier ce « familier » que j'invente pour l'occasion: l' identité partagée, d'une part, et les extensions matérielles de la famille, d'autre part. Identité partagée Au sein de ce complexe d'affinités et d'évitements qu'est l'espace familial, on peut considérer que se constitue une identité partagée plutôt qu'une association d'individus plus ou moins autonomes. Font partie de la famille ceux qui entrent dans le cercle de l'identité de ceux qui y participent. Nous adoptons trop souvent une définition psychologique de l'identité qui n'est pas toujours la plus fructueuse. Chaque membre de la famille n'est-il pas être un membre de soi et certains ne sont-ils pas plus membres de soi que d'autres ? Quand un individu ne peut plus vivre et se laisse mourir à la disparition d'un proche, on peut justement se poser la question. Quand les deux membres d'un couple ne se quittent plus, comme on le voit chez certains oiseaux, on peut aussi s'interroger sur l'individuation de chacun d'eux : n'est-ce pas le couple lui-même qui constitue alors l'individualité pertinente à prendre en compte ? · Etre lié jusqu'à la mort. Les associations familiales de l'animal ne sont pas seulement fonctionnelles ; elles sont souvent très émotionnelles chez les mammifères et même aller jusqu'à la mort, ce qui en constitue l'une des manifestations les plus spectaculaires. Jane Goodall a ainsi observé Flint, un jeune chimpanzé qui s'est mis à part de son groupe, a cessé de se nourrir et est mort d'un arrêt cardiaque après que sa mère, Flo, soit morte. Flint est devenue de plus en plus léthargique, a refusé la nourriture et avec son système immunitaire affaibli, s'est senti malade. Flint est resté pendant plusieurs heures près de Flo, a lutté un peu plus, s'est roulé en boule et n'a plus jamais bougé. On estime qu'entre 50 % et 70 % d'enfants gorilles orphelins captifs vont probablement mourir. La mort ne rompt d'ailleurs pas toujours le lien. Joyce Poole a également décrit très précisément comment des éléphants montrent des comportements d'attachement très forts vis-à-vis des ossements de leurs proches. · Monogamie. La prétendue monogamie de nombreux oiseaux – plus de 90 % espèces sont supposées l'être – peut être comprise comme une extension de leur identité. Des oies qui sont faiblement liées ne produisent pas autant de petits que des oies qui sont fortement liées. Chez les mouettes, les mâles et les femelle qui se retrouvent d'une année sur l'autre ont un taux de reproduction plus élevé…L'amour « romantique » peut également être inféré de la tristesse profonde que les individus montrent quand leur partenaire sexuel disparaît ou meurt. Certaines oies mâles ne copulent plus après la disparition de leur partenaire sexuel. Elles agissent comme si elles ne pouvaient surmonter cette épreuve. Des familles aussi fusionnelles que celles qui viennent d'être décrites paraissent symbiotiques par essence. J'ai déjà dit que la famille était un noeud entre le biologique, le psychologique et le social. Se pourrait-il qu'elle mime comportementalement des symbioses plus franchement biologiques ? Ces questions conduisent naturellement à se demander ce qui distinguerait vraiment la famille de formes plus biologiques de symbioses. Un élément de réponse se trouve dans la façon dont les divers éléments des agencements en cause sont liés les uns aux autres. La symbiose peut être caractérisée comme une relation rigide, dont les agencements constitutifs s'expriment toujours de la même façon, autour de la stabilité de l'espèce. La famille est plutôt constituée d'agencements en équilibre constant. La famille est une fragilité qui se constitue autour de la reproduction de l'individu. La symbiose est un verrou, alors que la famille est une serrure. La symbiose est appelée à rester fermée alors que la famille tend constamment à s'ouvrir. Pourquoi n'éclate-t-elle donc pas constamment ? Parce qu'elle s'inscrit dans une matérialité qui la lie et qui est constamment sous-estimée. Extensions matérielles de la famille Comme nous restons avec une conception très « walt disneyenne » de la famille, nous négligeons ce qui pourrait constituer des extensions matérielles de la famille. Sans doute à tort. Le nid fait-il partie de la famille de l'oiseau ? Le terrier fait-il partie de celle du renard ? Le territoire fait-il partie de celle du loup ? Qu'il faille peut être prendre le nid de l'oiseau comme extension matérielle de la famille est une idée qui m'est venue à la suite d'une observation de Bernd Heinrich (1999) qui était arrivé à la conclusion que c'était l'état du nid du corbeau plutôt que la condition de la femelle qui conduisait à l'accouplement. Le nid joue donc un rôle majeur dans un comportement qui n'engage a priori que le mâle et la femelle. A la suite de cette prise de conscience, d'autres comportements, abondamment commentés mais toujours très étonnants, ont pu prendre une signification éclairante. Les oiseaux à berceaux de Nouvelle-Guinée qui font des nids remarquables pour attirer les femelles, font plutôt ces nids comme faisant déjà partie de la famille qu'ils veulent constituer avec la femelle. Plutôt que de choisir une habitation à son goût, la femelle choisirait alors une famille à sa convenance, chacune ayant des caractéristiques matérielle qui lui sont propres. Ces comportements sont d'ailleurs non seulement génétiquement déterminés mais de surcroît culturellement acquis, comme le dialecte des oiseaux. Durant une longue adolescence, les oiseaux à berceau de plusieurs espèces prennent beaucoup de temps à observer des adultes qui construisent des berceaux. Leurs premières constructions sont très rudimentaires. Ce n'est qu'avec l'entraînement qu'ils deviennent plus experts en construisant et en décorant leurs berceaux . Le nid fait vraiment partie de la famille. De la même façon, le territoire du coyotte fait partie de la famille. Un mâle observé par Marc Bekoff, Bernie, est resté pendant trois ans dans sa meute pour aider à élever des petits. Bernie ne pouvait pas se reproduire quand son père était présent et aider tenait lieu de substitut à la reproduction. Quand son père a quitté la meute, Bernie a hérité du territoire de la meute, et a copulé avec une femelle qui a rejoint la meute après que la mère de Bernie soit partie. Bernie et sa partenaire ont reçu de l'aide pour l'élevage de ses petits de ceux dont Bernie s'était auparavant occupés quand ils étaient petits . Portrait de l'humain comme ‘pater-familias universel'. La matérialité de la famille et le rôle de l'identité partagée qu'elle suscite et autour de laquelle elle se constitue sont importants parce que ces ingrédients manipulés conduisent parfois à d'étonnantes recompositions familiales. Plus que jamais, les questions de savoir qui fait partie de la famille et où passent les frontières de la famille acquièrent une actualité d'autant plus troublantes que ces frontières s'avèrent très largement manipulables. La question de l'extension de la famille de l'animal s'avère particulièrement intéressante quand l'humain entre en jeu. Les expériences sur les « singes parlants » qui ont commencé vraiment aux USA dans les années 1960 ont poussé très loin ces pratiques en conceptualisant l'idée initialement exprimée par les Gardner de la « cross-fostering family » - la famille dans laquelle les membres d'une espèce élèvent les petits d'une autre espèce. Dans ces situations qui sont propres aux cultures occidentales, les humains élèvent vraiment les petits d'autres espèces, puisqu'il ne s'agit pas seulement de les aider à vivre mais également leur permettre de pénétrer dans le monde du symbolique à travers la maîtrise d'un authentique langage. La véritable « vie de famille » que constituent ces communautés hybrides homme/animal de partage de sens, d'intérêts et d'affects ne surgit pas de nulle part . Elle s'inscrit au contraire dans une tendance très profonde de l'histoire du vivant qui a cependant été très largement négligé par les historiens de la culture. La domestication peut être vue, fondamentalement, comme une manipulation très efficace des familles animales par l'humain et l'animal de compagnie est sur-domestiqué. L'historien James Serpell en défend la pratique contre ses détracteurs qui trivialisent ou dénigrent les relations affectives qu'hommes et animaux peuvent entretenir dans notre culture. Ces sarcasmes, il est vrai, profitent d'un terrain mal connu et peu fréquenté. Pourquoi les pratiques de l'animal de compagnie ont-elles reçu si peu d'attention en sciences sociales ? Aux USA, par exemple, il y a autant de chats et de chiens que de postes de TV, et les gens tendent à traiter leurs animaux familiers comme s'ils étaient leurs enfants. On a évoqué le parasitisme social à propos de ces relations. Comme les coucous. Il faudrait plutôt dire que l'humain a une propension profonde à jouer un rôle de « parent honoraire » vis-à-vis de nombreuses espèces animales, en s'occupant de petits animaux vis-à-vis desquels ils se sentent investis des mêmes responsabilités que vis-à-vis de leurs petits enfants, et vis-à-vis desquels ils ont un engagement affectif proche. Ces pratiques peuvent même atteindre une intimité parfois étonnante comme dans le cas de ces femmes qui sont décrites par l'ethnologue Jacqueline Millet et qui allaitent au sein des petits animaux qu'elles ont recueillis ou que les hommes du village ont ramenés de leurs chasses en forêts. L'universalité de ces pratiques, qui constituent la norme plutôt que l'exception chez les chasseurs-cueilleurs problématique. L'adoption d'animaux de compagnie n'est pas un phénomène rare chez de nombreux peuples autour du monde. Au 19e siècle, le naturaliste Bates, qui voyage en Amazonie, envoie à Galton une liste de 22 espèces de quadrupèdes dont il a observé l'apprivoisement dans les campements indiens. Les Guyanais nourrissent de nombreux animaux comme leurs propres enfants. Les Caraja du Brésil du sud-est sont pareillement dévoués à leurs enfants et à leurs animaux favoris. Les indiens Kalapalo du Brésil se spécialisent dans l'apprivoisement de l'oiseau avec lesquels ils entretiennent des rapports spéciaux. Les femmes sont les principaux apprivoiseurs d'animaux de compagnie, mais certains hommes, en particulier les chamans, s'y impliquent également avec une virtuosité remarquable. On cite même des cas où des indiens amazoniens traitent leurs animaux familiers ou leur volaille avec plus d'attention que leurs propres enfants. Quant aux Dayacks de Borneo et aux Indiens subarctiques, ils incluent ces animaux dans un système de nomination dans lequel les parents sont appelés d'après l'un de leurs enfants. La représentation occidentale moderne de la famille n'a aucun monopole. Il serait faux de conclure à la facilité des procédures mobilisées à partir de la multiplicité des exemples relevés. Ces agencements homme/animal s'appuient sur des manipulations parfois extrêmement subtiles. Pour ne donner qu'un seul exemple, les Fulani d'Afrique sont connus pour la façon dont ils utilisent leur connaissance des signaux de dominance du bétail et les comportements d'affiliation des animaux qui le composent pour s'introduire eux-mêmes dans les troupeaux comme dominants sociaux et leaders . La domestication pourrait-elle fondamentalement être comprise comme un phénomène d'extension de la sphère familiale au-delà de l'espèce ? Les historiens de la domestication se demandent encore comment l'humain a commencé à domestiquer les premiers animaux et pourquoi une telle pratique est devenue si courante. Je ferais l'hypothèse qu'il faut chercher ce phénomène extraordinaire dans les dérives de la famille. Ces animaux qui sont justement appelés familiers se sont tout simplement introduits dans les familles humaines et ces dernières leur ont donné une place au sein de leurs familles. Le chat de la famille, comme on dit, est d'abord un chat de famille. C'est parce que l'animal est un animal de famille qu'il peut étendre cette dernière à l'humain. Rappelons-nous que deux caractéristiques de la famille animale m'ont semblées particulièrement importantes : l'identité partagée, d'une part, et ses extensions matérielles, d'autre part. Nous les retrouvons totalement dans la domestication. Celle-ci inclut en effet une matérialité qui fait partie de la famille (comme la laisse, la niche ou le panier) et le partage d'identité est ce qui frappe tout observateur extérieur d'un couple homme/animal. « Docteur, nous avons mal au ventre », dit la dame en amenant son chien chez le vétérinaire. On peut certainement sourire de cette confusion des genres, mais on peut surtout se demander s'il n'y a pas là quelque chose de très vrai qui est le fait qu'à force de vivre ensemble, le chien et sa maîtresse ont fini par partager une « identité communiquante ». Je n'ai pas rappelé les bases biologiques de la famille pour rien. Elles me semblent toujours tout aussi importantes pour expliquer pourquoi un animal et un humain peuvent devenir si attachés l'un à l'autre – et pourquoi l'arrivée d'un enfant dans la famille peut être perçue comme une menace ou un concurrent direct par l'animal. Même dans le cas des animaux d'élevage intensif, une telle responsabilité ne laisse pas l'homme insensible, comme l'a très bien montré un film récent de Manuela Frasil. Les humains ne se contentent d'ailleurs pas d'introduire des animaux non humains dans leur propre famille ; ils manipulent de surcroît les familles animales elles-mêmes. Les chiens de berger, comme les patous, qui doivent protéger les moutons contre les loups sont élevés avec les moutons avec lesquels « ils font famille ». Ces chiens se croient moutons et communiquent de façon privilégiée avec les ovins qu'ils doivent garder. Ouverture J'ai suggéré que de nombreux animaux étaient beaucoup plus sensibles à une topologie des procédures qu'à une psychologie sensu stricto – et que les familles animales constituaient des noeuds auxquels l'animal était particulièrement attentif. L'éthologue Konrad Lorenz s'est rendu célèbre à la suite de ses expériences sur l'empreinte. Pour Lorenz, l'oie ou le canard par exemple, sont prêts à reconnaître comme mère le premier mobile qu'ils rencontrent à condition toutefois que cet événement se produise au cours d'une fenêtre temporelle très précise de quelques heures ou moins. Tout le monde a vu ces célèbres images sur lesquelles on voit l'éthologue barbu adopté comme mère par les petits canards ou les petites oies. L'éthologue fait d'ailleurs si bien partie de la famille que l'oiseau devenu pubère cherchera à s'accoupler avec … des éthologues barbus ! Et c'est bien protection, affection et identité que l'animal recherche avec l'humain avec lequel il vit. Les expériences de Lorenz sont assez troublantes, parce qu'elles suggèrent non seulement que n'importe qui peut faire partie de la famille de l'animal, mais que n'importe quoi peut également être adopté de cette façon à condition d'être au bon moment au bon endroit. Les agencements homme/animal, sans être pour autant symétriques, sont néanmoins réversibles. C'est ce que montrent à l'envi les histoires d'enfant-loups, et plus généralement d'enfants humains adoptés par des familles animales. L'écrivain anglais Rudyard Kipling a popularisé la figure de l'enfant-loup avec Mowgli, le héros du « Livre de la Jungle ». Ce n'est pas seulement une belle histoire. L'anthropologue belge Lucienne Strivay a fait une remarquable étude historique des enfants loups . A-t-on jamais observé des enfants-loups vivant dans leur famille exotique ? Pas à ma connaissance. Il existe en revanche un tel témoignage, très intéressant et peu connu, de l'explorateur Jean-Claude Armen, à propos d'un enfant humain qui a été adopté par des gazelles qui constituaient sa famille au Sahara Espagnol. L'un des aspects les plus intéressants de l'enfant-gazelle concernait son « engazellement », c'est-à-dire son appropriation des caractéristiques comportementales des gazelles qui l'avaient recueilli. Le petit d'homme, pour parler comme Kipling, se déplaçait par bonds puissants, flairait constamment autour de lui, cou tendu face au vent, avec un nez constamment agité de petits soubresauts entraînant le troupeau à sa suite ou au contraire se laissant entraîner par le troupeau. Il reniflait en permanence « le flanc des bêtes, des brindilles, des bouts d'épineux, des fleurs, des baies, des dattes tombées, des billes de crottin, des traces d'urine » – et même l'arrière-train des gazelles ! Ce n'est pas tout. Jean-Claude Armen décrit en détail comment l'enfant-gazelle frémissait également « des oreilles et du cuir chevelu au moindre bruit suspect ou insolite, muscles tendus et spasmodiques » - comme une authentique gazelle. Le jeune garçon communiquait de surcroît avec ses compagnes herbivores comme elles, par « souffles, rots, petits cris et surtout signes de tête ou de pattes ». Plus tard, et après de plus longues observations, Armen affine sa perception de la complexité des communications qui liaient l'enfant aux gazelles : coups de talons ou de sabots frappés, torsion de col, coups de tête, remuements rythmés de queue, d'oreilles, de cornes, de poignets ou de doigts. Il se roulait comme elles dans des dépressions argileuses pour se protéger de la chaleur et du soleil. Il coupait même sur une paroi verticale de rocher un chou du désert d'un coup de dents arasées d'herbivore. Enfin, il participait avec les autres gazelles à tous ces signes d'affection qui liaient les animaux les uns aux autres : flairements, échanges de coups de langue rapides, « susurrements ». Et quand tombait le crépuscule, l'enfant s'endormait sous le cou d'une grande gazelle. Même endormi, il se « gazellifiait » d'ailleurs : il frémissait des oreilles malgré un sommeil profond, dressait la tête au moindre bruit insolite, humait les alentours, les paupières mi-closes. Tout ne relevait cependant pas de l'imitation. L'enfant gazelle avait des caractéristiques inconnues de ses compagnes. Il grimpait à quatre « pattes » sur des palmiers-dattiers. Inversement, nombre d'expressions humaines semblaient lui faire totalement défaut. Il ne pleurait pas, il ne riait pas, et il ne se mettait pas en colère… J'ai insisté sur les transformations comportementales et physiologiques de l'enfant qui vivait dans une famille de gazelles. C'est un point qui me semble essentiel. Nous avons souvent tendance à considérer que les « familles » animales sont purement biologiques alors que les familles humaines seraient essentiellement sociales et culturelles. Je pense que les unes et les autres sont à la fois biologiques (toute famille se constitue autour de la reproduction de l'individu, même si on peut constituer des associations très familiales qui n'ont pourtant rien à voir avec la famille) et sociales, et que c'est l'une des raisons qui rendent si difficile toute caractérisation de la famille. L'animal domestique lui-même, celui qui entre dans la famille de l'homme, subit d'importantes transformations biologiques. Une sélection sur de nombreuses générations peut encore accentuer les différences. Les travaux de l'éthologue hongrois Adam Miklosi sur le chien le montrent amplement. Comparant les capacités cognitives du loup et du chien, il met en évidence la capacité de ce dernier à pouvoir communiquer avec l'homme par l'intermédiaire d'échanges visuels et de signes gestuels qui restent hors de porté du premier. Le chien, conclut-il, a été sélectionné pendant des centaines d'années pour devenir un bon interlocuteur de l'homme. J'ai commencé cet exposé en rappelant quelques bizarretés de la reproduction chez l'animal, et la difficulté à trouver une explication satisfaisante à l'apparition de la sexualité et sur les formes étonnantes qu'en prend parfois l'expression chez certaines espèces. Il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler les conditions de la reproduction. Celles-ci sont sans aucun doute biologiques, mais elles sont également et fondamentalement sociales et matérielles même chez l'animal. Les familles hybrides homme/animal sont incontestablement reproductives, à cette différence près, mais somme toute assez secondaire, du point de vue qui m'intéresse, que cette reproduction s'établit peu entre l'homme et l'animal. Je dis peu et non qu'elle ne s'établit jamais, non pas parce que je veux choquer les âmes sensibles ou faire de la provocation, mais parce que l'humain joue souvent un rôle non négligeable dans la reproduction de l'animal – ce qui est normal puisqu'il fait partie de la famille. Dans le contexte des sexualités baroques de l'animalité, l'invention de la famille telle que je l'ai caractérisée apparaît comme une étape significative et le passage par l'humain n'est pas aussi absurde qu'on aurait pu initialement le croire mais en constitue au contraire une extension somme toute assez raisonnable. La famille reconstituée serait plutôt la norme que l'exception, et dans une extension beaucoup plus radicale que ce qu'on était prêt à imaginer a priori. Reste à savoir jusqu'où la famille va pouvoir s'étendre. Un film récent de Steven Spielberg est intéressant de ce point de vue : AI raconte comment une machine intelligente vient s'installer dans une famille humaine sous la forme d'un enfant « parfait ». la vogue des tamagushis nous avaient déjà mis la puce électronique à l'oreille : après l'animal de compagnie, nous sommes prêts à accepter des artefacts dans le cercle familial.
VIDEO CANAL U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
L'IMPACT DES NEUROSCIENCES SUR LES THÃRAPIES |
|
|
| |
|
| |

L'IMPACT DES NEUROSCIENCES SUR LES THÉRAPIES
Les neurosciences sont à l'origine de beaucoup d'espoirs et de fantasmes. Grâce à quelques exemples on peut démythifier ce qui est présenté dans les journaux, ce que tout le monde pense, les attentes des patients…Une vision plus réaliste sera présentée grâce à une connaissance du système nerveux, des ses troubles, de quelques modes exploratoires ainsi que des possibilités de traitements.
Transcription de la 526 e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 23 janvier 2004
Yves Agid « L'impact des neurosciences sur les thérapies »
L'Europe comporte 400 millions d'individus, dont 17 % ont plus de 65 ans, et représente la population la plus touchée par les maladies neurodégénératives, telles que les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Il existe beaucoup d'autres pathologies neurologiques, telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC), l'épilepsie ou la sclérose en plaque. Ces maladies posent des problèmes de santé publique, mais aussi des problèmes socio-économiques. La maladie d'Alzheimer, qui concerne cinq millions de personnes en Europe, entraîne une dépendance totale trois à cinq ans après le début de la maladie et un coût d'environ 80 milliards d'euros par an. Au total, ces maladies neurologiques sont fréquentes, et coûtent plus de 300 milliards d'euros par an à la communauté européenne, ce qui peut paraître énorme, mais qui représente cependant moins que le coût des problèmes psychiatriques. Des dizaines de millions de personnes endurent des dépressions, des angoisses, 4 millions souffrent de psychoses (schizophrénie, délires,...). Les traumatisés de la route représentent quant à eux 1,7 million de nouveaux patients chaque année en Europe. Que peut faire la médecine pour soulager tous ces patients sur le plan neurologique ?
La première chose que le médecin apporte à son patient tient à la relation particulière qu'ils entretiennent ensemble. Tout bon médecin est un psychothérapeute qui s'ignore. Si la psychiatrie, la psychologie ou la neuropsychologie, sont des sciences très importantes dans la vie courante, elles le sont encore plus en médecine. Il y a d'ailleurs une analogie entre la psychothérapie et l'effet placebo (du latin je plairai). Cet effet existe dans tout médicament. Le placebo est une substance inerte administrée pour son effet psychologique. Il n'a, de manière remarquable, d'effet que lorsque le patient et le médecin ont une confiance parfaite dans son action. On dit que 40 % des médicaments prescrits dans en France sont d'ailleurs des placebo. Une expérience très classique illustre cet effet. Des étudiants en médecine reçoivent un comprimé parmi deux, l'un présenté comme sédatif et l'autre comme stimulant, mais ne contenant en réalité qu'une substance inactive. Plus des deux tiers des étudiants ayant reçu le « sédatif » ont déclaré avoir sommeil, et ceux ayant pris deux comprimés avaient plus envie de dormir que ceux qui n'en avaient pris qu'un. Un tiers de l'ensemble du groupe a signalé des effets secondaires, tels des maux de têtes, un picotement des extrémités, ou une démarche titubante. Trois étudiants seulement sur 56 n'ont ressenti aucun effet ! Cela prouve que l'acte médical, le fait de donner un médicament, n'a de sens que dans un contexte médecin/malade, ce que les médecins, parfois débordés, mais aussi les patients, ont tendance à oublier. Une relation médecin/patient de qualité est une chose absolument fondamentale.
Il y a encore une trentaine d'années, le cerveau était vu comme une boite noire, dans laquelle personne ne pouvait ni ne voulait regarder. Nous verrons que le cerveau est en effet une structure extraordinairement complexe. On commence cependant aujourd'hui à comprendre ce qui se passe dans un cerveau, normal ou anormal. Cette connaissance pourrait nous permettre d'agir de manière sélective sur les dysfonctionnements du cerveau malade.
Le cerveau humain pèse en moyenne 1350 g (celui de Lord Byron pesait 2,3 kg, et celui d'Anatole France, supposément le plus grand QI ayant jamais existé avec Voltaire, 900 g). Le cerveau est formé de deux hémisphères, chacun divisé par convention en quatre lobes, qui tirent leur nom des os du crâne qu'ils recouvrent : les lobes frontal, pariétal, temporal et occipital. Le cerveau humain est constitué de 100 milliards de cellules nerveuses. Chaque neurone présente des branches (des axones et des dendrites) qui ont chacune à leur extrémité des petites spicules sur laquelle sont établis en moyenne 10 000 contacts avec les cellules voisines. Le cerveau est donc un véritable réticulum. Chaque cellule nerveuse émet environ 1000 signaux par seconde. Par conséquent 1018 signaux sont véhiculés dans le cerveau chaque seconde, soit un milliard de milliard de signaux ! Vu de l'intérieur, le cerveau se présente comme une couche de cellules périphériques (le cortex cérébral) d'où des faisceaux de cellules nerveuses envoient des prolongements (projettent) vers les structures profondes du cerveau, que l'on appelle les noyaux gris centraux, ou les ganglions de la base. Différentes zones fonctionnelles ont été identifiées dans le cerveau : celle qui permet d'accomplir un acte moteur, la partie associative qui sous tend la fonction intellectuelle et le cortex dit limbique, qui contrôle les émotions. Chaque zone projette de manière spécifique vers la zone correspondante dans les structures profondes. Ces régions ne sont cependant pas cloisonnées : comment expliquer une fonction aussi extraordinaire que l'émotion déclenchée en voyant un tableau de Botticelli ?
Une cellule nerveuse peut mesurer un mètre de long : c'est le cas de cellules dont le noyau se trouvent dans la moelle, et l'extrémité de l'axone dans un orteil par exemple. Dans le cerveau, un neurone se trouvant dans une structure et projetant dans une autre émet aussi au cours de son trajet d'autres prolongements vers d'autres structures. Ce n'est pas un vecteur qui transmet une seule information à une cible unique : il reçoit des milliers d'afférences, et distribue son information électrique à une multitude d'endroits différents. L'arborescence des prolongements des neurones est d'une grande complexité, et les lois qui régissent l'établissement de ces réseaux ne sont pas encore parfaitement comprises. Les extrémités des prolongements des neurones contactent d'autres cellules nerveuses et présentent un métabolisme cellulaire extrêmement compliqué : des milliers ou dizaines de milliers de voies de transduction de signaux différentes, des récepteurs par milliers modulé par des neuromédiateurs. La vision que nous avons de ces mécanismes n'est encore que fragmentaire.
Il réside donc un hiatus entre la connaissance que nous avons du cerveau dans son ensemble et au niveau cellulaire alors que tout est relié physiologiquement. Si on veut imaginer des traitements futurs pour le malade, il faut comprendre comment il fonctionne, c'est à dire quelles sont les lois physiologiques qui vont permettre à l'information d'être émise et reçue. Comment des paroles, lorsqu'elles arrivent au cerveau, sont-elles intégrées, mémorisées, et provoquent-elles une réponse, que nous en ayons conscience ou non ? Les bases cellulaires de la mémoire, du langage et du subconscient commencent à être décortiquées et nous allons notamment voir des exemples illustrant notre compréhension de mécanismes contrôlant des phénomènes d'une part moteurs et d'autre part psychologiques.
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on bouge le pouce ? Il faut avoir l'idée de le faire, sélectionner le programme moteur (qui implique en fait tous les muscles de l'organisme car lorsque le bras est levé, le corps entier est mobilisé, ce qui est fait de manière subconsciente), le préparer à partir et exécuter le mouvement. C'est donc un problème sensori-moteur très cognitif. La neuro-imagerie, notamment l'IRM, permet de commencer à élucider ces étapes, en repérant les zones activées par une action. Les ganglions de la base s'allument ainsi lors de la préparation du mouvement. Lors de l'exécution, d'autres zones sont activées, et les ganglions de la base s'éteignent. Tout se passe très rapidement : 30 ms sont nécessaires pour qu'un signal aille de la moelle au pouce. Même si les échelles de temps sont beaucoup plus grandes que dans le domaine informatique (0,0003 ms pour la transmission d'un signal), l'homme parle et pense très vite.
Si un mouvement comme celui-ci est contrôlé, il peut aussi arriver que des pathologies entraînent des mouvements involontaires : les dyskinésies. Si tous les circuits qui permettent de réaliser ce mouvement sont connus, il doit être possible d'agir sur l'étape qui fonctionne mal. Dans certains cas les médicaments peuvent supprimer des symptômes, mais un médicament prescrit pour une petite défaillance à un endroit donné du cerveau diffuse dans tout le cerveau, ce qui provoque des effets secondaires. Un patient atteint de la maladie de Parkinson est gêné dans ses déplacements, il est très lent. Lorsqu'il est traité par de la dopamine, l'absence de mouvement fait place à la frénésie, l'hyperkinésie. Pour éviter ces complications, il est aussi possible d'aller directement à l'endroit défectueux. Pour ce faire, des électrodes stimulantes reliées à une pile, un pacemaker placé sous la clavicule, sont implantées dans une structure très profonde du cerveau, large de quelques millimètres (le noyau subthalamique). Le traitement de malades de Parkinson par cette technique pointue leur a permis de retrouver des mouvements normaux. Malheureusement cette technique ne permet de soulager que 5 % des cas de maladie de Parkinson, mais elle représente un énorme progrès scientifique : grâce à la connaissance parfaite de la physiopathologie, c'est-à-dire des bases neuronales des circuits altérés, et de ce pourquoi ils sont non fonctionnels, la vie de patients a été transformée.
La connaissance avance aussi dans le domaine du traitement par le cerveau des mécanismes émotionnels, notamment grâce à l'étude de patients présentant des pathologies atypiques. Prenons l'exemple d'un homme de 45 ans, opéré à deux reprises pour une grosse tumeur du cerveau. Quelques temps après l'opération, ce patient a commencé à collectionner les télévisions dans sa cave, sa chambre, sa salle de bain et jusque dans les tuyaux d'aération de son appartement. Cet homme était pourtant normal, malgré une légère apathie : son QI était tout à fait usuel et il vivait en famille. L'IRM a en fait montré une lésion très limitée des deux cotés du cortex limbique, dans une zone jouxtant l'ancienne place de la tumeur, expliquant ainsi ses troubles psychiques. Il existe des malades psychiatriques qui ont des lésions organiques du cerveau.
Ces cinq dernières années de nombreuses études non pathologiques ont été menées. Des patients sains sont placés dans des situations provoquant une émotion simple, et une IRM est réalisée pour observer les zones du cerveau qui s'activent. Lors d'une expérience, les témoins sont confrontés à deux photos d'une personne attrayante, la seule différence entre les deux images étant le fait que le sujet de l'image semble regarder le témoin ou non. Cela provoque donc une émotion élémentaire. Les régions du cerveau allumées dans le premier et le second cas sont soustraites. La seule zone activée uniquement dans le second cas est une petite structure se trouvant avec d'autres à la base du cerveau, l'ensemble contrôlant les émotions : le striatum ventral. Ces structures existent aussi chez les reptiles, et jouent un rôle dans les activités automatiques motrices, psychiques, et intellectuelles. De la même manière qu'il existe des structures nous permettant d'avoir une activité motrice inconsciente (on peut parler tout en conduisant), nous avons un inconscient psychique. Il est intéressant de noter que ces structures très anciennes s'activent pour une émotion aussi subtile.
De la même façon, des expériences ont été menées sur des singes avec une électrode implantée dans une unique cellule du cortex préfrontal. Ces singes apprennent à réaliser une action pour recevoir une récompense. L'enregistrement du neurone permet d'évaluer si ce neurone est actif ou non. Si la tâche est complexifiée et oblige le singe à effectuer un raisonnement abstrait, cette cellule nerveuse s'active de manière spécifique. Ce neurone encode donc des règles abstraites. La compréhension du cerveau dans ses grandes fonctions commence aussi à se faire à l'échelle cellulaire.
Une cartographie assez précise des circuits de cellules nerveuses activés et des fonctions aussi complexes que ce que l'on vient de décrire peut ainsi être réalisée. C'est très simplificateur dans la mesure où l'allumage de ces structures ne signifie pas forcément qu'elles sont un centre intégrateur.
Les malades présentant des désordres psychologiques dramatiques sont pour le moment traités avec des médicaments (anti-dépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques) mais cela représente une véritable camisole chimique. Chez des patients présentant un dysfonctionnement de l'attraction ou de la récompense (comme chez les toxicomanes, les pédophiles), on peut imaginer repérer les circuits de cellules participant à ces grandes fonctions intellectuelles et ici émotionnelles, affectives, pour trouver un médicament avec une action très sélective sur le circuit cérébral défectueux. Sans revenir au désastre de la psychochirurgie, on pourrait transposer ce qui a été fait sur les malades de Parkinson, c'est-à-dire l'utilisation d'une technique réversible, qui ne donne pas d'effet secondaire et qui est adaptable. Le développement d'une neurochirurgie du comportement, qui est actuellement du domaine de la recherche, peut se concevoir, dans des cas d'extrêmes sévérités et dans des conditions éthiques et juridiques réglementées. Il pourrait être possible par exemple de modifier de manière sélective des circuits de neurones pour soulager les patients.
Quelles disciplines sont mises en Suvre pour soulager les patients ? La neurophysiologie permet de comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement des réseaux nerveux. Des préparations in vitro, des tranches de cerveau contenant quelques millions de neurones constituent des modèles simplificateurs. Des techniques très performantes sont mises en Suvre pour comprendre, par exemple, le phénomène épileptique et trouver des médicaments. Il faut cependant tenir compte du fait que les réseaux de neurones ne sont pas rigides comme un câblage informatique, mais peuvent se reconfigurer. Ce sont des assemblages plastiques, où les cellules repoussent et établissent de nouveaux contacts, contrairement à ce que l'on croyait dans le temps. Chaque cellule a de plus une mémoire personnelle. Il faut tirer profit de toutes ces propriétés pour essayer de soulager les malades avec des thérapeutiques adaptées pour chacune des cellules. D'autres disciplines telles que les neurosciences cognitives, la robotisation, l'informatique, la modélisation, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, la neuropsychologie et bien d'autres ont énormément à apporter au patient, et c'est un drame qu'existe un tel hiatus entre la faculté des lettres et celle des sciences. Des programmes de recherche en commun sont nécessaires. Les neurosciences cognitives tirent profit de l'avantage de l'homme par rapport aux modèles cellulaires ou animaux, du fait qu'il peut s'exprimer, ce qui procure des informations précieuses sur le vécu des individus et leur souffrance. La neuro-imagerie permet en outre de mesurer le volume du cerveau de certaines structures, leur fonction, d'étudier leur anatomie, voire leur chimie par spectro-IRM. La sémiologie (l'étude des signes cliniques de la maladie) est une science moins connue, mais apporte énormément, et permet de faire des diagnostics et de trouver des thérapeutiques originales.
Nous venons de montrer comment progresse notre compréhension du fonctionnement du cerveau à l'échelle des comportements, de son organisation et de son anatomie. Dans quelle mesure cela permet-il de trouver des médicaments ou des thérapies pour soulager les symptômes des malades, guérir, prévenir ou réparer ?
A l'heure actuelle, des vaccins, préviennent certaines maladies mais pas celles du cerveau. Les seuls outils disponibles pour guérir les maladies sont les antibiotiques. En outre, la chirurgie permet de réparer les fractures, et de retirer les tumeurs. Néanmoins, la médecine actuelle ne sait arrêter l'évolution ni du diabète, ni de l'arthérosclérose, ni d'aucune maladie neurodégénérative, même s'il est possible de soulager certains symptômes.
La neurodégenérescence est le résultat de deux phénomènes : une mort cellulaire d'une part sélective (des neurones dopaminergiques dans le cas de la maladie de Parkinson) et d'autre part lente, mais plus rapide que le viellissement normal d'une cellule. Une cellule peut mourir de deux manières : quand un tissu est brûlé, ou quand un abcès se forme, les cellules qui le composent meurent par nécrose, mais, dans les cas naturels, la cellule se suicide pour mourir, elle entre en apoptose. La plupart de nos neurones vivent toute notre vie, les cellules nerveuses ne meurent que très peu. Cependant leurs capacités diminuent. Dans la substance noire des patients atteints de Parkinson se trouvent trois types de neurones : des neurones sains vieillissants, quelques neurones en apoptose qui meurent en quelques jours et surtout des neurones malades, en état d'affaiblissement pathologique, qui meurent en quelques mois. En tant que pharmacologue, quel mécanisme analyser pour combattre pour arrêter l'évolution de la maladie ? Le vieillissement normal, l'apoptose, la mort pathologique ? Un grand nombre d'équipes travaillent sur l'apoptose, qui ne concerne pourtant qu'une petite partie de la mort cellulaire dans cette maladie.
La biologie moléculaire à notre disposition permet d'identifier et de comprendre le rôle des gènes qui codent les protéines, à la base de la vie cellulaire, et de leurs mutations. L'avancement actuel des connaissances montre cependant que le même gène peut être responsable de différentes maladies, et une même pathologie peut être causée par différents gènes. Il existe par exemple une maladie génétique dominante pour laquelle plus de quarante gènes ont été mis en cause. Il a été identifié une protéine (une ligase du protéasome) impliquée dans la nécessaire dégradation des protéines de la cellule qui est absente dans l'une des multiples formes de la maladie Parkinson. Néanmoins cette découverte ne permet pas de prévoir dans quel délai il sera possible de guérir la maladie. La compréhension d'une mutation et l'identification de la protéine anormale permettent d'attaquer la maladie sur un point précis mais chaque protéine a de multiples partenaires, ce qui rend la recherche encore plus difficile.
La biologie cellulaire envisage de modifier de manière spécifique le comportement de certaines cellules. Cependant les cellules malades ne représentent qu'une fraction de l'ensemble de l'organisme, et il est difficile de trouver des animaux mimant exactement les pathologies. Dans le cas de la maladie de Parkinson, les patients sont par exemple traités avec de la dopamine, ce qui permet de rétablir la transmission dopaminergique des cellules atteintes. D'autres médicaments comme les anxiolytiques ou les neuroleptiques modifient de manière connue le fonctionnement de certains neurones assez spécifiquement. Des thérapies utilisant des facteurs trophiques sont à l'étude. Ces substances produites naturellement au cours du développement du système nerveux favorisent la repousse neuronale.
La thérapie génique a pour objectif de travailler directement au niveau des gènes. L'idée est de remplacer le gène défectueux, in ou ex vivo. Dans le premier cas, l'objectif est de greffer le gène normal sur un vecteur particulier introduit dans le cerveau pour que l'échange de gènes se produise. Dans le second cas, il s'agit de modifier des cellules en culture et de les greffer par la suite. La thérapie cellulaire est envisagée de la même manière, dans l'optique de greffer de nouvelles cellules. L'ARN interférent a pour but d'agir sur l'intermédiaire entre le gène et la protéine
Ces concepts sont très intéressants sur le plan théorique, mais le cerveau est contrairement à beaucoup d'autres organes composé de tant de cellules différentes, dont on connaît mal les interactions, qu'il est chimérique de vouloir passer trop vite de la boite de Petri à l'homme.
La recherche scientifique doit concilier beaucoup d'impératifs à commencer par assurer une synergie entre des recherches cognitives et appliquées. La société a besoin, entre autre, de recherche finalisée, et il faut en même temps assurer la liberté de créer et la rentabilité industrielle. C'est le défi de l'interaction entre recherche fondamentale et recherche clinique. La recherche en neurosciences pose en outre des problèmes particuliers. Toutes ces études sont chères, et cela soulève des questions morales à l'échelle mondiale lorsque l'on sait que la tuberculose, le paludisme et le sida tuent par millions dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, les associations contre les maladies rares sont très puissantes, et trouvent beaucoup d'argent sur des sujets très spécifiques. Ainsi le budget de fonctionnement du Téléthon est supérieur à celui de l'INSERM ! Pour finir, la recherche sur le cerveau pose naturellement des problèmes éthiques considérables.
VIDEO canal U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ALLÃLE |
|
|
| |
|
| |
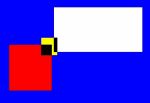
Allèle
Un allèle (abréviation d'allélomorphe) est une version variable d'un même gène, c'est-à dire une forme variée qui peut être distinguée par des variations de sa séquence nucléotidique. En général, il existe deux allèles pour chaque gène, mais certains gènes (par exemple ceux du CMH) possèdent plusieurs dizaines d'allèles. Les allèles d'une paire de chromosomes homologues peuvent être identiques, c'est l'homozygotie, ou différents, c'est l'hétérozygotie.
C'est ainsi qu'au sein d'une même espèce, le génome d'un individu est différent de celui d'un autre individu, c'est le polymorphisme génétique. Ce polymorphisme est également dû à l'apparition de mutations qui sont des variations de la séquence nucléotidique. Il peut donc exister dans les populations naturelles plusieurs séquences différentes d'ADN pour un même locus.
DOCUMENT wikipédia LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Utiliser un virus pour parasiter autrui |
|
|
| |
|
| |

Utiliser un virus pour parasiter autrui
J-M. Drezen, M. Poirié, Y. Bigot et G. Periquet dans mensuel 296
daté mars 1997
De très nombreux insectes, et notamment certaines guêpes, ont développé des stratégies parasitaires élaborées aux dépens d'autres insectes, particulièrement les papillons. Pour contourner la défense immunitaire de leurs hôtes, ils ont mis au point des procédés permettant de manipuler la physiologie de l'hôte. Beaucoup de ces procédés recourent Ñ situation exceptionnelle dans le monde animal Ñ à des virus, dans de véritables symbioses. Le parasitisme prend ainsi une forme à trois étages où seul l'hôte est perdant. Dans certains cas, les gènes des virus se comportent comme des gènes de la guêpe parasite, qu'elle transmet à ses descendants. Il reste à expliquer quels scénarios évolutifs ont pu conduire à ces associations extraordinaires.
Dans le film fantastique Alien de Ridley Scott, les héros sont décimés par des créatures extraterrestres monstrueuses dont les larves détruisent en quelques jours le corps humain. Ce type d'aventure est monnaie courante sur Terre sous forme de relations hôte-parasite agressives, mais fort heureusement elles restent limitées au monde des invertébrés et en particulier à celui des insectes. Parmi ceux-ci, l'ordre des hyménoptères qui compte plus de 300 000 espèces dont les abeilles, les guêpes et les fourmis a particulièrement développé les stratégies parasitaires puisque la moitié des familles qui le constituent comprennent exclusivement des espèces parasites. Comment s'établissent les relations entre les insectes hôtes et les hyménoptères qui les parasitent, et comment évoluent-elles ?
Les hyménoptères « endoparasites » sont des guêpes qui effectuent la totalité de leur développement embryonnaire et larvaire à l'intérieur du corps d'autres insectes, qu'elles utilisent comme réserve de nourriture. Ce type de stratégie a été très productif sur le plan évolutif, puisque plusieurs dizaines de milliers d'espèces sont répertoriées dans ce groupe. Ces espèces parasitent à peu près toutes les familles d'insectes, souvent de manière étroitement spécialisée, c'est-à-dire qu'elles ne parasitent qu'une espèce particulière. Des individus aussi petits que les pucerons ou aussi difficiles à atteindre que les larves d'insectes xylophages vivant à l'intérieur du bois, sont victimes d'hyménoptères endoparasites spécialisés. Cependant, de nombreux hôtes parasités appartiennent à l'ordre des lépidoptères les papillons et les relations entre lépidoptère hôte et hyménoptère parasite sont de loin les plus étudiées.
Pour un endoparasite, le corps de l'hôte constitue un garde-manger qu'il doit maintenir en bon état de conservation jusqu'à la fin de son propre développement. Cependant, il est aussi un environnement hostile. En effet, l'existence chez les insectes d'un système immunitaire complexe ne fait aujourd'hui plus aucun doute1. Les oeufs du parasite doivent donc échapper aux mécanismes de défense de l'hôte et notamment à l' « encapsulation » formation d'une capsule autour de l'oeuf empêchant son développement. Pour parvenir à ce résultat, les hyménoptères endoparasites ont développé des procédés de manipulation de la physiologie de leur hôte. D'un point de vue évolutif, l'originalité de certains de ces procédés est qu'ils font intervenir des particules virales. Nous allons comparer plusieurs exemples de ces relations à trois partenaires, hôte, parasite et virus.
Pour pondre, les guêpes endoparasites utilisent leur tarière, une longue aiguille creuse située à l'extrémité de l'abdomen, qui perce la cuticule de l'hôte sans l'endommager. Les oeufs sont alors expulsés sous pression par le canal interne de l'aiguille et parviennent dans les tissus de l'hôte. Le fluide génital, liquide qui permet notamment l'expulsion des oeufs, est également injecté. Il s'agit d'une sécrétion complexe contenant un cocktail de substances qui jouent un rôle dans la suppression de la réponse immunitaire de l'hôte, la perturbation de son développement et la modification de son comportement2.
Ces substances peuvent être classées en trois catégories suivant leur origine. Elles comprennent des « venins » produits par des glandes qui déversent leur contenu dans le tractus génital, des protéines à action immunosuppressive sécrétées par l'épithélium ovarien, et enfin des virus qui participent à la modification de la physiologie de l'hôte.
La description de l'influence exercée par les différents facteurs provenant du parasite sur la régulation de l'hôte pourrait faire l'objet à elle seule de plusieurs articles. Nous nous limiterons ici à l'aspect le plus original de ces interactions hôte-parasite, le rôle des facteurs viraux. En effet, la présence chez l'hyménoptère de particules virales injectées lors du parasitisme peut prendre la forme d'une asso-ciation guêpe-virus plus ou moins étroite pouvant aller jusqu'à la symbiose. Ces relations guêpe-virus sont le seul exemple connu où l'évolution a conduit à une association symbiotique entre un virus et un organisme eucaryote. La présence de particules virales a été mise en évidence par microscopie électronique dans le tractus génital de nombreuses espèces d'hyménoptères endoparasites ou dans les glandes à venin qui y débouchent. Dans plusieurs cas, il a pu être montré que ces particules se répliquent en fait dans un épithélium spécialisé des ovaires. Les virus identifiés appartiennent à différents groupes et n'induisent généralement pas de pathologie perceptible chez l'hyménoptère3. La présence de virus dans l'appareil génital des hyménoptères femelles trouve probablement son origine dans le comportement de ces dernières. En effet, en piquant leur tarière dans un hôte infecté, pour pondre ou pour s'alimenter, elles peuvent être contaminées et transmettre le virus aux insectes piqués par la suite. Les virus trouvent un avantage à pouvoir se maintenir ou même se multiplier dans le tractus génital des hyménoptères puisqu'ils peuvent ainsi maximiser le nombre d'hôtes infectés.
Il existe une catégorie de virus, les ascovirus virus à ADN, pour laquelle l'utilisation des hyménoptères comme vecteurs constitue probablement la principale voie de transmission dans les populations d'insectes. Ces virus, découverts par le groupe de Brian Federici à l'université de Riverside, en Californie, sont létaux pour les larves des lépidoptères qu'ils infectent. Le virus dissout les tissus de l'insecte en un liquide d'aspect laiteux tout à fait caractéristique de cette pathologie4.
Contrairement à d'autres virus d'insectes, les ascovirus sont peu infectieux par ingestion, ce qui montre que ce n'est pas leur voie naturelle d'infection. Cependant, ils se montrent très infectieux s'ils sont introduits directement dans la chenille à l'aide d'une aiguille préalablement contaminée. Cela suggère que les ascovirus utilisent des insectes piqueurs en tant que principal mode de dissémination dans les populations de papillons. De fait, les chenilles infectées par un ascovirus sont le plus souvent également parasitées par un hyménoptère. Les ascovirus n'induisent pas de pathologie visible chez les guêpes qui leur servent de vecteurs. Par contre, l'infection d'une chenille hôte entraîne indirectement la mort de la larve du parasite. En effet lorsqu'un hyménoptère parasite une chenille, le virus injecté élimine le papillon infecté et, par contrecoup, la descendance du parasite vecteur. Cependant, dans certaines espèces, le parasite a trouvé le moyen de s'accommoder de l'infection virale : le système a évolué vers un état d'association stabilisée.
Il en est ainsi pour l'un des modèles biologiques que nous étudions, une guêpe nommée Diadromus pulchellus qui parasite la chrysalide d'un lépidoptère, la teigne du poireau. Cette guêpe héberge un ascovirus qui est systématiquement injecté dans l'hôte lors de la ponte. Le virus se maintient dans les tissus de l'hyménoptère mais n'y est pas produit en grande quantité. Il ne se montre pas pathogène pour cette espèce. En revanche, après son injection dans la chrysalide hôte, l'ascovirus entraîne la Iyse destruction des cellules de ses différents tissus. La caractéristique intéressante de ce modèle est la suivante : lorsque le virus est injecté avec l'oeuf du parasite, la Iyse des tissus de la chrysalide se produit beaucoup plus lentement que si le virus est introduit seul, à l'aide d'une aiguille contaminée. Ce délai permet à la larve du parasite de consommer les tissus de l'hôte avant leur désagrégation totale et d'achever ainsi son développement. L'ascovirus élimine donc l'hôte mais non la descendance de l'hyménoptère vecteur. Ces observations montrent que Diadromus pulchellus a développé, au cours de l'évolution, des mécanismes permettant de ralentir le cycle du virus dans l'hôte. Il peut ainsi utiliser à son profit la lyse des tissus de l'hôte induite par l'ascovirus. De son côté, l'ascovirus n'est pas perdant. Il a en effet avantage à être véhiculé par la guêpe pour infecter le plus grand nombre de chrysalides possibles. De fait, tous les individus des populations de Diadromus hébergent des ascovirus. La modification de la durée du cycle viral dans la chrysalide de papillon parasité est donc due à des mécanismes qui ont pu être sélectionnés chez la guêpe pour permettre son développement larvaire dans l'hôte en présence de l'infection virale, mais également chez le virus lui-même pour éviter la disparition de la population d'hyménoptères vecteurs.
Cette association Diadromus ascovirus pourrait en fait être plus étroite qu'il n'y paraît. Comme cela a été décrit pour d'autres systèmes biologiques, la présence du virus pourrait également permettre à la guêpe de contourner les défenses immunitaires de l'hôte en perturbant sa physiologie par le biais de l'infection. Cependant, il est difficile de tester l'existence de cet avantage conféré à la guêpe par l'ascovirus car le génome viral Ñ une molécule d'ADN circulaire de 150 kilobases Ñ se trouve dans toutes les cellules des guêpes des deux sexes et l'on ne peut donc évaluer le succès parasitaire en l'absence de virus. En conclusion, nous observons ici une étape importante dans l'évolution de l'association virus-hyménoptère mais il est clair que l'on n'est pas en présence d'une symbiose. L'ascovirus a conservé son autonomie et peut se transmettre en utilisant occasionnellement les individus d'autres espèces d'hyménoptères. Il se comporte alors comme un ascovirus « classique » entraînant l'échec du parasitisme.
Plusieurs espèces de guêpes ont développé des associations avec des virus plus étroites encore que celle décrite ci-avant. Le virus y perd toute autonomie et a été transformé en une véritable arme de combat biologique, utilisée par la guêpe pour modifier la physiologie de l'hôte. Ces entités virales très particulières ont été découvertes par le groupe de Donald Stoltz de l'université d'Halifax, au Canada, et sont nommées « polydnavirus », en référence à leur génome, qui est composé de plusieurs dizaines de molécules circulaires d'ADN double brin. Tous les polydnavirus identifiés à l'heure actuelle sont associés à des espèces appartenant à deux familles apparentées d'hyménoptères : les ichneumonidés et les braconidés.
Dans le cas du parasitisme d'un papillon, le sphinx du tabac Manduca sexta, par la guêpe Cotesia congregata, modèle que nous étudions en collaboration avec le groupe de Nancy Beckage de l'université de Californie, les particules virales sont produites dans la guêpe par des cellules spécialisées situées à la base de l'ovaire, dans un renflement appelé le calice. Puis les virus sont libérés dans la lumière de l'ovaire, en quantité très importante. Lors de la ponte, les virus présents dans le fluide génital sont injectés dans le corps de l'hôte. Le génome viral pénètre ensuite dans de nombreux types cellulaires et en particulier les plasmatocytes, cellules immunitaires de l'hémolymphe. Les protéines virales sont alors produites en quantité considérable. Par exemple, la protéine virale majeure, EP1, atteint 5 % du total des protéines de l'hémolymphe de l'hôte quarante-huit heures après l'introduction du virus5. Cependant, ce début de cycle viral, qui devrait se poursuivre par la réplication de l'ADN du virus, avorte et il n'y a pas production de nouveaux virus. Les polydnavirus sont donc totalement dépendants de l'hyménoptère pour leur multiplication.
La présence de ces virus est également capitale pour l'hyménoptère. En effet, il a été démontré expérimentalement que les polydnavirus sont nécessaires au succès du parasitisme, ceci aussi bien pour l'espèce de guêpe que nous étudions famille des braconidés que pour une espèce de la famille voisine des ichneumonidés.
L'introduction artificielle des oeufs du parasite dans l'hôte en l'absence de fluide génital conduit à leur destruction. En revanche, lorsque les oeufs sont introduits avec du virus purifié injecté en solution, ils se développent normalement. Par ailleurs, si le génome viral a été détruit par rayonnement ultraviolet, les particules infectées ne confèrent plus aucune action protectrice aux oeufs du parasite6. Ce n'est donc pas la simple présence des particules virales dans l'hôte qui est nécessaire à la survie et au développement du parasite, mais bien l'expression des gènes viraux.
De manière encore plus remarquable, l'association guêpe-polydnavirus va au-delà de la dépendance physiologique. Il a en effet été montré que le génome viral présent dans le noyau des cellules de l'hyménoptère ne s'y trouve pas uniquement sous forme de molécules circulaires d'ADN viral, mais également sous forme intégrée dans une structure génomique de grande taille qui correspond, selon plusieurs auteurs, à un chromosome de la guêpe. C'est à partir de cette matrice que sont fabriqués les cercles d'ADN viral. Ce phénomène a été mis en évidence dans deux espèces de la famille des Ichneumonidés7. Nos résultats montrent que cette forme intégrée du génome viral existe également pour un polydnavirus associé à l'hyménoptère braconidé Cotesia Congregata. Les gènes intégrés des polydnavirus se comportent en fait comme de véritables gènes de la guêpe, transmis verticalement à ses descendants. La présence du polydnavirus est indispensable à la réussite parasitaire de la guêpe et le virus, de son côté, ne peut se multiplier que dans l'hyménoptère. Ces deux partenaires ont ainsi constitué une association de type symbiotique, stabilisée grâce à l'intégration de l'ADN viral dans le génome de l'hyménoptère.
Pour comprendre l'action des polydnavirus dans l'hôte, il faut rappeler qu'il existe chez les insectes un mécanisme permettant d'éliminer un corps étranger, comme par exemple l'oeuf d'un parasite. Ce mécanisme consiste dans un premier temps à isoler ce corps étranger en l'entourant d'une « capsule », généralement composée de cellules immunitaires et d'une substance synthétisée par l'organisme, la mélanine. L'« encapsulation » est un phénomène complexe et encore mal connu. Chez les lépidoptères, la première étape de la formation d'une capsule est la reconnaissance de l'oeuf du parasite par les granulocytes, cellules qui contiennent des inclusions dans leur cytoplasme. Cette reconnaissance entraîne leur dégranulation, c'est-à-dire la libération de leurs inclusions et des médiateurs chimiques qu'elles contiennent. Les facteurs libérés vont attirer les plasmatocytes qui vont entourer le corps étranger pour former la capsule8.
Les polydnavirus sont capables d'inhiber ce mécanisme d'encapsulation9. Il a en effet été montré que l'injection de polydnavirus purifié provoque très rapidement une modification des capacités d'adhésion des plasmatocytes. Ces cellules ne sont alors plus capables de s'attacher sur un corps étranger et ne forment pas de capsule. D'autre part, non contents d'altérer ces fonctions, les polydnavirus induisent un phénomène de mort cellulaire massive des cellules immunitaires de l'hôte. Ce phénomène, décrit par le groupe de Michael Strand de l'université du Wisconsin, concerne particulièrement les granulocytes dont le nombre baisse considérablement dans les jours qui suivent la ponte du parasite. Ces cellules sont détruites par l'activation de leurs propres gènes d'apoptose, c'est-à-dire les gènes déclenchant la mort cellulaire programmée. Notre connaissance actuelle permet d'imaginer des scénarios expliquant l'évolution des interactions guêpes-virus vers une symbiose du type hyménoptère polydnavirus. Nous avons vu que les hyménoptères parasites sont des outils de dissémination des virus dans les populations d'insectes hôtes. Ce phénomène favorise l'apparition d'associations hyménoptère virus, qui peuvent être stabilisées si le virus ne défavorise pas le parasite en ayant un effet pathogène ou en empêchant le développement de la larve dans l'hôte. Par exemple, dans le modèle Diadromus ascovirus , des mécanismes entraînant le ralentissement du cycle viral de l'ascovirus dans lachrysalide parasitée et donc permettant le développement du parasite, ont été sélectionnés. Ceci a permis de stabiliser l'association guêpe ascovirus : comme nous l'avons montré, dans les populations naturelles d'hyménoptères, tous les individus hébergent cet ascovirus. Cette observation suggère que l'association est également bénéfique pour la guêpe. Si le virus devient non plus avantageux mais indispensable à la réussite parasitaire de l'hyménoptère, on peut observer l'apparition d'associations de type symbioses. Dans le cas des polydnavirus, nous pouvons imaginer plusieurs scénarios évolutifs différents.
Dans une première hypothèse, un virus infecte, à l'origine, une espèce de lépidoptère parasitée par un hyménoptère : il effectue son cycle viral complet chez le papillon et se maintient chez la guêpe. Ce virus est avantageux pour l'hyménoptère en favorisant sa réussite parasitaire. A un moment donné, le matériel génétique viral s'intègre dans le génome d'une cellule germinale ou d'un oeuf du parasite. Il est alors transmis à la descendance de cette guêpe. Cette association irréversible étant avantageuse pour l'hyménoptère, elle se fixe dans la population. Sous l'effet de la sélection, le virus peut alors perdre progressivement sa capacité à effectuer un cycle complet dans l'hôte puisque la production de particules infectieuses n'est plus nécessaire à sa transmission. De même, le parasite peut perdre sa capacité à « réussir » le parasitisme en l'absence de virus.
A terme, seules seront conservées chez le virus les fonctions utiles à la réussite parasitaire, c'est-à-dire la réplication des gènes codant pour les protéines à action immunosuppressive et la production des particules permettant de les transporter dans les cellules de l'hôte. Le virus est alors devenu une véritable « sécrétion génétique » du parasite. En poussant ce raisonnement à l'extrême, le génome viral présent dans les particules peut même finir par disparaître si ces dernières sont à elles seules suffisantes à conférer l'avantage sélectif au parasite. Cette situation a été décrite pour une guêpe ichneumo-nidée, Venturia canescens, qui produit des VLP Virus like particule, c'est-à-dire des particules virales sans matériel génétique. Les VLP recouvrent les oeufs du parasite et assurent son camouflage vis-à-vis des mécanismes de défense de l'hôte, permettant ainsi le succès parasitaire10.
Une autre hypothèse pouvant expliquer la mise en place de ces symbioses suppose l'existence d'un virus effectuant son cycle viral chez l'hyménoptère. Ce virus peut être quelque peu pathogène pour la guêpe mais il améliore la réussite parasitaire lorsqu'il est injecté dans l'hôte parasité en même temps que l'oeuf. A la suite de l'intégration exceptionnelle de l'ADN viral dans la lignée germinale de la guêpe, l'association devient irréversible. La sélection peut alors conduire à la perte des gènes viraux dont l'expression constituait un désavantage pour l'hyménoptère ; le virus perd son caractère pathogène pour la guêpe. La production de grandes quantités de virus dans les cellules du tractus génital de la guêpe est en revanche sélectionnée puisqu'elle présente un avantage lors du parasitisme. En faveur de cette hypothèse d'une origine hyménoptère des polydnavirus, il faut noter que des cercles d'ADN viraux sont produits en faible quantité dans tous les tissus de la guêpe. Cette faible production virale pourrait être le reflet d'une multiplication ancestrale ubiquiste du virus. Comme dans le premier scénario, le parasite peut alors perdre sa capacité à réussir le parasitisme en l'absence de virus.
Ces observations soulignent le caractère original des associations mises en place dans le groupe des hyménoptères. Ainsi, elles montrent que les virus qui utilisent leur hôte pour se multiplier peuvent parfois être eux-mêmes utilisés par l'organisme qui les abrite. Dans le cas extrême des polydnavirus, cette évolution a conduit à la mise en place d'une symbiose. Dans les années à venir, la poursuite des travaux sur d'autres modèles biologiques et l'obtention d'une meilleure connaissance des phylogénies des hyménoptères et de leurs virus permettront de tester et d'améliorer les scénarios évolutifs de mise en place de ces associations. Ces tra- vaux permettront également d'expliquer comment, non contents d'avoir inventé la vie en société, les hyménoptères ont également réussi à mettre au point l'arme biologique.
1 J.A. Hoffman, « Innate imunity of insects », Current Opinion in Immunology, 7 , 1995.
2 N.E. Beckage, Parasites and pathogens of insects , vol. 1, Academic Press Inc, San Diego, 1993.
3 D. Stoltz et J.B. Whitfield, Journal of Hymenopteran Research , 1 , 125, 1992.
4 B.A. Federici, P NAS , 80 , 7664, 1983.
5 S. Harwood et al. , Journal of Virology , 205 , 381, 1994.
6 K.M. Edson et al. , Science , 211 , 582, 1981.
7 J.G. W. Fleming et al. , in « Parasites and pathogens of insects » , vol 1, Academic Press Inc, San Diego,1993.
8 M.D. Summers et S.D. Dib-Hajj., P NAS , 92 , 29, 1995.
9 M.R. Strand et al. , Annual Review of Entomology, 40 , 31, 1995.
10 I. Feddersen et al. , Experientia , 42 , 1278, 1986.
DOCUMENT larecherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
