|
| |
|
|
 |
|
Mémoire |
|
|
| |
|
| |

Mémoire
Une affaire de plasticité synaptique
MODIFIÉ LE : 29/01/2019
PUBLIÉ LE : 23/06/2017
TEMPS DE LECTURE : 19 MIN
La mémoire permet d’enregistrer des informations venant d’expériences et d’événements divers, de les conserver et de les restituer. Différents réseaux neuronaux sont impliqués dans de multiples formes de mémorisation. La meilleure connaissance de ces processus améliore la compréhension de certains troubles mnésiques et ouvre la voie à des interventions auprès des patients et de leur famille.
Dossier réalisé en collaboration avec Francis Eustache, directeur de l’unité 1077 Inserm/EPHE/UNICAEN, Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine
Comprendre le fonctionnement de la mémoire
La mémoire est la fonction qui nous permet d’intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Elle fournit la base de notre identité.
Cinq systèmes interconnectés
La mémoire se compose de cinq systèmes interconnectés, impliquant des réseaux neuronaux distincts :
* La mémoire de travail (à court terme) est au cœur du réseau.
* La mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont deux systèmes de représentation consciente à long terme.
* La mémoire procédurale permet des automatismes inconscients.
* La mémoire perceptive est liée aux différentes modalités sensorielles.
On rassemble parfois toutes les mémoires autres que celle de travail sous le nom générique de mémoire à long terme. Par ailleurs, on distingue souvent les mémoires explicites (épisodique et sémantique) des mémoires implicites (procédurale et perceptive).
La mémoire de travail
La mémoire de travail (ou mémoire à court terme) est la mémoire du présent. Elle permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d’une tâche ou d’une activité.
Cette mémoire est sollicitée en permanence : c’est elle qui permet par exemple de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter, ou de retenir le début d’une phrase le temps de la terminer. Elle utilise une boucle phonologique (répétition mentale), qui retient les informations entendues, et/ou un calepin visuospatial, qui conserve les images mentales.
Elle fonctionne comme une mémoire tampon : les informations qu’elles véhiculent peuvent être rapidement effacées, ou stockées dans la mémoire à long terme par le biais d’interactions spécifiques entre le système de mémoire de travail et la mémoire à long terme.
7, le nombre magique
On estime que le nombre de chiffres, de lettres, ou de mots qu’une personne peut restituer immédiatement dans l’ordre proposé est égal à 7, plus ou moins deux (on parle de l’empan verbal). Il peut être augmenté en regroupant les données (une série de 8 chiffre est plus facile à retenir lorsqu’ils sont groupés par 2 que lorsqu’ils sont pris isolément). Par ailleurs, une série de mots est d’autant plus facile à retenir qu’ils sont courts ou qu’ils sont proches phonologiquement ou sémantiquement.
La mémoire sémantique
La mémoire sémantique est celle du langage et des connaissances sur le monde et sur soi, sans référence aux conditions d’acquisition de ces informations. Elle se construit et se réorganise tout au long de notre vie, avec l’apprentissage et la mémorisation de concepts génériques (sens des mots, savoir sur les objets), et de concepts individuels (savoir sur les lieux, les personnes…).
La mémoire épisodique
La mémoire épisodique est celle des moments personnellement vécus (événements autobiographiques), celle qui nous permet de nous situer dans le temps et l’espace et, ainsi, de se projeter dans le futur. En effet, raconter un souvenir de ses dernières vacances ou se projeter dans les prochaines font appel aux mêmes circuits cérébraux.
La mémoire épisodique se constitue entre les âges de 3 et 5 ans. Elle est étroitement imbriquée avec la mémoire sémantique. Progressivement, les détails précis de ces souvenirs se perdent tandis que les traits communs à différents événements vécus favorisent leur amalgame et deviennent progressivement des connaissances tirées de leur contexte. Ainsi, la plupart des souvenirs épisodiques se transforment, à terme, en connaissances générales.
La mémoire procédurale
La mémoire procédurale est la mémoire des automatismes. Elle permet de conduire, de marcher, de faire du vélo ou jouer de la musique sans avoir à réapprendre à chaque fois. Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c’est-à-dire inconsciente : la personne ne peut pas vraiment expliquer comment elle procède, pourquoi elle tient en équilibre sur ses skis ou descend sans tomber. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés.
La constitution de la mémoire procédurale est progressive et parfois complexe, selon le type d’apprentissage auquel la personne est exposée. Elle se consolide progressivement, tout en oubliant les traces relatives au contexte d’apprentissage (lieu, enseignant…).
La mémoire perceptive
La mémoire perceptive s’appuie sur nos sens et fonctionne la plupart du temps à l’insu de l’individu. Elle permet de retenir des images ou des bruits sans s’en rendre compte. C’est elle qui permet à une personne de rentrer chez elle par habitude, grâce à des repères visuels. Cette mémoire permet de se souvenir des visages, des voix, des lieux.
Avec la mémoire procédurale, la mémoire perceptive offre à l’humain une capacité d’économie cognitive, qui lui permet de se livrer à des pensées ou des activités spécifiques tout en réalisant des activités devenues routinières.
La mémoire – animation pédagogique – 5 min 44 – vidéo extraite de la série Recherche à suivre, réalisée dans les années 90 Mémorisation : De l’organisation cérébrale….
Il n’existe pas « un » centre de la mémoire dans le cerveau. Les différents systèmes de mémoire mettent en jeu des réseaux neuronaux distincts, répartis dans différentes zones du cerveau. L’imagerie fonctionnelle (tomographie par émission de positons, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) permet aujourd’hui d’observer le fonctionnement cérébral normal impliqué dans les processus cognitifs.
Ainsi, le rôle de l’hippocampe et du lobe frontal semble particulièrement déterminant dans la mémoire épisodique, avec un rôle prépondérant des cortex préfrontaux gauche et droit dans son encodage et sa récupération, respectivement. La mémoire perceptive recrute des réseaux dans différentes régions corticales, à proximité des aires sensorielles. La mémoire sémantique fait intervenir des régions très étendues, et particulièrement les lobes temporaux et pariétaux. Enfin, la mémoire procédurale recrute des réseaux neuronaux sous-corticaux et au niveau du cervelet.
Zones du cerveau impliquées dans la mémoire © Inserm, F. Koulikoff
La phase de stockage de l’information nécessite des étapes répétées de consolidation. L’hippocampe semble constituer un élément important dans le processus. Enfin, la restitution d’un souvenir, quelle que soit son ancienneté, reposerait également sur cette structure cérébrale, en interaction avec différentes régions néocorticales. Pour autant, il serait moins sollicité lorsque le rappel provient de la mémoire sémantique plutôt que de la mémoire épisodique.
...à la plasticité synaptique
La mémorisation résulte d’une modification des connexions entre les neurones d’un système de mémoire : on parle de « plasticité synaptique ». Les différentes formes de mémoire fonctionnent en interaction, selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique, implicite ou explicite. Ainsi, un souvenir se traduit par l’intervention de neurones issus de différentes zones cérébrales et assemblés en réseaux. Ces connections interneuronales évoluent constamment au gré des expériences et sont responsables de la persistance d’un souvenir à long terme ou non, selon les cas (importance de l’évènement, contexte environnemental et émotionnel…).
Pris isolément, le souvenir correspond à une variation de l’activité électrique au niveau d’un circuit spécifique formé de plusieurs neurones interagissant par le biais des connexions synaptiques (les synapses étant les points de contacts entre les neurones). Sa formation repose sur le renforcement ou la création d’une connexion synaptique temporaire, stimulée par le biais de protéines produites puis transportées au sein des neurones, comme le glutamate, le NMDA ou la syntaxine qui va elle-même moduler la libération du glutamate.
Le souvenir est ensuite consolidé ou non en fonction la présence de médiateurs cellulaires au niveau du réseau neuronal impliqué dans les heures suivantes. L’activation régulière et répétée de ce réseau permettrait de renforcer ou de réduire ces connexions et, par conséquent, de consolider ou oublier ce souvenir. Sur le plan morphologique, cette plasticité est associée à des changements de forme et de taille des synapses, des transformations de synapses silencieuses en synapses actives, la croissance de nouvelles synapses.
Le maintien à long terme d’un souvenir repose sur la modification de la cinétique d’élimination ou de renouvellement de certains médiateurs. La phosphokinase zêta (PKM zêta) joue un rôle prépondérant dans ce mécanisme en favorisant la persistance des mécanismes impliqués dans la stabilisation et la consolidation des souvenirs. Elle possède pour cela deux propriétés spécifiques : elle n’est soumise à aucun mécanisme d’inhibition et elle s’autoréplique.
Au cours du vieillissement, la plasticité des synapses diminue et les modifications des connexions sont plus éphémères, ce qui pourrait expliquer des difficultés croissantes à retenir des informations.
Section transversale d’hippocampe, région cérébrale du système nerveux central impliquée dans la mémoire. Des neurones sont créés continuellement dans le gyrus denté (partie claire), participant ainsi à la plasticité cérébrale. Ici, les noyaux cellulaires et les « corps de Nissl », des organelles spécifiques aux neurones, sont marqués révélant l’organisation de l’hippocampe en couches très structurées. © Inserm/Damien Guimond
La réserve cognitive, soutien de la mémoire
Les capacités de maintien de la mémoire et d’adaptation en cas de lésions semblent variables d’un individu à l’autre. En effet, il a été décrit qu’à lésions cérébrales équivalentes en imagerie, tous ne présenteraient pas les mêmes altérations cognitives. Ces capacités dépendraient de la réserve cérébrale, relative au tissu cérébral, et de la réserve cognitive, qui repose sur sa fonctionnalité.
Selon différentes études, un volume cérébral accru, ou un nombre élevé de neurones ou de synapses est associé à une survenue plus tardive de démence. À lésions équivalentes, ceux qui présentent une réserve cérébrale plus importantes présenteraient des troubles moins sévères. Cette réserve cérébrale serait sous l’influence de paramètres génétiques et probablement environnementaux.
La réserve cognitive correspond à l’efficacité des réseaux neuronaux impliqués dans la réalisation d’une tâche et celle du cerveau à mobiliser ou mettre en place des réseaux compensatoires en cas de lésions pathologiques ou de perturbations physiologiques liées à l’âge. Elle se traduit également par une variabilité, d’un sujet à l’autre, de la tolérance des lésions cérébrales identiques. En effet, les données disponibles suggèrent que la richesse des interactions et le niveau d’éducation sont associés à une survenue plus tardive des troubles cognitifs ou des démences Alzheimer ou apparentées. À l’inverse, l’évolution du déclin cognitif chez ces derniers serait plus rapide une fois installé : elle s’expliquerait par le fait que les symptômes sont identifiés à un stade où les lésions sont plus nombreuses et importantes.
La constitution de la réserve cognitive pourrait dépendre :
* de l’importance des apprentissages
* du niveau d’éducation
* d’une stimulation intellectuelle tout au long de la vie
* de la qualité des relations sociales
* de l’alimentation
* du sommeil
* des paramètres génétiques seraient également probablement impliqués
Hygiène de vie et mémoire
Des expériences ont montré que dormir améliore la mémorisation, et ce d’autant plus que la durée du sommeil est longue. A l’inverse, des privations de sommeil (moins de 4 ou 5 heures par nuit) sont associées à des troubles de la mémoire et des difficultés d’apprentissage. Par ailleurs, le fait de stimuler électriquement le cerveau (stimulations de 0,75 Hz) pendant la phase de sommeil lent (caractérisée par l’enregistrement d’ondes corticales lentes à l’encéphalogramme) améliore les capacités de mémorisation d’une liste de mots. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène : pendant le sommeil, l’hippocampe est au repos, évitant les interférences avec d’autres informations au moment de l’encodage du souvenir. Il se pourrait aussi que le sommeil exerce un tri, débarrassant les souvenirs de leur composante émotionnelle pour ne retenir que l’informationnelle, facilitant ainsi l’encodage. Pour en savoir plus, consulter le dossier Sommeil.
Le sommeil n’est pas le seul paramètre d’hygiène de vie qui influence notre capacité de mémorisation : l’alimentation (bénéfice du régime méditerranéen), l’activité physique et les activités sociales jouent également un rôle important.
Mémoire et émotions : de l’amélioration mnésique à la pathologie
Il est démontré que les émotions peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée, l’émotion renforçant ponctuellement l’attention. Ainsi, une émotion positive peut se traduire par une amélioration ponctuelle des performances mnésiques. Il apparaît également que la consolidation, et donc la rétention d’une information est favorisée par l’émotion : le rappel d’un souvenir émotionnel après un long intervalle est souvent plus important que lorsque ce souvenir est neutre. L’imagerie fonctionnelle montre d’ailleurs que le rappel des souvenirs est proportionnel à leur intensité émotionnelle qui peut être observée par l’activation de l’amygdale, siège des émotions. Enfin, la récupération d’un souvenir est aussi améliorée par la présence d’une émotion positive. Chez les personnes présentant un trouble cognitif, les expériences montrent un effet protecteur des émotions positives sur les capacités résiduelles de mémoire. Ce mécanisme existe cependant uniquement dans les premiers stades de la maladie. Ensuite, l’incapacité de l’amygdale à remplir son rôle rend ce mécanisme compensatoire inefficace.
Il existe un pendant pathologique à ce processus : en effet, une émotion trop intense, notamment traumatique, entraîne une distorsion de l’encodage. L’état de stress post-traumatique (ESPT) des personnes victimes ou témoins d’un évènement dramatique en est l’illustration type. Le souvenir est mémorisé sur le long terme, avec à la fois une amnésie de certains aspects et une hypermnésie d’autres détails qui laissent la personne hantée durablement par cet événement. Il s’accompagne d’une décharge de glucocorticoïdes (hormone du stress), dans l’hippocampe au moment de l’événement. Cette distorsion profonde de l’encodage des événements, au contraire d’un souvenir normal, rend le souvenir persistant au cours du temps sans qu’il ne perdre de son intensité ou de sa spécificité. La victime a ainsi le sentiment de revivre continuellement la scène traumatisante, même des années après.
Dans d’autres situations ayant également trait à une émotion vive (stress, agression...), certains sujets développent plus volontiers une amnésie dissociative : véritable stratégie défensive adaptative, développée de façon inconsciente, elle repose sur l’oubli d’une partie des souvenirs autobiographiques ou sémantiques, ainsi que de l’évènement l’ayant déclenchée. Ces souvenirs peuvent être réactivés, progressivement ou brutalement, à l’issue d’une conscientisation de l’évènement déclencheur.
Sur le plan thérapeutique, la compréhension des mécanismes de stabilité des souvenirs et de l’influence émotionnelle offrent les moyens d’envisager la prise en charge thérapeutique de certaines pathologies : ainsi, le développement d’approches psychothérapeutiques fondées sur la dissociation entre les souvenirs et les émotions peut permettre de réduire le handicap lié à des maladies comme certaines formes d’anxiété ou l’état de stress post-traumatique.
Mémoire et oubli : du physiologique au pathologique
Depuis une vingtaine d’années, la prévalence croissante des troubles de la mémoire tel que la maladie d’Alzheimer, a fait de l’oubli un symptôme. Pourtant, l’oubli est aussi un processus physiologique, indispensable au bon fonctionnement de la mémoire.
En effet, l’oubli est nécessaire pour l’équilibre du cerveau, permettant à ce dernier de sélectionner les informations secondaires qu’il est possible d’éliminer afin de ne pas saturer les circuits neuronaux. L’oubli est un corollaire de la qualité de la hiérarchisation et de l’organisation des informations stockées. Ainsi, certaines personnes souffrent d’hypermnésie idiopathique, une pathologie de l’abstraction et de la généralisation du souvenir dans laquelle l’oubli des détails est aboli. Ces personnes rencontrent des difficultés de vie quotidienne liées à l’incapacité d’organiser leurs souvenirs en fonction de leur significativité et de leur importance.
Cependant, l’oubli peut aussi correspondre à la disparition involontaire de souvenirs acquis par apprentissage volontaire ou implicite, alors que son codage a été réalisé correctement. Ce phénomène reste physiologique tant qu’il est sporadique. Il concerne plus souvent la mémoire épisodique que la mémoire sémantique, procédurale ou sensorielle. Il devient pathologique, et prend plus volontiers le nom d’amnésie, lorsqu’il concerne des pans entiers de mémoire sémantique ou épisodique.
Les multiples troubles de la mémoire
Certaines situations entraînent des incapacités sévères et des amnésies durables. Les causes possibles sont :
* un traumatisme physique entraînant des lésions cérébrales
* un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique
* une tumeur du cerveau
* ou encore une dégénérescence neuronale comme la maladie d’Alzheimer
Dans d’autres cas, les troubles sont moins sévères et le plus souvent réversibles. Les causes possibles sont :
* des maladies mentales comme la dépression
* le stress et l’anxiété, ou la fatigue
* un événement traumatisant (deuil)
* des effets indésirables de médicaments comme des somnifères, des anxiolytiques (d’autant plus fréquent que la personne est âgée)
* l’usage de drogues
Les troubles de la mémoire ont différentes origines biologiques, comme un déficit en certains neuromédiateurs ou une faible connectivité entre les réseaux cérébraux.
Les manifestations de ces troubles sont extrêmement variables selon leur origine et les localisations cérébrales des processus pathologiques. Ainsi, des patients atteints d’une démence sémantique, dans laquelle des mots ou des informations sont oubliés, perdent également des souvenirs anciens alors qu’ils continuent à mémoriser de nouveaux souvenirs épisodiques (souvenirs « au jour le jour »). Ces troubles sont associés à une atrophie des lobes temporaux. Chez d’autres patients, notamment ceux souffrant de la maladie d’Alzheimer, les troubles concernent la mémoire épisodique : chez eux, les souvenirs les plus anciens sont épargnés plus longtemps que les plus récents. D’autres types de déficiences existent : celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire procédurale peuvent engendrer la perte de certains automatismes, comme chez les personnes atteintes par la maladie de Parkinson ou de Huntington. Celles affectant les neurones impliqués dans la mémoire du travail, peuvent quant à elles donner des difficultés à se concentrer et à faire deux taches en même temps.
Maladie d’Alzheimer et démence sémantique. Visualisation des zones atrophiées dans la maladie d’Alzheimer (en haut), dans la démence sémantique (au milieu) et, de façon commune dans ces deux pathologies (en bas). Les flèches rouges indiquent la région commune hippocampique affectée par ces démences. © Inserm/Renaud Lajoie / Unité 1077
Il existe également des troubles de la mémoire sévères mais transitoires, comme l’ictus amnésique idiopathique : survenant le plus souvent entre 50 et 70 ans, il s’agit d’une amnésie soudaine et massive pendant laquelle le patient est incapable de se souvenir de ce qu’il vient de faire, sa mémoire épisodique est annihilée. Mais sa mémoire sémantique est intacte : il peut répondre à des questions de vocabulaire et évoquer des connaissances générales. Cette amnésie disparaît souvent après six à huit heures.
Les enjeux de la recherche
La mémoire et ses troubles donnent lieu à de nombreuses recherches qui font appel à des expertises variées dans un cadre pluridisciplinaire : génétique, neurobiologie, neuropsychologie, électrophysiologie, imagerie fonctionnelle, épidémiologie, différentes disciplines médicales (neurologie, psychiatrie…), mais aussi sciences humaines et sociales.
La mémoire a longtemps été considérée comme individuelle et étudiée comme telle. Cette approche est aujourd’hui caduque, ou du moins incomplète. Le souvenir se situe en effet à l’interface entre l’identité personnelle et les représentations collectives : il se constitue à partir des interactions entre la personne, les autres et l’environnement. Il ne peut être détaché du contexte social dans lequel il prend place. Les interactions, mais aussi les représentations sociales et les stéréotypes influencent le fonctionnement de notre mémoire.
On parle de cognition sociale : elle permet, par exemple, d’adapter son comportement selon le contexte dans lequel on se trouve, et cela grâce à la mémorisation et l’analyse des expériences passées. L’empathie découle également de cette notion interindividuelle de la mémoire : elle utilise notamment les informations de la mémoire épisodique afin de permettre un « voyage de l’esprit » se traduisant en capacité à partager la détresse de l’autre. Aussi appelée « théorie de l’esprit », cette capacité à se mettre à la place de quelqu’un et à imaginer et interpréter ses pensées fait appel à nos mémoires dont nous décentrons l’objet. Sur le plan médical, la dégénérescence des neurones au niveau frontotemporal, retrouvée dans certaines démences (Alzheimer et apparentées), se caractérise par une diminution de la cognition sociale : le malade peut présenter des troubles du comportement ou des dysfonctionnements sociaux.
Par ailleurs, sur un plan plus large, il existe aussi une mémoire collective ou culturelle, celle qui prend place autour des évènements historiques (autour de leur évocation ou de leur commémoration) et des évènements contemporains médiatisés. Il s’agit d’une mémoire partagée constituée des différentes représentations de l’évènement par l’ensemble des personnes.
Ce domaine de recherche est particulièrement novateur et rapproche les expertises en neurosciences et en psychologie de celles en sociologie, en histoire, en philosophie ou en éthique. En termes thérapeutiques, cette transdisciplinarité peut également apporter un intérêt : l’état de stress post-traumatique correspond par exemple à une hypermnésie des perceptions et émotions liées à l’évènement, à une amnésie des aspects contextuels, ainsi qu’à une perturbation de la mémoire autobiographique. À la suite d’un évènement traumatisant, une prise en charge appropriée de la charge émotionnelle associée pourrait être d’autant plus efficace que l’évènement en question est inscrit dans le cadre social, à la fois familial et professionnel. Il en serait d’autant plus question dans le cadre d’un évènement inscrit dans la mémoire collective.
Sonder la mémoire individuelle et collective des attentats
Le programme 13-Novembre, mené par des chercheurs de l’Inserm et du CNRS, associe différents volets de recherche transdisciplinaire autour du témoignages recueillis sur les attentats du 13 novembre 2015. Il cherche à évaluer comment le souvenir traumatique des attentats évolue dans les mémoires individuelles et collectives, comment les deux fonctionnent en interaction et quels sont les facteurs de vulnérabilité face à l’ESPT. À quatre reprises durant dix ans, les témoignages et les éventuels troubles (ESPT, images envahissantes, dépression…) de 1 000 personnes volontaires seront analysés selon leur proximité avec les attentats : cette cohorte rassemble des personnes exposées directement (survivants, témoins, familles), indirectement (habitants des quartiers des attentats) ainsi que des habitants franciliens ou non franciliens. Ces données seront recueillies parallèlement à une analyse de l’opinion des français sur le sujet, ainsi qu’une analyse du discours et de la textométrie des informations télévisuelles ou radiophoniques liés à ces évènements, afin d’en identifier les interactions.
Lancement du Programme « 13-Novembre » – Reportage – 3 min 02 min – 2016
Pour en savoir plus sur l’avancement de ce projet de recherche : Programme 13-Novembre – point d’étape 5 ans après le démarrage du projet (communiqué de presse du 10/11/21)
La mémoire au futur
Selon le contexte, nos propres aspirations, nos projets, nous avons une capacité à élaborer des scénarios plausibles pour le futur, constitués de pensées, d’images et d’actions. Ceux-ci ne peuvent prendre forme que sur la base des représentations du passé. La mémoire du futur fait donc appel à notre mémoire épisodique et sémantique, contrairement aux idées reçues ou aux conceptions habituelles de la mémoire, traditionnellement associées au passé. Ainsi, l’imagerie permet de vérifier que l’évocation d’un souvenir autobiographique ou l’imagination d’un scénario futur font intervenir des régions cérébrales très proches les unes des autres. Par ailleurs, les études montrent que les amnésiques ne peuvent se projeter dans le futur.
La capacité à remplir une tâche à une date ou un jour précis entre aussi dans le cadre de la mémoire du futur : on l’appelle alors plus volontiers mémoire prospective, articulée autour de différents volets selon la nature des tâches à effectuer : « mémoire prospective propre » pour les actions ponctuelles (poster une lettre, aller à un rendez-vous…), « mémoire prospective habituelle » pour toutes les tâches routinières, « monitoring » pour l’attention portée à la fin d’une tâche tandis qu’une autre est en cours (penser à arrêter le four à la fin d’une cuisson, par exemple).
Cette notion de mémoire du futur peut avoir des applications thérapeutiques. Ainsi, des « thérapies orientées vers le futur » ont été développées et testées auprès de patients souffrant de dépression majeure ou de schizophrénie : menées à travers plusieurs séances réparties sur quelques semaines, elles consistent à sensibiliser les sujets sur l’importance des projections mentales dans le futur, la façon dont celles-ci peuvent être améliorées en luttant contre des mécanismes personnels de résistance, puis, progressivement à leur proposer des activités de pleine conscience et, enfin, à travailler sur l’évocation de leurs propres valeurs, leurs objectifs, et les moyens d’y arriver. Les premières études montrent que cette approche peut être plus efficace que les thérapies cognitivo-comportementales conventionnelles.
Mémoires externes
Il semble clair aujourd’hui que notre mémoire interne et nos capacités de projection sont influencées par la mémoire externe : les supports de mémoire collective (livres, films…) sont un élément utile pour modeler notre mémoire du futur. La multiplication des dispositifs électroniques de stockage d’information dans notre quotidien est cependant décrite comme modifiant l’organisation et la puissance de notre mémoire, que nous sollicitons par conséquent moins. Cet équilibre entre mémoire interne et externe constitue un enjeu majeur pour l’avenir.
Sur le plan thérapeutique, les supports externes de stockage sont aujourd’hui testés sous forme d’implants cérébraux dans la prise en charge de patients amnésiques. De façon plus futuriste, l’idée de greffe de mémoire artificielle fait également l’objet de développements actuels.
Modifier la mémoire grâce à l’optogénétique
Outre l’imagerie fonctionnelle, qui fait aujourd’hui partie des modes d’exploration incontournables de l’organisation mnésique, d’autres approches sont plus récentes et en pleine évolution. C’est notamment le cas de l’optogénétique, qui est une technique alliant génétique et optique : elle consiste à modifier génétiquement des cellules afin de les rendre sensibles à la lumière et, grâce à cette dernière, d’en moduler le fonctionnement. Ainsi, l’optogénétique permet d’activer ou d’inhiber expérimentalement des groupes spécifiques de neurones dans le tissu cérébral et d’en évaluer l’impact.
Elle permet aussi de développer des méthodes de manipulation de la mémoire (implantations de faux souvenirs, oubli expérimental…). Ces travaux permettent d’envisager des approches thérapeutiques intéressantes dans la prise en charge de certains troubles psychiatriques.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le cancer et la thyroïde |
|
|
| |
|
| |
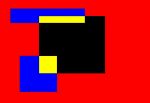
Le cancer et la thyroïde
Le cancer de la thyroïde est-il un cancer fréquent ? Peut-on identifier les causes d'un cancer de la thyroïde ? Comment traite-t-on le cancer de la thyroïde ? Découvrez les réponses à ces questions et à de nombreuses autres dans ce chapitre.
Publié le 3 octobre 2012
"Le cancer de la thyroïde est-il un cancer fréquent ?"
Le cancer de la thyroïde est un cancer rare, puisqu'il ne représente en France qu'1% des cancers. Sa fréquence est en revanche plus élevée chez la femme (environ 2 à 3 fois plus que chez l'homme) et variable suivant les régions du monde. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie connaît la plus forte fréquence de cancers de la thyroïde chez les femmes.
Ces variations de fréquence suivant les régions géographiques font suspecter des facteurs hormonaux, alimentaires et génétique. En Europe, le taux d'incidence est d'environ 40 par million et par an chez la femme, et 14 par million et par an chez l'homme. L'incidence est de 1 cas par million et par an chez l'enfant.
Depuis les années 1970, on constate que la fréquence des cancers de la thyroïde augmente dans tous les pays développés. Cette augmentation est attribuée pour l'essentiel à de meilleurs moyens de diagnostic comme l'échographie.
Le cancer de la thyroïde est un cancer rare, puisqu'il ne représente en France que 1% des cancers.
Actuellement, on constate qu'entre 3% et 5% des patients atteints de cancer de la thyroïde ont un membre de leur famille atteint aussi d'un cancer de la thyroïde.
"Peut-on identifier les causes d'un cancer de la thyroïde ?"
La seule cause exogène identifiée de cancer de la thyroïde est l'irradiation de la thyroïde survenue pendant l'enfance soit à la suite d'une irradiation externe, soit après une contamination par de l'iode radioactif. Cependant d'autres facteurs pourraient jouer un rôle déterminant comme la carence en iode stable, des prédispositions génétiques, des facteurs hormonaux.
Actuellement, on constate qu'entre 3% et 5% des patients atteints de cancer de la thyroïde ont un membre de leur famille atteint aussi d'un cancer de la thyroïde. Dans le cas de l'accident de Tchernobyl, des incertitudes demeurent sur le rôle respectif des différents isotopes de l'iode (Iode 131 ou isotopes de période plus courte).
Parmi les différents types histologiques de cancers, c'est principalement le cancer de type papillaire qui est radio-induit. C'est également le cancer spontané le plus fréquent. Une anomalie génétique est fréquemment retrouvée dans les cellules cancéreuses des cancers de personnes irradiées pendant l'enfance. Dans les cancers apparus précocement après l'accident de Tchernobyl dans l'ex-URSS, d'autres anomalies génétiques spécifiques ont été observées.
"Comment traite-t-on le cancer de la thyroïde ?"
La guérison du cancer de la thyroïde est obtenue dans 90% des cas.
Lorsque l'examen cytologique est en faveur d'un nodule malin ou suspect, la chirurgie est indiquée. Elle consiste en une ablation totale de la glande thyroïde (thyroïdectomie). Lorsqu'il existe un risque de rechute, un traitement à l'iode 131, un mois après la chirurgie, permet de détruire sélectivement les cellules thyroïdiennes restantes. A la suite de ces interventions, un traitement par hormone thyroïdienne (thyroxine) est prescrit à vie. Cet apport médicamenteux permet de compenser l'absence d'hormones physiologiques et de maintenir le taux de TSH* à une valeur basse, évitant ainsi d'activer des cellules tumorales résiduelles.
La guérison du cancer de la thyroïde est obtenue dans 90% des cas. Elle est plus fréquente chez les sujets de moins de 45 ans, porteurs d'une tumeur de petite taille bien différenciée, que chez les sujets plus âgés et porteurs de tumeurs plus grosses et peu différenciées.
Chez les sujets à risque, ayant subi une irradiation de la thyroïde à dose élevée pendant l'enfance, il est recommandé de pratiquer une palpation et une échographie de la thyroïde tous les 1 à 2 ans. Un traitement par la thyroxine peut être indiqué
* TSH : Thyroid Stimulating Hormon, hormone secrétée par l'hypophyse qui permet de stimuler la thyroïde.
"Pourquoi y a-t-il eu autant de cancers de la thyroïde en Biélorussie, Fédération de Russie et Ukraine après l'accident de la centrale de Tchernobyl ?"
Tchernobyl
Le niveau élevé des doses à la thyroïde s'explique par l'importance des rejets mais aussi par la mise en place tardive de mesures sanitaires entraînant une forte et rapide augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants des régions les plus contaminées de Biélorussie, Ukraine et Fédération de Russie.
Lors de l'accident de Tchernobyl, de grandes quantités d'isotopes radioactifs de l'iode ont été relâchées et se sont dispersées dans l'environnement. L'iode radioactif a été incorporé par inhalation mais surtout par ingestion d'aliments contaminés (en particulier le lait). La contamination, maximale juste après l'accident (fin avril - début mai 1986), a diminué rapidement du fait de la courte période radioactive de l'iode 131*, le plus abondant des iodes radioactifs dispersés. Après 3 périodes (24 jours), 90 % de l'iode radioactif avait disparu et au bout de 10 périodes (80 jours), l'iode radioactif n'était plus détectable (juillet 1986).
Les doses furent supérieures à 1 gray**(Gy) chez plus de 15 000 enfants des régions les plus contaminées par l'accident : la Biélorussie, l'Ukraine et la Fédération de Russie. Or le risque d'augmentation de cancer de la thyroïde chez l'enfant apparaît pour des doses supérieures à 100 milligrays ( 1 milligray = 1 millième de gray). Le niveau élevé des doses s'explique par l'importance des rejets mais aussi par la mise en place tardive de mesures sanitaires comme la distribution de comprimés d'iode ou l'interdiction de consommation des produits frais. Ceci explique la forte et rapide augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants des régions les plus contaminées de Biélorussie, Ukraine et Fédération de Russie après l'accident de Tchernobyl.
Les études menées dans les autres pays européens, moins contaminés que les régions autour de Tchernobyl n'ont pas montré d'augmentation de la fréquence des cancers de la thyroïde (étude du Centre international de la recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé - Sali D, Cardis E et al Int J of Cancer 1996)
* La radioactivité de l'iode 131 diminue de moitié tous les 8 jours
** Gray : unité utilisée en dosimétrie pour mesurer l'énergie délivrée par les rayons et absorbée dans le tissu cible
"J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cancers de la thyroïde en France, est-ce à cause de l'accident de Tchernobyl ?"
L'augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde est observée depuis 1970 dans tous les pays développés, et se confirme depuis environ quinze ans, grâce à la généralisation de l'échographie cervicale.
On sait depuis bien avant l'accident de Tchernobyl (1986) que le cancer thyroïdien reste très fréquemment inapparent chez les adultes : alors que les cancers ayant des manifestations cliniques sont rares (14 par million et par an chez l'homme et 40 par million et par an chez la femme), quelle que soit l'origine du décès, des autopsies systématiques retrouvent un cancer de la thyroïde chez 6 à 28 % des adultes*. L'augmentation de l'incidence du cancer thyroïdien est vraisemblablement liée à l'amélioration du dépistage, les tumeurs détectées étant de plus en plus petites.
Cette augmentation d'incidence est observée depuis 1970 dans tous les pays développés, et se confirme depuis environ quinze ans, grâce à la généralisation de l'échographie cervicale qui met aujourd'hui en évidence des nodules thyroïdiens de 2 mm de diamètre. Comme pour tout cancer dépisté précocement, l'incidence augmente mais la mortalité du cancer thyroïdien est en baisse.
* Fukunaga FH. Yatani R. Geographic pathology of occult thyroïd carcinoma. Cancer 36 : 1095-1099, (1975 )
DOCUMENT cea LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
IA : Un nouvel algorithme français sâinspirant de GPT améliore la surveillance des traumatismes |
|
|
| |
|
| |

IA : Un nouvel algorithme français s’inspirant de GPT améliore la surveillance des traumatismes
04 Mai 2023 | Par Inserm (Salle de presse) | Santé publique
En France, un tiers des passages aux urgences sont dus à des traumatismes. Afin de mieux comprendre leurs mécanismes et améliorer leur prise en charge, des chercheuses et chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux au centre de recherche Bordeaux Population Health, avec des équipes du CHU de Bordeaux, ont mis au point un algorithme capable de classer les visites aux urgences pour cause de traumatisme grâce à l’analyse des comptes rendus cliniques par le bais d’une intelligence artificielle (GPT). Les performances de ce projet baptisé TARPON[1], qui atteignent 97% d’exactitude, ont fait l’objet d’une publication dans la revue Journal of Medical Internet Research Artificial Intelligence. Les résultats permettent d’imaginer la mise en place prochaine d’un observatoire national du traumatisme.
Les traumatismes représentent 9% de la mortalité en France et concernent des populations souvent jeunes. Plus du tiers des 21 millions de passages aux urgences annuels, le sont pour des traumatismes. Il s’agit donc d’un problème majeur de santé publique qui représente un poids sanitaire, sociétal et économique important, face auquel les scientifiques œuvrent pour apporter des solutions.
L’idée du projet TARPON mené par des chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux avec le CHU de Bordeaux est partie du constat que pour chaque visite aux urgences, les soignants rédigent un compte-rendu. Ces derniers représentent une mine d’informations : exposé des symptômes, état des patients, ainsi que de nombreux détails sur les circonstances de survenue du traumatisme.
Or, ces données restent aujourd’hui inexploitées, et l’on dispose de peu de statistiques sur les victimes d’accidents de la vie courante, de violences ou encore de tentatives de suicide. Dans le domaine des accidents de la route, un observatoire existe mais il n’est complet que pour la mortalité et la plupart des accidents liés aux déplacements en vélo, à pied ou à trottinette n’y figurent pas. Une analyse des informations anonymisées issues des comptes rendus des urgences permettrait de constituer le socle d’un système de surveillance des traumatismes quasi exhaustif.
Ces comptes rendus sont des textes non structurés rédigés avec un mélange de termes courants mais aussi médicaux, techniques, et des abréviations. Afin d’en extraire les informations intéressantes, sans avoir à tous les lire, les équipes de recherche ont développé une technique de traitement automatique du langage basée sur des réseaux de neurones artificiels.
Les chercheurs ont adapté le modèle d’intelligence artificielle GPT et l’ont entraîné avec un échantillon de plus de 500 000 comptes rendus provenant des urgences adultes du CHU de Bordeaux[2]. Ils ont ainsi abouti à un outil de traitement du langage clinique francophone, dans le respect des règles RGPD.
Avec le soutien du Health Data Hub, de Bpifrance, de la région Nouvelle Aquitaine, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la Délégation à la Sécurité Routière, les chercheurs ont pu financer l’achat d’un puissant serveur, dédié à l’intelligence artificielle et installé au sein même de l’hôpital. Ce dernier a permis d’implémenter l’algorithme développé par les scientifiques, pour classer automatiquement les traumatismes selon leurs types, et cela avec une précision surprenante.
En effet, la méthode développée par les chercheurs permet de classer correctement 97% des comptes rendus (contre 86% avec les anciennes méthodes), comme le détaillent les chercheurs dans leur article scientifique. Grâce à cette première étape, l’étude des données pourra débuter sur la plateforme technologique du Health Data Hub d’ici l’été.
Ces résultats ouvrent la voie à la mise en place d’un système national de surveillance des traumatismes mais aussi à des analyses épidémiologiques portant par exemple sur l’impact des consommations de médicaments sur le risque d’accident. Des travaux qui devraient donc apporter un éclairage nouveau sur des enjeux de santé publique importants. Dans l’immédiat, le projet TARPON sera étendu à une quinzaine de services d’urgences répartis sur tout le territoire français.
[1] TARPON : Traitement Automatique des Résumés de Passages aux urgences pour un Observatoire National
[2] Cette recherche répond aux obligations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Obésité : le monoxyde de carbone protecteur chez la souris |
|
|
| |
|
| |

Obésité : le monoxyde de carbone protecteur chez la souris
* PUBLIÉ LE : 30/05/2024 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE
*
À l’Institut Mondor de recherche biomédicale, une équipe a développé un composé qui protège la souris de l’obésité. Cette molécule délivre du monoxyde de carbone en quantité contrôlée dans l’organisme. Après ingestion, elle limite la prise de poids des animaux et les désordres métaboliques associés à un régime gras. Son action bénéfique passe par un rééquilibrage de la flore intestinale, perturbée en cas d’obésité. Le développement de ce composé se poursuit.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz naturellement produit par l’organisme en petite quantité. Il a des propriétés anti-inflammatoires, vasodilatatrices et anti-ischémiques. Dans de précédents travaux menés chez la souris, son administration a protégé les animaux des méfaits d’un régime riche en graisses, limitant leur prise de poids et les désordres métaboliques associés. Consciente de l’intérêt thérapeutique de ce gaz, l’équipe de Roberta Foresti et Roberto Motterlini, à l’Institut Mondor de recherche biomédicale à Créteil, développe des composés qui libèrent du CO dans l’organisme à dose contrôlée et en étudie les effets. Grâce aux expériences conduites avec une des molécules qu’ils ont mises au point (CORM-401), les chercheurs ont montré que chez la souris, les effets bénéfiques du CO pour lutter contre les méfaits de l’obésité passent, au moins en partie, par un rééquilibrage du microbiote intestinal. Cette flore joue en effet un rôle fondamental dans la maladie. Chez l’animal et chez l’humain, il a été montré à plusieurs reprises que l’obésité est associée à des anomalies importantes du microbiote intestinal, caractérisées par des excès ou au contraire des déficits en certaines souches bactériennes ainsi que des modifications de l’activité de plusieurs d’entre elles.
Un rééquilibrage
Les chercheurs ont centré leur analyse sur le microbiote suite à une observation importante. Lorsqu’ils administraient du CORM-401 par voie orale à des souris, ils constataient une accumulation de CO dans les selles des animaux, suggérant une action de ce composé au niveau intestinal. Pour le vérifier, les chercheurs ont donné la molécule à des souris rendues obèses, puis ils ont collecté à plusieurs reprises des échantillons de leurs selles pour analyse.
À partir des données recueillies (génomiques, transcriptomiques et métabolomiques), de nombreuses différences sont apparues entre le microbiote des souris obèses exposées au CO et celui des animaux qui n’avaient pas reçu le traitement. « Au moins une vingtaine de souches bactériennes associées à l’obésité dans différentes études, qui ont un effet protecteur ou au contraire délétère, sont modifiées par le traitement à base de CO », expliquent Roberta Foresti et Roberto Motterlini. L’une d’entre elles, Akkermansia muciniphila, connue pour être bénéfique sur le plan métabolique chez la souris comme chez l’humain, devient par exemple très abondante après le traitement par CORM-401 alors qu’elle est fortement déficitaire en cas d’obésité. « Nous observons également la restauration d’une activité normale du microbiote, telle qu’observée chez les sujets sains : les marqueurs associés à la respiration bactérienne, à leur métabolisme énergétique ou la production d’acides aminés se normalisent. Il semble que le CO reprogramme le microbiote et le fait repasser d’un état malade à un état sain », clarifient les chercheurs. Ces changements sont en outre associés à une amélioration de plusieurs paramètres cliniques, avec notamment un meilleur équilibre glucidique et une diminution de la résistance à l’insuline, phénomène délétère qui précède l’apparition d’un diabète.
Perspectives cliniques
« Cette molécule CORM-401 est très prometteuse. Pour autant, des études de toxicologie restent à effectuer avant d’envisager son évaluation chez l’humain. Aucun effet indésirable évident n’a été observé chez la souris à l’issue d’un traitement de trois mois, mais nous devons poursuivre le développement préclinique sur d’autres modèles animaux pour nous assurer de sa sécurité d’utilisation », concluent Roberta Foresti et Roberto Motterlini. Affaire à suivre…
Roberta Foresti, professeur de biochimie à l’Université Paris-Est-Créteil, et Roberto Motterlini est directeur de recherche Inserm, travaillent à l’Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB, unité Inserm 955) à Créteil.
Source : D.E. Benrahla et coll. An orally active carbon monoxide-releasing molecule enhances beneficial gut microbial species to combat obesity in mice. Redox Biol, 2024 Jun;72:103153. doi : 10.1016/j.redox.2024.103153.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
