|
| |
|
|
 |
|
La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 28/01/2024 |
|
|
|
| |

La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ?
14.12.2023, par Laure Cailloce
Avec le changement climatique, un tiers de la population mondiale devrait se retrouver confrontée à la raréfaction de la ressource en eau. Cela ne va pas sans susciter des tensions croissantes, à l’international comme à l’échelle locale, et interroge la façon dont nous gérons et utilisons la ressource en eau.
Début octobre 2023, le président français Emmanuel Macron était en visite d’État de deux jours en Suisse, avec à son agenda une négociation d’un genre particulier : le chef d’État venait demander très officiellement d’augmenter le débit du Rhône, dont le « robinet » se trouve en Suisse et est contrôlé par le barrage du Seujet, en plein cœur de Genève. « Le débit du Rhône est un sujet extrêmement sensible, car une bonne partie de la chaîne hydronucléaire de la France en dépend », explique Stéphane Ghiotti, géographe au laboratoire Acteurs, ressources et territoires dans le développement1 de Montpellier. Outre le transport fluvial, l’irrigation des cultures et l’alimentation en eau potable de grandes villes comme Lyon, la France a en effet besoin de l’eau du Rhône pour refroidir ses quatre centrales nucléaires présentes le long du fleuve et alimenter une vingtaine de centrales hydroélectriques… et ce alors que le niveau du Rhône baisse de manière préoccupante, notamment durant la période estivale.
Plus de précipitations, mais pas partout
Le réchauffement du climat planétaire dû aux activités humaines rebat en effet complètement les cartes de la distribution mondiale de la ressource en eau. « Le réchauffement global accélère le cycle de l’eau, explique Bertrand Decharme, hydrologue et modélisateur au Centre national de recherches météorologiques2, à Toulouse. Il y a plus d’évaporation, donc plus de précipitations à l’échelle mondiale, mais celles-ci ne se répartissent pas de manière homogène. » Résultat : selon les dernières projections, un tiers de la population mondiale devrait voir (et voit déjà) sa ressource en eau diminuer de façon drastique dans les décennies qui viennent. « C’est le cas de tout le pourtour méditerranéen, de l’ouest des États-Unis, de l’Afrique australe ou encore de l’Australie, explique le chercheur. À l’inverse, d’autres régions devraient voir leurs précipitations annuelles moyennes augmenter, comme par exemple le nord de l’Europe – pays scandinaves, Pologne, Ukraine, etc. –, le Canada et l’Alaska, toute la Sibérie et une partie du sud de l’Asie. »
Modélisation des précipitations dans le monde à l'horizon 2070-2100. En bleu les régions qui vont voir la ressource en eau augmenter, en jaune celles qui vont la voir diminuer.
Maya Costantini et. al, Projected Climate-Driven Changes of Water Table Depth in the World's Major Groundwater Basins, 2023
Partager
Le paradoxe, c’est que les régions du monde qui vont voir leurs ressources en eau augmenter sont celles qui en ont déjà en abondance, et que les régions où la diminution sera la plus forte sont celles où il existe déjà de forts besoins, notamment pour le secteur agricole.
Le cas de la France est plus difficile à trancher, le pays se trouvant dans la zone de transition entre deux zones aux évolutions diamétralement opposées : le nord de l’Europe et la région méditerranéenne. Si les scientifiques prévoient, et constatent déjà, que la ressource en eau va significativement diminuer dans la partie sud du pays, ils ont plus de mal à modéliser ce qu’il va se passer au nord de la Seine. « Le paradoxe, c’est que les régions du monde qui vont voir leurs ressources en eau augmenter sont pour beaucoup celles qui en ont déjà en abondance, et que les régions où la diminution sera la plus forte sont celles où il existe déjà de forts besoins, notamment pour le secteur agricole », poursuit Bertrand Decharme. Ce n’est pas le seul : car même les régions où les précipitations devraient augmenter en moyenne annuelle doivent se préparer à faire face à une irrégularité de la ressource, du fait d’une plus grande amplitude saisonnière, avec des hivers plus arrosés et des sécheresses plus sévères l’été.
Conséquence de ces bouleversements : « les instances internationales, et notamment celles chargées de la sécurité et de la défense, estiment que l’eau va devenir la première source de conflits sur la planète », explique la juriste Nathalie Hervé-Fournereau, spécialiste en droit de l’environnement à l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe3, à Rennes. Et ce, d’autant que 40 % des ressources en eau sont transfrontalières, qu’il s’agisse des nappes phréatiques comme la nappe alluviale du Rhin, plus grande nappe phréatique d’Europe à cheval entre la France et l’Allemagne, ou des 250 bassins hydrographiques partagés par plusieurs pays : Rhône, Rhin, Danube, Nil, Mékong, etc. Entre l’Espagne et le Portugal, c’est aujourd’hui autour du Tage que le torchon brûle, les associations écologistes portugaises accusant les Espagnols de trop puiser dans le fleuve coulant de l’Espagne vers le Portugal pour l’irrigation de la vaste zone agricole située tout au sud de l’Andalousie. « Ils remettent en cause la convention d’Albufeira, signée il y a 25 ans entre les deux pays et qui à l’époque prévoyait un transfert des eaux du fleuve vers le sud de l’Espagne », raconte Nathalie Hervé-Fournereau.
En Espagne, l'eau du Tage a été en partie détournée pour irriguer les cultures en Andalousie, tout au sud du pays.
JOSE JORDAN / AFP
Partager
Vol d’icebergs
Les fleuves sont loin d’être le seul sujet de frictions. Plus proches des pôles, c’est la propriété des icebergs qui est source de débats. Ainsi, des tensions entre le Canada et le Groenland (région autonome du Danemark) sont apparues autour des blocs d’eau gelée qui se détachent de la calotte glaciaire groenlandaise et dérivent jusque dans les eaux canadiennes. « Le Canada a autorisé l’exploitation de ces icebergs pour fabriquer de l’eau douce, notamment, mais le Groenland a contesté cette utilisation au motif que c’est une ressource naturelle lui appartenant », détaille la juriste. À l’autre bout du globe, c’est la ville du Cap, en Afrique du Sud, qui envisageait très sérieusement en 2018 de remorquer jusqu’à la côte un petit iceberg détaché de la calotte glaciaire antarctique pour fournir en eau potable sa population.
Un sommet exceptionnel sur l’eau organisé par l’ONU en mars 2023 a pris acte des tensions croissantes et appelé les États à davantage de coopération sur la question.
« Il y a un vrai flou juridique autour de la qualification de ces plateformes glaciaires, commente Nathalie Hervé-Fournereau. De quoi parle-t-on exactement ? Car ces objets bougent, circulent… Une chose est sûre : avec 100 000 icebergs qui fondent en mer chaque année, selon le décompte de l’Organisation des Nations unies (ONU), la question de leur statut va continuer de se poser – même si le coût de leur remorquage et de leur exploitation reste à ce jour prohibitif et limite de facto les initiatives. »
L’ensemencement des nuages, destiné à les faire éclater au-dessus des zones agricoles qui le nécessitent, est une autre source de tension potentielle. Et ce, alors que les projets de géo-ingénierie se multiplient en Amérique, au Moyen-Orient ou encore en Chine, où la centaine de programmes actuellement en développement ne laisse pas d’inquiéter les voisins du géant asiatique. « En France, l’ensemencement avec des particules d’iodure d’argent est utilisé dans une vingtaine de départements pour neutraliser les nuages de grêle », précise la juriste. Si l’efficacité de la technique imaginée dès les années 1960 reste à évaluer scientifiquement, elle pose d’ores et déjà la question : À qui appartiennent les nuages ?
SADIQ ASYRAF / AFP
Partager
Problème : à ce jour, aucune organisation internationale n’est en charge de réguler la question de l’eau, pas plus que de l’environnement. Un sommet exceptionnel sur l’eau organisé par l’ONU en mars 2023 a pris acte des tensions croissantes et appelé les États à davantage de coopération sur la question… « Mais sur la question de l’eau, les États sont jaloux de leurs prérogatives et peu enclins à revenir sur leur souveraineté », souligne la juriste.
Mais le sujet de l’eau dépasse de loin le cadre des relations internationales. À l’échelle plus locale, la raréfaction de la ressource, ou à tout le moins son irrégularité dans le temps et dans l’espace, embrase le débat public et soulève la question de son partage. Ainsi, les tensions nées autour des projets de mégabassines dans l’ouest de la France – des bassines alimentées par le pompage dans les nappes phréatiques durant la période hivernale, afin d’irriguer les cultures durant la période estivale – posent avec une acuité nouvelle la question des usages dans l’Hexagone.
Quantité et qualité en baisse
« Pendant des décennies, en France comme dans de nombreux pays développés, on a pensé que la ressource en eau était inépuisable. On a puisé dedans sans se poser de questions », raconte Gilles Pinay, écologue et biogéochimiste au laboratoire Environnement, ville et société4, à Lyon. Des interventions majeures sur le cycle de l’eau ont été opérées, à tous les niveaux. « Nos sociétés ont bouleversé le cycle de l’eau sans attendre le changement climatique et sont devenues extrêmement dépendantes de cette ressource en eau, confirme Florence Habets, hydroclimatologue au Laboratoire de géologie de l’École normale supérieure5, à Paris. Pour répondre aux besoins croissants des secteurs industriel et agricole, notamment, on a détourné des masses d’eau considérables, via la construction de barrages, de dérivations en tout genre… Au point qu’aujourd’hui, la moitié des débits des fleuves de la planète sont dérivés et en partie consommés par les humains, et que les volumes d’eau stockés sont quatre fois plus importants que la quantité de neige qui tombe chaque année. »
Nos sociétés ont bouleversé le cycle de l’eau sans attendre le changement climatique et sont devenues extrêmement dépendantes de cette ressource.
Des actions bien souvent irréversibles, comme les modifications opérées dès les années 1950-1960 sur le cours de la Durance, l’un des affluents du Rhône. Des barrages comme celui de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), la construction d’innombrables canaux d’irrigation et la déviation de la Durance vers l’étang de Berre, en toute fin de course, ont bouleversé le fonctionnement de ce cours d’eau qui, désormais, ne vient quasiment plus grossir le débit du Rhône. « La Durance est une rivière dont la particularité aujourd’hui est que son débit diminue de l’amont vers l’aval – normalement, c’est l’inverse qui se produit ! », commente Florence Habets.
La Durance n’est pas un cas isolé. En plus des interventions sur les fleuves – barrages, réservoirs en tout genre destinés à sécuriser la filière hydronucléaire de la France… –, de nombreuses rivières ont été « rectifiées » pour accompagner la modernisation du secteur agricole. « Avec l’intensification de l’agriculture, on a agrandi les parcelles, ce qui a impliqué de modifier le trajet des rivières, décrit Florence Habets. Dans les zones humides de l’ouest de la France, les champs ont été drainés afin que les tracteurs puissent passer et que les plantes ne soient pas saturées en eau, au moyen de tuyaux enterrés à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Pour évacuer toute cette eau, les rivières ont été approfondies, ce qui a eu pour dommage collatéral de faire diminuer le niveau des nappes phréatiques… »
Construit sur la Durance, le barrage de Serre-Ponçon, dans le sud-est de la France, fait partie des nombreux aménagements qui ont totalement modifié le fonctionnement de ce cours d'eau qui, désormais, ne vient quasiment plus grossir le débit du Rhône.
Thibaut Durand / Hans Lucas via AFP
Partager
« Nos sociétés n’ont pas arrêté d’accélérer la circulation de l’eau et de l’évacuer, l’évacuer…, constate la scientifique. Et aujourd’hui, ce que l’on a fait se révèle extrêmement néfaste pour notre adaptation au changement climatique. » Sans compter la dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines, qui a notamment pour effet d’entraîner la fermeture à ce jour d’environ 25 % des points de captage d’eau potable depuis 1980 dans l’Hexagone, réduisant un peu plus la quantité d’eau réellement disponible.
Débat sur les usages
Conséquence : le débat sur les usages – qui, de l’industrie, de l’agriculture ou de la production d’eau potable, a les besoins les plus légitimes –, commence à virer à l’orage. « Les grandes masses d’eau prélevées en France sont connues dans les grandes lignes. Il est globalement admis que 32 milliards de mètres cubes sont prélevés annuellement dans les eaux de surface et souterraines, avance Stéphane Ghiotti. Sur ce total, les prélèvements industriels représenteraient 8 %, les usages agricoles 9 %, l’alimentation des voies de navigation 16 %, la production d’eau potable 17 % et le refroidissement des centrales nucléaires et thermiques 50 %. » Mais ces chiffres n’ont de valeur qu’indicative, selon le géographe, tant il est difficile d’estimer les quantités réelles d’eau ponctionnées – ainsi, une grande partie des prélèvements pour l’irrigation agricole sont individuels, c’est-à-dire sans contrôle ou basés sur la seule déclaration. De plus, ils ne donnent qu’une vision incomplète des usages.
Quand on voit les niveaux des nappes phréatiques baisser et de plus en plus de cours d’eau asséchés l’été, il est clair que nos pratiques ont un impact et qu’il faut les revoir.
Car la réalité, lorsqu’il s’agit de l’eau, s’avère d’une redoutable complexité. Ainsi, les prélèvements ne sont pas tous de même nature : la plupart de l’eau utilisée par le secteur industriel (pour refroidir, nettoyer, etc.) finit par revenir dans le cycle local de l’eau, de même que l’eau potable qui, une fois utilisée, est traitée et rejetée dans les cours d’eau… sans préjuger de sa qualité. Tandis que l’eau prélevée par le secteur agricole pour irriguer est consommée en quasi-totalité par la plante ou évaporée et ne revient pas dans les sols, les nappes ou les cours d’eau.
Résultat : « Si l’on regarde uniquement les volumes d’eau consommés, c’est-à-dire l’eau qui ne retourne pas dans les écosystèmes, les proportions changent, précise Stéphane Ghiotti. Sur les 4,1 milliards de mètres cubes consommés en France annuellement, 57 % sont en effet de l’eau agricole, utilisée pour l’irrigation – une pratique en plein essor depuis les années 1980 et l’expansion de la culture du maïs sur le territoire français, sur des sols et/ou dans des régions pas toujours adaptés à cette plante. Le reste se partage entre l’eau potable (26 %), le refroidissement des centrales nucléaires (12 %) et l’industrie (5 %). »
L’eau prélevée par le secteur agricole pour irriguer est consommée en quasi-totalité par la plante ou évaporée et ne revient pas dans les sols, les nappes ou les cours d’eau.
Laurent GRANDGUILLOT/REA
Partager
Raisonner sur des bilans globaux et entrer dans une bataille d’interprétation des chiffres trouve rapidement ses limites, pour l’écologue Gilles Pinay. D’autant que les contextes sont extrêmement variables d’une région de France à l’autre. Une chose est sûre : « Quand on voit les niveaux des nappes phréatiques baisser et de plus en plus de cours d’eau asséchés l’été, il est clair que nos pratiques ont un impact et qu’il faut les revoir », assène le scientifique. Les revoir, mais comment ? Et en priorisant quels usages ? En d’autres termes : à qui appartient l’eau, dans notre pays ?
Partager l'eau
« En France, le principe, c’est que l’eau est la chose commune. Une chose qui n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous. Cette approche patrimoniale, inscrite dans le Code civil, empêche l’appropriation de la ressource, précise Nathalie Hervé-Fournereau. Seules exceptions : l’eau de pluie et les sources situées sur des propriétés privées. » Depuis la loi sur l’eau de 1964, l’eau est gérée à l’échelle des grands bassins hydrographiques – Adour-Garonne, Seine-Normandie, Rhin-Meuse… – par des établissements publics (les agences de l’eau) réunissant l’ensemble des acteurs : élus locaux, industriels, agriculteurs, associations d’usagers. « Ces agences que d’aucuns à une époque ont appelé les “parlements de l’eau” sont censées assurer un partage équitable de la ressource en eau et hiérarchiser ses usages », explique la juriste.
Dans le cas des mégabassines en projet en Poitou-Charentes, dont le financement est assuré à 80 % par de l’argent public, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a d’ailleurs demandé un moratoire sur l’édification de ces ouvrages destinés à l’usage d’un petit nombre d’agriculteurs – un avis à l’époque outrepassé par les préfets des départements concernés, dont certaines des autorisations font aujourd’hui l’objet de recours devant la justice administrative française6.
Les solutions techniques évoquées pour pallier la raréfaction de la ressource, telles que les bassines ou l’emploi controversé des eaux usées pour l’irrigation, ne peuvent être que des solutions ponctuelles et ne nous dispenseront pas d’un nécessaire débat démocratique.
Les instances européennes se retrouvent aussi régulièrement sollicitées sur la question de l’eau. « De nombreuses associations environnementales portent les litiges devant les institutions européennes en s’appuyant sur les directives comme la directive-cadre sur l’eau (DCE), un cadre juridique majeur mis en place au niveau européen au début des années 2000 pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau », précise Nathalie Hervé-Fournereau. C’est le cas de l’association Eaux et rivières de Bretagne, en lutte contre les pollutions diffuses issues du secteur agro-alimentaire, nitrates en tête. « La question de l’eau est d’ordre politique et social, et doit être démocratiquement envisagée, considère Stéphane Ghiotti. Les solutions techniques évoquées pour pallier la raréfaction de la ressource, telles que les bassines mais aussi le dessalement de l’eau de mer ou l’emploi controversé des eaux usées pour l’irrigation7, ne peuvent être que des solutions ponctuelles et ne nous dispenseront pas d’un nécessaire débat démocratique. »
Des manifestants protestent contre la construction de la première mégabassine française à Mauzé-sur-le-Mignon, dans le Marais poitevin, en 2022.
PHILIPPE LOPEZ / AFP
Partager
Au-delà des seuls usages humains, la raréfaction de la ressource en eau demande à réfléchir d’urgence au partage équitable de celle-ci avec les non-humains. « Les écosystèmes dépendent directement de l’eau des sols, des nappes et des rivières, rappelle Nathalie Hervé-Fournereau. Il est intéressant de noter que ce sont d’ailleurs leurs besoins que la directive-cadre sur l’eau cite en priorité, avant l’eau potable ou les besoins agricoles. » La juriste invite à s’inspirer des exemples internationaux pour faire évoluer le droit à l’eau « vers un cadre moins anthropocentré et individualiste » : en Amérique latine et en Nouvelle-Zélande, certains fleuves se sont vu attribuer une personnalité juridique, tandis qu’en Espagne, avec la Loi Mar Menor de 2022, c’est désormais une lagune d’eau salée qui bénéficie de cette protection. L’eau, un bien commun aux humains comme aux non-humains. ♦
A lire sur notre site
« Les mégabassines ne résoudront pas la crise de l’eau » (point de vue par Vincent Bretagnolle, écologue)
L'hydraulique, une histoire vieille de 9000 ans (entretien avec Louise Purdue, géoarchéologue)
Notes
* 1.
Unité CNRS/Cirad/Université Paul Valery Montpellier/Université Perpignan Via Domitia.
* 2.
Unité CNRS/Météo-France.
* 3.
Unité CNRS/Université de Rennes.
* 4.
Unité CNRS/École nationale des travaux publics d’État/ENS Lyon/Ensa Lyon/Université Jean Monnet/Université Lumière/Université Jean Moulin.
* 5.
5. Unité CNRS/ENS-PSL.
* 6.
Le tribunal administratif de Poitiers a annulé mardi 3 octobre 2023 deux projets de mégabassines représentant quinze ouvrages au total. Des projets « surdimensionnés », qui ne tiennent « pas compte des effets prévisibles du changement climatique », selon la juridiction.
* 7.
Parmi les réserves à l’égard de l’utilisation des eaux « grises » pour l’irrigation, leur forte concentration en polluants. Bien que traitées, les eaux usées comportent encore de nombreuses substances chimiques telles que les médicaments et d’autres molécules de synthèse. Des polluants qui jusqu’à présent se diluaient dans les rivières où ils étaient rejetés.
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
L'usine du futur |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 12/11/2023 |
|
|
|
| |

L'usine du futur
Publié le 25 septembre 2015
Transformation digitale, usine 4 .0, usine du futur, quatrième révolution industrielle… les appellations sont nombreuses pour désigner la modernisation des systèmes de production des entreprises introduite par les nouvelles technologies. Robotique, réalité virtuelle ou augmentée, réseaux de capteurs et logiciels, traitement des données, contrôle non destructif… les technologies du numérique permettent à l’industrie de se réinventer pour gagner en agilité, en flexibilité, mais aussi de répondre aux nouvelles exigences en matière de responsabilité environnementale et sociétale.
« MANUFACTURING AVANCÉ » ET NOUVEAUX SYSTÈMES DE PRODUCTION
La compétitivité économique réside dans cette capacité des entreprises à maîtriser l’industrialisation et augmenter la performance de leur système de production. Cette évolution met en jeu de nombreuses activités technologiques, utilisant l’information, l’automatisation, le calcul, les logiciels, les capteurs et la mise en réseau. Ce périmètre technologique assez large est connu depuis quelques années sous le nom de « manufacturing avancé » (ou advanced manufacturing). Pour concevoir les usines de demain, le manufacturing avancé repose sur des technologies à la fois innovantes, efficientes et surtout numériques, telles que la simulation, la modélisation, ou encore la virtualisation.
Les systèmes industriels actuels doivent résoudre des environnements complexes, et ainsi permettre la fabrication de produits répondant à de multiples contraintes : besoins des utilisateurs (innovation et personnalisation), réglementations, concurrence mondiale, etc. Il est donc impératif d’optimiser les coûts de conception et de production avec un délai maîtrisé tout en introduisant des innovations de rupture et de qualité.
Cette transformation industrielle se traduit par :
* un déploiement majeur des technologies numériques issues de différents domaines, depuis l'Internet jusqu’aux systèmes embarqués en passant par les jeux ou « serious game » ;
* l’évolution des modèles d’organisation du travail et le rapprochement des métiers et des acteurs ;
* une capacité d’adaptation des machines au besoin de production, en intégrant bien entendu l’Homme à ces systèmes ;
* une vision du cycle de production dans son ensemble incluant la maintenance prédictive, la gestion des risques, le recyclage et la gestion des ressources ;
* une assistance aux actions et interventions de l’Homme dans le système, que ce soit dans les phases amont de conception du produit et formation des acteurs (avec la virtualisation et l’immersion) mais aussi dans la production, avec un suivi et un guidage des actions orchestrées au plus juste, et enfin l’intégration de la connaissance et du retour d’expérience dans le système de production ;
* une évolution des technologies de la robotique, vers la cobotique, plus agile.
DES TECHNOLOGIES INDISPENSABLES
À L’USINE DU FUTUR
Intégrer des robots collaboratifs dans l’usine
Dans l’industrie, les modes de production évoluent progressivement pour augmenter la productivité et la qualité tout en diminuant la pénibilité du travail, et en prenant en compte l’interaction entre l’Homme et la machine. La cobotique répond à ces nouveaux enjeux en proposant des outils robotiques collaboratifs, véritables assistants pour l’Homme. Le cobot augmente la capacité à effectuer des tâches pénibles tout en s’adaptant rapidement aux diverses configurations industrielles. Personnaliser des produits, ou créer des lignes de production pour des petites séries devient possible, notamment par l’apprentissage in situ du robot.
« Booster » le poste de travail
grâce au numérique
Le recours croissant au numérique est devenu incontournable pour optimiser l’outil de production, dès sa conception, mais aussi simuler la réalisation de tâches ou superviser le fonctionnement des robots. La réalité virtuelle et la réalité augmentée contribuent ainsi de façon croissante à la formation industrielle et à l’apprentissage de certaines techniques de maintenance.
Maintenir l’outil industriel
et prévenir les risques
par le contrôle non destructif
Déjà utilisé dans l’industrie de l’aéronautique, du transport et de l’énergie, pour le contrôle de constituants importants (structures, pièces moteurs, trains d'atterrissage, réacteurs, turbines), le contrôle qualité devient un contrôle global du produit et du processus de production pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Le contrôle non destructif (CND) est l’une des composantes essentielles de l’usine de demain.
De nouvelles méthodes et techniques d’inspection indispensables aux activités de CND se développent pour mettre en évidence l’état de santé des composants des produits, pièces mécaniques ou matériaux et structures utilisés dans les usines, sans altérer les caractéristiques de ces composants ni perturber l’exploitation. Ultrasons et ondes guidées, méthodes électromagnétiques, radiographie et tomographie X constituent les techniques qui pourront apporter innovation et qualité au secteur du CND dans les usines de demain.
Concevoir les logiciels du futur
et des réseaux interconnectés
Autre domaine de la construction de l’usine du futur, les logiciels et réseaux interconnectés. Les chercheurs mettent au point des algorithmes et des outils logiciels pour traiter et analyser une grande variété de données issues d’appareils de mesure (biologie, industrie agroalimentaire, contrôle de procédé…), de réseaux de capteurs (bâtiments, équipements industriels, véhicules…), voire des réseaux sociaux. La gestion de ces données constitue un véritable enjeu notamment pour la compréhension de son écosystème, la réalisation de choix stratégiques en marketing, de la conception de nouveaux produits à la vente, jusqu’à la détection de défauts de produits ou services. Les industriels doivent donc acquérir de nouvelles technologies d’analyse leur permettant une meilleure gestion, connectée et intelligente, des données de l’entreprise.
Par ailleurs, ces données sont difficiles à interpréter car souvent très volumineuses, ou hétérogènes, avec des liens complexes. Aujourd’hui les chercheurs développent des solutions pour rendre ces données exploitables par des outils automatiques d’aide à la décision tels que l’analyse de résultats, des recommandations ou des prescriptions.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une voix pour la vie ? |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 28/05/2023 |
|
|
|
| |
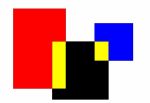
Une voix pour la vie ?
La hauteur de notre voix est déterminée avant que nous parlions
Le pleur d’un bébé n’informe pas seulement sur son état de santé, d’insatisfaction ou de douleur. Selon une équipe scientifique internationale impliquant Florence Levréro (UJM) et Nicolas Mathevon (UJM et Institut universitaire de France), membres de l’Equipe de Neuro-Ethologie Sensorielle (ENES) à l’Institut des neurosciences Paris Saclay (CNRS/Université Paris-Sud), la tonalité du pleur d’un bébé âgé de 3 mois donne une idée fiable de la hauteur de sa voix à 5 ans. Ce résultat, publié dans la revue internationale Biology Letters, souligne l’importance des premiers stades de la vie sur le développement de l’individu.
La hauteur - le fait d’être grave ou aigüe - est un paramètre
acoustique de la voix humaine qui varie entre les individus et les
sexes après la puberté. Elle porte des informations importantes ayant
des conséquences sur nos relations sociales. On sait par ailleurs que
la vie fœtale dans l’utérus impacte le développement de l’enfant et
sa vie d’adulte. En comparant le pleur de bébés enregistrés quelques
mois après la naissance avec leur voix à l’âge de cinq ans, les
scientifiques ont découvert que la hauteur du pleur était corrélée à
la hauteur de la voix - un bébé pleurant dans les graves aura plus de
chance de développer une voix grave qu’un bébé pleurant dans les
aigus, quel que soit son sexe. Leurs travaux soulignent également un probable lien entre l’environnement hormonal qu’a connu l’enfant dans le ventre de sa mère et la hauteur de sa voix.
Les chercheurs et chercheuses ont d’abord enregistré des bébés de 3 mois pleurant au moment du bain. Cinq années plus tard, elles et ils ont à nouveau enregistré leurs voix - les enfants devaient alors s’exprimer librement devant des images. En comparant les caractéristiques acoustiques des pleurs et des paroles, les scientifiques ont constaté que la hauteur des voix était prédite par celle des pleurs enregistrés quelques années auparavant. En mesurant un indice reposant sur la taille relative des doigts de la main et connu pour être lié à l’environnement hormonal du fœtus, elles et ils ont par ailleurs découvert que les différences de hauteur de voix entre les humains trouvent pour partie leur origine dans la vie prénatale. Ces résultats sont renforcés par une autre étude des mêmes scientifiques montrant que la hauteur de la voix à l’âge de sept ans prédit avec succès celle de la voix adulte.
Pour percer tous les mystères de notre voix, il faudra poursuivre les recherches car il est difficile d’enregistrer les mêmes enfants à plusieurs années d’intervalles. Ici, seuls 15 enfants ont pu être suivis, tous de nationalité française, alors que l’acoustique des pleurs et des voix est influencée par le contexte culturel.
Référence : Levréro F, Mathevon N, Pisanski K, Gustafsson E, Reby D, 2018. The pitch of babies’ cries predicts their voice pitch at age five. Biology Letters 14: 20180065.http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2018.0065, publié le 10/07/2018.
Voir aussi cette étude : Fouquet M, Pisanski K, Mathevon N, Reby D, 2016. Seven and up: Individual differences in male voice fundamental frequency emerge before puberty and remain stable throughout adulthood. R Soc Open Sci 3, 160395.
CONTACT CHERCHEUR
Nicolas MATHEVON - Université Jean Monnet Saint-Etienne
Equipe de Neuro-Ethologie Sensorielle (ENES)
Institut des Neurosciences Paris Saclay (CNRS/Université Paris-Sud) mathevon@univ-st-etienne.fr
CONTACT PRESSE
Sonia CABRITA - Service communication, Université Jean Monnet 04 77 42 17 75 - 07 87 69 29 29
sonia.cabrita@univ-st-etienne.fr
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Rapport du GIEC : un cri d'alarme sur l'état des océans |
|
|
 |
|
Auteur : sylvain Date : 18/12/2022 |
|
|
|
| |

MERS ET OCÉANS
Rapport du GIEC : un cri d'alarme sur l'état des océans
Par Sylvie Rouat le 25.09.2019 à 15h46
Lecture 5 min.
Les experts du GIEC viennent de remettre leur premier rapport sur l'état des océans. Le constat est alarmant : réchauffement accéléré, fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, effondrement de la biodiversité... Ce sont à terme les sociétés humaines qui vont en souffrir.
Les environnements naturels de beaucoup d'espèces sont profondément touchés par les changements climatiques.
AFP/ARCHIVES - JONATHAN NACKSTRAND
Notre planète est couverte à plus de 70% par les océans. Pourtant, les experts du climat ne s’étaient pas encore penchés à leur chevet. Jusqu’à ce 25 septembre où a été rendu public, à Monaco, le premier "rapport spécial sur l'océan et la cryosphère dans un contexte de changement climatique". Il s’agissait d’évaluer les impacts des changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre non seulement sur les océans, mais aussi sur les écosystèmes côtiers et ceux qui dépendent des environnements gelés du système terrestre, aux pôles et en montagne. Car, rappelle le rapport en préambule, "tous les habitants de la Terre dépendent directement ou indirectement de l'océan et de la cryosphère", cette dernière représentant environ 10% de la surface terrestre.
Océans et cryosphère (glaciers, banquises...) sont en effet totalement interconnectés avec les autres composants du système climatique par le biais d’un échange global d’eau, d’énergie et de carbone. Les océans produisent de surcroît 50% de notre oxygène, tout en absorbant plus de 25% du CO2 émis chaque année par les activités humaines. Leur rôle est donc crucial dans la régulation du climat. Aujourd'hui, environ 680 millions de personnes vivent en zone côtière –elles seront plus d’un milliard d’ici 2050–, 65 millions sur des îles susceptibles d’être submergées par la montée des eaux et plus de 3 milliards dépendent des ressources alimentaires marines. Auxquels il faut ajouter les quelque 670 millions de personnes qui peuplent des régions de montagne sur tous les continents. Or ces milieux, constatent les scientifiques, sont déjà gravement touchés par les changements climatiques.
Même l'océan profond se réchauffe
Le réchauffement, tout d’abord. Depuis les années 1970, les océans ont déjà absorbé plus de 90 % de l’excès de chaleur produit par les activités humaines. Depuis 1993, le taux de réchauffement des océans a plus que doublé. Entre 2013 et 2015, le Pacifique Nord-Ouest a ainsi vu sa température augmenter de plus de 6°C… D’ici 2100, ils devraient en capter de 5 à 7 fois plus encore ! Cela donne lieu à un nouveau phénomène de vagues de chaleur océaniques, dont la fréquence a doublé depuis 1982. L’impact de ces phénomènes sur la biodiversité marine est encore mal connu. L'océan profond au-dessous de 2000 m s'est lui-même réchauffé depuis 1992, en particulier dans l'océan Austral.
Du côté de la cryosphère, le réchauffement atmosphérique a eu pour effet la fonte accélérée des glaciers, banquises, calottes polaires et pergélisols. Entre 2006 et 2015, la calotte glaciaire du Groenland a perdu quelque 278 gigatonnes de glace chaque année, la calotte glaciaire antarctique 155 gigatonnes en moyenne par an et les glaciers du monde entier en ont perdu 220 gigatonnes par an. Même constat dramatique en Arctique, où l'étendue de la couverture neigeuse en juin a diminué d'environ 2,5 millions de km2 entre 1967 et 2018. Quant au pergélisol arctique et boréal, qui stocke de 1460 à 1600 Gt de carbone organique, il commencerait déjà à relarguer du méthane et du CO2 dans l’atmosphère.
Conséquence de cette fonte accélérée : le niveau des mers monte plus vite que prévu. Si l’augmentation a été de 3,6 mm par an au cours de la dernière décennie, elle pourrait être de 1,5 cm par an d’ici à la fin du siècle, entraînant une hausse globale du niveau de la mer de 1,10 mètre à la fin du siècle. Cet apport d’eaux douces aux hautes latitudes contribue à la stratification des milieux marins en fonction de la densité, notamment dans les 200 mètres de surface de l'océan, empêchant le mélange entre les eaux de surface et les eaux plus profondes. La fonte des glaces et l’augmentation des températures ont également un impact sur les courants marins, provoquant notamment le ralentissement du courant Nord Atlantique, ce qui diminue la productivité marine, provoque des tempêtes hivernales en Europe et réduit les précipitations au Sahel et en Asie du sud.
Acidification accrue des eaux de surface
L’océan a absorbé entre 20 et 30% des émissions anthropiques totales de CO2 depuis les années 1980 provoquant une acidification accrue de 95% eaux de surface, un phénomène irréversible, même si nous arrêtions dès aujourd’hui d’émettre du CO2. Et de surcroît, il perd de l’oxygène dans certaines zones entre la surface et 1000m de profondeur. Dans ces régions, nombre d’espèces ne peuvent survivre. La désoxygénation pourrait mener à une perte de 15% de la biomasse globale des animaux marins d’ici 2100. Depuis 1950, de nombreuses espèces marines ont déjà subi des changements dans leur répartition géographique et leurs activités saisonnières en réponse au réchauffement des océans, à la disparition de la glace de mer ou à la perte de leurs habitats.
La modification des interactions entre les espèces a entraîné des effets en cascade sur les écosystèmes, par ailleurs malmenés par la surpêche et les rejets de l’agriculture. Par ailleurs, des écosystèmes terrestres et d'eau douce ont également été bouleversés par les changements hydrologiques de la cryosphère. La haute montagne et les régions polaires ont ainsi vu apparaître des portions de terres précédemment recouvertes de glace, ce qui a contribué à modifier les activités saisonnières, l’abondance et la répartition des espèces végétales et animales. Au final, ce sont les sociétés humaines –souvent les plus fragiles– qui vont en pâtir, que ce soit pour l’approvisionnement en eau et en nourriture. Le recul des glaciers et les changements de la couverture de neige ont notamment contribué à la baisse des rendements agricoles dans certaines régions de haute montagne, que ce soit dans l'Hindu Kush (Himalaya) ou dans les Andes tropicales.
Ce rapport du GIEC égrène donc des constats scientifiques plus sombres les uns que les autres, dont certains sont désormais irréversibles. Pour Dan Laffoley, responsable des aires marines au sein de la Commission mondiale des aires protégées, "nous avons largement dépassé le temps des simples avertissements : nous devons aujourd’hui faire preuve d’un égoïsme éclairé et prendre les mesures qui s’imposent pour la protection de l’Océan et du climat afin qu’à leur tour, ils protègent et soutiennent l’humanité".
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
