|
| |
|
|
 |
|
Effets du lithium sur le cerveau dans le traitement du trouble bipolaire : vers la confirmation dâun mécanisme dâaction |
|
|
| |
|
| |

Effets du lithium sur le cerveau dans le traitement du trouble bipolaire : vers la confirmation d’un mécanisme d’action
08 AVR 2019 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Communication neuronale©Inserm/Delapierre, Patrick
Une collaboration entre le CEA, l’INSERM, l’Institut Pasteur, la Fondation FondaMental, les Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor AP-HP et le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, apporte un nouvel éclairage sur l’action du lithium dans le traitement des troubles bipolaires. La modélisation de la diffusion de l’eau (NODDI[1]), mesurée par IRM, a permis d’analyser la microstructure cérébrale de patients souffrant de troubles bipolaires. Les résultats indiquent une densité dendritique augmentée dans le des patients traités par lithium. Ils étayent l’hypothèse selon laquelle une amélioration de la plasticité du cerveau et de la communication entre neurones dans cette région du cerveau aurait des effets bénéfiques du lithium dans le traitement des troubles bipolaires. Ces résultats sont publiés dans le journal « Psychotherapy and Psychosomatics » le 5 avril 2019.
Les résultats de cette étude permettent de confirmer que la prise régulière de lithium est associée à une plasticité bénéfique de la matière grise, mais est surtout la première à permettre d’en préciser l’origine à l’échelle microscopique grâce à la simulation numérique. Ces premiers résultats, qui nécessitent d’être reproduits, suggèrent qu’une amélioration de la communication entre neurones dans cette région pourrait étayer l’hypothèse selon laquelle le lithium aurait des effets bénéfiques dans le traitement des troubles bipolaires. Au-delà, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives très intéressantes pour d’autres pathologies neurologiques ou psychiatriques.
Augmentation de la densité des dendrites.
Les données d’imagerie par résonance magnétique de diffusion (voir encadré) acquises chez 41 participants souffrant de troubles bipolaires et suivis au sein du service de psychiatrie de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP et du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, dont l’expertise clinique est appuyée par celle des centres experts des Troubles Bipolaires de la fondation FondaMental, ont été comparées aux mêmes données recueillies chez 40 volontaires sains issus des deux centres.
Les résultats de l’étude montrent que les patients traités par lithium ont une densité des dendrites plus importante dans la région frontale en comparaison aux patients ne prenant pas de lithium. Les dendrites sont des prolongements des corps cellulaires des neurones recevant l’information transmise par leurs voisins. Le niveau de densité dendritique semble être identique chez les sujets sains et chez les patients traités par lithium alors que le niveau de densité dendritique dans cette région frontale reste inférieur chez les patients non traités par lithium.
Le lithium est un traitement utilisé depuis près d’un siècle chez les patients souffrant de trouble bipolaire et reconnu comme le meilleur stabilisateur de l’humeur. Bien que son efficacité ne soit plus à prouver, les mécanismes biologiques de son action thérapeutique sur le cerveau restent encore mal connus, supposés multiples, et semblent notamment agir sur le tissu en lui-même en entraînant une préservation, voire une augmentation du volume de la matière grise. Jusqu’à présent, il n’était pas possible de qualifier ou quantifier quels changements s’opéraient à l’échelle microscopique.
Repère
Le trouble bipolaire est un trouble psychiatrique qui touche 1 % de la population mondiale, soit près de 80 millions de personnes dans le monde et 700 000 en France.
Apport de l’IRM de diffusion et de la modélisation
L’émergence de nouvelles techniques d’imagerie par résonance magnétique capables de rendre compte de l’organisation du tissu cérébral à l’échelle microscopique (aussi appelée microstructure) permet aujourd’hui de cartographier directement le cerveau à l’échelle microscopique. Cette nouvelle approche repose sur l’observation par IRM du déplacement des molécules d’eau dans le cerveau (communément appelé processus de diffusion), déplacement largement perturbé par la présence des cellules au sein du tissu cérébral. Ces perturbations du mouvement de l’eau induisent à leur tour une modification du signal IRM qui est propre à l’organisation cellulaire sous-jacente. Grâce à un modèle mathématique nommé NODDI, il est devenu possible d’analyser les données d’IRM de diffusion acquises chez les patients adultes et de déterminer les propriétés microscopiques du tissu. Cette nouvelle méthode, disponible sur la plateforme d’imagerie par résonance magnétique du centre NeuroSpin, a ainsi permis de caractériser les propriétés microscopiques de la substance grise de patients souffrant d’un trouble bipolaire et de les comparer à ceux de sujets sains.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lire les sons du langage : une aire du cerveau spécialisée dans la reconnaissance des graphèmes |
|
|
| |
|
| |

Lire les sons du langage : une aire du cerveau spécialisée dans la reconnaissance des graphèmes
08 OCT 2019 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Activation du cortex visuel, auditif et somatosensoriel. ©Inserm/CRICM – Plateau MEG/EEG – Inserm U975
Une étude conduite par une équipe de Sorbonne Université et du département de neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, dirigée par le Pr Laurent Cohen à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Sorbonne Université / CNRS / Inserm) a permis d’analyser les mécanismes de la lecture à l’œuvre chez les adultes. Les chercheurs ont identifié une région cérébrale du cortex visuel qui serait responsable de la reconnaissance des graphèmes, c’est-à-dire des lettres ou groupes de lettres transcrivant un son élémentaire de la langue parlée (phonèmes). Les résultats de cette étude et la métholodogie utilisée ont été publiés dans la revue PNAS.
Hormis les idéogrammes chinois, la quasi-totalité des systèmes de lecture ont pour principe d’écrire les sons composant les mots sous leur forme parlée. Comment fait-on donc en français pour écrire un son, par exemple le son « o » ? La réponse qui vient immédiatement à l’esprit est que ce sont les lettres qui jouent ce rôle. Ce n’est en réalité pas vraiment le cas. Prenons l’exemple du mot « chapeau », formé de quatre sons (ch + a + p + o), mais de sept lettres. En moyenne, les sons ne sont donc pas définis par une lettre, mais par plusieurs. Les linguistes utilisent le terme de graphème pour désigner l’écriture d’un son. Dans le mot « chapeau », il y a quatre sons correspondant à quatre graphèmes qui sont CH, A, P, et EAU. On constate donc que le système alphabétique repose entièrement sur ces graphèmes.
Dans une étude réalisée à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Sorbonne Université / Inserm / CNRS) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, Florence Bouhali, doctorante dans l’équipe « PICNIC – Neuropsychologie et neuroimagerie fonctionnelle », a identifié une petite région du cortex précisément responsable de la reconnaissance des graphèmes et dont le rôle dans la lecture semble a priori essentiel (figure).
Cette région est située au sein d’une vaste étendue de cortex responsable de la reconnaissance des objets en général et qui occupe le dessous de toute la partie arrière du cerveau. Elle abrite de petites zones spécialisées, mobilisées notamment dans la reconnaissance des visages ou des lieux, mais aussi des graphèmes. La région « des graphèmes » se situe dans l’hémisphère gauche, où se trouve en général tout le système du langage. Cela permet, une fois les graphèmes reconnus, d’envoyer l’information rapidement aux régions du langage, qui vont les transformer en sons (figure).
Comment les chercheurs ont-ils procédé ?
Pendant que les participants inclus dans l’étude étaient allongés dans un appareil d’IRM, des mots défilant les uns après les autres sur un écran leur étaient présentés. Ces mots étaient écrits de façon bicolore afin de mettre en valeur le découpage en graphèmes (CHAMPIGNON) ou au contraire, de le perturber (CHAMPIGNON). La région « des graphèmes » identifiée s’activait alors de façon différente selon les frontières de graphèmes définies par les couleurs.
Si l’expérience menée paraît simple, elle était en réalité plus complexe. En effet, l’importance des graphèmes n’est pas la même selon le genre de lecture : ils sont indispensables quand il s’agit de lire à haute voix un mot jamais vu (par exemple CHANDISSON), mais moins importants lorsque les participants devaient juste reconnaître en silence un mot familier (par exemple, CHAPEAU). Les chercheurs ont donc demandé aux participants tantôt de lire à haute voix, tantôt de simplement reconnaître en silence de vrais mots, mais aussi des mots inventés. La région identifiée répondait différemment à la manipulation des graphèmes selon le type de lecture.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le comportement suicidaire des plus de 65 ans est associé à lâatrophie dâune petite zone cérébrale |
|
|
| |
|
| |

Le comportement suicidaire des plus de 65 ans est associé à l’atrophie d’une petite zone cérébrale
03 MAI 2011 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) |
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
La modification d’une zone cérébrale serait elle à l’origine de comportements suicidaires ? Pour la première fois, une étude de l’unité mixte de recherche (Inserm / Université Montpellier 1) « Neuropsychiatrie : recherche épidémiologique et clinique », coordonnée par Sylvaine Artero, chargée de recherche à l’Inserm, établit un lien entre l’atrophie d’une petite zone cérébrale qui relie les deux hémisphères cérébraux, et les comportements suicidaires. Les mesures cérébrales obtenues grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), chez 3 groupes de sujets âgés de 65 ans et plus, ont révélé que cette zone était significativement plus petite chez les personnes ayant déjà fait au moins une tentative de suicide. Pour autant, à ce stade, les chercheurs ne peuvent affirmer qu’il s’agit d’un lien de cause à effet. Les résultats de cette étude sont disponibles sur le site internet de la revue Biological psychiatry, à partir du 2 mai 2011.
Depuis quelques années, les chercheurs en psychiatrie s’attachent à mettre en évidence des anomalies cérébrales (structurales ou fonctionnelles) associées à une vulnérabilité aux comportements suicidaires et cela indépendamment des autres troubles psychiatriques co-existants. Le corps calleux (CC), la principale commissure reliant les hémisphères cérébraux, est constitué de nombreuses fibres nerveuses et a un rôle pivot dans l’intégration des informations et leur traitement. Cette zone a fait l’objet de plusieurs études montrant des liens entre des anomalies structurales du CC et des pathologies neuropsychiatriques (maladies neurodégénératives, autisme, schizophrénie, troubles bipolaires…) sans que le lien de cause à effet ne soit démontré.
Sylvaine Artero, chargée de recherche Inserm en collaboration avec l’équipe du Pr Philippe Courtet et des chercheurs australiens, viennent de mettre en évidence pour la première fois un lien entre une atrophie de la partie postérieure du corps calleux (CC) et les comportements suicidaires.
Pour parvenir à ce résultat, l’équipe a comparé les mesures du CC de 435 sujets âgés de 65 ans et plus issus de la cohorte ESPRIT (recrutés de 1999 à 2001).
Les chercheurs ont répartis les personnes en trois groupes suivant leur profil :
* les sujets ayant déjà fait au moins une tentative de suicide (21 personnes)
* les sujets dépressifs mais n’ayant jamais fait de tentative de suicide (180 personnes)
* les sujets ni dépressifs, ni suicidants2 (234 personnes).
Ils ont démontré, grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), que la partie postérieure du CC était significativement plus petite chez les suicidants (219,5 mm2) par rapport aux témoins sains (249,5 mm2) mais aussi aux témoins dépressifs (245,5 mm2). Cette étude démontre l’existence d’anomalies structurales du corps calleux associées aux comportements suicidaires chez des sujets âgés, concluent les chercheurs. Cependant, les auteurs de l’étude mettent en garde quant à la signification de cette association : « La relation de cause à effet entre une atrophie du CC et la survenue de comportements suicidaires reste encore à être confirmée par la mise en évidence des mécanismes cellulaires impliqués dans cette relation » précise Sylvaine Artero.
En
s’appuyant sur de précédentes études, les chercheurs émettent l’hypothèse d’un rôle possible du CC dans les mécanismes fonctionnels entrainant des conduites suicidaires. « L’atrophie du corps calleux pourrait contribuer à une connectivité inter-hémisphérique anormale et conduire à des dysfonctionnements des régions cérébrales impliquées dans les mécanismes des troubles de l’humeur incluant des anomalies cognitives comme des déficits dans la résolution de problèmes » suggère Sylvaine Artero.
L’équipe envisage de généraliser ce premier résultat, notamment par l’étude de la taille du CC de sujets plus jeunes. Pour les chercheurs, la confirmation de cette observation structurale dans d’autres populations désignerait le CC comme un des biomarqueurs potentiels de la vulnérabilité aux conduites suicidaires et ouvrirait la voie à de nouvelles études qui porteraient sur les mécanismes physiopathologiques.
Notes
(1) Pour toute demande de reproduction, contacter Elsevier
(2) Suicidants: Personnes ayant déjà fait une tentative de suicide
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
La suggestion hypnotique éclairée par les neurosciences |
|
|
| |
|
| |
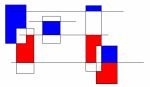
La suggestion hypnotique éclairée par les neurosciences
18 MAR 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Dans les murs de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP où Charcot a exploré l’hypnose à la fin du XIXe siècle, une équipe de recherche associant des chercheurs et chercheuses de Sorbonne Université, de l’AP-HP, du CNRS et de l’Inserm1, et dirigée par le professeur Lionel Naccache, vient de rapporter une observation originale qui éclaire les mécanismes cérébraux et psychologiques de la suggestion hypnotique. Ce travail de recherche vient d’être publié dans la revue Frontiers in Neuroscience.
La suggestion hypnotique permet d’induire volontairement chez un individu des états mentaux conscients très variés, et elle peut être utilisée à la fois dans le cadre de la recherche sur la biologie de la conscience, et dans un cadre thérapeutique où elle peut, par exemple, diminuer l’expérience douloureuse associée à une intervention chirurgicale chez un sujet éveillé conscient.
Dans ce travail dont le premier auteur est l’étudiant en thèse de neurosciences et chercheur à l’Inserm Esteban Munoz-Musat, les auteurs ont induit une surdité transitoire chez une femme en bonne santé, tout en disséquant les étapes cérébrales de sa perception auditive à l’aide de la technique de l’électroencéphalographie (EEG) à haute densité qui permet de suivre la dynamique du fonctionnement cérébral à l’échelle fine du millième de seconde.
Les chercheurs ont enregistré l’activité cérébrale de la volontaire en situation normale et en situation de surdité hypnotique.
Ils avaient formulé les trois prédictions suivantes qui dérivent des mécanismes cérébraux connus de la perception auditive (voir encadré) et de la théorie de l’espace de travail neuronal global conscient élaborée depuis 2001 par Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux et Lionel Naccache:
1 – Les premières étapes corticales de la perception d’un stimulus auditif devraient être préservées durant la surdité hypnotique ;
2 – La surdité hypnotique devrait être associée à une disparition totale de la P300 qui signe l’entrée de l’information auditive dans l’espace neuronal global conscient ;
3 – Ce blocage devrait être associé à un mécanisme inhibiteur déclenché volontairement par l’individu qui accepte de suivre la consigne d’induction hypnotique.
De manière remarquable, les analyses détaillées et approfondies de l’activité cérébrale de cette volontaire ont permis de confirmer ces trois prédictions, et ont également mis en lumière l’implication probable d’une région du lobe frontal connue pour son rôle inhibiteur : le cortex cingulaire antérieur.
L’équipe de recherche a ensuite pu proposer un scénario cérébral précis du phénomène d’induction hypnotique qui affecte spécifiquement les étapes de la prise de conscience tout en préservant les premières étapes inconscientes de la perception.
Ce travail original apporte une preuve de concept importante et va être prolongé sur un groupe plus important d’individus.
Outre leur importance pour les théories biologiques de la conscience et de la subjectivité, ces résultats ouvrent également des perspectives thérapeutiques non seulement dans le champ de l’hypnose médicale, mais également dans le champ voisin des troubles neurologiques fonctionnels qui sont très fréquents (près de 20 % des urgences neurologiques), et dans lesquels les patients souffrent de symptômes invalidants.
Ces symptômes sont souvent sensibles à l’induction hypnotique, et semblent partager avec l’hypnose plusieurs facteurs clés.
Résumé de la physiologie de la perception auditive
La signification et la portée de ces résultats nécessite le rappel suivant : la perception auditive d’un stimulus extérieur débute dans l’oreille interne où les variations de pression de l’air induites par ce son sont converties en impulsions électriques, puis se poursuit dans les différents relais neuronaux des voies auditives avant de gagner le cortex auditif vers 15 millièmes de seconde. A partir de cette entrée en scène du cortex, la perception auditive enchaîne trois étapes sérielles principales que l’on peut identifier à l’aide des outils de neuro-imagerie fonctionnelle tel que l’EEG.
Premièrement, les régions auditives dites primaires construisent activement une carte mentale des caractéristiques acoustiques du son perçu. Cette première étape est identifiable notamment par une onde cérébrale (l’onde P1 qui survient moins de 100 millièmes de seconde après le son). Puis des régions auditives primaires et secondaires qui calculent en temps réel les régularités statistiques de la scène auditive à l’échelle de la seconde écoulée, – et qui anticipent donc quels devraient être les sons suivants -, détectent à quel point ce stimulus transgresse leurs prédictions.
Cette deuxième étape est identifiable par une onde cérébrale découverte vers la fin des années 1970 : la MMN (MisMatch Negativity) ou négativité de discordance (vers 120 et 200 millièmes de seconde). Enfin, vers 250-300 millièmes de secondes après le son, la représentation neuronale du stimulus auditif gagne un vaste réseau cérébral qui s’étend entre les régions antérieures (préfrontales) et postérieures (pariétales) du cerveau.
Cette troisième étape est identifiable par l’onde P300. Fait crucial, alors que les deux premières étapes corticales de la perception auditives opèrent de manière inconsciente, la P300 est la signature de la prise de conscience subjective de ce son qui devient alors rapportable à soi-même : « J’entends le son X ».
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
