|
| |
|
|
 |
|
EMPIRE INCA |
|
|
| |
|
| |

Empire inca
Cet article fait partie du dossier consacré aux grandes découvertes.
Empire de l'Amérique précolombienne, qui s'étendait depuis le sud de la Colombie jusqu'au río Maule au Chili, et à l'est jusqu'à la forêt amazonienne.
HISTOIRE
INTRODUCTION
Les Incas considéraient Ayar Manco, ou Manco Cápac, comme le premier des douze ou treize souverains de leur dynastie ; il aurait régné vers le xiie s. De ce règne jusqu’à celui d’Atahualpa, vaincu en 1532 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, l’Empire inca étendit son pouvoir sur une vaste région de l'Amérique andine. L'une des grandes singularités de cet Empire, né dans la région de Cuzco, dans le Sud du Pérou, fut d'avoir intégré, dans une organisation étatique originale, la multiplicité socioculturelle des populations hétérogènes qui le composaient. Constitué en un peu moins d'un siècle, cet Empire – le Tahuantinsuyu, ou empire des Quatre Quartiers – s'étendait au moment de son apogée, à la fin du xve s., sur un territoire de 950 000 km2. Cuzco était son centre symbolique.
Les Incas n'étaient à l'origine qu'une des nombreuses tribus qui peuplaient le Pérou. Vers l'an 1000 après J.-C., après la chute des empires de Huari et de Tiahuanaco, ces tribus se regroupèrent en confédérations, parfois structurées en royaumes, et se développèrent comme autant de petites puissances régionales, qui s'affrontaient dans des guerres locales et entretenaient un état de conflit quasi permanent dans les Andes centrales. Les Incas s'associèrent à trois peuples voisins pour former la confédération de Cuzco, dont ils prirent le contrôle pour devenir l'une des principales puissances du sud du Pérou.
UN PEUPLE CONQUÉRANT
MYTHES ET LÉGENDES
L'époque qui précède l'expansion de l'Empire est relatée dans les mythes d'origine, qui content la pérégrination des quatre frères Ayar, depuis la « grotte du devenir », Pacari-tampu (Paqarina), jusqu'à Cuzco. Issus du Soleil, Inti, qui va occuper une place prépondérante dans la religion officielle du futur Empire, les quatre frères, chacun à la tête de son clan, se seraient dirigés dans la vallée de Cuzco, fondant un village à chacune de leurs haltes jusqu'au jour où Ayar Manco, après s'être débarrassé de ses frères, resta seul chef de la migration. Au terme de ce voyage, il s'établit dans la vallée de Cuzco, où il fonda l'État inca, dont il devint le premier souverain sous le nom de Manco Cápac. Après lui se succédèrent sept Incas également légendaires – Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yáhuar Huácac et Viracocha – dont les premiers se contentèrent, pour affirmer leur domination, du pillage résultant d'escarmouches avec les peuples voisins; aucun d'entre eux ne paraît avoir été animé de l'esprit de conquête qui se manifesta, au xive s., sous le règne du septième Inca, Yáhuar Huácac : à cette époque, les Incas imposèrent par les armes leur pouvoir à tous les autres peuples de la vallée de Cuzco.
Cette situation se trouva encore renforcée dès l'accession au pouvoir, au début du xve s., de Viracocha, successeur de Yáhuar Huácac, et dernier des souverains légendaires. Toutefois, sur ses vieux jours, Viracocha ne parvint pas à contenir l'expansion d'un autre peuple de la Cordillère centrale du Pérou, les Chancas ; en 1438, ces derniers, après avoir établi leur domination sur les Quechuas, groupe établi entre les territoires chanca et inca, tentèrent d'envahir la région de Cuzco. Devant cette menace, Viracocha dut abandonner Cuzco et s'enfuir avec son fils Urco.
EXTENSION DE L’EMPIRE
Mais un autre de ses fils, Cusi Yupanqui, rassembla les troupes incas et parvint à défaire les envahisseurs sous les murs mêmes de la capitale. Cusi Yupanqui s'empara alors du pouvoir, se fit proclamer Inca sous le nom de Pachacútec (« le Réformateur du monde »), envahit le territoire des Chancas avec l'aide de son fils, Túpac Yupanqui, puis, après avoir écrasé les Collas du bassin du Titicaca, transforma l'État inca en l'une des plus grandes puissances andines. Dès lors, de 1438 à 1471, l'Empire n'allait cesser de s'étendre en développant une politique souvent présentée comme l'accomplissement du destin civilisateur des Incas. Certaines conquêtes furent effectuées au prix de guerres sanglantes, d'autres se firent par des alliances obtenues sous la menace ou par la séduction. Les chefs des autres peuples préféraient entrer de leur plein gré dans l'Empire avant d'être vaincus, capturés, tués ou dépossédés du pouvoir par les troupes incas, réputées quasi invincibles.
Vers 1471, après avoir organisé l'État, bâti sa capitale et mené de grandes guerres, Pachacútec céda le pouvoir à son fils Túpac Yupanqui. Le nouvel Inca demeura fidèle à la volonté d'expansion qui avait caractérisé le règne de son père. Au nord, il soumit les Cañars pour étendre sa domination sur la presque totalité de l'actuel Équateur ; le royaume des Chimus tomba entre ses mains et, avec lui, toute la côte jusqu'à Lima ; au sud, malgré la vaillante résistance des guerriers Araucans, Túpac Yupanqui recula les frontières de l'Empire jusqu'au río Maule, en plein territoire chilien.
CHUTE DE L’EMPIRE
Huayna Cápac, qui lui succéda en 1493, ne fit que consolider ce vaste empire en réprimant les révoltes qui éclatèrent çà et là. Il mourut en 1527, l'année même où Francisco Pizarro, débarquant pour la première fois à Tumbes, découvrait le royaume des Incas. À sa troisième expédition, quatre ans après, Pizarro trouva le Pérou en proie à une grave crise intérieure : à la mort de Huayna Cápac, une lutte de succession s'était ouverte entre deux de ses fils, Huáscar et Atahualpa. Ce dernier, après avoir vaincu les troupes de Huáscar, venait de prendre le pouvoir. Le 15 novembre 1532, Pizarro et la poignée d'hommes qu'il avait sous ses ordres parvenaient sans encombre à Cajamarca ; dès le lendemain, ils préparèrent la capture d'Atahualpa. L'Inca fut pris dans un guet-apens et fait prisonnier. La défaite de ses armées, sa mise à mort moins d'un an plus tard, le 29 août 1533, en dépit du versement d'une immense rançon, marquèrent l'écroulement définitif de l'Empire inca. Le Pérou devint la vice-royauté de Nouvelle-Castille, et Lima la nouvelle capitale en 1535. Malgré plusieurs tentatives désespérées pour secouer la domination espagnole, la puissance inca ne se relèvera plus : en 1572, le vice-roi, Francisco de Toledo, ordonna la capture et l'exécution de Túpac Amaru, fils du dernier souverain inca.
UNE SOCIÉTÉ RIGIDE SOUMISE À L’INCA
L’ÉLITE
Au sommet de la pyramide sociopolitique se trouvait le souverain, le Sapa Inca, c'est-à-dire « seul Inca », le fils du Soleil, qui régnait en maître absolu : le pouvoir était centralisé et d'origine divine. Toute une élite dirigeante, formée principalement des lignages des souverains antérieurs, les panaqas impériaux, gravitait autour de l'empereur. Cette noblesse de naissance occupait les plus hautes fonctions administratives, militaires et religieuses. Toutefois, le pouvoir n'était pas réservé à ces seuls dignitaires. En effet, les chefs locaux (curacas) continuaient d'exercer leur autorité, tant qu'ils restaient fidèles au souverain et se soumettaient à la tutelle impériale ; ils n'étaient destitués que s'ils étaient défaits militairement ou s'ils résistaient à la conquête inca.
LE PEUPLE
Tous les sujets adultes valides étaient tenus de fournir à l'État des prestations de travail. Ainsi, divers travaux agricoles, domestiques ou artisanaux, comme le tissage, étaient accomplis au bénéfice de l'État, qui ne percevait, en revanche, ni impôts ni tributs sous forme de biens. Elles formaient l'essentiel des sujets, les hatun-runas, qui continuaient d'appartenir à leurs groupes ethniques et culturels selon des liens et des rapports sociaux bien établis. Ces classes comprenaient les paysans, les agriculteurs et les pasteurs de la côte et des montagnes. Le long de la côte, il existait d'autres classes, notamment celle des artisans, celle des pêcheurs et celle des marins.
LES DÉCLASSÉS
Les yanas faisaient partie d'une caste servile et n'avaient pas une situation déterminée dans la tradition andine : en perdant leur statut d'appartenance à leur groupe d'origine, même si leurs occupations n'étaient ni serviles ni subalternes (ils étaient au service de la noblesse), ils se retrouvaient en marge de l'Empire. Malgré tout, l'empereur les autorisait à conserver quelques biens. Les pinas, qui ne figurent pas dans l'organisation hiérarchique officielle de la société inca, se trouvent au bas de l'échelle sociale : ce sont les prisonniers de guerre, aux fonctions et au statut imprécis.
LA PLACE DES FEMMES
Il existait aussi des catégories strictement féminines, qui correspondaient aux mamaconas et aux aqllas, souvent appelées « femmes choisies ». Les femmes de la noblesse étaient désignées pour diverses fonctions du culte, les femmes d'une beauté exceptionnelle étaient choisies pour devenir les épouses secondaires de l'Inca ou des principaux chefs militaires, alors que les autres étaient offertes comme épouses par le souverain à des chefs de rang inférieur. Enfin, certaines femmes remplissaient le rôle de servantes pour la cour impériale, les hauts dignitaires, le clergé et le culte.
LES « AYLLU », PIÈCE MAÎTRESSE DE L’ORGANISATION SOCIALE
La domination inca s'appuyait sur la division de l'empire en petites communautés, les ayllu, composées d'un groupe de familles qui se réclamaient d'un ancêtre commun. Les membres des différentes familles d'un ayllu se mariaient généralement entre eux. Ces unions perpétuaient moins un clan qu'un vaste lignage patrilinéaire, dont la cohérence était encore assurée par la possession commune de terres cultivables. S'opposant à l'aspect égalitaire et démocratique de ces communautés, les curacas, établis dans leur fonction par l'Inca, exerçaient en son nom, au sein des ayllu, une autorité qui s'étendait parfois sur plusieurs d'entre elles. La prospérité des ayllu tenait à une intense activité dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. Les travaux agricoles étaient favorisés par une grande variété de microclimats répartis entre les vallées ensoleillées de la côte et les terrasses construites en altitude à flanc de montagnes. Ils se développèrent sur des terres rendues fertiles grâce à un apport massif de guano depuis les côtes et grâce à l'aménagement d'un immense réseau de canaux d'irrigation.
L'extension de l'aire agricole dans un pays comme le Pérou impliqua, de la part des Incas, d'énormes travaux. Or, on sait qu'ils ignoraient aussi bien la roue que l'outillage de fer. On s'interroge sur la disproportion entre le nombre considérable de larges routes, solidement empierrées, et leur utilisation, le lama étant l'unique bête de somme. Si la pomme de terre était la nourriture indigène de base, le maïs constituait l'aliment noble par excellence. Le riz des montagnes (la quinoa), très résistant aux gelées, nourrissait également une grande partie de la population qui, au niveau des terres chaudes, trouvait sa subsistance dans le manioc, les haricots, les fèves, les patates douces, les courges, les tomates et les piments. Sur les hauts plateaux, où l'agriculture se révélait très difficile, les habitants menaient une existence exclusivement pastorale, élevant des troupeaux de lamas et d'alpacas pour la viande et la laine.
UNE ÉCONOMIE CONTRÔLÉE PAR L’INCA
L'Inca faisait exercer un contrôle rigoureux sur l'élevage et les produits de la terre ; ceux-ci étaient distribués après le prélèvement des parts qui revenaient au souverain, aux seigneurs, au dieu-Soleil et aux greniers de l'État, ou tampu, qui constituaient à la fois les stocks d'une intendance militaire et des réserves en cas de famine.
L'Inca imposait également sa loi sur le commerce, qui restait toutefois peu développé. L'or et l'argent ne possédaient de valeur qu'en tant que matériaux réservés à la fabrication des ornements et des objets rituels. Dès qu'il s'agissait de compter, les Incas, qui ignoraient l'écriture et la monnaie, utilisaient le quipu, sorte de cordelette à nœuds dont l'usage était basé sur la numérotation décimale. Le quipu servait en outre à une certaine catégorie de fonctionnaires, les quipu kamayoc, chargés par les gouverneurs de recenser la population.
L'artisanat ne jouait pas un grand rôle dans la vie économique. Les artisans représentaient toutefois un groupe social mieux considéré que les agriculteurs, voués au despotisme de la caste dirigeante.
UNE RELIGION OMNIPRÉSENTE
INTI
La religion tenait une place prépondérante dans la culture. Le Soleil, Inti, apparaît comme la divinité tutélaire ; le culte qui lui était voué le distinguait des autres puissances divines traditionnellement vénérées dans les Andes en ce qu'il était étendu à tout l'Empire. Pachacámac était l'un des principaux lieux de cérémonie de la côte centrale du Pérou, où des monuments étaient érigés à la gloire du dieu-Soleil. Sa représentation, le punchao, consistait en une statue en or de forme humaine, surmontée d'un disque en or, et conservée à Cuzco dans le Coricancha, le célèbre temple du Soleil, qu'aucun autre édifice religieux inca ne surpassa en force majestueuse. Une importante fête, l'Inti Raymi, fixée au solstice de juin, était dédiée au dieu et constituait l'une des principales dates du calendrier inca.
Le culte rendu à l'Inti, dieu du Soleil et fondateur de la dynastie, tendit bientôt à se confondre avec celui de l'Inca lui-même. La construction de temples ériges en l'honneur d'Inti revêtait un caractère politique en même temps que religieux. Par-delà les pratiques naturistes, fétichistes, animistes des peuples sous domination inca, elle permettait de renforcer l'unité du royaume. Les divinités des peuples soumis, loin d'être en butte à l'hostilité des Incas, ont été intégrées là leur panthéon.
VIRACOCHA
Au sein de la hiérarchie cléricale, le prestige qui s'attachait aux prêtres du culte de l'Inti était inégalable. L'influence croissante de ces religieux sur les affaires de l'État n'est peut-être pas étrangère à la décision de l'inca Pachacutec d'instaurer, parallèlement au culte du Soleil, un autre culte, celui de Viracocha (le Créateur) ; la divinité solaire se trouveant reléguée au rang de simple créature engendrée par l'Être suprême. Les origines de ce « nouveau » dieu se confondent avec les très nombreux mythes amérindiens d'une divinité supérieure (« l'Ancien », le « Vieux du ciel », etc.), génératrice du monde où elle instaure le premier ordre civilisateur.
Viracocha créa d'abord le ciel, et la terre peuplée d'une humanité qui vivait dans les ténèbres. Pour l'expiation d'une faute mystérieuse, il métamorphosa les premiers hommes en statues de pierre. Dans une seconde manifestation, le dieu, sorti du lac Titicaca, inventa le Soleil, la Lumière, la Lune et les Étoiles, sculpta dans le roc les ancêtres du genre humain, assignant à chacun une portion de territoire où il devait se rendre. Son œuvre achevée, l'Être suprême, ayant jeté son manteau à la surface de la mer, s'éloigna en direction du soleil couchant. Les plus graves défectuosités de la nature s'expliquent par la présence d'un personnage maléfique aux côtés du dieu : Taguapica, fils méchant et perpétuel contradicteur de son père, s'est appliqué à détériorer le monde au fur et à mesure que Viracocha le créait.
L'Être suprême relevait d'une théologie qui concernait avant tout le clergé, les seigneurs et l'entourage immédiat de l'inca. Par ailleurs, un culte particulier était rendu à la Lune (Killa), considérée comme sœur et épouse du Soleil, et à des constellations comme les Pléiades, et des phénomènes tels que le tonnerre, l'éclair (Illapa), ou la foudre étaient également des divinités honorées.
UN PEUPLE D’UNE GRANDE PIÉTÉ
La Terre, Pacha Mama, participait du monde religieux, comme en témoignent les libations et les offrandes à la terre nourricière. Dans de nombreux sites incas, il reste encore les circuits de distribution de l'eau taillés dans la roche, dont la complexité montre le degré d'évolution de la société inca. Enfin, il existait une vénération particulière pour les éléments naturels, étranges ou remarquables. Des rochers ou des grottes, considérés comme sacrés et désignés sous le terme général de huacas, faisaient l'objet d'un culte religieux, de même que certaines montagnes, les apus. De nos jours, ces croyances traditionnelles, mêlées à la religion chrétienne, sont encore vivaces chez les populations andines.
La piété du peuple inca s'exerçait surtout envers une foule d'objets ou de lieux (les huacacs) qui pouvaient devenir sacrés dès qu'un lien apparaissait entre eux et le chef suprême de l'empire (le fait par exemple, que telle maison ait abrité plusieurs jours la personne de l'inca). Les conopas, fétiches individuels de petite taille, se voyaient attribuer un pouvoir protecteur.
Dans le déroulement de la vie quotidienne inca, une grande place était réservée aux fêtes religieuses. Les plus importantes célébraient le retour d'un événement capital : solstice, moisson, récolte, etc. Quelques-unes, dont celle qui accompagnait l'intronisation d'un nouvel inca, impliquaient des sacrifices humains. S'ils ne revêtaient pas l'ampleur atroce des sacrifices aztèques, ils n'en consistaient pas moins à immoler des enfants en bas âge et des jeunes filles. On prélevait un certain nombre d'entre elles parmi les aclla-cuna (femmes choisies), autrement dit les « Vierges du soleil », qui, enlevées dès l'enfance à leur famille, vivaient enfermées dans des couvents ; le plus célèbre, celui de Cuzco, abritait près de quinze cents femmes. Là, sous l'autorité des plus anciennes (les mama-aclla), celles qui ne devenaient pas les concubines de l'inca étaient occupées au tissage des vêtements de cérémonie ou au brassage d'une sorte de bière à base de maïs, la chicha.
Enfin, le pouvoir et la religion étaient étroitement liés. Si l'ethnie se rattachait au dieu-Soleil par son mythe d'origine, les derniers souverains incas finirent par être perçus comme son incarnation sur la Terre, associant ainsi la religion officielle au projet politique de l'Empire. Le respect des morts ainsi que les rites rendus aux souverains défunts étaient très importants. Les momies des empereurs étaient placées dans le Coricancha, auprès de l'image du Soleil. Le lignage de chaque souverain défunt était tenu d'assurer les rites, et, tous les ans en novembre, le jour d'ayarmaca, jour du culte des morts, les momies étaient sorties en procession sur des litières portées à bras dans les rues de la capitale.
Toutefois, les Incas surent ménager les croyances religieuses propres aux groupes culturels intégrés à l'Empire. Ils laissèrent ainsi largement survivre des religions et des cultes aux côtés de la religion officielle impériale.
L'ART INCA
UNE ARCHITECTURE EXCEPTIONNELLE
L'expansion de l'Empire (vers 1438) coïncide avec un remarquable essor de l'architecture. Les vestiges les plus remarquables de la maçonnerie inca proprement dite se trouvent à Cuzco. Les constructions édifiées en pierres colossales – elles présentent des analogies avec l'architecture mycénienne – comptent au nombre des plus remarquables réalisations des Incas. Presque dépourvue d'armements, composée d'appareils divers, comportant des murs généralement inclinés vers l'intérieur, cette architecture est à l'image de ce peuple vigoureux et discipliné. La sobriété des constructions et des édifices s'allie à la virtuosité technique de la taille de la pierre et de la mise en place de blocs, le plus souvent polygonaux, parfaitement ajustés les uns aux autres.
La forteresse de Sacsahuaman constitue le plus bel exemple de la maîtrise des bâtisseurs incas. Un nombre considérable de blocs « cyclopéens », pesant plusieurs tonnes chacun, a été utilisé pour la construction de sa triple enceinte. L'ensemble, où voisinent plusieurs styles, comportait non seulement des tours, mais aussi, à l'intérieur de la forteresse, un temple du Soleil, une résidence pour l'inca entourée de maisons formant une véritable petite ville. Des gradins sont aménagés dans le centre cérémoniel, où prennent place le monarque et sa cour lors de fastueuses cérémonies, véritables feux d'artifices d'or, d'argent, de costumes aux couleurs vives et de plumages éclatants ravis aux oiseaux peuplant les abords de la forêt amazonienne.
Les bâtiments de Cuzco, aussi bien que ceux des cités construites sur les hauts plateaux comme Machu Picchu (découverte en 1912) ou Ollantaytambo, possèdent des portes et des fenêtres dont la forme trapézoïdale est très caractéristique. Tous ces sites impériaux qui servaient, par leur ampleur et leur solidité, la puissance et la stabilité du pouvoir, furent construits par une main-d'œuvre spécialisée aidée par d'innombrables ouvriers temporaires.
UNE LITTÉRATURE ORALE
Le quechua, ou runa-simi, était la langue la plus courante dans l'Empire et fut largement diffusée. Il y avait trois autres langues principales : le puquina, le yunga et l'aymara, sans compter un grand nombre de langues et de dialectes régionaux. Aucune de ces langues vernaculaires n'était écrite, mais des transcriptions postérieures à la conquête espagnole ont permis de recueillir en partie les littératures orales, riches de plusieurs modes d'expression artistique : des poèmes, des chants, des élégies, ainsi que des légendes et des mythes. La musique et la danse complétaient cet ensemble : elles accompagnaient les fêtes religieuses et officielles, les réjouissances populaires, de même que certains moments de la vie quotidienne.
LES ARTS DÉCORATIFS
Il règne une certaine sobriété sur les objets décoratifs incas. Fabriquée sans tour, leur céramique est ornée de motifs géométriques ; un aryballe à anse en étrier est l'une des formes typiques ainsi que le kero de bois, gobelet cylindrique ou légèrement évasé. Ils maîtrisaient parfaitement la métallurgie de l'or, de l'argent, du cuivre et de l'étain, avec lesquels ils réalisaient divers alliages. Mais il ne reste que peu de pièces d’orfèvrerie : les conquistadores pillèrent les trésors faits d'idoles, de bijoux, d'ornements et d'objets somptuaires, qu'ils fondirent pour récupérer les métaux précieux. Production quasi industrielle, le tissage est de belle qualité, mais sa décoration géométrique assez monotone. La sculpture sur pierre se caractérise surtout par de petits objets votifs, les conopas, représentant souvent des lamas et des alpagas. De grands récipients de pierre, qui servaient de bassins rituels, comportent aussi des animaux sculptés. Quelques représentations de serpents se trouvent sculptées, en léger relief, sur certains murs incas. De la sculpture en ronde bosse, exceptionnelle, il ne reste que de très rares effigies humaines, sans doute des empereurs, et quelques sculptures animales. La sculpture sur bois concerne surtout des objets cérémoniels : vases gravés ou peints (qeros), récipients spécifiques employés pour les libations (paqchas).
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
GUERRE FROIDE |
|
|
| |
|
| |

guerre froide
Cet article fait partie du dossier consacré à la guerre froide.
État de tension qui opposa, de 1945 à 1990, les États-Unis, l'URSS et leurs alliés respectifs qui formaient deux blocs dotés de moyens militaires considérables et défendant des systèmes idéologiques et économiques antinomiques.
DONNÉES GÉNÉRALES
Un monde bipolaire. La guerre froide présente deux caractéristiques principales. Premièrement, elle oppose deux très grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, dotées de vastes territoires et de moyens militaires considérables, affirmant des valeurs idéologiques incompatibles et fondées sur des systèmes économiques antinomiques.
Cette situation a pour conséquence un effet de bipolarisation dans la mesure où chacun des adversaires attire dans sa sphère d'influence les États moins puissants. Bien que ce phénomène affecte surtout l'Europe, enjeu principal, il se répercute également sur le processus de décolonisation puis sur les affrontements régionaux qui se développent dans le tiers-monde.
Un conflit indirect. Deuxièmement, dès 1949, ces deux puissances disposent de l'arme nucléaire, d'abord à fission (bombe A) puis à fusion (bombe H), et, dans les années suivantes, de vecteurs balistiques pouvant transporter cette arme sur des distances intercontinentales (environ 8 000 km).
Cette situation nouvelle, dans la mesure où elle crée pour chacun le risque de devoir subir des dommages intolérables, sans aucune commune mesure avec les capacités de destruction connues jusqu'alors, interdit que l'on recoure à la guerre directe pour dénouer la rivalité. En revanche, les manœuvres indirectes (guerres périphériques par alliés interposés), les affrontements économiques (usure du système adverse) et politico-idéologiques (guerre psychologique) prennent une importance accrue. On distingue trois périodes dans la guerre froide.
1. ENGAGEMENT ET FORMATION DES BLOCS (1945-1962)
1.1. LA RUPTURE DES ÉQUILIBRES TRADITIONNELS EN EUROPE
LA SUPRÉMATIE SOVIÉTIQUE EN EUROPE
La défaite de l'Allemagne au centre de l'Europe, l'effondrement de la France et l'affaiblissement du Royaume-Uni à son extrémité occidentale créent, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une rupture des équilibres traditionnels sur le continent. En dépit des immenses destructions qu'elle a subies, l'Union soviétique manifeste désormais une écrasante suprématie. Ayant gagné 600 000 km2 en Europe, elle dispose, à l'été de 1946, d'une armée de 100 divisions, soit 4 millions d'hommes, et de 6 000 avions, tandis que les Anglo-Saxons procèdent à la démobilisation rapide de leurs forces et à la reconversion des industries de guerre.
LA DOCTRINE AMÉRICAINE DE L'ENDIGUEMENT
En mars 1946, dans le discours de Fulton, dit « du rideau de fer », le « vieux lion » britannique Churchill met en garde contre le risque de domination communiste sur une Europe dont la division s'aggrave. On assiste, en effet, à une succession de crises d'intensité croissante (Iran, Turquie, Grèce) et à la mise en place de régimes procommunistes dans les pays d'Europe orientale occupés par l'Armée rouge. Ces faits conduisent le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, à réviser la traditionnelle politique isolationniste des États-Unis et à adopter une stratégie (doctrine Truman, mars 1947) à laquelle le diplomate George Kennan qui en est l'inspirateur donne le nom d'« endiguement » (containment).
Dans cette logique, en juin 1947, le général Marshall, secrétaire d'État américain, annonce un plan d'aide pour tous les pays européens qui en feront la demande, proposition que les régimes soumis à Moscou sont contraints de refuser.
1.2. FORMATION ET CONFRONTATION DES DEUX BLOCS (1947-1953)
POUSSÉE COMMUNISTE, INQUIÉTUDES À L'OUEST : LA FORMATION DES DEUX BLOCS (1947-1949)
La division du monde en deux blocs engagés dans une lutte sans merci est solennellement énoncée par le délégué soviétique Jdanov lors de la réunion de formation du Kominform (bureau d'information des partis communistes) à Szklarska Poręba en Pologne, le 22 septembre 1947.
Ce que l'on a appelé le « coup de Prague » de février-mars 1948 – le parti communiste s'empare du pouvoir faisant basculer le dernier régime démocratique d'Europe centrale, et la Constitution du 9 mai 1948 fait de la Tchécoslovaquie une démocratie populaire – suscite une très vive inquiétude chez les Européens de l'Ouest et conduit d'abord à la formation du pacte de Bruxelles (mars 1948) puis à l'engagement de pourparlers en vue d'une alliance défensive avec les États-Unis.
Le blocus de Berlin (juin 1948-mai 1949) aggrave la tension et favorise la conclusion rapide du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en avril 1949. La formation, la même année, de deux États allemands antagonistes achève d'entériner la division de l'Europe et l'impossibilité de donner à la guerre une conclusion juridique acceptable.
Enfin, la victoire des communistes chinois sous la direction de Mao Zedong, à l'automne de 1949, et l'attaque, en 1950, de la Corée du Sud par le leader communiste de la Corée du Nord, Kim Il-sung, confèrent au conflit sa dimension intercontinentale.
À LA RECHERCHE D'UNE DÉFENSE OCCIDENTALE COMMUNE (1950-1953)
La probabilité d'une agression en Europe paraît augmenter d'autant. La politique de défense des États-Unis prend sa forme définitive dans la directive de sécurité nationale de 1950 (NSC-68), élaborée par le haut fonctionnaire américain Paul H. Nitze, qui fixe comme objectif la dissuasion par l'acquisition de la supériorité à tous les niveaux.
Or, il apparaît à la conférence de Lisbonne, en 1952, que, en l'absence d'une armée allemande, l'OTAN n'est pas réellement en mesure de faire face à une attaque soviétique massive. Cela conduit les États-Unis à soutenir le projet français de Communauté européenne de défense (CED). Mais l'hostilité, en France même, à l'égard du réarmement allemand est telle que le plan ne verra jamais le jour. Il en résulte que les États-Unis prennent en 1953 la décision d'introduire sur le théâtre européen des armes nucléaires tactiques capables d'interdire les fortes concentrations de troupes nécessaires pour une attaque d'envergure.
1.3. L'ÉCHEC DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE (1953-1962)
La mort de Staline en 1953 n'apporte aucune accalmie dans la guerre froide. En dépit de l'évacuation de l'Autriche par l'URSS pour prix d'une avantageuse neutralité (1955), en dépit aussi des déclarations, en 1956, du dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev sur la coexistence pacifique, rien ne vient concrétiser une réelle détente.
« REPRÉSAILLES MASSIVES » ET PACTE DE VARSOVIE
En janvier 1954, le chef du département d'État, John Foster Dulles, énonce la doctrine dite « des représailles massives », qui prévoit l'engagement de toutes les forces nucléaires américaines en cas d'agression soviétique contre les États-Unis et leurs alliés.
En outre, la création d'une armée ouest-allemande (→ Bundeswehr) étroitement intégrée dans l'OTAN provoque la formation par les Soviétiques de l'Organisation du pacte de Varsovie en 1955. L'échec des deux conférences de désarmement de Genève en 1955 puis l'intervention soviétique à la fin de 1956 en Hongrie (→ insurrection de Budapest) accroît fortement l'anxiété des États-Unis, alors que l'URSS annonce bientôt, en 1957, la mise en orbite du premier satellite artificiel, Spoutnik.
Le territoire américain ayant cessé d'être totalement à l'abri d'une frappe nucléaire adverse, les États-Unis intensifient la production d'armements nucléaires et de vecteurs (fusées, sous-marins, bombardiers) capables de les emporter.
AU RISQUE DE LA CRISE
Dans ce contexte où chacun teste les capacités de l'autre, Berlin devient un point de crispation : Khrouchtchev réclame d’abord dans les six mois l’intégration de la ville à la RDA ou son érection en ville libre sous contrôle de l’ONU, puis, devant l’enlisement des négociations, fait élever le « mur de la honte » entre les deux parties de la ville en août 1961 (→ mur de Berlin), mais renonce de ce fait à son projet d’annexion ; enfin, le président John Fitzgerald Kennedy vient, en juin 1963, exprimer sa solidarité avec les Berlinois par son fameux discours : « Ich bin ein Berliner ! ».
Cette deuxième crise de Berlin (1958-1963) et la crise de Cuba (septembre 1962) se situent dans la perspective de cette compétition où il s'agit de pousser le plus loin possible ses pions jusqu'à rencontrer les limites que son adversaire a décidé de fixer, dans un mélange d'audace exploratoire et de prudence – en témoigne la correspondance entre Khrouchtchev et Fidel Castro de septembre 1962 (publiée en 1990).
2. STABILISATION ET CODIFICATION DE L'AFFRONTEMENT (1963-1978)
Tandis que la cohésion des blocs est elle-même partiellement remise en question (conflit sino-soviétique, sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN), cette deuxième période de la guerre froide se caractérise par la combinaison de deux types d'entreprises différentes qui s'affectent mutuellement. Au niveau central, une communication étroitement bilatérale s'instaure entre les deux Grands, tandis qu'à la périphérie se développe une compétition violente, bien qu'indirecte.
2.1. UNE PRUDENTE COOPÉRATION AU SOMMET
TÉLÉPHONE ROUGE ET DOCTRINE DE LA RIPOSTE GRADUÉE
La mise en place d'un « téléphone rouge » (liaison directe par télex) entre la Maison-Blanche et le Kremlin ne fait pas cesser la course aux armements (développement des Polaris américains et des missiles sol-sol soviétiques). Néanmoins, elle matérialise la volonté d'entretenir une communication non seulement en cas de crise, mais afin de prévenir une confrontation directe qui impliquerait un risque d'utilisation des armes nucléaires.
Le traité de limitation des essais nucléaires de 1963 puis celui relatif à la non-prolifération des armes nucléaires (1968) témoignent de l'existence d'un intérêt commun minimal, mais qui n'exclut nullement la compétition. Cette ambiguïté apparaît dans la nouvelle doctrine de l'OTAN, officiellement adoptée en 1968 et dite « de la riposte graduée » (flexible response) : il s'agit de maintenir l'incertitude quant au risque d'escalade d'une guerre conventionnelle qui éclaterait en Europe et évoluerait en une guerre nucléaire.
LES NÉGOCIATIONS AU SOMMET
Vienne, Helsinki, Stockholm deviennent à partir de 1965 des lieux de rencontres régulières où se préparent les sommets entre les deux Grands. Si certaines de ces négociations s'enlisent durablement, comme les MBFR (Mutual Balanced Forces Reduction), d'autres aboutissent. C'est le cas pour les SALT (Strategic Arms Limitation Talks), qui limitent les vecteurs balistiques porteurs d'armes nucléaires, et le traité ABM (Anti Ballistic Missiles), qui fixe à deux le nombre de sites défensifs sur le territoire de chacune des deux parties – accords imparfaits, partiels et temporaires qui visent à réguler le développement des armes plus qu'à les supprimer.
D'autres négociations visent à réduire les risques de conflit nucléaire, particulièrement sur le théâtre majeur de la confrontation, l'Europe (accord quadripartite sur Berlin de septembre 1971 et accord de juin 1973 sur la prévention de la guerre nucléaire). La Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), constitue, en août 1975, une sorte de point d'orgue de ces manœuvres, qui donnent le sentiment que l'on entérine un statu quo préférable à des remises en cause trop dangereuses.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
L'ÃCRITURE |
|
|
| |
|
| |
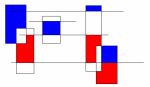
écriture
(latin scriptura)
Consulter aussi dans le dictionnaire : écriture
Cet article fait partie du dossier consacré à la Mésopotamie.
Système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre.
HISTOIRE
Toutes les civilisations qui ont donné naissance à une forme d'écriture ont forgé une version mythique de ses origines ; elles en ont attribué l'invention aux rois ou aux dieux. Mais les premières manifestations de chaque écriture témoignent d'une émergence lente et de longs tâtonnements. Dans ces documents, les hommes ont enregistré : des listes d'impôts et des recensements ; des traités et des lois, des correspondances entre souverains ou États ; des biographies de personnages importants ; des textes religieux et divinatoires. Ainsi l'écriture a-t-elle d'abord servi à noter les textes du pouvoir, économique, politique ou religieux. Par ailleurs, les premiers systèmes d'écriture étaient compliqués. Leur apprentissage était long et réservé à une élite sociale voulant naturellement défendre ce statut privilégié et qui ne pouvait guère être favorable à des simplifications tendant à faciliter l'accès à l'écriture, instrument de leur pouvoir.
À partir du IIIe millénaire avant J.-C., toutes les grandes cultures du Proche-Orient ont inventé ou emprunté un système d'écriture. Les systèmes les plus connus, et qui ont bénéficié de la plus grande extension dans le monde antique, demeurent ceux de l'écriture hiéroglyphique égyptienne et de l'écriture cunéiforme, propre à la Mésopotamie. L'écriture égyptienne est utilisée dans la vallée du Nil, jusqu'au Soudan, sur la côte cananéenne et dans le Sinaï. Mais, pendant près d'un millénaire, l'écriture cunéiforme est, avec la langue sémitique (l'assyro-babylonien) qu'elle sert à noter, le premier moyen de communication international de l'histoire. L'Élam (au sud-ouest de l'Iran), les mondes hittite (en Anatolie) et hourrite (en Syrie du Nord), le monde cananéen (en Phénicie et en Palestine) ont utilisé la langue et l'écriture mésopotamienne pour leurs échanges diplomatiques et commerciaux, mais aussi pour rédiger et diffuser leurs propres œuvres littéraires et religieuses. Pour leur correspondance diplomatique, les pharaons du Nouvel Empire avaient eux-mêmes des scribes experts dans la lecture des textes cunéiformes.
À la même époque, d'autres systèmes d'écriture sont apparus, mais leur extension est limitée : en Anatolie, le monde hittite utilise une écriture hiéroglyphique qui ne doit rien à l'Égypte. Dans le monde égéen, les scribes crétois inventent une écriture hiéroglyphique, puis linéaire, de 80 signes environ, reprise par les Mycéniens.
Au Ier millénaire, l'apparition de l'alphabet marque une histoire décisive dans l'histoire de l'écriture. Depuis des siècles, l'Égypte dispose, au sein de son écriture nationale, du moyen de noter les consonnes. Au xive siècle avant J.-C., les scribes d'Ougarit gravent sur des tablettes d'argile des signes cunéiformes simplifiés et peu nombreux, puisqu'ils ne sont que 30, correspondant à la notation de 27 consonnes et de 3 valeurs vocaliques. Mais les uns et les autres ne font pas école. Ce n'est qu'après le xie siècle que le système d'écriture alphabétique se généralise à partir de la côte phénicienne. Une révolution sociale accompagne cette innovation radicale : les scribes, longuement formés dans les écoles du palais et des temples, voient leur rôle et leur importance diminuer.
LE SYSTÈME CUNÉIFORME
Le premier système d'écriture connu apparaît dans la seconde moitié du IVe millénaire avant notre ère, en basse Mésopotamie, pour transcrire le sumérien. Dans l'ancienne Mésopotamie, les premiers signes d'écriture sont apparus pour répondre à des besoins très concrets : dénombrer des biens, distribuer des rations, etc. Comme tous les systèmes d'écriture, celui-ci apparaît donc d'abord sous forme de caractères pictographiques, dessins schématisés représentant un objet ou une action. Le génie de la civilisation sumérienne a été, en quelques siècles, de passer du simple pictogramme à la représentation d'une idée ou d'un son : le signe qui reproduit à l'origine l'apparence de la flèche (ti en sumérien) prend la valeur phonétique ti et la signification abstraite de « la vie », en même temps que sa graphie se stylise et, en s'amplifiant, ne garde plus rien du dessin primitif.
LES PICTOGRAMMES DE L'ÉCRITURE CUNÉIFORME
Trouvées sur le site d'Ourouk IV, de petites tablettes d'argile portent, tracés avec la pointe d'un roseau, des pictogrammes à lignes courbes, au nombre d'un millier, chaque caractère représentant, avec une schématisation plus ou moins grande et sans référence à une forme linguistique, un objet ou un être vivant. L'ensemble de ces signes, qui dépasse le millier, évolue ensuite sur deux plans. Sur le plan technique, les pictogrammes connaissent d'abord une rotation de 90° vers la gauche (sans doute parce que la commodité de la manipulation a entraîné une modification dans l'orientation de la tablette tenue en main par le scribe) ; ultérieurement, ces signes ne sont plus tracés à la pointe sur l'argile, mais imprimés, dans la même matière, à l'aide d'un roseau biseauté, ce qui produit une empreinte triangulaire en forme de « clou » ou de « coin », cuneus en latin, d'où le nom de cunéiforme donné à cette écriture.
LE SENS DES PICTOGRAMMES CUNÉIFORMES
Sur le plan logique, l'évolution est plus difficile à cerner. On observe cependant, dès l'époque primitive, un certain nombre de procédés notables. Ainsi, beaucoup de ces signes couvrent une somme variable d'acceptions : l'étoile peut tour à tour évoquer, outre un astre, « ce qui est en haut », le « ciel » et même un « être divin ». Par ailleurs, les sumériens ne se sont pas contenté de représenter un objet ou un être par un dessin figuratif : ils ont également noté des notions abstraites au moyen de symboles. C'est ainsi que deux traits sont parallèles ou croisés selon qu'ils désignent un ami ou un ennemi.
Le sens peut aussi procéder de la combinaison de deux éléments graphiques. Par exemple, en combinant le signe de la femme et celui du massif montagneux, on obtient le sens d'« étrangère », « esclave ».
Tous ces signes, appelés pictogrammes par référence à leur tracé, sont donc aussi des idéogrammes, terme qui insiste sur leur rôle sémantique (leur sens) et indique de surcroît leur insertion dans un système. L'écriture cunéiforme dépasse ensuite ce stade purement idéographique. Un signe dessiné peut aussi évoquer le nom d'une chose, et non plus seulement la chose elle-même. On recourt alors au procédé du rébus, fondé sur le principe de l'homophonie (qui ont le même son). Ce procédé permet de noter tous les mots et ainsi des messages plus élaborés.
L'ÉCRITURE DES AKKADIENS
Cependant, les Sumériens considèrent les capacités phonétiques des signes, nouvellement découvertes, comme de simples appoints à l'idéographie originelle, et font alterner arbitrairement les deux registres, idéographique et phonographique. Lorsque les Akkadiens empruntent ce système vers − 2300, ils l'adaptent à leur propre langue, qui est sémitique, et font un plus grand usage du phonétisme, car, à la différence du sumérien, dont les vocables peuvent se figurer par des idéogrammes toujours identiques, flanqués d'affixes qui déterminent leur rôle grammatical, l'akkadien renferme déclinaisons et conjugaisons.
L'ÉVOLUTION DU SUMÉRO-AKKADIEN
L'écriture suméro-akkadienne ne cesse d'évoluer et connaît notamment une expansion importante au IIe millénaire. Le cunéiforme est adopté par des peuples de l'Orient qui l’adaptent à la phonétique de leur langue : Éblaïtes, Susiens, Élamites, etc. Vers − 1500, les Hittites adoptent les cunéiformes babyloniens pour noter leur langue, qui est indo-européenne, associant leurs idéogrammes à ceux venus de Mésopotamie, qu'ils prononcent en hittite. L'ougaritique, connu grâce aux fouilles de Ras Shamra (l'antique Ougarit), dans l'actuelle Syrie, est un alphabet à technique cunéiforme ; il note plusieurs langues et révèle que, à partir de − 1400 environ, l'écriture en cunéiformes est devenue une sorte de forme « véhiculaire », simplifiée, servant aux échanges internationaux. Au Ier millénaire encore, le royaume d'Ourartou (situé à l'est de l'Anatolie) emprunte les caractères cunéiformes (vers − 800) et ne les modifie que légèrement. Enfin, pendant une période assez brève (vie-ive s. avant notre ère), on utilise un alphabet à technique cunéiforme pour noter le vieux perse. Au Ier millénaire, devant les progrès de l'alphabet et de la langue des Araméens (araméen), l'akkadien devient une langue morte ; le cunéiforme ne se maintient que dans un petit nombre de villes saintes de basse Mésopotamie, où il est utilisé par des Chaldéens, prêtres et devins, jusqu'au ier s. après J.-C., avant de sombrer dans l'oubli.
DU HIÉROGLYPHE AU DÉMOTIQUE
Hiéroglyphes
Tout d'abord hiéroglyphique, l'écriture égyptienne évolue en se simplifiant vers une écriture plus maniable, et d'un usage quotidien. Le hiéroglyphe est une unité graphique utilisée dans certaines écritures de l'Antiquité, comme l'égyptien. Les premiers témoignages « hiéroglyphiques » suivent de quelques siècles les plus anciennes tablettes sumériennes écrites en caractères cunéiformes. Le mot « hiéroglyphe », créé par les anciens Grecs, fait état du caractère « sacré » (hieros) et « gravé » (gluphein) de l'écriture égyptienne monumentale, mais n'est réservé à aucun système d'écriture particulier. On désigne par le même terme les écritures crétoises du minoen moyen (entre 2100 et 1580 avant J.-C.), que l'on rapproche ainsi des signes égyptiens, mais qui demeurent indéchiffrées.
LES HIÉROGLYPHES ÉGYPTIENS
La langue égyptienne est une langue chamito-sémitique dont la forme écrite n'est pas vocalisée. Vers 3000 avant J.-C., l'Égypte possède l'essentiel du système d'écriture qu'elle va utiliser pendant trois millénaires et dont les signes hiéroglyphiques offrent la manifestation la plus spectaculaire. Quelque 700 signes sont ainsi créés, beaucoup identifiables parce que ce sont des dessins représentant des animaux, un œil, le soleil, un outil, etc.
Cette écriture est d'abord pictographique (un signe, dessiné, représente une chose ou une action). Mais dès l'origine, l'écriture égyptienne eut recours, à côté des signes-mots (idéogrammes), à des signes ayant une valeur phonétique (phonogrammes), où un signe représente un son. Le dessin du canard représente l'animal lui-même, mais canard se disant sa, le même signe peut évoquer le son sa, qui sert aussi à désigner le mot « fils ». Pour éviter au lecteur confusions ou hésitations, le scribe a soin de jalonner son texte de repères : signalisation pour désigner l'emploi du signe comme idéogramme (signe-chose, représentant plus ou moins le sens du mot) ou phonogramme, et compléments phonétiques qui indiquent la valeur syllabique. Il existe également des idéogrammes déterminatifs, qui ne se lisent pas, mais qui indiquent à quelle catégorie appartient le mot. Les signes peuvent être écrits de gauche à droite ou de droite à gauche.
On distingue trois types d'écriture égyptienne : l'écriture cursive ou hiératique, tracée sur papyrus, l'écriture démotique, plus simplifiée que l'écriture hiératique, et l'écriture hiéroglyphique proprement dite, c'est-à-dire celle des monuments, antérieure à 2500 avant J.-C. Ces hiéroglyphes, gravés à l'origine dans la pierre, en relief ou en creux, peuvent être disposés verticalement ou horizontalement, comme ils peuvent se lire de droite à gauche ou de gauche à droite, le sens de la lecture étant indiqué par la direction du regard des êtres humains et des animaux, toujours tourné vers le début du texte.
L'écriture hiéroglyphique apparaît toute constituée dès les débuts de l'histoire (vers 3200 avant J.-C.) ; la dernière inscription en hiéroglyphes, trouvée à Philae, date de 394 après J.-C.
LE SYSTÈME DE L'ÉCRITURE ÉGYPTIENNE
Les idéogrammes peuvent être des représentations directes ou indirectes, grâce à divers procédés logiques :
– la représentation directe de l'objet que l'ont veut noter ;
– la représentation par synecdoque ou métonymie, c'est-à-dire en notant la partie pour le tout, l'effet pour la cause, ou inversement : ainsi, la tête de bœuf représente cet animal ; deux yeux humains, l'action de voir ;
– la représentation par métaphore : on note, par exemple, la « sublimité » par un épervier, car son vol est élevé ; la « contemplation » ou la « vision », par l'œil de l'épervier, parce qu'on attribuait à cet oiseau la faculté de fixer ses regards sur le disque du Soleil ;
– représentation par « énigme » – le terme est de Champollion – ; on emploie, pour exprimer une idée, l'image d'un objet physique n'ayant qu'un rapport lointain avec l'objet même de l'idée à noter : ainsi, une plume d'autruche signifie la « justice », parce que, disait-on, toutes les plumes des ailes de cet oiseau sont parfaitement égales ; un rameau de palmier représente l'« année », parce que cet arbre était supposé avoir autant de rameaux par an que l'année compte de mois, etc.
L'ÉVOLUTION DE L'ÉCRITURE ÉGYPTIENNE
L'évolution des hiéroglyphes vers le phonétisme
À partir des idéogrammes originels, l'écriture égyptienne a évolué vers un phonétisme plus marqué que celui du cunéiforme. Selon le principe du rébus là aussi, on a utilisé, pour noter telle notion abstraite difficile à figurer, l'idéogramme d'un objet dont le nom a une prononciation identique ou très proche. Par exemple, le scarabée, khéper, a servi à noter la notion qui se disait également khéper, le « devenir ».
Poussé plus loin, le recours au phonétisme mène à l'acronymie. Un acronyme est en l'occurrence une sorte de sigle formé de toute consonne initiale de syllabe. Apparaissent ainsi des acronymes trilitères et bilitères (nfr, « cœur » ; gm, « ibis »), ainsi que des acronymes unilitères (r, « bouche »), qui constituent une espèce d'alphabet consonantique de plus de vingt éléments.
Mais le fait de noter exclusivement les consonnes entraîne beaucoup trop d'homonymies. Pour y remédier, on utilise certains hiéroglyphes comme déterminatifs sémantiques destinés à guider l'interprétation sémantique des mots écrits phonétiquement. Par exemple, le signe du « Soleil », associé à la « massue », hd, et au « cobra », dj, qui jouent un rôle phonétique, mène à la lecture hedj, « briller ».C'est dans la catégorie des déterminatifs qu'entre le cartouche, encadrement ovale signalant un nom de souverain. Quelle que soit sa logique, cette écriture est d'un apprentissage et d'une lecture difficiles, et se prête peu à une graphie rapide.
L'écriture hiératique
Sur le plan technique, si la gravure dans la pierre s'accommode de ces formes précises, l'utilisation du roseau ou du pinceau sur du papyrus ou de la peau entraîne une écriture plus souple. Les hiéroglyphes sont simplifiés pour aboutir à deux formes cursives : l'écriture hiératique (usitée par les prêtres) et l'écriture démotique (servant à la rédaction de lettres et de textes courants). Tracée sur papyrus à l'aide d'un roseau à la pointe écrasée, trempée dans l'encre noire ou rouge, l'écriture hiératique est établie par simplification et stylisation des signes hiéroglyphiques. Avec ses ligatures, ses abréviations, elle sert aux besoins de la vie quotidienne : justice, administration, correspondance privée, inventaires mais aussi littérature, textes religieux, scientifiques, etc.
Le démotique
Vers 700 avant J.-C., une nouvelle cursive, plus simplifiée, remplace l'écriture hiératique. Les Grecs lui donnent le nom de « démotique », c'est-à-dire « (écriture) populaire », car elle est d'un usage courant et permet de noter les nouvelles formes de la langue parlée. Utilisée elle aussi sur papyrus ou sur ostraca (tessons de poterie), cette écriture démotique suffit à tous les usages pendant plus de 1000 ans, exception faite des textes gravés sur les monuments, qui demeurent l'affaire de l'hiéroglyphe, et des textes religieux sur papyrus pour lesquels on garde l'emploi de l'écriture hiératique.
Sur le plan fonctionnel, les Égyptiens, tout comme les Sumériens, n'ont pas exploité pleinement leurs acquis et se sont arrêtés sur le chemin qui aurait pu les mener à une écriture alphabétique. Demeuré longtemps indéchiffrable, le système d’écriture égyptien fut décomposé et analysé par Champollion (1822) grâce à la découverte de la pierre de Rosette, qui portait le même texte en hiéroglyphe, en démotique et en grec.
LES ÉCRITURES ANCIENNES DÉCHIFFRÉES
Alliant érudition, passion et intuition, les chercheurs du xixe s. déchiffrent les écritures des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes.
Dans leurs travaux, ils durent résoudre deux problèmes : celui de l'écriture proprement dite, d'une part ; celui de la langue pour laquelle un système d'écriture était employé, d'autre part. Le document indispensable fut donc celui qui utilisait au moins deux systèmes d'écriture (ou davantage) dont l'un était déjà connu : la pierre de Rosette, rédigé en 2 langues et trois systèmes d’écritures (hiéroglyphe, démotique et grec) permit de déchiffrer les hiéroglyphes, grâce à la connaissance du grec ancien. Les savants durent ensuite faire l'hypothèse que telle ou telle langue avait été utilisée pour rédiger un texte donné ; Jean-François Champollion postula ainsi que la langue égyptienne antique a survécu dans la langue copte, elle-même conservée dans la liturgie de l'église chrétienne d'Égypte. De même le déchiffreur de l’écriture cunéiforme, sir Henry Creswicke Rawlinson, une fois les textes en élamite et vieux-perse de Béhistoun mis au point, fit l'hypothèse, avec d'autres chercheurs, que le texte restant était du babylonien, et qu'il s'agissait d'une langue sémitique dont les structures pouvaient être retrouvées à partir de l'arabe et de l'hébreu.
LES DÉCHIFFREURS
1754 : l'abbé Barthélemy propose une lecture définitive des textes phéniciens et palmyriens.
1799 (2 août) : mise au jour de la pierre de Rosette, dans le delta du Nil, portant copie d'un décret de Ptolémée V Épiphane (196 avant J.-C.) rédigé en trois écritures, hiéroglyphique, hiératique et grecque.
1822 : Lettre à Monsieur Dacier, de J.-F. Champollion, où ce dernier expose le principe de l'écriture égyptienne.
1824 : parution du Précis du système hiéroglyphique rédigé par Champollion.
À partir de 1835 : l'Anglais H. C. Rawlinson copie, à Béhistoun, en Iran, une inscription célébrant les exploits de Darius Ier (516 avant J.-C.) rédigée selon trois systèmes d'écriture cunéiforme, en vieux-perse, en élamite et en babylonien (akkadien), langues jusqu'alors inconnues.
1845 : le texte en vieux-perse est déchiffré par Rawlinson.
1853 : le texte en élamite est déchiffré par E. Norris.
1857 : un même texte babylonien est confié à quatre savants qui en proposent des traductions identiques.
1858 : Jules Oppert publie son Expédition scientifique en Mésopotamie, qui contribue au déchiffrement du cunéiforme.
1905 : F. Thureau-Dangin établit l'originalité de l'écriture et du système linguistique des Sumériens.
1917 : le Tchèque Hrozny établit que les textes hittites, écrits en caractères cunéiformes, servent à noter une langue indo-européenne, désormais déchiffrée.
1945 : découverte d'une stèle bilingue à Karatépé, en Cilicie ; la version phénicienne du texte permet de déchiffrer un texte louwite (proche du hittite) noté en écriture hiéroglyphique.
1953 : les Anglais M. Ventris et J. Chadwick établissent que les textes rédigés en écriture dite « linéaire B » sont du grec archaïque (mycénien) ; le linéaire B est une écriture syllabique comprenant environ 90 signes.
LA « LANGUE GRAPHIQUE » DES CHINOIS
Après les écritures sumérienne et égyptienne, l'écriture chinoise est la troisième écriture importante à avoir découpé les messages en mots. Mais elle n'a pas évolué comme les deux autres, car, à la différence de tous les systèmes d'écriture, qui sont parvenus, à des degrés divers, à exprimer la pensée par la transcription du langage oral, l'écriture chinoise note une langue conçue en vue de l'expression écrite exclusivement, et appelée pour cette raison « langue graphique ».
L'ÉVOLUTION DES IDÉOGRAMMES CHINOIS
Les premiers témoignages de l’écriture chonoise datent du milieu du IIe millénaire avant J.-C. : ce sont des inscriptions divinatoires, gravées sur des carapaces de tortues ou des omoplates de bœufs. Les devins y gravaient les questions de leurs « clients » puis portaient contre ce support un fer chauffé à blanc et interprétaient les craquelures ainsi produites. Ce type d’écriture a évolué à travers le temps et les différents supports : inscriptions sur des vases de bronze rituels aux alentours du ixe s. ; écriture sigillaire, gravée dans la pierre ou l'ivoire, au milieu du Ier millénaire ; caractères « classiques », peints au pinceau, à partir du iie s. avant J.-C. Ces derniers signes ont traversé deux millénaires ; en 1957, une réforme en a simplifié un certain nombre.
LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRITURE CHINOISE
Écriture chinoise
Sur le plan fonctionnel, les pictogrammes originels ont évolué vers un système d'écriture où les éléments sont dérivés les uns des autres. Soit le caractère de l'arbre (mu) : on peut en cocher la partie basse pour noter « racine » (ben), ou la partie haute pour « bout, extrémité » (mo) ; on peut aussi lui adjoindre un deuxième arbre pour noter « forêt » (lin), un troisième pour noter « grande forêt », et ultérieurement « nombreux », « sombre » (sen).
Un dérivé peut servir à son tour de base de dérivation. Ainsi, le pictogramme de la « servante », de l'« esclave », figurant une femme et une main droite (symbole du mari et du maître), est associé au signe du cœur, siège des sentiments, pour signifier la « rage », la « fureur », éprouvée par l'esclave.
Cette langue graphique use également d'indicateurs phonétiques. Ainsi, le caractère de la femme, flanqué de l'indicateur « cheval » (mâ), note « la femme qui se prononce comme le cheval » (au ton près), c'est-à-dire la « mère » (m"a) ; si l'on associe « cheval » avec « bouche », on note la particule interrogative (ma) ; avec deux « bouches », le verbe « injurier ».
Inversement, le caractère chinois peut être lu grâce au déterminatif sémantique. Ces déterminatifs, ou clés (au nombre de 540 au iie s. après J.-C., réduits à 214 au xviie s., et portés à 227, avec des modifications diverses, en 1976), sont des concepts destinés à orienter l'esprit du lecteur vers telle ou telle catégorie sémantique. Le même signe signifiera « rivière » s'il est précédé de la clé « eau », et « interroger » s'il est précédé de la clé « parole ».
Le système chinois repose donc sur le découpage de l'énoncé en mots. Il semble que, de l'autre côté du Pacifique, et au xvie s. de notre ère seulement, à la veille de la conquête espagnole, les glyphes précolombiens (que nous déchiffrons très partiellement à ce jour, malgré des progrès dans la lecture des glyphes mayas) présentent des similitudes avec cette écriture. Mais ils ne se sont pas entièrement dégagés de la simple pictographie.
L'AVENTURE DURABLE DE L'ALPHABET
LA NAISSANCE DE L'ALPHABET
L'invention de l'alphabet (dont le nom est forgé par les Grecs sur leurs deux premières lettres alpha et bêta) se situe au IIe millénaire avant notre ère en Phénicie. Deux peuples y jouent un rôle important, les Cananéens et, à partir du xiie s. avant J.-C., les Araméens ; ils parlent chacun une langue sémitique propre et utilisent l'akkadien, écrit en cunéiformes, comme langue véhiculaire. Dans les langues sémitiques, chacun des « mots » est formé d'une racine consonantique qui « porte » le sens, tandis que les voyelles et certaines modifications consonantiques précisent le sens et indiquent la fonction grammaticale. Cette structure n'est sans doute pas étrangère à l'évolution de ces langues vers le principe alphabétique, et plus précisément vers l'alphabet consonantique, à partir du système cunéiforme.
L'ALPHABET OUGARITIQUE
Le premier alphabet dont on ait pu donner une interprétation précise est l'alphabet ougaritique, apparu au moins quatorze siècles avant notre ère. Différent du cunéiforme mésopotamien, qui notait des idées (cunéiformes idéographiques), puis des syllabes (cunéiformes syllabiques), il note des sons isolés, en l'occurrence des consonnes, au nombre de vingt-huit. Il a probablement emprunté la technique des cunéiformes aux Akkadiens, en pratiquant l'acrophonie (phénomène par lequel les idéogrammes d'une écriture ancienne deviennent des signes phonétiques correspondant à l'initiale du nom de l'objet qu'ils désignaient. Ainsi, en sumérien, le caractère cunéiforme signifiant étoile, et qui se lisait ana, finit par devenir le signe de la syllabe an) et en simplifiant certains caractères. La véritable innovation est celle des scribes d'Ougarit : gravés dans l'argile, comme les signes mésopotamiens, les caractères d'apparence cunéiforme sont en fait des lettres, déjà rangées dans l'ordre des futurs alphabets. C'est en cette écriture que les trésors de la littérature religieuse d'Ougarit, c'est-à-dire la littérature religieuse du monde cananéen lui-même, nous sont parvenus.
L'ALPHABET DE BYBLOS
Alors que l'« alphabet » ougaritique demeure réservé à cette cité, l'alphabet sémitique dit « ancien » est l'ancêtre direct de notre alphabet. Sa première manifestation en est, au xie s., le texte gravé sur le sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos : 22 signes à valeur uniquement de consonnes. Cet alphabet apparaît donc à Byblos (aujourd'hui Djebaïl, au Liban), lieu d'échanges entre l'Égypte et le monde cananéen. Ce système est utilisé successivement par les Araméens, les Hébreux et les Phéniciens. Commerçants et navigateurs, ces derniers le diffusent au cours de leurs voyages, notamment vers l'Occident, vers Chypre et l'Égée, où les Grecs s'en inspirent pour la création de leur propre alphabet. Car ce sont les Grecs qui, au xie s. avant J.-C., emploient, pour la première fois au monde, un système qui note aussi bien les voyelles que les consonnes, constituant ainsi le premier véritable alphabet.
Pour les deux alphabets d'Ougarit et de Byblos, entre lesquels il ne devrait pas y avoir de continuité globale, il est frappant que l'ordre des lettres soit le même et corresponde à peu près à celui des alphabets ultérieurs. Cet ordre, dont l'origine reste mystérieuse, serait très ancien.
LA FORME ET LE NOM DES LETTRES
Mais quel critère a déterminé le choix de tel graphisme pour noter tel son ? D'où viennent les noms des lettres ? L'hypothèse retenue répond à ces deux questions à la fois : une lettre devait fonctionner à l'origine comme un pictogramme (A figurait une tête de bœuf) ; on a utilisé ce pictogramme pour noter le son initial du nom qui désignait telle chose ou tel être dans la langue (A utilisé pour noter « a », issu par acrophonie d'aleph, nom du bœuf en sémitique) ; enfin, on a donné à la lettre alphabétique nouvelle le nom de la chose que figurait le pictogramme originel (aleph est le nom de la lettre A). C'est sur cette hypothèse que s'est fondé l'égyptologue Alan Henderson Gardiner dans ses travaux sur les inscriptions dites « protosinaïtiques » découvertes dans le Sinaï. Elles sont antérieures au xve s. avant J.-C., présentent quelque signes pictographiques et notent une langue apparentée au cananéen. Les conclusions de Gardiner ne portent que sur quelques « lettres » de ce protoalphabet, mais elles semblent convaincantes et devraient permettre de repousser de cinq à sept siècles la naissance du système alphabétique.
LA CHAÎNE DES PREMIERS ALPHABETS
Des convergences dans la forme, le nom et la valeur phonétique des lettres établissent, entre les alphabets, une parenté incontestable. Pour l'araméen et le grec, celle-ci est collatérale : ils ont pour ancêtre commun le phénicien. De l'alphabet araméen dérivent l'hébraïque (iiie ou iie s. avant J.-C.) et probablement l'arabe (avant le vie s. après J.-C.), avec ses diverses adaptations, qui notent le persan ou l'ourdou, par exemple ; à moins qu'il ne faille distinguer une filière arabique qui aurait une parenté collatérale avec le phénicien. Du grec découle la grande majorité des alphabets actuels : étrusque (ve s. avant J.-C.), italiques puis latin (à partir du ve s. avant J.-C.), copte (iie-iiie s. après J.-C.), gotique (ive s.), arménien (ve s.), glagolitique et cyrillique (ixe s.). La propagation du christianisme joua un rôle majeur dans cette filiation : c'est pour les besoins de leur apostolat que des évangélisateurs, s'inspirant des alphabets grec ou latin dans lesquels ils lisaient les Écritures, constituèrent des alphabets adaptés aux langues des païens.
Quant aux alphabets asiatiques, au nombre d'au moins deux cents, on pense qu'ils remontent tous à l'écriture brahmi. La devanagari, par exemple, a servi à noter le sanskrit et note aujourd'hui le hindi. D’aucuns supposent que l'écriture brahmi aurait été elle-même créée d'après un modèle araméen. Selon cette hypothèse, tous les alphabets du monde proviendraient donc de la même source proche-orientale.
L'ALPHABET AUJOURD’HUI
Avec la grande extension de l'alphabet, la fonction de l'écrit a évolué. À la conservation de la parole, ou, sur une autre échelle, de la mémoire des hommes, s'est ajoutée l'éducation, l'œuvre de culture, souvent synonyme d'« alphabétisation ». Il existe bel et bien une civilisation de l'alphabet, accomplissement de celle de l'écriture, où un autodafé de documents écrits est considéré comme un acte de barbarie. Depuis le siècle dernier, une étape importante s'est amorcée avec la diffusion de l'alphabet latin hors de l'Europe occidentale, surtout pour noter des parlers encore non écrits, en Afrique ou dans l'ex-Union soviétique. En Turquie, par exemple, la réforme de 1928 (utilisation de l’alphabet latin, légèrement enrichi de diacritiques et d’une lettre supplémentaire) a permis de rapprocher le pays de la civilisation occidentale.
LINGUISTIQUE
L'écriture est un code de communication secondaire par rapport au langage articulé. Mais, contrairement à celui-ci, qui se déroule dans le temps, l'écriture possède un support spatial qui lui permet d'être conservée. La forme de l'écriture dépend d'ailleurs de la nature de ce support : elle peut être gravée sur la pierre, les tablettes d'argile ou de cire, peinte ou tracée sur le papyrus, le parchemin ou le papier, imprimée ou enfin affichée.
Selon la nature de ce qui est fixé sur le support, on distingue trois grands types d'écriture, dont l'apparition se succède en gros sur le plan historique, et qui peuvent être considérés comme des progrès successifs dans la mesure où le code utilisé est de plus en plus performant : les écritures synthétiques (dites aussi mythographiques), où le signe est la traduction d'une phrase ou d'un énoncé complet ; les écritures analytiques, où le signe dénote un morphème ; les écritures phonétiques (ou phonématiques), où le signe dénote un phonème ou une suite de phonèmes (syllabe).
LES ÉCRITURES SYNTHÉTIQUES
On peut classer dans les écritures synthétiques toutes sortes de manifestations d'une volonté de communication spatiale. Certains, d'ailleurs, préfèrent parler en ce cas de « pré-écriture », dans la mesure où ces procédés sont une transcription de la pensée et non du langage articulé. Quoi qu'il en soit, le spécialiste de la préhistoire André Leroi-Gourhan note des exemples de telles manifestations dès le moustérien évolué (50 000 ans avant notre ère) sous la forme d'incisions régulièrement espacées sur des os ou des pierres. À ce type de communication appartiennent les représentations symboliques grâce à des objets, dont un exemple classique, rapporté par Hérodote, est le message des Scythes à Darios ; il consistait en cinq flèches d'une part, une souris, une grenouille et un oiseau d'autre part, formes suggérées à l'ennemi pour échapper aux flèches. Ce genre de communication se retrouve un peu partout dans le monde dans les sociétés dites primitives. On peut ainsi signaler les systèmes de notation par nœuds sur des cordelettes (quipus des archives royales des Incas), mais la forme la plus courante d'écriture synthétique est la pictographie, c'est-à-dire l'utilisation de dessins figuratifs (pictogrammes), dont chacun équivaut à une phrase (« je pars en canot », « j'ai tué un animal », « je rentre chez moi », etc.) : c'est le système utilisé par les Inuits d'Alaska, les Iroquois et les Algonquins (wampums) ou encore par les Dakotas. Les limites de ces modes d'expression apparaissent évidentes : ils ne couvrent que des secteurs limités de l'expérience, ils ne constituent pas, comme le langage, une combinatoire.
LES ÉCRITURES ANALYTIQUES
Dans les écritures analytiques (dites aussi, paradoxalement, « idéographiques »), le signe ne représente pas une idée mais un élément linguistique (mot ou morphème), ce n'est plus une simple suggestion, c'est une notation. En réalité, le manque d'économie de ce système (il y aurait un signe pour chaque signifié) fait qu'il n'existe pas à l'état pur : toutes les écritures dites idéographiques comportent, à côté des signes-choses (idéogrammes), une quantité importante de signes à valeur phonétique, qu'il s'agisse des cunéiformes suméro-akkadiens, des hiéroglyphes égyptiens ou de l'écriture chinoise. Par exemple, en chinois, on peut distinguer, en gros, cinq types d'idéogrammes : les caractères représentant des objets, et qui sont, à l'origine, d'anciens pictogrammes (le soleil, la lune, un cheval, un arbre, etc.) ; les caractères évoquant des notions abstraites (monter, descendre, haut, bas) ; les caractères qui sont des agrégats logiques, formés par le procédé du rébus, en associant deux signes déjà signifiants (une femme sous un toit pourra dénoter la paix) ; les caractères utilisés pour noter des homophones : tel caractère désignant à l'origine un objet donné sera utilisé pour noter un mot de même prononciation mais de sens complètement différent ; les caractères qui sont des composés phonétiques, constitués, à gauche, d'un élément qui indique la catégorie sémantique (clef) et, à droite, d'un élément indiquant la prononciation (ce dernier type de caractère constitue jusqu'à 90 % des entrées d'un dictionnaire chinois). Cependant, l'écriture chinoise, malgré ses recours au phonétisme, n'est pas liée à la prononciation : elle peut être lue par les locuteurs des différents dialectes chinois, entre lesquels il n'y a pas d'intercompréhension orale ; elle sert, d'autre part, à noter des langues complètement différentes comme le lolo, l’ancien coréen (qui a depuis créé son propre alphabet, le hangul) ou le japonais, où les idéogrammes chinois coexistent avec une notation syllabique.
LES ÉCRITURES PHONÉTIQUES
Les écritures dites « phonétiques » témoignent d'une prise de conscience plus poussée de la nature de la langue parlée : les signes y ont perdu tout contenu sémantique (même si, à l'origine, les lettres sont d'anciens idéogrammes), ils ne sont plus que la représentation d'un son ou d'un groupe de sons. Trois cas peuvent se présenter, selon que le système note les syllabes, les consonnes seules ou les voyelles et les consonnes. Les syllabaires ne constituent pas toujours historiquement un stade antérieur à celui des alphabets. S'il est vrai que les plus anciens syllabaires connus (en particulier le cypriote) précèdent l'invention de l'alphabet (consonantique) par les Phéniciens, d'autres sont, au contraire, des adaptations d'alphabets : c'est le cas de la brahmi, ancêtre de toutes les écritures indiennes actuelles, qui procède de l'alphabet araméen, ou du syllabaire éthiopien, qui a subi des influences sémitiques et grecques.
Quant à la naissance de l'alphabet grec, elle a été marquée, semble-t-il, aussi bien par le modèle phénicien que par celui des syllabaires cypriote et crétois (linéaires A et B). Les systèmes syllabiques se caractérisent par leur côté relativement peu économique, puisqu'il faut, en principe, autant de signes qu'il y a de possibilités de combinaison voyelle-consonne. D'autre part, ils présentent l'inconvénient de ne pouvoir noter simplement que les syllabes ouvertes (C+V) ; en cas de syllabe fermée (C+V+C) ou de groupement consonantique (C+C+V), l'un des signes contiendra un élément vocalique absent de la prononciation.
Les alphabets consonantiques, dont le phénicien est historiquement le premier exemple, ne conviennent bien qu'à des langues ayant la structure particulière des langues sémitiques : la racine des mots y possède une structure consonantique qui est porteuse de leur sens, la vocalisation pouvant être devinée par l'ordre très rigoureux des mots dans la phrase, qui indique leur catégorie grammaticale et, par là même, leur fonction. L'alphabet araméen a servi de modèle à toute une série d'alphabets (arabe, hébreu, syriaque, etc.), ainsi qu'à des syllabaires (brahmi) ; l'alphabet arabe a servi et sert à noter des langues non sémitiques, non sans quelques difficultés (il a ainsi été abandonné pour le turc).
Alphabet grec
L'alphabet grec est historiquement le premier exemple d'une écriture notant à la fois et séparément les consonnes et les voyelles. Il a servi de modèle à toutes les écritures du même type qui existent actuellement : alphabets latin, cyrillique, arménien, géorgien, etc.
PÉDAGOGIE
L'apprentissage de l'écriture fait appel à une maîtrise de la fonction symbolique ainsi qu'à une maîtrise motrice de l'espace et du temps. Il s'effectue soit par l'étude progressive et linéaire des lettres, servant à former les mots (méthode analytique), soit par la compréhension directe des mots dans le contexte de la phrase, dont on décomposera seulement après les lettres (méthode globale d’Ovide Decroly). Mais ce sont de plus en plus des méthodes mixtes qui sont utilisées, intégrant parfois expression corporelle et exercices de motricité.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
OTAN |
|
|
| |
|
| |
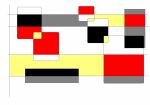
OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) ou NATO (North Atlantic Treaty Organization) ou pacte de l'Atlantique Nord
Alliance militaire signée à Washington, le 4 avril 1949.
1. L'ALLIANCE ATLANTIQUE
L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est née de la guerre froide. Au lendemain de la défaite de l'Allemagne, le monde se partage en deux blocs, opposant les États-Unis et l'URSS, ainsi que leurs alliés respectifs. L'Alliance atlantique est alors destinée à contrer la puissance soviétique.
Aujourd'hui, l'OTAN comprend 29 membres : depuis l'origine, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal ; depuis 1952, la Grèce et la Turquie ; depuis 1955, la République fédérale d'Allemagne ; depuis 1982, l'Espagne ; depuis mars 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. La Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie rejoignent l'Alliance en 2004, l’Albanie et la Croatie en 2009 et le Monténégro en 2017. Tous ces pays en font partie afin de « sauvegarder la paix et la sécurité, et de développer la stabilité et le bien-être dans la région de l'Atlantique nord ». Après la chute du mur de Berlin, en 1989, l'Alliance a redéfini son rôle. À Rome, en 1991, puis lors du Conseil de l'Atlantique Nord à Washington, en 1999, elle a adopté un nouveau concept stratégique.
L'OTAN s'est ouvert et pourrait s'ouvrir à de nouveaux États (Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord), développer des partenariats avec la Russie et l'Ukraine, élargir le dialogue avec les pays de la Méditerranée. Une conception élargie de la sécurité peut conduire l'Organisation à mener des opérations de maintien de paix hors de sa zone de compétence. La condition en est alors une réforme de ses structures militaires.
2. GENÈSE ET FINALITÉ DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE
2.1. LA FORMATION DU PACTE DE L'ATLANTIQUE NORD
L'origine du Pacte est multiple. Elle se trouve, tout d'abord, dans la déclaration du président américain Harry Truman, datant du 12 mars 1947. La « doctrine Truman », motivée, entre autres, par l'essor de mouvements de guérilla nationalistes soutenus par les Soviétiques ou à direction communiste (Kurdistan, Chine, Grèce, Viêt Nam), remet en question la tradition isolationniste des États-Unis en temps de paix, en militant en faveur d'une solidarité militaire au sein du monde occidental.
L'OTAN doit aussi sa création au désir des Européens de se lier aux États-Unis par un pacte durable de défense. Soucieux de la menace soviétique (création du Kominform, grèves communistes en Italie et en France en 1947-1948, et surtout « coup de Prague » de février 1948, puis blocus de Berlin en juin), la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg, déjà liés par le traité de Bruxelles (17 mars 1948), décident d'élargir leur pacte d'alliance à d'autres pays de l'Europe occidentale et aux deux grands États industriels d'Amérique du Nord. Le traité de l'Atlantique Nord est signé le 4 avril 1949 par les douze pays fondateurs et entre en vigueur le 24 août suivant.
La zone couverte par le traité, s'étendant aux territoires métropolitains des États membres mais non à leurs possessions d'outre-mer, est décrite dans l'article 6 : l'Alliance intervient en cas d'« attaque contre le territoire de l'une des parties en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d'Algérie (mention supprimée en 1963, après l'accession du pays à l'indépendance), contre les îles placées sous la juridiction de l'une des parties dans la région de l'Atlantique nord, au nord du tropique du Cancer, ou contre les navires ou aéronefs de l'une des parties dans la même région. »
Le traité peut être révisé au bout de dix ans à la demande de l'une des parties et par voie de consultation (article 12). Il peut être dénoncé par toute partie au bout de vingt ans, mais sa durée est illimitée, comme le préciseront les Alliés dans les accords de 1954. Enfin, d'autres pays peuvent être admis dans l'Alliance, aux conditions fixées par l'article 10, qui précise : « Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique nord. » La zone sera progressivement élargie à la Grèce et à la Turquie, à l'Allemagne, à l'Espagne, et finira par s'étendre aux pays de l'Europe de l'Est avec l'adhésion, en 1999, de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque.
2.2. LES OBJECTIFS DU PACTE
L'esprit et les buts du traité sont exposés dans le Préambule et dans les trois premiers articles. Le Pacte a pour objet d'assurer collectivement la sécurité des États signataires. La référence à la charte de l'Atlantique de 1941 et à la charte des Nations unies de 1944 est constante. Comme elles, le texte du traité mentionne les grands principes sur lesquels doit reposer l'ordre international : la liberté des peuples, le règne du droit, la justice, la coopération économique et le refus de l'emploi de la force pour résoudre les conflits, sauf en cas de légitime défense.
En temps de paix, la sécurité collective des États membres est assurée par l'assistance mutuelle et la coopération économique. Il est dit, dans l'article 3, que chaque pays signataire devra accroître sa capacité de « résistance à une attaque armée ». Et, selon l'article 5, toute agression armée contre un des membres est considérée « comme une attaque dirigée contre toutes les parties. […] Chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense […], assistera la partie ou les parties ainsi attaquées ». Chaque État membre conserve cependant le choix des moyens. Pour la première fois de son histoire, l'OTAN a mis en œuvre la disposition de l'article 5, le 12 septembre 2001, après les attentats qui ont frappé les États-Unis. (→ événements du 11 septembre 2001.)
2.3. LES ÉVOLUTIONS DOCTRINALES
Dès sa création, en 1949, l'OTAN est une organisation purement défensive et dissuasive, et, dans l'hypothèse où une agression est commise sur le territoire des pays membres, ceux-ci bénéficient, le cas échéant, du « parapluie nucléaire » américain. Mais la fabrication, par l'URSS, de missiles balistiques à capacité intercontinentale l'amène, en 1967, à adopter la doctrine de « riposte graduée », qui fixe les conditions nouvelles de l'engagement des forces armées de l'Alliance.
En cas d'échec de la dissuasion, cette riposte doit se faire en trois paliers : l'engagement des forces conventionnelles ; l'emploi des armes nucléaires tactiques en soutien des armes conventionnelles ; et, par voie de conséquence, la mise en œuvre des forces nucléaires stratégiques des deux adversaires – les représailles étant alignées sur le niveau d'agression de l'adversaire. Cette évolution doctrinale conduit la France, en 1966, à se retirer du commandement intégré de l'Alliance, puis à exiger le retrait des forces stationnées sur son territoire et à récupérer la souveraineté complète de son espace aérien. Toutefois, un certain nombre de liens sont préservés, grâce à des accords d'état-major.
Une seconde évolution se fait jour avec la crise des euromissiles : au déploiement, à partir de 1977, des missiles SS 20 soviétiques, l'OTAN réplique, en 1979, par la « double décision », qui envisage ou le retrait des SS 20 ou, en cas de maintien de leur présence, le déploiement des missiles américains Pershing 2 sur le territoire des alliés européens (Allemagne, Italie, Grande-Bretagne principalement). Cette seconde option est effectivement appliquée en 1983, dans un climat d'intense agitation pacifiste, hostile à l'action de l'Alliance.
3. LE FONCTIONNEMENT DE L'OTAN
Pour que la politique de sécurité de l'Alliance soit définie et appliquée avec le concours des États membres, indépendants et souverains, chacun des gouvernements doit être parfaitement informé des choix et des orientations de ses partenaires et des motivations qui les inspirent. L'OTAN n'est pas une organisation supranationale ; il s'agit d'une alliance internationale à vocation défensive. Fin 1949, l'Europe et le monde paraissent de plus en plus nettement s'organiser autour de deux pôles de puissance : les États-Unis, qui, poussés par les circonstances, sont amenés à exercer leur leadership sur le « monde libre », et assument les responsabilités majeures au sein de l'Alliance atlantique ; l'URSS, qui, en attendant la mise en place du pacte de Varsovie en 1955, a signé des traités militaires avec ses satellites et s'efforce, depuis janvier 1949, de les intégrer économiquement à l'espace soviétique par le biais du Comecon, réplique à la création de l'OECE (Organisation européenne de coopération économique). Ce sont désormais deux « blocs » relativement homogènes qui vont s'affronter dans les batailles de la guerre froide.
En mai 1956, toutefois, le Conseil de l'Atlantique crée un comité chargé de rechercher les moyens de développer la coopération entre les pays de l'OTAN dans les domaines non militaires. Le 13 décembre est présenté le rapport dit « des trois sages ». Qualifié aussi de « charte morale », ce rapport affirme que l'existence de relations étroites au niveau politique et économique entre les membres de l'Alliance est la condition sine qua non à la réalisation effective de la mission de dissuasion de l'OTAN. Ainsi, la procédure de consultation n'est pas limitée aux seules questions militaires. Le comité politique, les groupes d'experts ad hoc, le groupe consultatif sur la politique atlantique sont autant d'organes qui contribuent au développement de la consultation politique entre les gouvernements des États membres de l'OTAN. Enfin, la déclaration d'Ottawa de 1974 – sur les relations atlantiques – réaffirme la volonté des Alliés de « maintenir entre eux une étroite consultation et un esprit de coopération et de confiance mutuelle » (paragraphe 11).
4. LES STRUCTURES DE L'OTAN
Ce qui distingue fondamentalement ce traité des alliances de type traditionnel qui l'ont précédé, ce sont les organes permanents qui se sont développés pour en assurer l'exécution et qui constituent l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, instituée par la convention d'Ottawa du 20 septembre 1951.
4.1. LES STRUCTURES CIVILES DE L'ALLIANCE
LE CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD
Le Conseil de l'Atlantique Nord, organe politique le plus élevé de l'OTAN, présidé par le secrétaire général, est la seule structure définie par le traité de l'Atlantique Nord. En son sein, les États membres ont les mêmes droits, quels que soient leur poids économique ou leur importance militaire, et les décisions sont prises à l'unanimité – ce qui implique un droit de veto pour chacun. Les gouvernements des États membres peuvent y conduire des consultations sur toutes les questions touchant à leur sécurité. C'est l'organe décisionnel suprême.
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN
Le secrétaire général de l'OTAN est nommé par le Conseil de l'Atlantique Nord par consensus, au terme de consultations. Sa fonction est à la fois civile et militaire. Chargé de promouvoir et de diriger le processus de consultation et de prise de décision au sein de l'OTAN, il se doit de donner des impulsions et des conseils fondés sur ses contacts avec les membres de l'Alliance et les responsables d'autres États.
LE COMITÉ DES PLANS DE DÉFENSE (CPD)
Le Comité des plans de défense (CPD) est chargé de donner des orientations aux autorités militaires de l'OTAN. Il a été institué après la décision prise par la France, en 1966, de ne plus laisser participer son ministère de la Défense au Conseil de l'Atlantique Nord et de se faire représenter au sein de ce dernier par son seul ministère des Affaires étrangères.
LE GROUPE DES PLANS NUCLÉAIRES (GPN)
Le Groupe des plans nucléaires (GPN), composé des représentants de tous les États membres, à l'exception de la France, est la principale enceinte de consultation pour toutes les questions relatives au rôle des forces nucléaires dans le cadre des politiques de sécurité et de défense mises en place par l'OTAN. Depuis 1992, cet organisme a cessé de travailler activement, l'OTAN n'ayant plus aujourd'hui d'« adversaire global ». Toutefois, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui sont, avec la France, les seuls pays membres de l'OTAN à posséder des armements nucléaires, continuent de se concerter au sein du GPN.
4.2. LES STRUCTURES MILITAIRES FONCTIONNELLES
Le Comité militaire, créé en octobre 1949, est l'instance militaire suprême de l'OTAN. Placé sous l'autorité politique du Conseil de l'Atlantique Nord, du CPD et du GPN, il donne des orientations au haut commandement de l'OTAN. En temps de paix, il est chargé de préparer les mesures et les plans jugés nécessaires à la défense commune de la zone de l'OTAN en Europe. Le Comité dispose d'un état-major militaire international (EMI), qui veille à ce que ses décisions et directives soient appliquées ; c'est l'organe exécutif du Comité militaire, dont la France, qui l'avait quitté en 1966, se rapproche depuis 1995. Ainsi, la mission militaire de la France participe à tous les travaux, sauf à ceux qui sont relatifs à la planification nucléaire.
4.3. LES COMMANDEMENTS OPÉRATIONNELS
LE COMMANDEMENT SUPRÊME ALLIÉ EN EUROPE (SACEUR)
Au niveau stratégique, le nombre des commandements suprêmes a été ramené (par dissolution, en 1992, du Commandement suprême allié de la Manche, ou CINCHAN) de trois à deux. Le Commandement suprême allié en Europe (SACEUR), basé à Mons, en Belgique, a pour mission fondamentale de contribuer au maintien de la paix, de la sécurité et de l'intégrité territoriale des États membres de l'Organisation. Il couvre les zones terrestres allant du cap Nord à l'Afrique du Nord et de l'Atlantique à la frontière orientale de la Turquie, à l'exception du Portugal et du Royaume-Uni. En cas de conflit armé, le SACEUR a vocation à prendre la direction de toutes les opérations terrestres, navales et aériennes dans cette zone qui couvre près de 2 millions de kilomètres carrés. De lui dépendent trois commandements régionaux : pour le Nord-Ouest (à High Wycombe, en Grande-Bretagne), pour le Centre-Europe (à Brunssum, aux Pays-Bas) et pour le Sud (à Naples).
LE COMMANDEMENT SUPRÊME ALLIÉ DE L'ATLANTIQUE (SACLANT)
Basé à Norfolk, aux États-Unis, le SACLANT étend sa compétence de l'Arctique au tropique du Cancer et des eaux territoriales de l'Amérique du Nord aux côtes d'Europe et d'Afrique, y compris le Portugal, mais à l'exclusion de la Manche et des îles Britanniques. Il a pour fonction, en temps de paix, de préparer des plans de défense, ainsi que de diriger des exercices d'entraînement intégrés et combinés. En temps de guerre, sa mission fondamentale est de prendre en charge la sécurité de tout l'océan Atlantique, en assurant la protection de ses voies maritimes.
5. LA POSITION DE LA FRANCE
En 1966, la France s'est retirée du commandement militaire intégré de l'OTAN, car la politique française reposait – depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle – sur la constitution d'une force de dissuasion nationale. Cela répondait à un double objectif : reconquérir l'indépendance nationale, tant militaire que politique, et ne pas se laisser entraîner par les États-Unis dans un conflit qui ne concernait pas la France. La doctrine française de la dissuasion proportionnelle s'opposait, à l'époque, à la doctrine de la « riposte massive ». Or, bien qu'en 1967 l'OTAN eût adopté la doctrine de la « riposte graduée », en élevant le seuil de recours au nucléaire, la position de la France resta inchangée.
Après trois décennies d'ostracisme, la France a admis que la défense européenne ne pouvait se concevoir comme concurrente de l'Alliance atlantique. Sans que les forces armées du pays soient en permanence intégrées dans l'OTAN, les représentants de la France ont fait leur retour au sein du Conseil des ministres de la Défense et au Comité militaire à partir de 1994, quand on commença à envisager l'emploi des troupes françaises déployées en Bosnie dans le cadre de l'OTAN. En 1996, le chef d'état-major des armées françaises, le général Jean-Philippe Douin, a affirmé que la France était prête à adhérer à une nouvelle structure militaire de l'Alliance atlantique. Mais, l'année suivante, le refus américain d'attribuer à un Européen le commandement régional pour le sud de l'Europe (Naples) a mis un terme à cette démarche.
6. UN NOUVEAU CONCEPT STRATÉGIQUE
La fin de la guerre froide, synonyme de disparition de la menace soviétique et de démocratisation des pays de l'Europe de l'Est, a également obligé l'OTAN à s'interroger sur ses raisons d'être, tant la chute du mur de Berlin semblait dicter l'effacement d'une structure politico-militaire née pour répondre aux tensions Est-Ouest. Désireuse de justifier sa survie, l'OTAN a vu sa tâche facilitée par les enseignements tirés de la guerre du Golfe de 1990-1991 et du conflit dans l'ex-Yougoslavie, qui, tout autant que la nouvelle donne stratégique, ont imposé une révision de sa doctrine stratégique et une restructuration de ses forces.
6.1. L'OUVERTURE AUX PAYS DE L'EUROPE DE L'EST
Au lendemain de la guerre froide, l'OTAN a été contrainte de modifier ses structures pour être en mesure de faire face aux exigences de la nouvelle situation en Europe. L'Organisation a manifesté la volonté de se rénover en lançant un processus de coopération avec les États membres de l'ex-pacte de Varsovie, qui estiment vivre dans « un vide stratégique ». Les nouvelles missions ayant, a priori, pour terrain d'application privilégié l'Europe centrale et orientale, l'intégration des pays qui en font partie apparaît comme le corollaire logique de la volonté d'assurer la stabilité de cette partie de l'Europe. Pour répondre au désir d'adhésion que ceux-ci ont formulé, deux organismes ont été créés.
LE CONSEIL DE PARTENARIAT EURO-ATLANTIQUE (CPEA)
Il a remplacé, en 1997, le Conseil de coopération nord-atlantique (COCONA), créé en novembre 1991, à l'instigation du président américain George Herbert Walker Bush, pour être un forum réunissant les représentants de l'Alliance atlantique et ceux des États de l'ex-pacte de Varsovie. Le CPEA offre le cadre général dans lequel ont lieu les consultations touchant aux questions politiques et à la sécurité, en vue d'un renforcement de la coopération entre les États européens, y compris les républiques de l'ex-URSS (soit, au total, 50 États).
LE PARTENARIAT POUR LA PAIX (PPP)
Le Partenariat pour la paix (PPP) a été créé et proposé aux pays de l'ancienne Europe communiste dès 1994. Il se compose alors de 24 membres. En adhérant à ce Partenariat, les anciens pays communistes s'engagent à respecter et à défendre les principes du droit international, de même qu'à s'acquitter des obligations posées par la charte de l'ONU et à se conformer aux principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les partenaires doivent également réaffirmer qu'ils sont résolus à tenir les engagements pris en application de l'Acte final d'Helsinki ainsi que de la totalité des documents ultérieurs de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), devenue l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).
En contrepartie, ils doivent être associés à des exercices militaires de l'OTAN, tels que des manœuvres communes et des échanges de personnels militaires ; dans certaines circonstances, ils doivent aussi être associés à des opérations de maintien de la paix. Enfin, ils ont la possibilité de recourir à l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, et peuvent donc demander des « consultations » aux pays membres de l'OTAN, s'il advient que leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité sont menacées. En revanche, ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 5.
Le PPP est un élément clé de l'instauration de nouvelles relations de sécurité entre l'Alliance et ses partenaires. Il est devenu une composante permanente de la sécurité européenne et a vocation à poursuivre sa fonction d'antichambre de l'OTAN. De fait, l'admission de pays d'Europe centrale et orientale en tant que membres à part entière a été l'une des questions fondamentales du sommet de Madrid, en juillet 1997. Le 12 mars 1999, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été les premiers d'entre eux à quitter le PPP pour faire leur entrée dans l'Alliance. En novembre 2002, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sont invitées à rejoindre l'Alliance en mai 2004. En avril 2009, la Croatie et l’Albanie rejoignent à leur tour l’OTAN, composée désormais de 28 États membres. L’ex-République yougoslave de Macédoine (devenue en 2019 la République de Macédoine du Nord) et le Monténégro participent, depuis 1999 et 2009 respectivement, au « plan d’action pour l’adhésion », et la coopération avec la Bosnie-Herzégovine progresse également. En juin 2017, le Monténégro devient le 29e État membre de l’organisation.
LE CONSEIL OTAN-RUSSIE
Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN a également tenu à amorcer le dialogue avec la Russie, l'Ukraine et certains pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Ainsi, le 27 mai 1997, à Paris, les membres de l'Alliance atlantique et la Fédération de Russie ont signé l'Acte fondateur instituant les relations de coopération et de sécurité mutuelles entre eux et crée un Conseil permanent conjoint, transformé en Conseil OTAN-Russie le 28 mai 2002.
La « charte sur un partenariat spécifique entre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Ukraine » a été paraphée à Sintra, au Portugal, le 29 mai 1997. Depuis, cette coopération s’est approfondie et s’est intensifiée en réaction à l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 et des menaces pesant sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, avec le conflit entre les forces sécessionnistes soutenues par Moscou et l’armée ukrainienne dans l’est du pays. La coopération militaire et civile avec Moscou est alors suspendue.
De même, l’OTAN apporte son soutien aux aspirations euro-atlantiques de la Géorgie, exprimées dès 2002, notamment depuis l’affrontement armé entre cette dernière et la Russie, en août 2008, et la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie.
L'OTAN ET LE PROCHE-ORIENT
Par ailleurs, à Bruxelles, le 8 février 1995 et lors de la réunion interministérielle tenue à Sintra le 29 mai 1997, le Conseil de l'Atlantique Nord a décidé d'entamer un dialogue direct avec l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie afin que ces pays apportent « leur contribution à la paix et à la sécurité dans la région ». Ce « dialogue méditerranéen », auquel s’est jointe l’Algérie en 2000, a été réaffirmé et précisé lors des sommets d’Istanbul en juin 2004 et de Berlin en avril 2011.
6.2. UNE CONCEPTION ÉLARGIE DE LA SÉCURITÉ
La multiplication des conflits qui ont fait suite à la guerre froide dans l'ex-Yougoslavie et dans l'ex-URSS a montré que la disparition de la menace globale que représentait pour l'Europe occidentale l'Union soviétique ne signifiait pas la fin de l'insécurité. Dans la perspective de ces nouveaux défis, et dans le cadre de « la conception élargie de la sécurité », formulée à Rome en novembre 1991, l'OTAN a cherché à redéfinir ses missions, afin de conserver le rôle majeur dans la gestion des crises à venir.
Le document établi à Rome énonce les principes qui déterminent le rôle futur de l'OTAN dans le système de sécurité de la nouvelle Europe. Le dialogue, la coopération ainsi que le maintien d'un potentiel de défense collectif sont les éléments clés de la nouvelle stratégie de l'Alliance, éléments qui doivent permettre de résoudre de manière pacifique les crises affectant la sécurité européenne. Ce nouveau concept autorise des interventions de l'Alliance au-delà des frontières des pays membres (il s'agit du « hors zone »). Il est affirmé que « le rôle fondamental des forces nucléaires des Alliés est politique : préserver la paix et prévenir la coercition et toute forme de guerre ». Lors du sommet de Bruxelles de janvier 1994, les chefs d'État et de gouvernement des pays alliés ont reconnu la menace que constitue la prolifération des armes de destruction massive pour la sécurité internationale. Les forces nucléaires sont devenues « l'arme du dernier recours ».
L'OTAN a aujourd'hui abandonné la stratégie de l'« avant » et a adopté un dispositif de joint precision interdiction ; ses forces doivent être capables d'opérer des frappes au-delà de l'Europe orientale, et jusque dans la profondeur du dispositif ennemi. En 1991, les huit corps d'armée nationaux ont été remplacés par cinq corps d'armée multinationaux. Une force de réaction rapide de 70 000 hommes, rassemblant des divisions multinationales, est en mesure d'intervenir à tout moment sur le territoire européen de l'Alliance.
De nouvelles structures de commandement sont également conçues avec la mise en œuvre de QG multinationaux et interarmées, et celle de Groupes de forces interarmées multinationales (GFIM). Ces forces doivent être interopérables et disposer de doctrines ainsi que de technologies adaptées.
Enfin, l'OTAN adopte une approche globale de la sécurité, considérant que les intérêts de l'Alliance peuvent être mis en cause par des actes relevant du terrorisme, du sabotage et du crime organisé, aussi bien que par la rupture des approvisionnements en ressources vitales.
7. LE RÔLE DE L'OTAN DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX
L'OTAN n'a jamais eu à intervenir militairement au moment des plus vives tensions entre les blocs américain et soviétique. Paradoxalement, c'est au moment où l'Alliance voit disparaître son objectif initial – faire face à la menace soviétique – que des missions nouvelles s'ouvrent à elle. Elle doit désormais s'acquitter de tâches de maintien de la paix et gérer les crises en coopération avec des pays qui n'en sont pas membres, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales.
Pour sa première intervention à l'étranger depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN a participé, en 1994, à la zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. C'est à la demande de l'ONU que les appareils de l'Alliance atlantique sont intervenus contre l'aviation serbe qui survolait l'espace aérien bosniaque. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné, le 15 décembre 1995, autorité à l'OTAN pour faire appliquer, si nécessaire en recourant à la force, les dispositions militaires de l'accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine, signé à Paris le 14 décembre 1995. Aux termes de cet accord, l'OTAN a pris le relais de la force de protection de l'ONU (la FORPRONU) qui avait été déployée, en mars 1992, dans l'ex-Yougoslavie pour accomplir une mission de maintien de la paix, de séparation des forces en présence et d'assistance humanitaire. La force multinationale de mise en application de la paix (IFOR) a achevé sa mission en décembre 1996 et a été remplacée par une force de stabilisation de la paix (SFOR), plus réduite, et qui s'emploie à faire exécuter l'accord de paix dans son intégralité.
Cette première opération militaire d'envergure de l'OTAN a été réalisée selon des modalités qui n'avaient pas été imaginées lors de sa fondation. Pour la première fois depuis 1949, l'OTAN est sortie de sa zone traditionnelle d'intervention telle qu'elle avait été définie à l'origine. Enfin, il s'agit également de la première opération de l'OTAN avec des pays non membres de l'Organisation : la Russie, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie et la Turquie, qui tous ont participé à l'opération « Effort concerté ».
Depuis, l'OTAN s'est engagée au Kosovo (1999), en Macédoine (2001), dans le cadre de la mission « Moissons essentielles » (récupération des armes des militaires de l'UCK [Armée de libération du Kosovo]) et en Afghanistan où, intervenant pour la première fois hors de la zone « euro-atlantique », elle assure, en 2003-2014, le commandement de la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS), déployée autour de Kaboul. Depuis janvier 2015, la nouvelle mission non combattante (« soutien résolu »), visant à prodiguer formation, conseil et assistance aux forces de sécurité et aux institutions afghanes, en a pris la relève.
Le sommet de Prague du 21 novembre 2002 a tiré, en effet, les enseignements des attentats du 11 septembre 2001 pour mieux prendre en compte la menace terroriste.
8. L'OTAN ET LA DÉFENSE EUROPÉENNE
Au-delà de la nature de ses missions et de l'étendue de la zone géographique qu'elle couvre, c'est surtout la structure de l'OTAN que la fin de la guerre froide a mise en cause, dans la mesure même où la disparition de la menace globale que représentait le bloc soviétique a libéré de facto l'Europe de sa dépendance à l'égard de Washington. Cela explique que la fin des années 1990 ait été marquée par une course de vitesse entre les partisans d'un renforcement de l'Identité européenne de sécurité et de défense (IESD) au sein de l'OTAN – le retour de la France jouant alors le rôle de moteur – et ceux qui visaient à l'« otanisation » de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), considérée par le traité de Maastricht lui-même comme le « bras armé » de l'Union européenne. Or, celle-ci, en se dotant des instruments propres à la mise en place de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), a ôté sa finalité à l'UEO, qui a mis fin à son existence en novembre 2000.
Désormais, l'OTAN soutient pleinement le développement de l'Identité européenne de sécurité et de défense. Les Américains ne la conçoivent plus comme une concurrente, mais comme le moyen de renforcer le lien transatlantique sur une base plus équilibrée. Le Conseil européen de Feira (juin 2000) a décidé de mettre en place des relations spécifiques entre l'OTAN et l'Union européenne sous la forme de groupes chargés d'étudier les capacités militaires, les questions de sécurité, les modalités de transfert des moyens de l'OTAN à l'UE et les arrangements permanents entre les deux organisations. Ces derniers ont été précisés lors du Conseil européen de Göteborg (juin 2001).
QUELQUES DÉFINITIONS
euromissiles
Systèmes balistiques nucléaires intermédiaires (missiles SS 20 et Pershing 2, missiles de croisière), ayant une portée comprise entre 1 000 et 5 500 km. Ils furent déployés en Europe par les Soviétiques et les Américains, entre 1977 et décembre 1987, date à laquelle fut signé le traité sur les Forces nucléaires intermédiaires (F.N.I.), officialisant le début de leur démantèlement, avant leur complète destruction.
O.S.C.E. (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)
Nouveau nom donné à la C.S.C.E. (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), en janvier 1995. Elle regroupe tous les États de Vancouver à Vladivostok, afin de renforcer la sécurité commune et la prévention des conflits.
G.F.I.M. (Groupe de forces interarmées multinationales)
Il se caractérise par ses structures d'état-major, sa logistique, ses unités militaires et ses capacités de renseignement.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
