|
| |
|
|
 |
|
Lâabus dâalcool altèrerait le circuit de la récompense dans le cerveau des ado |
|
|
| |
|
| |
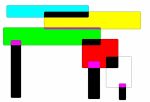
L’abus d’alcool altèrerait le circuit de la récompense dans le cerveau des ado
PUBLIÉ LE : 13/09/2019
TEMPS DE LECTURE : 4 MIN
* ACTUALITÉ SCIENCE
Une nouvelle étude indique que l’alcoolisme chez les adolescents est associé à une altération des fibres nerveuses dans le tronc cérébral, et à une modification du « système de récompense ». Les jeunes concernés deviennent alors hypersensibles aux « récompenses » : de quoi suspecter un risque accru de maintien dans la dépendance.
Les conséquences du binge drinking, consistant à boire de grandes quantités d’alcool ponctuellement, notamment à l’occasion de soirées festives, ont été étudiées chez les jeunes de 16–18 ans. Mais l’effet d’une consommation élevée et régulière d’alcool chez les jeunes adolescents (autour de l’âge de 14 ans) a été peu explorée, probablement en raison du caractère assez exceptionnel de ce comportement à cet âge. C’est donc à ce travail que se sont attelés André Galinowski, Jean-Luc Martinot et leur collaborateurs de l’unité de recherche Neuroimagerie et psychiatrie* (Gif-sur ‑Yvette).
Dans ce but, les chercheurs ont recruté des jeunes de la cohorte IMAGEN, un projet européen destiné à évaluer l’influence des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux sur le développement du cerveau pendant l’adolescence. Parmi les 1 510 jeunes qui avaient rempli un questionnaire sur leur consommation d’alcool à 14 ans, 32 avaient une consommation problématique (score AUDIT égal ou supérieur à 7).
10 questions pour faire le point sur son risque d’addiction à l’alcool
Le questionnaire AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), développé par l’Organisation mondiale de la santé, permet d’établir un score selon le niveau et les habitudes de consommation. Un score inférieur à 7 indique un risque faible ou anodin (simples consommateurs). Un score compris entre 7 et 10 correspond à une consommation problématique, à risque. Au-delà, la dépendance à l’alcool est probable.
Le questionnaire a de nouveau été rempli à l’âge de 16 ans : 34 adolescents supplémentaires, abstinents à 14 ans avec un score AUDIT de 0, étaient devenus de gros consommateurs à 16 ans (score >7). Les chercheurs ont également sélectionné 128 adolescents témoins, totalement abstinents à 14 et à 16 ans. Des questionnaires et un entretien avec un psychiatre ont permis d’écarter de l’analyse les jeunes ayant des antécédents familiaux d’alcoolisme, consommant d’autres types de drogue, ou souffrant de troubles psychiatriques de type dépression, schizophrénie...
Le tronc cérébral, cible de l’alcool
Les chercheurs ont analysé des images du cerveau de l’ensemble des participants, obtenues par IRM aux âges de 14 ans et de 16 ans. Ils ont observé des anomalies chez les consommateurs problématiques âgés de 14 ans, absentes chez les témoins. Elles étaient localisées dans le mésencéphale, le cerveau reptilien, une région cérébrale très conservée au sein des espèces en raison de son implication dans des fonctions vitales essentielles : le tonus général, la respiration, la fonction cardiaque... Des groupes de neurones irradient par ailleurs de cette zone vers d’autres régions du cerveau, contrôlant notamment le système de récompense. Ce système renforce la motivation à des actions ou des comportements qui le « mettent en marche » : quand un individu attend une récompense à l’issue d’une action il sera plus enclin à l’effectuer. Cette récompense peut être matérielle (une somme d’argent), ou biologique avec une libération d’endorphine qui procurera un sentiment de bien-être.
Plaisir et Addiction – vidéo pédagogique – 4 min – extraite de la série POM Bio à croquer (2013)
Les anomalies observées dans le mésencéphale des jeunes alcooliques correspondent à une altération des fibres nerveuses, notamment au niveau de la myéline, la substance qui recouvre les fibres et favorise les conductions nerveuses. « On peut en déduire que le développement de ces fibres est perturbé chez ces jeunes », clarifie Jean-Luc Martinot. De plus, des tests ont montré que ces adolescents sont hypersensibles à la récompense : ils sont plus efficaces que les adolescents témoins quand une récompense sous forme de sucreries est promise au terme de l’action demandée. « Cela peut faire craindre une hypersensibilité à l’envie des effets hédoniques de l’alcool, entretenant le cercle vicieux de la dépendance pour se sentir mieux », s’inquiète Jean-Luc Martinot.
Autre observation, les chercheurs ont retrouvé ces mêmes altérations chez les adolescents devenus alcooliques à l’âge de 16 ans. Ils ont en outre, constaté que de légères anomalies étaient déjà présentes dans cette même région lorsqu’ils avaient 14 ans et qu’ils étaient abstinents, suggérant une possible prédisposition. « Nous avions déjà trouvé ces altérations mésencéphaliques chez des adultes sortis de leur dépendance à l’alcool. Ces nouveaux travaux confirment l’effet d’une consommation importante d’alcool sur le mésencéphale des adolescents. Une preuve supplémentaire qu’il faut renforcer la prévention ciblant le tout début de l’adolescence », conclut Jean-Luc Martinot.
Note :
*unité 1000 Inserm/Université Paris-Sud, équipe Neuroimagerie et psychiatrie, Gif-sur-Yvette
Source : A Galinowski et coll. Heavy drinking in adolescents is associated with change in brainstem microstructure and reward sensitivity. Addiction Biology, juillet 2019. DOI : 10.1111/adb.12781
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Lâétonnante capacité des cellules souches sanguines à répondre aux situations dâurgences |
|
|
| |
|
| |
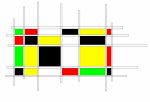
L’étonnante capacité des cellules souches sanguines à répondre aux situations d’urgences
11 AVR 2013 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Une équipe de chercheurs de l’Inserm, du CNRS et du MDC, dirigée par Michael Sieweke du Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CNRS, Inserm, Aix Marseille Université) et du Centre de Médecine Moléculaire Max Delbrück de Berlin-Buch, révéle aujourd’hui un rôle inattendu des cellules souches hématopoïétiques : outre leur capacité à assurer le renouvellement continu de nos cellules sanguines ces dernières sont aussi capables de produire, « à la demande » et en urgence, les globules blancs qui permettent à l’organisme de faire face à une inflammation ou une infection. Cette propriété insoupçonnée pourrait être utilisée pour protéger des infections les patients ayant bénéficié d’une greffe de moelle osseuse, le temps que leur système immunitaire se reconstitue. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature datée du 10 avril 2013.
© M Sieweke /Inserm
Les cellules de notre sang nourrissent, nettoient et défendent nos tissus mais leur durée de vie est limitée. Ainsi, l’espérance de vie d’un globule rouge ne dépasse guère trois mois, nos plaquettes meurent après une dizaine de jours et la grande majorité de nos globules blancs ne survivent que quelques jours.
Le corps doit donc produire en temps voulu des cellules de remplacement. C’est le rôle des cellules souches hématopoïétiques, plus communément appelées cellules souches sanguines. Nichées au cœur de la moelle osseuse (le tissu mou situé au centre des os longs comme ceux du thorax, du rachis, du bassin et de l’épaule), ces dernières déversent chaque jour des milliards de nouvelles cellules dans le flux sanguin. Pour accomplir cette mission stratégique, elles doivent non seulement se multiplier mais aussi se différencier, c’est à dire se spécialiser pour produire des globules blancs, des globules rouges ou des plaquettes.
Depuis de nombreuses années, les chercheurs s’intéressent à la façon dont les cellules souches déclenchent ce processus de spécialisation. Michael Sieweke et son équipe ont ainsi précédemment découvert que ces dernières ne s’engageaient pas de façon aléatoire dans telle ou telle voie de différenciation mais « décidaient » de leur destin sous l’influence de facteurs internes et de signaux venus de l’environnement.
Restait une question d’importance : comment la cellule souche parvient-elle à répondre avec discernement aux situations d’urgences en fabriquant, par exemple, des globules blancs mangeurs de microbes comme les macrophages pour lutter contre une infection ?
Jusqu’à présent la réponse était entendue : la cellule souche ne savait pas décoder ce genre de messages et se contentait de se différencier de façon aléatoire. L’équipe de Michael Sieweke vient de démontrer que loin d’être insensible à ces signaux, la cellule souche les perçoit et fabrique en retour les cellules les plus aptes à faire face au danger.
« Nous avons découvert qu’une molécule biologique produite en grande quantité par l’organisme lors d’une infection ou d’une inflammation indique le chemin à prendre aux cellules souches » déclare le Dr. Sandrine Sarrazin, chercheuse Inserm, co-signataire de la publication.
« Sous l’effet de cette molécule dénommée M-CSF (Macrophage Colony-Stimulating Factor), l’interrupteur de la lignée myéloide s’active (le gène PU.1) et la cellule souche produit rapidement les cellules les plus adaptées à la situation, au premier rang desquelles, les macrophages. »
« Maintenant que nous avons identifié ce signal, il serait possible de l’utiliser pour accélérer artificiellement la fabrication de ces cellules chez les malades confrontés à un risque aiguë d’infections » souligne le Dr Michael Sieweke, Directeur de recherche CNRS.
« C’est le cas des 50 000 patients dans le monde qui sont totalement démunis face aux infections juste après une greffe de moelle osseuse*.
Le M-CSF pourrait stimuler la production des globules blancs utiles tout en évitant de fabriquer des cellules susceptibles d’attaquer l’organisme de ces patients. Ainsi, ils seraient protégés des infections le temps que leur système immunitaire se reconstitue »
A propos de la découverte
Cette découverte apparemment toute simple est pourtant très originale tant par son approche que par les technologies de pointe qu’elle a nécessité. Ainsi, pour parvenir à leurs conclusions, l’équipe a dû mesurer le changement d’état au niveau de chaque cellule ce qui a constitué un double défi : les cellules souches sont en effet non seulement très rares (on en compte à peine une pour 10 000 cellules dans la moelle osseuse d’une souris) mais aussi parfaitement indistinguables de leurs descendantes.
« Pour distinguer les protagonistes, nous avons utilisé un marqueur fluorescent pour signaler l’état (on ou off) de l’interrupteur des cellules myéloides : la protéine PU.1. D’abord chez l’animal, puis en filmant les cellules en accéléré sous un microscope, nous avons ainsi montré que les cellules souches « s’allument » presque instantément en réponse au M-CSF » rappelle Noushine Mossadegh-Keller, assistante ingénieure CNRS, co-signataire de cette publication. « Pour en avoir le cœur net, nous avons alors récupéré une à une chaque cellule et confirmé que dans toutes les cellules où l’interrupteur était passé au vert, les gènes de la lignée myéloide étaient bien activés : une fois perçu le message d’alerte elles avaient bien changé d’identité. »
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
à lâorigine de la satiété, des cellules du cerveau qui changent de forme après un repas |
|
|
| |
|
| |
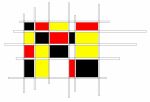
À l’origine de la satiété, des cellules du cerveau qui changent de forme après un repas
03 MAR 2020 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Neurones POMC (points oranges) dans l’hypothalamus, à la base du cerveau. Photo acquise chez la souris avec un microscope confocal.© Danaé Nuzzaci / CNRS / CSGA
Vous venez de terminer un bon repas et vous vous sentez repu ? Des chercheurs du CNRS, de l’Inserm, d’Inrae, de l’Université de Bourgogne, d’Université de Paris et de l’Université du Luxembourg1 viennent de comprendre les mécanismes qui, dans votre cerveau, ont conduit à cet état. Il s’agit d’une cascade de réactions déclenchée par l’élévation du taux de glucose dans le sang. Cette étude, menée chez la souris, est publiée dans Cell Reports le 3 mars 2020.
Les circuits de neurones qui gouvernent les sensations de faim et de satiété dans notre cerveau ont la capacité de modifier leurs connexions, ce qui permet d’ajuster le comportement alimentaire aux conditions de vie et de maintenir un équilibre entre apports et dépenses énergétiques. Les scientifiques soupçonnent d’ailleurs que cette plasticité pourrait être altérée chez les sujets obèses.
Dans une nouvelle étude menée chez la souris, une équipe dirigée par Alexandre Benani, chercheur du CNRS au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CNRS/Inrae/Université de Bourgogne/ AgroSup Dijon) montre que ces circuits sont activés à l’échelle d’un repas, ce qui contribue à la régulation du comportement alimentaire. Mais cette activation ne passe pas par un changement dans les « branchements » du circuit.
Remodelage du circuit de la satiété des neurones POMC après un repas équilibré. Encadré rouge : zone correspondant à la photo de droite.© Alexandre Benani / CNRS / CSGA
Les scientifiques se sont intéressés aux neurones POMC de l’hypothalamus, situés à la base du cerveau. Ces neurones sont connus pour limiter la prise alimentaire. Ils reçoivent un grand nombre de terminaisons nerveuses provenant d’autres régions du cerveau et les connexions de ce circuit sont malléables : elles peuvent se faire et se défaire très rapidement au gré des fluctuations hormonales. Les chercheurs ont observé qu’après un repas équilibré, ce circuit neuronal n’est pas modifié. En revanche, d’autres cellules nerveuses associées aux neurones POMC, les astrocytes, changent de forme.
Les astrocytes sont des cellules nerveuses en forme d’étoiles, d’abord décrites pour leur rôle de support des neurones. Dans les conditions habituelles, ils recouvrent étroitement les neurones POMC et agissent un peu à la manière de plaquettes de frein, limitant leur activité. Après un repas, le taux de glucose dans le sang (glycémie) s’élève transitoirement et ce signal est ressenti par les astrocytes qui se rétractent en moins d’une heure. Le « frein » étant levé, les neurones POMC se trouvent activés, ce qui favorise in fine le sentiment de satiété.
De manière étonnante, un repas riche en graisses n’induit pas ce remodelage. Est-ce à dire que les lipides sont moins efficaces pour couper la faim ? Les scientifiques cherchent à déterminer s’ils ne déclencheraient pas la satiété par un autre circuit. Il reste aussi à savoir si les édulcorants ont les mêmes effets ou s’ils sont de véritables leurres pour le cerveau, qui ne procurent que la sensation sucrée addictive sans couper la faim.
1 L’étude a été menée au Centre des sciences du goût et de l’alimentation (CNRS/Inrae/Université de Bourgogne/Agrosup Dijon), en étroite collaboration avec des collègues de l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (CNRS/Université Côte d’Azur), de l’Institut de génomique fonctionnelle (CNRS/Inserm/Université de Montpellier) et de l’Université du Luxembourg, et avec les contributions de l’Unité de biologie fonctionnelle et adaptative (CNRS/Université de Paris) et de l’Institut de psychiatrie et de neuroscience de Paris (Inserm/Université de Paris).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Hémophilie Une maladie hémorragique héréditaire |
|
|
| |
|
| |
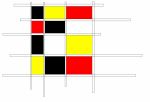
Hémophilie
Une maladie hémorragique héréditaire
MODIFIÉ LE : 16/04/2013
PUBLIÉ LE : 10/07/2017
TEMPS DE LECTURE : 9 MIN
L’hémophilie correspond à l’impossibilité pour le sang de coaguler : en cas de saignement, l’écoulement ne peut pas s’arrêter ou très difficilement. Les conséquences sont majeures, avec des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés, notamment au niveau des articulations. L’hémophilie ne se guérit pas, mais elle se contrôle bien grâce aux traitements substitutifs. Des recherches sont actuellement conduites pour améliorer l’efficacité de ces traitements, et même parvenir à traiter la maladie par thérapie génique.
Dossier réalisé en collaboration avec Sébastien Lacroix-Desmazes, équipe 16 Inserm UMRS 872, Centre de recherche des Cordeliers, Paris
Comprendre l’hémophilie
L’hémophilie est une maladie héréditaire grave, se traduisant par une impossibilité pour le sang de coaguler. La coagulation est un processus complexe mobilisant plusieurs protéines, les facteurs de coagulation, qui s’activent en cascade. Il existe deux types d’hémophilie prédominants : L’hémophilie A est la plus fréquente (un garçon touché sur 5 000 naissances). Elle se caractérise par un déficit du facteur de coagulation VIII. L’hémophilie B, cinq fois plus rare (un garçon sur 25 000 naissances), est liée quant à elle à un déficit du facteur de coagulation IX.
Selon la nature de la mutation génétique qui est l’origine de la maladie, le facteur de coagulation affecté peut être totalement absent de l’organisme du patient, ou présent mais sous une forme dysfonctionnelle. Ces différences se traduisent par des degrés variables de sévérité de la maladie. Elle est sévère dans la moitié des cas, mineure chez 30 à 40 % des patients et modérée chez les autres.
Les filles très rarement concernées
L’hémophilie est une maladie génétique héréditaire, qui se transmet par le chromosome X où se situent les gènes incriminés. N’ayant qu’un exemplaire de ce chromosome, les garçons sont systématiquement malades dès lors qu’ils héritent d’un gène muté. A l’inverse, les filles possédant deux chromosomes X, elles ne sont malades que si elles héritent de deux chromosomes X portant chacun un gène muté. Cette situation est rarissime.
En cas d’antécédents d’hémophilie dans la famille, un diagnostic prénatal est effectué par dosage des facteurs de coagulation. Il est également possible de procéder à un diagnostic pré-implantatoire en cas de fécondation in vitro.
Des hémorragies plus ou moins graves dès le plus jeune âge
La maladie est rapidement diagnostiquée au vue de saignements excessifs, quelle que soit la nature et l’endroit de la plaie. Ces saignements peuvent survenir dès l’âge de 3 mois. Lors des premiers déplacements de l’enfant, des bleus apparaissent au niveau des jambes. Des saignements au niveau des muscles ou des articulations peuvent également survenir et entraîner des hématomes qu’il faut parfois ôter chirurgicalement car ils compriment d’autres vaisseaux ou des nerfs. Plus tard, des saignements internes au niveau du cerveau ou de l’abdomen peuvent engager le pronostic vital. L’hémophilie n’est pas une maladie évolutive : quelle que soit sa sévérité, elle reste identique tout au long de la vie.
Une des complications majeures de l’hémophilie est l’apparition d’hémarthroses : il s’agit d’épanchements de sang au niveau des articulations. Ce phénomène douloureux provoque un gonflement et une perte de souplesse. En cas de récidives, il finit par altérer l’articulation et mène à l’arthropathie hémophilique, c’est à dire une dégradation du cartilage, une déformation articulaire et une perte de mobilité. Cette évolution peut être prévenue par un traitement substitutif prophylactique du facteur de coagulation déficient (voir plus loin).
L’hémophilie n’est pas la seule cause de troubles de la coagulation
La coagulation est un processus complexe qui fait intervenir bien d’autres facteurs que ceux impliqués dans les hémophilies A et B. Il existe donc d’autres maladies de la coagulation qui touchent les deux sexes. C’est le cas de la maladie de Willebrand, la plus fréquente des maladies hémorragiques après l’hémophilie (prévalence mondiale de 1 %). Elle est liée à un déficit en facteur Willebrand, une protéine impliquée dans la toute première étape de la coagulation (hémostase primaire). D’autres pathologies sont liées à des déficits en d’autres facteurs de coagulation ou à des défauts d’agrégation plaquettaires. Face à un trouble de la coagulation, le dosage des différents facteurs impliqués permet, entre autre, de réaliser un diagnostic différentiel.
Des traitements de substitution efficaces mais contraignants
L’hémophilie ne se guérit pas, mais elle se contrôle bien grâce aux traitements substitutifs. Ces traitements consistent à injecter aux patients, par voie intraveineuse, des facteurs de coagulations fonctionnels. Un patient atteint d’hémophilie A reçoit du facteur VIII et un patient atteint d’hémophilie B reçoit du facteur IX. Ces substituts peuvent être dérivés du sang humain ou bien produits par génie génétique (facteurs « recombinants »). Ils peuvent être L’hémophilie n’est pas la seule cause de troubles de la coagulationL’hémophilie n’est pas la seule cause de troubles de la coagulation.
Un traitement prophylactique (préventif) est indiqué en cas d’hémophilie sévère ou modérée. Il consiste en deux ou trois injections de facteur de coagulation par semaine. L’objectif est de maintenir une concentration suffisante en facteur de coagulation dans le sang, pour permettre une coagulation quasi-normale en cas de saignement. Ce traitement est contraignant mais efficace. Il permet de passer du stade sévère de la maladie à un stade modéré, dès le plus jeune âge. Les injections peuvent être réalisées au domicile par le patient lui-même à partir de l’âge de 12 ans, ou par un proche à partir de 4 ans (après une formation dans un centre de prise en charge de l’hémophilie). Elles peuvent aussi être réalisées par une infirmière, au domicile ou dans un centre de soins. Chez les personnes atteintes d’hémophilie A modérée, la desmopressine vient en complément du traitement substitutif. Inhalée ou administrée par voie intraveineuse, cette molécule permet de prolonger la durée de vie du facteur VIII injecté.
Sans traitement prophylactique et en cas d’accident, un patient hémophile doit s’injecter le plus rapidement possible une dose de facteur de coagulation.
La principale difficulté avec les traitements de substitution est l’apparition d’anticorps dirigés contre le facteur de coagulation injecté. Ces anticorps vont conduire à l’« inactivation » du facteur de substitution, et donc à l’inefficacité du traitement. Ce problème concerne 5 à 30 % des hémophiles. Le risque dépend en partie du type d’anomalie génétique à l’origine de la maladie. Si le facteur de coagulation faisant défaut est totalement absent de l’organisme du patient, ce risque est important : le système immunitaire aura davantage tendance à prendre le facteur de substitution pour un corps étranger et à produire des anticorps chargés de le neutraliser. En revanche, si le facteur de coagulation est produit dans l’organisme du patient sous une forme non fonctionnelle, le système immunitaire sera déjà habitué à la présence de la protéine. Le risque d’apparition des anticorps sera donc moins important. En cas d’apparition d’anticorps dirigés contre le facteur VIII, il est possible de provoquer une coagulation en le remplaçant par le facteur VII ou en utilisant un complexe de facteurs pro-thrombotiques (FEIBA). Toutefois, ces stratégies thérapeutiques ne fonctionnent pas chez tous les malades.
Quelques précautions pour mieux vivre avec la maladie
Certaines précautions sont nécessaires pour éviter les saignements ou les risques d’hémorragie. Ainsi, il est convient d’utiliser avec parcimonie l’aspirine qui fluidifie le sang et de bannir les sports à risque comme la boxe, le parachutisme, les arts martiaux, le rugby...
La kinésithérapie, ainsi qu’une activité physique douce et régulière sont nécessaires pour prévenir l’apparition de séquelles articulaires dues aux hémorragies intra articulaires et musculaires répétitives.
En cas d’arthropathie articulaire trop avancée, une chirurgie orthopédique est parfois nécessaire. Mais grâce aux traitements prophylactiques, cela est de plus en plus rare.
Le suivi de la maladie a lieu dans un centre de traitement de l’hémophilie (CTH). Ces centres, répartis dans toute la France, délivrent au patient une carte d’hémophile qui permet à tout professionnel de santé de connaître le statut du malade et ses traitements en cas d’urgence. En l’absence de cette carte, le soignant doit être informé au plus vite de l’hémophilie du patient.
Les enjeux de la recherche
Des progrès attendus pour les traitements de substitution
Des recherches sont actuellement conduites pour améliorer l’efficacité des traitements de substitution. Plusieurs stratégies sont étudiées : augmenter de la durée de vie des facteurs de substitution, contrer l’apparition d’anticorps dirigés contre ces facteurs ou encore inhiber leur activité.
Augmenter la durée de vie des facteurs de substitution permettrait d’espacer les injections. Pour y parvenir, la stratégie actuellement à l’étude consiste à coupler le facteur de substitution avec une molécule ou une protéine qui a une longue demi-vie dans l’organisme. Le couplage avec un fragment d’immunoglobuline humaine (fragment Fc d’IgG) est en cours de développement. Les résultats préliminaires sont prometteurs, permettant de multiplier par trois à cinq la durée de vie du facteur IX et par deux celle du facteur VIII. Ainsi, chez les patients atteints d’hémophilie B sévère, ce couplage pourrait permettre de réaliser une seule injection prophylactique par semaine, au lieu de trois. Des facteurs VIII et IX recombinés de ce type devraient arriver sur le marché européen d’ici environ deux ans.
Les chercheurs tentent par ailleurs de décrypter les mécanismes qui entraînent l’apparition des anticorps dirigés contre les facteurs de substitution. En étudiant la réponse immunitaire induite par le facteur VIII de substitution, le rôle central de cellules particulières du système immunitaire, les cellules dendritiques, a pu être mis en évidence. En empêchant ces cellules de reconnaître le facteur de substitution, il devrait donc être possible de contrer l’apparition des anticorps indésirables. Or les résultats de chercheurs de l’Inserm montrent que les sucres présents à la surface du facteur sont très importants pour cette étape de reconnaissance. Un facteur VIII dépourvu de sucres est en cours de développement.
D’autres équipes s’attèlent à trouver des alternatives thérapeutiques à utiliser en cas d’apparition de ces anticorps. L’idée est de mettre au point des molécules qui miment l’activité du facteur de substitution rendu inactif par les anticorps. C’est le cas d’anticorps bispécifiques, capables de reconnaître et d’activer les facteurs IX et X à la place du facteur VIII. Un facteur X chimérique, capable de fonctionner sans facteur VIII ou sans facteur IX, a également été mis au point par des chercheurs de l’Inserm. Son développement clinique est en cours. Il pourrait permettre de traiter les patients hémophiles de type A et de type B. De plus, il a le gros avantage de présenter une demi-vie longue, réduisant par trois le nombre d’injections à réaliser en prophylaxie.
Une toute autre stratégie explorée consiste à induire une tolérance au facteur de substitution dès la vie fœtale. L’idée a été testée chez la souris : les chercheurs injectent à la mère du facteur VIII couplé à une immunoglobuline pendant la grossesse. L’immunoglobuline traverse le placenta ce qui permet au fœtus de développer une tolérance au facteur VIII.
Corriger les anomalies par thérapie génique
Autre approche développée dans le domaine de la prise en charge de l’hémophilie : la thérapie génique. En apportant aux patients une version fonctionnelle du gène muté à l’origine de leur hémophilie, cette stratégie peut théoriquement leur permettre de produire le facteur de coagulation qui leur fait défaut et, ainsi, de se passer du traitement de substitution.
Un premier essai de thérapie génique concluant a eu lieu en décembre 2011. Il concernait le traitement de l’hémophilie de type B. La technique consiste à empaqueter le gène fonctionnel codant pour le facteur IX dans un adénovirus. Le virus sert de vecteur pour acheminer le gène-médicament dans les cellules du foie où le facteur coagulation est normalement produit. Pour la première fois, l’équipe anglo-américaine dirigée par le Dr Amit Nathwani (du University College London Cancer Institute et du St Jude Children’s Research Hospital de Memphis, États-Unis) a obtenu une réponse prolongée : les six patients inclus dans l’étude n’ont pas été guéris, mais la sévérité de leur maladie a été nettement diminuée pendant plusieurs mois suite à une seule injection intraveineuse. Quatre d’entre eux ont pu se passer complètement de l’administration pluri hebdomadaire de facteur IX dont ils avaient besoin pour éviter des saignements spontanés.
Il faudra toutefois encore plusieurs années pour poursuivre le développement de cette technique et la rendre accessible aux patients. Par ailleurs, il est important de noter qu’un tel essai est beaucoup plus difficile à envisager dans le cadre de l’hémophile de type A : le gène codant pour le facteur VIII est en effet plus grand (donc plus compliqué à véhiculer dans l’organisme des patients) et il sera bien plus difficile d’obtenir son expression dans les cellules des patients.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
